Ceci constitue la seconde partie de l’entretien avec Jean-Luc Nancy ; la première partie est disponible ici.
L’histoire après l’Histoire
AP : On passe du coup au deuxième volet de questions que je voudrais poser, en commençant, en continuité, par la question de l’histoire après l’histoire. Pour le dire rapidement, sous le régime de l’histoire, on avait des choses qui pouvaient être périssables dans un horizon de pérennité. Maintenant, on peut avoir des choses qui demeurent par elles-mêmes, qui peuvent être solides, mais l’horizon de pérennité n’est plus là. Ce qui tient tient par lui-même, sans se référer à sa postérité, ou en tout cas en ne le faisant plus de la même manière. Les actes et les paroles ne vont plus s’inscrire de la même façon dans la durée : en quelque sorte, c’est le temps lui-même qui n’est plus inscrit, qui est configuré, dont qui n’abrite plus le passé pour l’avenir. Tenir n’a pas le même sens : pour autant, la question de l’inscription se pose plus que jamais, elle est au cœur de la pensée de Derrida et de la votre, vous insistez beaucoup sur le fait qu’on ne vit pas « exactement » pour rien.
Pour autant, je ne sais pas si on peut jusqu’au bout se satisfaire d’un tel rapport au temps. Je me demande si un tel rapport au temps n’est pas voué à une forme d’effritement, d’arasement : c’est quelque chose qu’on vous oppose assez souvent. Badiou, en particulier dans son texte « Offrande réservée », dans Sens en tous sens. Catherine Malabou dans Le change Heidegger est assez convaincante quand elle parle des risques d’ossification d’un temps sans mouvement, sans création, qui finit par se reconvertir en temps du mauvais infini. Je suis dans l’ensemble d’accord avec elle sur la nécessité de s’interroger sur (elle n’accepterait pas cette formule) la possibilité de donner du temps au sens, en d’autres termes de créer, de continuer à créer, en un sens qui ne soit pas mutilé. Je me souviens, lorsque je vous ai écrit pour la première fois, avoir évoqué cette question, et elle me travaille encore : est-ce que le sens pour circuler, vivre, n’a pas besoin tout de même d’épaississement, d’incarnation, plus de mise en forme ?
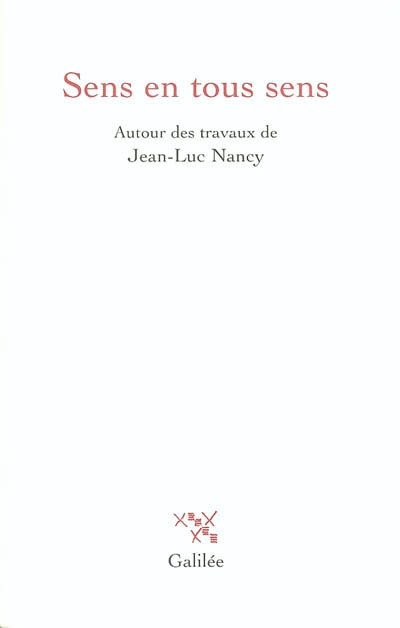
JLN : Je ne vois pas très bien sur quoi porte le reproche ou la crainte. Il ne me semble pas que je refuse ni la mise en forme, ni la durée. Je n’en parle guère, peut-être même pas du tout, parce que je ne trouve pas nécessaire d’en parler. La création qui dure se prouve par les faits, par les postérités, par les relances ou les reprises. Elle n’a pas à s’annoncer comme destinée à durer.
Si j’insiste sur le présent, c’est que rien ne dure qui n’ait d’abord été présent. Le présent de 1789 n’a certes pas, en 1789, la portée que nous pouvons lui reconnaître (et dont nous pouvons en outre discuter) mais il a bel et bien lieu d’abord cette année-là. C’est toujours au présent que quelque chose a lieu, jamais dans la seule projection d’un futur. Or nous avons du mal avec notre présent parce que d’une part nous avons trop vécu de projets, d’attentes, de plans tirés sur l’avenir, et d’autre part depuis que s’est brouillée cette perspective de progression (sinon de programmation) depuis que nous sommes sortis d’une époque de l’histoire comme Foucault l’a diagnostiqué très tôt, et d’une histoire « résumptrice » de son propre procès (comme Derrida le disait dans un texte des années 60), c’est-à-dire aussi depuis la fin de la guerre froide, des grands mouvements de décolonisation et du changement des données pétrolières, nous n’avons pas cessé de voir déferler des événements qui tous échappaient à nos schèmes historiques. L’effondrement de l’URSS et les crises et conflits des nationalités de l’empire désarticulé, les conflits renouvelés en Afrique, l’émergence des « dragons » asiatiques, celle des Etats arabes, la révolution iranienne, etc, – sans oublier les révolutions informatiques et biologiques: rien de tout cela n’entrait plus dans notre « histoire ». Cela fait, certes, d’autant plus d’événements, de mouvements, d’agitations et de transformations, mais d’une manière qui ne se laisse pas rassembler en histoire, ni comme projet, ni même comme durée – sauf le fait que nous sentons de mieux en mieux qu’est en train de s’ouvrir une nouvelle durée, une ère peut-on dire sans doute, un nouveau cours du monde, mais dont par définition nous ignorons l’essentiel.
Or si nous ne faisons rien de notre présent, sinon le vouer à regretter le processus perdu ou bien à déplorer l’égarement de la civilisation entière (égarement dont on ne voit pas que quoi que ce soit vienne le corriger, pas plus en provenance du vieil « Occident » que de n’importe quel autre site spirituel) – alors nous laissons tout à nos descendants et nous capitulons. Mais nous pouvons au contraire affirmer notre présent de veilleurs, de guetteurs. Nous pouvons tenter de donner forme à ce suspens qui nous coupe le souffle.
Bien sûr c’est une activité qui n’est plus celle du militant (bien qu’elle n’empêche pas du tout de militer pour telle ou telle cause ni de s’engager dans les luttes politiques, sociales, intellectuelles). Mais le militant a trop été celui qui sacrifiait sa vie présente à celle des générations futures. Ma génération a bien connu ce débat interne au militantisme : la contradiction de vivre au futur. Ne vivre ni au futur, ni au passé, mais au présent, voilà ce dont il s’agit – à condition que ce présent ne soit pas l’immédiat ni l’instant ponctuel, qu’il ne soit ni carpe diem, ni « temps suspens ton vol » et que pourtant il sache interpréter ces vers de Rimbaud :
Elle est retrouvée
Quoi ? l’éternité
C’est la mer allée
Avec le soleil
AP : Je comprends bien cette nécessité : ma « génération », pour utiliser ce mot est à ce sujet dans une situation ambiguë. Elle se tient en équilibre entre deux abîmes : le « no future », vivre au présent seul, qui est aussi celui de la consommation, et quelque chose comme un rapport de plus en marqué à un avenir qui gronde, grossit, et face à quoi on sera seul. Entre le « jouir » à tout prix, et le « chacun sauve sa peau », l’avenir est devenu quelque chose d’abstrait, individuel. Du coup, nous avons tendance à être en quête de formes – pas nécessairement éternelles, mais mobilisatrices, qui permettent au présent de se répercuter, de se renouveler, de transmettre quelque chose de son éclat…
JLN : Vous faites bien de rappeler l’ambivalence que peut recouvrir « le présent » : la consommation, le refuge, la dénégation, et l’avancée sur le bord, dans l’ouverture, vers ce qui vient et que pourtant on n’arraisonne pas à l’avance. Je pourrais ajouter que tout tient à ce qu’on entend par ce mot – « jouir » – que vous mettez entre guillemets sans vous expliquer mais dont je crois pouvoir penser que vous voulez rester méfiant envers le jouir-satisfaction que propose la consommation et un autre jouir, non consumériste. De fait je crois que « jouir » est à entendre du côté de la joie et d’un mouvement infini plutôt que du côté d’une réplétion où la saturation succède à l’avidité.
Mais je me demande même si on ne risque pas parfois de trop croire que les gens « jouissent » dans la consommation. La machine techno-capitaliste nous propose/impose des acquisitions incessantes (mp3, smartphone, twitter, surgelés, croisières…) mais ne prenons pas le climat des publicités (profitez ! faites-vous plaisir !) pour celui des consciences ni des inconsciences. Peut-être y a-t-il un fond moins rose-luisant que nous ne l’imaginons, nous les « intellectuels » qui pouvons ou qui croyons nous tenir un peu à l’écart de la boulimie. D’autre part et en même temps nous oublions ce qui pouvait être pénible, désagréable, pesant dans le monde antérieur. Les disques vinyl donnent-ils vraiment un son plus chaud, moins lissé que celui des cd ? Je sais que certains aiment même entendre les petits craquements des rayures… mais enfin les vinyl avaient aussi leurs inconvénients – et de toutes façons avec le vinyl on est déjà dans l’enregistrement massif et commercial, et personne ne regrette le temps des cylindres de cire, ni le temps d’avant tout enregistrement…
Il faut être très attentif à ce qui est en jeu : peut-être la spirale vertigineuse des proliférations techniques nous cache-t-elle le fait qu’elle ne touche pas au sens, aux possibilités de sens, même si elle parait le faire. Mais nous avons à découvrir comment renouer du sens avec cette spirale, peut-être aussi malgré elle, contre elle, au-delà d’elle…
AP : Le paradoxe de la fin de l’histoire chez Hegel, c’est qu’elle est Histoire conçue, donc Histoire à charge, mais en cela même n’est plus vraiment une histoire. Le sens historique tombant dans nos mains cesse d’être sens ; toutes les figures de l’esprit sont « disponibles », mais se racornissent et fanent par-là même. Du coup, je suis d’accord avec Catherine Malabou sur la nécessité de réintroduire une pensée et une politique de la forme, de la métamorphose, de la plasticité, mais j’ai l’impression que comme telle, en tant que telle, elle ne répond pas à la question première qui est celle de l’aliment, de la dynamique, l’énergie, l’impulsion qui fait tenir les formes. Créer des formes en soi ne me suffit pas, et j’ai par ailleurs des doutes sur la possibilité comme telle de réaliser ce baroque post-moderne, cette prolifération, cette cascade créatrice, cette réverbération universelle que Deleuze a pu laisser entrevoir. L’impulsion créatrice n’est pas plus elle-même le problème que ne l’est la forme : le problème vient de la vie de la création, de cette vie de création partagée qui se ressource aux formes et leur insuffle leur propre puissance.
Je dirais plutôt que la façon dont le sens – le politique, ou l’art – tombe dans nos mains doit être pensée autrement. On pourrait lier la dimension politique du problème à la question, chez Hegel, de l’inscription matérielle de l’esprit, des articulations matérielles du sens, de cette hétéronomie qui fait que, malgré ce que dit Hegel, quelque chose du registre de l’art, demeure, insiste, joue, et ne se résout pas dans le politique, et que c’est parce qu’il y a cette matérialité que le politique peut continuer d’être. Dans Le sens du monde « L’art, fragment », vous écrivez : « L’art est plus primitif que tout schéma de primitivité et de succession, d’avancée du savoir. Et de même le monde. »1. Ou plus loin : « Ainsi le même Hegel qui avait présenté la fin de la religion antique comme fin de l’art, mort de la vie divine qui l’animait – « mort du grand Pan » – présente ici l’art lui-même comme le temple de tous les dieux, des dieux nombreux qui ne sont plus des dieux mais l’art lui-même en tous ses éclats (…) » 2. Je dirais : cette matérialité change le sens même à donner à l’action, celle-ci ne peut plus seulement être rassemblement de soi, auto-poiese. Du coup, la politique n’est plus le mode d’expression, de réalisation, d’accomplissement de l’histoire se prolongeant. La politique, vous l’avez plusieurs fois affirmé, ménage l’espace ou le sens (ou une histoire encore) possible, mais n’a plus à en décider.
Il me semble que le projet de Bernard Stiegler, qui parle d’une politique des consistances, est assez proche de cette perspective : non seulement préserver, non seulement inventer, mais ménager la possibilité que les choses tiennent, élaborer un espace qui résonne. Il faut, comme le dit Stiegler, une politique de l’esthétique, une politique du sensible, non qui créé, mais qui rende le concret capable de porter, répercuter, réverbérer l’acte créateur. Dans une autre optique, j’ai été intéressé par ce que m’expliquait Michel Melot sur l’esprit de cet Inventaire pour Malraux qui l’a conçu. Il s’agissait de continuer à écrire l’histoire de l’art après sa fin, de ménager la possibilité du jugement de goût et son partage, de ménager l’apparition et le partage possible de la beauté sans l’imposer, mais sans la laisser s’effriter, se dissoudre dans l’insignifiance de la paresse et de la facilité. On pourrait dire aussi : de mettre en place les conditions pour des formes puissent être crées, se partager, s’échanger, s’enrichir.
Il me semble voir là diverses prolongations concrètes possibles de votre pensée : accepteriez-vous ces parentés ?
JLN : Pourquoi pas ? Je ne suis pas très bien informé de ce que vous évoquez, mais je peux me sentir d’accord. Je ferais seulement observer que si on parle de « ménager, porter, mettre en place des conditions pour » – disons un partage de formes qui nourrissent du sens (et se nourrissent de lui) – on ne fait qu’énoncer des vœux formels (au sens cette fois restreint de « forme ») alors que ce dont il s’agit est d’un ordre « matériel » : il s’agit de textes, d’images, de chants. Et ces choses-là, si je peux parler ainsi, on ne les décrète pas et les souhaiter ne les fait as venir. Personne n’a préparé les conditions pour que vienne Beckett, pour que surgisse Celan, pour que – sur un autre plan, moins en altitude, Lars von Trier invente Melencholia (que je tiens pour un film très rare dans sa réussite en quelque sorte mythologique) – ni pour d’autres œuvres parmi lesquelles celles de Berio ou de Arvo Pärt (je parle un peu au hasard, très vite…).
Au fond je dirais qu’il est un peu vain de se vouloir veiller, gardien, garant ou accoucheur des formes. Nous devons nous vouloir tels mais en sachant que ce n’est pas cela qui crée les formes. Cette création est plutôt ce qui nous dépasse, nous précède, ce qui s’ouvre des voies secrètes en nous ou devant nous. Mais il faut être attentif et pour cela silencieux, discret – je ne veux pas dire « muet » mais silencieux dans sa parole même afin de laisser venir ce qui nous dépasse.
AP : En ce qui me concerne, cette angoisse du désert, de l’anesthésie, de « la montée de l’insignifiance » a aussi sans doute quelque chose à voir avec mon expérience des institutions. J’ai pu être – à Yale, – en position de sélection pour les achats d’ouvrages. Au bout d’une ou deux semaines, l’empilement des résumés d’ouvrages était venu à bout de toute ma « disponibilité ». Je n’attendais pratiquement plus rien de bon, et pire, je me disais que ce n’était finalement pas si important que ça de trouver quelque chose de bon. J’exagère un peu, bien sûr, et il n’y a peut-être rien de nouveau à cette façon dont les circonstances peuvent rendre indifférent aux créations les plus exemplaires – quoique j’ai l’impression que la consécration d’un auteur comme Houellebecq traduit quelque chose de très spécifique à notre époque…
JLN : Il en va de la médiocrité comme de la consommation, si je peux dire : de fait Houellebecq représente le parti-pris très délibéré d’une médiocrité qui assume de représenter la médiocrité, et qui de ce fait se met à la fois dans une exception et dans une règle renforcée, une littérature pour confirmer le pourrissement de la littérature. Cette ambiguïté se soustrait donc au simple reproche de méconnaître le génie, elle prétend même être le génie de la médiocrité. C’est une prétention vaine, je l’accorde. Mais cela fonctionne aussi comme un signal d’alarme. Je veux dire : ce n’est pas simplement le nième roman historique ou bien la nième « autofiction ». Ou ce n’est pas comme ce cinéma français qui s’épuise à répéter tous les scénarios des histoires de couples, de générations, d’infirmes, d’incestes, de bobos en mal de vivre – par rapport à quoi Melancholia de Lars von Trier a quelque chose de superbe et de magistralement dédaigneux.
J’ai souvent pensé à un recueil de textes de désespérance sur le temps présent… On pourrait commencer à Athènes au temps de Périclès… Mais en même temps je reconnais, je suis même un des premiers à l’avoir répété depuis quelque vingt ans, que nous changeons de civilisation. Mais changer est autre chose que décliner ou dégénérer.
La contingence de la chose
AP : Une autre question, purement philosophique, qui paraît centrale pour toutes les philosophies post-déconstructrices, est celle du « comment » du monde. Le monde est pluriel mais il n’est pas n’importe comment. Badiou, dans Logiques des mondes entend comprendre comment des motifs quasi-consistants peuvent se broder sur la base d’une ontologie de l’inconsistance. Je suis assez frappé, quand je pense à la discussion que vous avez eue avec Alain Badiou pendant le colloque Derrida, la tradition de la philosophie3 : Badiou vous opposait une différence (ou une différance) toujours déjà articulée au « transcendantal d’un monde » en insistant sur le risque, dans la perspective de Derrida, d’en arriver à identifier en quelque sorte la différance en la laissant, disons, différer d’elle-même. D’un autre côté, Badiou, en pensant le possible comme il le fait, ne « différentie les différences » que formellement : son modèle de monde possible s’applique pour penser n’importe quel monde rencontré, mais cette rencontre toujours spécifique avec un monde – le fait que l’événement est celui-là, dans ce monde-là » n’est plus pour lui l’affaire de la philosophie, mais de l’anti-philosophe (celui qui n’accepte l’assujetissement à aucune ontologie).
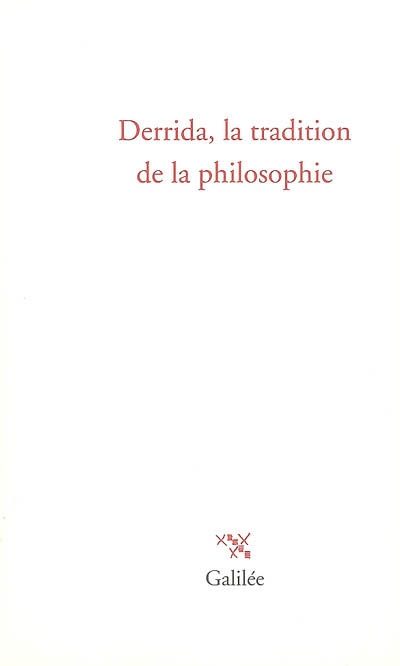
Je me demande si la leçon essentielle de votre travail, du votre, de celui de Lacoue-Labarte aussi, n’est pas au contraire que la philosophie, pour se survivre, doit apprendre à se laisser singulièrement pénétrer du non-philosophique, sans se perdre elle-même – qu’elle a à trouver une disposition, un rythme, un ton pour cela… Bref, que la reconduction formelle des problématiques ontologiques que propose le courant du réalisme spéculatif ne saute pas au-dessus du problème qui est décidément celui de l’entre-deux ; toujours à la fois indéterminé et singularisé, philosophique et non philosophique, transcendantal et empirique ?
JLN : Un peu dans le fil de ma précédente réponse je dirais que je trouve « formelle » la préoccupation de penser un ou des mondes, une ou des consistances. Les uns et les autres changent, voilà qui est certain. La pluralité d’un « multivers » qui engage à la fois les représentations du monde et la compréhension de la ou des « science(s) » et donc aussi de la « philosophie », voilà qui m’intéresse parce que cela conjoint des faits venus de la physique et d’autres venus de la pensée du « fictif » ou de l’ « imaginaire ».
Mais l’important est bien en effet ce qui vient du dehors à la philosophie : à nouveau je nommerais Celan ou Nono, mais aussi ce qui se passe dans notre rapport à la santé et à la vie, au sexe, à la mêlée des cultures, beaucoup de choses, de registres de savoir ou de discours, d’images, d’intérêts, de suggestions.
AP : J’écrivais dans la recension de votre livre écrit avec Aurélien Barrau qu’il y a encore besoin d’ontologies, de plusieurs ontologies, de métaphysiques, mais que celles-ci resteront flottantes, ne posséderont plus le sens de leur nécessité, ne se justifieront que dans l’effort et le travail qui les déploie. Il y a toujours des problèmes ontologiques. Il y a du philosophique partout mais ce philosophique ne tient plus en lui-même. Ici, ma question serait : est-ce ce que vous acceptez que le motif de « construction » soit réinvesti, peut-être sur-investi, à travers même sa déconstruction ?
JLN : Pour l’ontologie, je crois qu’il ne faut pas cesser de reprendre l’invitation de Heidegger : pas d’ « ontologie », tout au plus une « ontologie » dans laquelle il ne s’agit pas de l’être mais de être : du verbe seul et de son acte ou de sa motion, qui n’ »est » pas. Donc en bon grec même pas une ontologie mais une einologie (de einai, l’infinitif du verbe dont on est le participe) – et encore faudrait-il la comprendre comme un « dire être » : ne jamais nommer « l’être » mais dire toujours « être », le verbe. Dire, donc, que l’étant est mais que « l’être », lui, n’est pas. Ou bien que être « est » l’étant, c’est-à-dire porte, reçoit, ouvre, envoie l’étant.
L’idée d’une construction s’en trouve affectée : s’agit-il de construire ? Ou de mobiliser, d’ouvrir, d’adresser ? Bien entendu il faut des échafaudages, des structures, des institutions. Mais en même temps il ne faut pas perdre des yeux la struction : elle n’est pas « construction » si le « con-« désigne une raison architectonique. Certes la struction n’est pas sans « avec » : son avec est indistinct en tant qu’assemblage, construction. Il est un pêle-mêle ou bien une « agglomération » (même en son sens géographique ce terme reste vague par rapport à « ville », « métropole », « conurbation ») dans laquelle ça va dans tous les sens.
Etre « post-déconstructionniste » – comme Derrida m’a fait l’honneur légèrement critique de me qualifier – ne signifie pas « reconstruire » (je reconnais que vous n’employez pas ce mot !) et peut-être pas non plus « construire » qui semble exposé à virer en « re-« (construire comme Descartes ou Kant en manient la signification édifice, bâtiment, palais ou fabrique).
Le transcendantal et le toucher, pour finir
AP : Le problème qui s’est dès le début affirmé comme le problème capital de la philosophie comme discours depuis le Théétète c’est ce qui a été formalisé plus tard par le concept de transcendantal, c’est bien en effet la question du statut du discours philosophique. Qu’est-ce qu’on dit quand on dit quelque chose de philosophique ? L’énoncé philosophique semble exiger une certaine auto-possession, ou auto-présentation de son sens : si on arrête ce mouvement (et ce mouvement qui appelle l’énoncé philosophique à l’auto-possession de son sens est en quelque sorte le cœur de l’onto-théo-logie), alors le sens du philosopher passe à côté de lui-même. Le sens du post-modernisme, son défi le plus puissant, est là : la philosophie ne peut rester en elle-même et doit s’écrire hors d’elle-même sans se perdre. Non qu’une philosophie pure, un transcendantalisme absolu comme celui de Fichte ne soit plus consistant : l’enchaînement d’un tel transcendantalisme à aux autres corps d’énoncés ne se fait plus de soi, la Wissenschaftslehre ne peut pas seulement se répéter, se répéter, elle doit sortir d’elle-même – oser aller hors d’elle-même sans relève, mais sans abandon.
J’ai l’impression pour finir que vous êtes de ceux qui s’attachent peu à peu à faire entrer en philosophie de nouveaux mots, qui ne sont plus des outils, des concepts purs, mais des façons de s’orienter pour continuer à avancer, à pratiquer une philosophie qui se touche sans se posséder. Vous pratiquez quelque chose comme une dialectique musicale. Si pour Hegel, à la fin de son parcours, l’esprit est « partout chez lui », il s’agit plutôt chez vous, comme l’a souligné Derrida4, de montrer l’esprit touchant et touché par tout. A la fin de la Logique Hegel fait référence à Aristote, à une jouissance donnée par l’auto-possession de l’esprit. Mais ce que vous introduisez, il me semble, c’est l’idée qu’il s’agit autant d’une jouissance de l’esprit que d’une participation de la jouissance à l’esprit. L’esprit est partout chez lui, mais ne rend pas raison : il touche – Derrida a fait du toucher un motif majeur de votre travail -est touché, circule, hume, respire. Cette vision rejoint Wittgenstein – moins peut-être sa postérité, car il ne s’agit pas de dénier tout prise spécifique à la philosophie, à en faire une simple propédeutique, mais à assumer que le sens philosophique ne s’exprime et se dispense que dans l’étreinte et la rencontre avec du non-philosophique. Mais que la philosophie soit garder, ou retrouver la sensibilité suffisante pour que ces rencontres se fassent.
JLN : En effet, le discours philosophique est un discours qui ne dit rien sur quelque chose sans dire en même temps quelque chose sur soi. Le transcendantal au sens que Kant a donné au mot signifie un retour sur soi de la pensée destiné à légitimer la pensée (tous ses contenus possibles) par ses conditions intrinsèques, qu’elle est seule à pouvoir déterminer et dont la détermination est l’exercice philosophique fondamental. On pourrait dire aussi « proto-philosophique » pour circonscrire la philosophie à ce qu’elle dit de ses objets – le corps, le droit ou l’espace : mais ce serait une distinction fragile car il n’y a pas d’objet philosophique sans auto-détermination du sujet philosophique.
C’est comme si quelqu’un parlait, dans la vie quotidienne, par exemple d’ « arbre », en revenant toujours à ce qui lui permet de parler de quelque chose de tel que « arbre » et à quelles conditions, etc. Autrement dit, la philosophie est constant frayage de sens. Elle ne reçoit aucune signification donnée, elle en ouvre, en essaie, en construit, en crée ou en imagine de nouvelles – mais aucune en fait n’est close, aucune ne se dépose dans une langue constituée (sauf pour des besoins provisoires d’exposition, de mise en ordre). Aucune langue n’existe sans faire toujours bouger l’ensemble de ses significations, mais en tant que langue elle ne s’arrête pas sur ses propres mouvements de transformation, de déplacement, d’invention (ou bien elle fait son histoire, sa philologie). La langue philosophique le fait sans cesse, elle ne fait que ça.
C’est ce que montre bien le contraste entre une doctrine qui se formule par sentences et termes reçus, comme le Tao, et la philosophie. (Certes, le Tao invite à considérer une complexité infinie des significations, mais au-delà de la sentence, dans un silence, pour dire les choses trop simplement.)
C’est aussi par là que la philosophie peut être nommée « pensée » par Heidegger pour être opposée à « philosophie » au sens de « conception du monde, de l’homme, etc. » (Weltbild comme en parle un texte connu de Heidegger). En ce sens-là parler d’une « fin de la philosophie » voulait dire : recommencer l’exercice du retour sur soi de l’ouverture du discours, ne rien dire qui ne dise aussi ce qu’il en est du dire et toujours faire un geste – un signe, un Wink – retourné vers l’en-deçà du dire.
C’est peut-être cela qui prend pour moi cette allure de toucher que vous relevez à la suite de Derrida et que Derrida a relevée alors que je n’en avais pas vraiment conscience et qui de ce fait fonctionnait d’autant mieux comme une sorte de transcendantal implicite (sans quoi j’aurais pu être tenté de former un « haptocentrisme »). Toucher c’est approcher, effleurer, frôler : cela implique distance, écart, importance des peaux et des surfaces. C’est aussi tâter, tâtonner, explorer la chose par ses flancs, hanter l’exposition au dehors et par le dehors. Mais c’est aussi le vertige de la proximité, que rien ne réduit à néant, que tout garde dans le frémissement, le tremblé.
La phénoménologie
AP : Excusez-moi de poser cette question alors même que vous avez insisté sur son côté, pour vous terminologique, un peu formel. Vous disiez lors de votre conférence (au Lycée Henri IV pour la clôture du séminaire du Collège International de philosophie consacré à la déconstruction du Christianisme), que la phénoménologie, parce qu’elle porte sur le phénomène, ne peut que déboucher sur la corrélation d’un « sujet » et de ce qui lui apparaît, et que faire éclater ce cadre, outrepasser le phénomène comme le fait Marion venait à le détruire, à perdre son sens. Alain David vous répondait, en évoquant Levinas, et le thème dans « La ruine de la représentation » dans En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger de la co-constitution, du circuit fondé-fondant qui met le transcendantal en boucle sur lui-même, qui fait du transcendantal phénoménologique ce qui révèle en acte un en deçà plus profond et un au-delà.
J’ai l’impression qu’il s’agit en fait d’une question d’orientation du discours. Marc Richir, qui pour moi développe une des phénoménologies les plus profondes, riches, importantes des quarante dernières années a conduit un basculement du thème de l’ego au thème de la phénoménalisation dans son mouvement, et ainsi, de la corrélation à ce qu’il y a « sous » la corrélation. Le phénomène pris dans sa logique, sa dynamique propre, son clignotement, n’est plus assujetti à un apparaissant mais épaissi pour rendre compte de toute la tectonique de la phénoménalisation. En parlant de phénoménalisation là où vous parlez de « présentation », Richir, au lieu de prendre le sens dans la totalité de l’enchaînement, en décompose le rythme pour l’étudier de l’intérieur. En cela, il tente de montrer concrètement, comment « du sens » se fait, comment une amorce de sens éveille une phase de sens qui se temporalise à son tour en présence, comment quelque chose peut se transposer en présent sur cette base. Bref, il détaille les étapes, la « chimie » de la parution, la cuisine du sens, on pourrait dire, et la méthode phénoménologique est ce qui lui permet de fixer des termes, de mettre en place tout un aiguillage pour s’orienter dans cette masse. Richir rend ainsi compte des nouages, coalescences, concrétions du concret mobilisant des phases de sens.
C’est assez révélateur, parce que Richir et vous rencontrez souvent les mêmes questions ultimes : le toucher, le contact, la passibilité, la pluralisation des monde, l’élémentalité. Mais chez vous ce sont des mots que le discours rencontre – il s’avance jusqu’à eux, les effleure, n’en fait pas des concepts, alors que Richir les saisit les thématise. Ça lui permet une très grande richesse dans le détail des analyses – le savoir du sens – mais il laisse du coup quelque chose en point aveugle à son tour – cet ancrage du sens dans un sens, cette sortie de soi de la philosophie dans la langue par laquelle elle s’éveille au sens, cette matérialité assumée de la parole qui suit toujours le sens dans une impulsion, un jeu, un risque…
JLN : Je ne vois pas vraiment la question : vous dressez un tableau contrasté – me demandez-vous si je l’approuve ? Oui, je pense. J’ai parfois été très sensible à certains textes de Richir, à sa mobilité, sa sensibilité. Si je ne l’ai pas beaucoup fréquenté, c’est sans doute par un motif de… sensibilité, justement. Une difficulté à communiquer avec sa tonalité. Je pourrais dire que parfois j’ai trop senti chez lui un effort très concerté, très volontaire pour faire sentir qu’il sentait. Et je le comprends bien ! C’est donc peut-être à la fois un manque de « syntonisation » et une trop grande proximité, une empathie.
Quoi qu’il en soit, pour revenir à la phénoménologie, il est vrai que pour moi elle est restée prise dans une corrélation (visée, intention, remplissement) entre le sujet et le phénomène qui à mon sens enlève au phénomène son phainein, son apparaître. Je pense que Husserl a eu le sens de cet apparaître ou, mieux, de ce paraître qui est la vérité de la « chose même » laquelle n’est rien hors du paraître. Mais il n’a pas « brisé le cercle de la représentation » pour reprendre une formule de Granet. Il reprenait trop les choses à partir d’une tradition cartésiano-kantienne du sujet, de la conscience et de la perception. Heidegger a eu, lui, le sens de l’in-der-Welt-sein qui n’est pas tout à fait identique à un Umwelt ni à un Lebenswelt. Derrida, pour sa part, a compris que le sujet est toujours déjà hors de soi (ce qui lui venait de Heidegger) et en somme toujours à nouveau hors de… Ce qui devrait nous occuper maintenant, c’est l’ensemble « dedans-dehors » : être hors de soi dans un monde.
AP : Je me permettais simplement de souligner quelque chose que je ressens comme une proximité – et une distance, mais une distance non-médiatisable, au plus proche. Certes, la phénoménologie a tendance à vouloir se glisser dans l’épaisseur ou la masse du concret, de chercher à habiter les formes qui s’y dessinent – à vouloir habiter le schématisme – et ce n’est pas un hasard si le concept matriciel de la pensée de Richir est le schématisme. Mais ce qui apparaît, c’est une certaine parenté des quelques pensées qui s’avancent au-delà de l’espace de la déconstruction : la votre, celle de Deleuze, celle de Richir. Il y a de l’un à l’autre des échos – le pli, le sens, le schématisme en écart – comme s’il y avait une certaine figure de la pensée post-déconstructrice qui pouvait, certes, de très loin, se reconnaître.







