Placé sous l’égide de Marx, mais aussi de M. Foucault et J. Rancière, Sans objet s’inscrit dans le cadre d’une réactualisation de ce que l’École de Francfort a baptisé sous le nom de « philosophie sociale » et de « Théorie critique ». Il s’agit pour l’auteur de jeter un regard critique sur le fonctionnement de notre société capitaliste dans laquelle les agents souffrent du manque de reconnaissance sociale, du défaut de représentativité politique et, plus gravement encore, de leur propre impuissance à changer un état de chose devenu pour eux « l’intolérable »1 S’il est bien d’ordre théorique, le projet de F. Fischbach vise donc à redonner sens à « la critique sociale » et, par suite, à permettre aux acteurs sociaux de reconquérir leur dignité et leur vie.
À première vue, le livre peut sembler quelque peu déroutant dans la mesure où il emprunte une conceptualité propre à des philosophes très hétérogènes (Marx et Heidegger, Fichte et Lukács, Arendt et Deleuze etc.). Mais ces emprunts se justifient pleinement lorsqu’on apprend qu’il s’agit de reconstituer une tradition philosophique et critique – au-delà des divergences doctrinales – pour laquelle le sujet du capitalisme recouvre en partie le sujet promu par la philosophie moderne et contemporaine. À ce propos, on peut noter que F. Fischbach a récemment défini les « grands caractères » de cette nouvelle forme de réflexivité critique et précisé les raisons de son occultation en France dans son Manifeste pour une philosophie sociale, La découverte, Paris, 2009.
L’épine dorsale se situe dans la réinterprétation du concept d’aliénation chez Marx2 qu’on trouvait déjà in extenso dans la Présentation de sa propre traduction des Manuscrits économico-philosophiques de 18443, complétée, cette fois, d’une relecture des Grundrisse où il s’agit de démontrer – contre la célèbre « coupure épistémologique » d’Althusser et, plus récemment, G. Bensussan – que la problématique de l’aliénation est maintenue, même implicitement, jusqu’au Capital. Si le terme d’aliénation est moins présent dans les œuvres de la maturité, c’est en raison du « contenu totalement inédit »4 que Marx donne au concept par rapport à son sens hégélien ou feuerbachien, et non parce que sa problématique aurait disparu.
La démonstration suit alors un itinéraire éclectique, on l’a dit, qui passe par l’idéalisme allemand (Schelling, Fichte, Hegel), discute des thèses contemporaines (A. Honneth, S. Žižek, J. Butler, G. Agamben) en prenant toujours pour fil directeur le concept d’aliénation. Sans pouvoir reprendre l’ensemble du parcours, nous proposons une lecture transversale insistant sur les points qui nous ont semblé les plus essentiels.
L’aliénation comme perte du monde
Dans l’optique d’une réactualisation de la critique sociale, l’ouvrage part d’une thèse assez simple et dont les implications s’avèrent multiples : si les agents sociaux souffrent de leur propre impuissance à changer les choses, c’est parce qu’ils sont aliénés. Mais, et c’est le nerf de la thèse, l’aliénation ne signifie ni devenir un autre (perte d’identité), ni la perte de soi dans le monde, mais la « perte du monde » : véritable processus de désobjectivation (Entgegenständlichung) où la locution « sans objet » désigne ici la privation de tout ce qui est nécessaire à la vie (à commencer par son corps propre et ses affects). Être aliéné signifie dès lors être «gegenstandslos», littéralement « sans objet », comme l’écrit Marx dans les Manuscrits économico-philosophiques de 1844. De même que Rossellini, dans le prologue d’« Allemagne année zéro », voulait que son film puisse apprendre aux enfants allemands à « re-aimer la vie », de même le livre veut tenter – et c’est le sens de sa critique – « la lutte contre la désobjectivation de nos vies qui résulte de l’ensemble des mécanismes destructeurs et des dispositifs privatifs caractéristiques du capitalisme. »5.
Pourtant, la réactualisation du concept d’aliénation n’a rien d’évident, si l’on admet avec P. Ricœur que le mot, surchargé de significations, recueille en lui toute la misère des sociétés6. Par exemple, en allemand, le mot aliénation se caractérise par une duplicité entre le thème de l’étranger (fremd,Entfremdung) et / ou de l’extériorité (äusser,Veräusserung, Entäusserung) qui rend d’autant plus difficile sa traduction.
Or, dans sa propre traduction des M. 44, Fischbach choisit de différencier l’aliénation (Entfremdung) de l’Entäusserung (littéralement, extériorisation) en traduisant ce dernier terme par la « perte de l’expression »7 À travers ce choix de traduction, apparaît ainsi l’origine de sa compréhension de l’aliénation comme « perte du monde » : l’aliénation, au sens renouvelé, nomme « la perte du monde », soit la perte de l’expressivité propre à tout être vivant.
Si toute théorie de l’aliénation présuppose une anthropologie philosophique voire une ontologie sous-jacente8 – ne serait-ce que pour définir ce qui se perd ou se transforme dans son processus –, alors celle de Fischbach (dans la droite lignée de ses lectures de Spinoza, Marx et Nietzsche) repose sur une différence qu’il situe en amont de la différence sujet/objet, à savoir dans celle du sujet et de « l’individu » comme être réel et être de rapports (p. 22). Tandis que le premier n’est que le support de l’aliénation, le second s’affirme, au contraire, contre elle. Ce sont les droits de l’individualité vivante et expressive, comprise comme « être de rapports », qui doivent donc être restaurés (ce serait « la grande et vraie modification » (p. 264)) contre les droits exclusifs et privatifs de la subjectivité inexpressive et impuissante promue par le capitalisme. Le sujet se confond ainsi, selon Fischbach, avec le sujet même du capitalisme qu’il propose d’appeler le « sujet désinvolte » (p. 99) parce que devenu spectateur désengagé d’un monde en lequel, non seulement il ne se reconnaît plus, mais ne croit plus. D’où le sens ultime de la perte du monde comme figure de la subjectivité aliénée, et dont l’impuissance d’agir croît en raison inverse de sa capacité à « fonctionner au sujet » (p. 22).
L’aliénation comme produit de la subjectivité
Dès l’Avant propos, Fischbach nous livre son intention : « En définitive, nous ne ferons pas autre chose ici que déployer les présupposés et les conséquences d’une paraphrase de la formule de Foucault : « le sujet dont on nous parle et qu’on invite à libérer est déjà en lui-même l’effet d’une aliénation bien plus profonde » (p. 26). Il s’agit donc de remonter aux implications de cette hypothèse essentielle : l’aliénation est le produit de la subjectivité inconditionnée conçue comme liberté. Ce qui implique de renouer le fil d’une tradition qui cherche « non pas seulement à surmonter l’opposition sujet-objet, mais à montrer que l’opposition sujet/objet est elle-même déjà le produit ou le résultat théorique de l’aliénation elle-même » (p. 40). En ce sens, Heidegger et Marx ont ceci de commun de définir l’aliénation comme un processus consistant à faire de l’être humain (Dasein ou Arbeiter) un sujet abstrait et coupé du monde. Leur « rapprochement » (p. 40) s’impose donc dans la mesure où ils partagent la même idée selon laquelle l’aliénation signifie une séparation du sujet et du monde : chez l’un à cause de l’oubli de l’« être-au-monde » et chez l’autre, par la « désobjectivation » du travailleur réduit à l’état de pur sujet doté de sa force de travail.
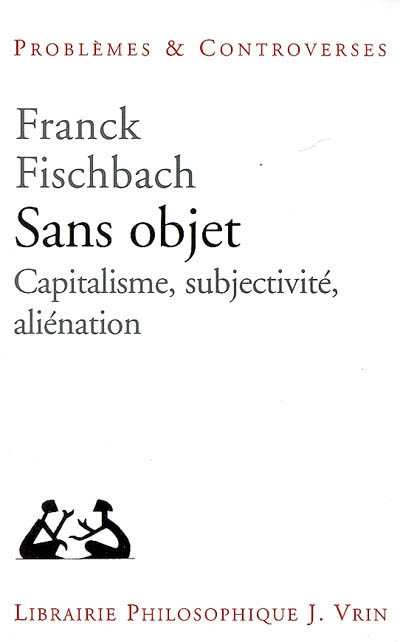
Comme on le voit, il s’agit donc plus que d’un simple « rapprochement » puisque Heidegger et Marx permettent à Fischbach de démontrer qu’il existe un lien étroit, pour ne pas dire ontologique, entre l’être du sujet et l’être aliéné qui sont comme les deux faces d’un même processus. Dans cette perspective, un sujet aliéné devient une sorte de pléonasme.
Origine du capitalisme moderne dans la subjectivité
L’analyse s’inscrit ainsi en faux par rapport l’une des thèses principales défendue dans Le nouvel esprit du capitalisme : L. Boltanski et E. Chiapello définissaient le nouvel esprit du capitalisme à partir du modèle managérial de la société réticulaire dans laquelle chacun de ses membres devait fonctionner « par projet », c’est-à-dire par incitation à l’autonomisation et l’autogestion. Cette thèse montre, par ailleurs, que le nouveau capitalisme a ceci de puissant qu’il a finalement su absorber en lui la critique sociale de l’aliénation développée à la fin des années 60 pour mettre les espoirs du sujet émancipé au centre de son dispositif9. Or « ce livre, écrit F. Fischbach, a voulu prétendre le contraire. Et c’est pourquoi j’y ai entrepris de montrer qu’il est possible de reconstituer une tradition philosophique pour laquelle la philosophie du sujet libre, du sujet détaché de tout être, de toute substance comme de tout objet, du sujet sans substance et tout en projet, loin d’avoir jamais constitué un horizon de libération, est au contraire la figure même de l’aliénation. » (p. 255).
Dans cette optique, la critique sociale se trouve « réarmée » (Ibid.) – n’en déplaise aux sociologues du capitalisme – dans la mesure où elle vise à démasquer les pseudos discours de l’émancipation, et notamment les injonctions à plus d’adaptabilité, de mobilité, et de flexibilité qui s’avèrent être autant de figures de l’aliénation. Si l’aliénation est un processus de désobjectivation, elle trouve en effet son corrélat dans les processus infinis de « subjectivation » (p. 30 sq.) qui, nous imposant de fonctionner comme des sujets, nous privent de facto du monde réel dans lequel nous vivons.
Ainsi la critique sociale menée par Fischbach consiste à mettre en évidence la collusion entre subjectivité et capitalisme moderne et montrer que le sujet libre et autonome est, en réalité, la figure type de l’être aliéné. Par où l’on voit que la fonction réflexive et critique de l’ouvrage consiste à identifier les ressorts théoriques et affectifs sur lesquels fonctionne la société capitaliste. Car c’est bien le même processus d’aliénation qui est responsable, pour une large part, des pathologies sociales comme la désaffiliation, le manque de reconnaissance sociale ou, pour le dire dans la terminologie marxienne, la désobjectivation de nos vies.
L’aliénation n’est pas la réification
Mais la thèse de l’aliénation comme perte du monde objectif n’est compréhensible qu’à la condition de prévenir la confusion entre aliénation et réification. Dans l’aliénation, le sujet résulte du processus d’aliénation, tandis que dans la réification, il demeure maintenu hors du processus, ne serait-ce que parce que, pour devenir chose ou marchandise, il faut bien présupposer un mode d’existence non chosale. L’aliénation entendue comme réification ne provient pas, en effet, de Marx mais de son interprétation par Lukács dans Histoire et conscience de classe. Reprise par de nombreux discours antilibéraux jusqu’à l’École de Francfort (La réification, A. Honneth), elle fait obstacle, selon Fischbach, à la juste compréhension du processus d’aliénation. La réification est encore redevable d’une philosophie du sujet déchu ou réifié alors qu’il s’agit, au contraire, de défendre l’identité entre l’émergence du sujet et le processus d’aliénation. Fischbach remonte ainsi jusqu’au « cadre formel de la pensée lukácsienne » (p. 68) qu’il situe chez Schelling lorsqu’il définit le moi comme non-chose ou comme être libre et inconditionné. Dans Le jeune Hegel cependant, Lukács a lui-même reconnu l’irréductibilité de l’aliénation à la réification. D’où la « palinodie lukácsienne » (p. 65 sq.) qui renforce d’autant plus la thèse de l’aliénation comme perte de l’objet et non comme perte du sujet dans l’objet.
Hegel ou Marx ?
Mais si l’on veut saisir l’originalité de la conception marxienne de l’aliénation, il faut la mettre en perspective avec la théorie hégélienne dans la mesure où elle repose sur « une négation sans négativité » (p. 129). Contrairement à Hegel, la perte du monde objectif n’est pas un moment dialectique de l’esprit mais un terme. Si, pour Hegel, la perte de l’objet (sans objet) est un moment succédant à la perte du sujet dans l’objectivité, c’est parce que cette double perte ouvre le chemin d’une reconquête par et pour l’esprit de son identité devenue (« quand il faut deux pertes pour faire un gain », p. 71 sq.). L’aliénation, se retournant positivement en solidification du sujet, représente donc « la respiration essentielle de la subjectivité » (p. 130). De sorte que Marx et Hegel s’opposent terme à terme dans la mesure où le premier considère que notre être d’individu s’exprime dans l’objectivité du monde tandis que le second veut la suppression de l’objectivité pour revenir à soi.
Plus radicalement encore, la philosophie hégélienne, non seulement irrigue – comme on le sait – la théorie de l’aliénation de Feuerbach à Marx, mais représente une sorte de démonstration par l’absurde de la thèse de l’aliénation comme désobjectivation et, corrélativement, comme subjectivation. C’est d’ailleurs en suivant la lecture proposée par J. Butler, dans La vie psychique du pouvoir, de la « dialectique du maîtrise et de la servitude » que Fischbach fait voir « toute la différence qui sépare Marx de Hegel » (p. 122) : ou bien le valet prépare au fond le « travail de la pensée » (Ibid.) – ce que Butler nomme « l’autonomie de la réflexion désincarnée – , ou bien le valet incarne, au contraire, l’aliénation pure et simple dans la mesure où il travaille pour le maître à deux niveaux : temporairement parce que le maître lui a délégué son corps productif, définitivement parce que ce dernier l’exproprie de l’objectivation de son être propre par et dans les objets de son travail. Ce qui nous conduit à un autre point extrêmement important de l’analyse : l’aliénation comme « transfert de passivité » (p.156 sq.).
L’aliénation comme privation de la passivité
Cette relecture de la dialectique de la maîtrise et de la servitude confirme en effet l’idée que l’aliénation n’est pas réification, puisque le maître – par un désaveu de la corporéité si essentielle selon Marx – délègue son propre corps productif au valet : « sois mon corps à ma place mais ne me dis pas que ce corps que tu es est mon corps » étant l’injonction proposée par J. Butler à l’appui de sa réinterprétation de Hegel et qui montre bien qu’il s’agit, dans l’aliénation, d’un transfert d’activité et de passivité. Car ce qui est aliénant, ce n’est pas tant que le valet agisse pour quelqu’un d’autre, mais qu’il demeure privé de la possibilité même d’être affecté (et de jouir) par les objets de sa vie. Devenu simple sujet d’une activité pure, c’est alors sa passivité qui lui est soustraite par le maître. Tel serait au fond le sens ultime et radical de l’aliénation propre au capitalisme : si l’homme aliéné est « sans objet », c’est d’abord parce qu’on le prive de la part passive de son être (besoin, désir, souhait), c’est-à-dire de sa propre capacité de sentir et d’être affecté par le monde :
« S’il y a une chose que les maîtres, les puissants, les dominants ne transfèrent jamais, c’est bien la capacité de jouir et encore moins la jouissance elle-même ! Or c’est justement le tour de force du capitalisme pour les masses laborieuses : il les « délivre » de leur passivité, c’est-à-dire qu’elle les en prive, permettant ainsi que le travailleur se présente comme le sujet d’une activité pure, comme le possesseur d’une puissance abstraite de travail » (p. 158).
La privation de la passivité – notion forgée par Fischbach à partir du « concept d’interpassivité » de Žižek – indique le versant pathologique de l’aliénation. Elle implique que le sujet du travail se transforme en sujet pur d’une activité désincarnée, parce qu’on le prive des besoins et des affects nécessaires à sa vie. Alors que le travail est « une expression la vie humaine, et une expression parmi d’autres » (p. 152), il est devenu, dans le capitalisme, le seul moyen de vivre, c’est-à-dire le seul objet pour un sujet aliéné. En sorte que l’aliénation n’est pas dans l’objectivation – par laquelle les hommes travaillent et expriment leur être de besoin et de désir – mais dans « une objectivation qui rate et qui échoue » (p. 155). Comme le souligne Marx, le travailleur irlandais ne connaît même plus le besoin de manger mais seulement le besoin de manger des patates à cochon, « la pire sorte de pomme de terre » (M44 p.179).
Résister à l’aliénation
La dernière partie de l’ouvrage tente d’établir la thèse que résister à la subjectivation ne consiste pas à faire appel, une fois de plus, à un sujet pur, libre ou non réifié, parce qu’on trouve au cœur de l’assujettissement un « attachement » pathologique du sujet à sa propre aliénation, comme le montre la scène banale de l’interpellation policière proposée par Althusser10. Scène qui décrit comment l’on parvient, par le biais de l’interpellation, à transformer des individus en sujets : processus d’assujettissement qu’Althusser assimile à « la catégorie idéologique abstraite de sujet » (p. 213).
Néanmoins, Fischbach en propose une interprétation sensiblement différente de celles que proposent Butler et Žižek. Résister à la subjectivation implique de ne plus chercher à défendre une subjectivité plus large ou plus originaire comportant tous « les traits fondamentaux du sujet de l’idéologie » (p. 232). Il faut, au contraire, se départir de la subjectivité et « persister autant que possible dans notre être concret » (p. 232) c’est-à-dire rester des individus vivants existant objectivement dans le monde.
Cette persistance n’est cependant possible qu’à la condition de redéfinir le droit de propriété sur les objets non pas comme un droit possessif mais comme un droit à une « activité libre » (Fichte). Activité permettant l’expressivité de soi et non la privatisation des choses du monde. Contrairement à la vulgate marxiste, Fischbach – s’appuyant ici sur les M. 44 – montre que si Marx y défend la suppression de la propriété privée, c’est qu’il cherche à supprimer le régime de la possession et « la soif d’avoir » (M. Hess) inhérents à la propriété. Mais la véritable opposition chez Marx ne se situe pas entre propriété privée ou collective mais entre un usage privatif ou commun des objets et des richesses propres à exprimer nos vies. Faire du monde notre monde, ce n’est donc ni le privatiser, ni le rendre collectif (perte du monde) mais permettre à chacun d’entre nous de le rendre expressif de soi et de ses besoins propres (réappropriation de nos objets propres).
Critique de la critique
Nous ne souhaitons nullement remettre en question ici le contenu riche et stimulant de la pensée développée par F. Fischbach dans Sans objet. Car, disons le clairement, l’ouvrage nous semble extrêmement important et novateur dans la mesure où il permet de mieux percevoir la logique à la fois théorique et affective sur laquelle repose l’organisation du capitalisme aujourd’hui.
Loin de céder, une fois de plus, à « l’omnipotence de la bête »11 que représenterait le capitalisme et face à laquelle la mélancolie de gauche a nourri sa critique déceptive, Sans objet échappe, selon nous – et c’est son immense qualité –, à ce que J. Rancière propose de nommer « les mésaventures de la pensée critique » (Ibid, p. 30-56). Sous les deux aspects de l’aliénation, la désobjectivation et la privation de la passivité, l’analyse de Fischbach permet en effet de réorienter l’objet de la critique sociale. Celle-ci n’est plus dirigée contre un système global et abstrait mais s’attache, au contraire, à faire ressortir les effets pathologiques que produit l’abstraction du capitalisme et à remonter à sa cause, à savoir la subjectivité désinvolte.
Néanmoins, nous voudrions insister sur deux points délicats que nous paraît soulever son analyse et qui portent justement sur les prémisses d’un tel renouveau de la pensée critique.
À un niveau interne, nous pensons d’abord que si cette relecture de la théorie marxienne de l’aliénation est tout à fait convaincante, elle suscite néanmoins des difficultés qui touchent au principe même de la relation sujet/objet : comment en effet parler d’objectivation de la vie sans présupposer un sujet ? La notion d’objet n’est-elle pas encore redevable d’une séparation (ou d’une perte) qui porterait alors les stigmates de l’aliénation elle-même ? Pour le dire autrement, pourquoi ne pas prendre congé du « langage des objets » lorsqu’on cherche, comme F. Fischbach, à remonter en amont de la subjectivité, c’est-à-dire vers l’individualité réelle et vivante ? Bref, la relation entre l’individu et la vie peut-elle se traduire, sans perte, dans le langage de l’objectivation ?
La difficulté que pose, selon nous, la réactualisation du concept d’aliénation versus objectivation de la vie, réside dans son inspiration spinoziste. Car si les hommes sont des « êtres objectifs », et ce plus que n’importe quel être vivant, c’est qu’ils sont à la fois des « parties de la nature » écrit Marx, et en même temps, « se savent comme des êtres objectifs ». Ce savoir de soi – et ce point est tout à fait essentiel pour l’auteur – ne désigne pas, au sens idéaliste, la souveraineté de la conscience de soi ou d’un Esprit absolu (Feuerbach ou Hegel), mais le fait que les hommes aient « une capacité à former une connaissance des causes, une connaissance des choses par leurs causes, étant entendu qu’une telle connaissance ne se forme que de manière immanente au déploiement de l’activité productive et vitale dont les hommes sont eux-mêmes les causes. » (p. 148). Ce que Fischbach propose de nommer « la connaissance de soi comme objet » (p. 146).
Or, ce savoir de soi n’est-il pas encore redevable d’une philosophie de la connaissance objective ou adéquate ? Tout se passe comme si Marx posait, au commencement, la vie, la sensibilité et donc la passivité (p. 152-153), mais finissait par promouvoir l’objectivation ou l’expression de soi comme idéal de conformité entre l’activité humaine et son monde. Le langage de l’objectivation et de l’appropriation du monde serait alors symptomatique de la volonté de maîtriser la vie qui, chez un Nietzsche par exemple, ne peut être qu’illusoire dans la mesure où elle partage, avec l’idéalisme, la même ambition de dominer l’ensemble de la vie. Dans cette optique, la critique s’infléchit en promettant l’émancipation par la connaissance comme si l’émancipation sociale « ne pouvait venir que comme la fin d’un processus global qui avait séparé la société de sa vérité »12
L’aliénation ne serait donc pas simplement du côté de l’objectivation qui échoue, mais déjà dans toute tentative d’interprétation de la vie comme objectivation, occultant par là-même son affectivité et sa passivité irréductibles. Sans développer davantage, le point nodal de la relecture proposée par Fischbach réside donc bien – et c’est sa force – sur l’économie générale entre passivité et activité de la vie. Mais la notion d’objectivation tend à l’occulter, selon nous, en raison de sa provenance idéaliste – et même subjectiviste – dont Marx hérite tout en cherchant à la subvertir. Mais, y parvient-il aussi certainement que l’affirme Fischbach ? Cela est moins sûr.
Ensuite, de manière plus globale, si l’on suit cette fois Manifeste pour une philosophie sociale, un livre comme Sans objet n’a pas seulement pour destinataire les philosophes mais « s’adresse à des agents sociaux susceptibles de s’approprier sinon le point de vue de la philosophie sociale, du moins ses résultats » (Manifeste pour une philosophie sociale, p.81). Une philosophie sociale se veut donc engagée et émancipatrice en ayant des impacts directs sur la réalité sociale. Or, force est de constater que la « réalité sociale » demeure à l’arrière-plan de l’ouvrage dont le propos essentiel consiste ici à réactualiser le concept d’aliénation. L’enjeu est donc finalement plus de s’expliquer avec un corpus de texte qui, ou bien utilise implicitement le concept, ou bien lui fait écran -, que de faire un usage du concept in concreto. Certes, on trouve ici et là quelques remarques faisant référence à l’actuel gouvernement (p. 32) ou aux manifestations anti-CPE (p. 249) mais cela reste très secondaire et dérivé dans l’ensemble du livre. Ce qui nous laisse, en tant que lecteur, dans l’attente d’un livre tout aussi spéculatif, mais peut-être davantage ancré sur la réalité sociale elle-même.
- Franck Fischbach, Sans objet, Capitalisme, subjectivité, aliénation,Vrin, Paris, 2009, p.11 sq.
- p. 151-208
- K. Marx, Manuscrits économico-philosophiques de 1844, trad. F. Fischbach, Vrin, Paris, 2007
- note n°2 p. 160
- Ibid. p. 264
- « Aliénation » in Dictionnaire de la philosophie, Encyclopædia Universalis, Albin Michel, Paris, 2000, p. 47 sq.
- Voir : Présentation in K. Marx, Manuscrits économico-philosophiques de 1844, p. 17-26
- P. Ricoeur, Ibid., p. 56
- L. Boltanski, E. Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris,1999, p.522 sq
- Voir : L. Althusser, Sur la reproduction, « Actuel- Marx Confrontation », P.U.F, Paris, 1995, p.226 sq.
- J. Rancière, Le spectateur émancipé, La fabrique, Paris, 2008, p. 55
- J. Rancière, Le spectateur émancipé, La fabrique, Paris, 2008, p. 49







