Le livre de Philippe Sabot, Lire Les mots et les choses de Michel Foucault1, est publié dans la collection « quadrige manuels » et se donne un objectif ambigu. Certes, il veut présenter le « best seller » de Foucault, mais il veut en montrer certaines aspérités ou certains aspects qui ont été négligés par les études foucaldiennes qui ne font de cet ouvrage qu’un jalon dans la progression, continue ou non 2, de l’itinéraire intellectuel de Michel Foucault. Aussi, si l’ouvrage propose effectivement un résumé de l’ouvrage, qui peut être considéré comme un guide de lecture, une introduction ou un commentaire des idées qui y sont développées, l’essentiel réside sans doute ailleurs : Philippe Sabot veut pointer du doigt les audaces et les réflexions qui sont passées inaperçues dans la réception des Mots et des choses 3.
Après une présentation de l’œuvre et de sa réception, l’auteur restitue relativement impartialement le raisonnement dans la première partie de l’œuvre et en ressaisit les étapes importantes pour la progression de son analyse avant de commenter très précisément la deuxième partie de l’ouvrage pour mettre en relief certains points de l’argumentation foucaldienne.
Dans l’introduction de son livre, Philipe Sabot insiste sur l’originalité des Mots et des choses dans le parcours philosophiques de M. Foucault. Cet ouvrage original fut un grand succès auprès du public. L’histoire de sa réception conduisit à deux démarches que l’auteur condamne : la première est de réduire l’œuvre de Foucault à n’être que l’ombre des Mots et des choses : la pensée de Foucault serait alors un vaste ou vague commentaire de l’ouvrage de 1966 – quand elle n’est abandonnée dès qu’elle parle d’autre chose (les réflexions sur la sexualité ou le pouvoir par exemple). La seconde est de ne pas s’intéresser aux analyses du philosophe sur les savoirs depuis la Renaissance, ne faisant de cette érudition qu’un prétexte ou un arrière-fond pour défendre une thèse antihumaniste et plus ou moins structuraliste.
Contre ces mauvaises interprétations du livre, Philippe Sabot veut questionner pour lui-même le livre, identifier les adversaires dans ce livre qui est – entre autre mais indéniablement – un livre de combat, à l’aide du reste de l’œuvre, ce qui devrait permettre une meilleure compréhension de la démarche archéologique présente dans ce livre.
Si Les mots et les choses sont un ouvrage capital en soi et dans la démarche de Foucault, comme le rappelle Philippe Sabot, c’est parce qu’il propose un triple enjeu : d’une part, il questionne le statut de la connaissance qui est un thème récurrent dans la réflexion de Foucault, d’autre part il interroge le lien entre histoire et vérité et enfin il étudie l’importance du langage pour l’enquête. Que veut faire Michel Foucault, si on s’en tient à la démarche propre des Mots et les choses, et qui trouve un écho dans le reste de son œuvre – particulièrement dans l’Archéologie du savoir 4? D’après Philippe Sabot, le problème intrinsèque à l’œuvre est celui-ci : « l’objectif principal de l’archéologie foucaldienne est de rendre compte de cette articulation entre le niveau des connaissances scientifiques, telles qu’elles existent et fonctionnent avec leur régularité propre et le niveau « épistémique » du savoir, où ces connaissances viennent trouver leurs propres conditions historiques de possibilité. En mettant au jour cette articulation entre la science et le pouvoir, Foucault entend ainsi proposer une thèse épistémologique forte qui décale le questionnement (de type kantien) sur la prétention légitime ou non d’un ensemble d’énoncés à la scientificité vers un autre questionnement critique, portant cette fois sur les conditions de possibilité de l’existence historique de tel ou tel type de discours et des modalités de son épistémologisation. » 5 Foucault développe la notion, qu’il ré-explicitera dans L’Archéologie du savoir, d’épistémè comme complexe non conscient formant une unité à une époque précise de l’histoire entre différentes connaissances, rationalités et croyances. Elle est, comme le dit F. Evrard : « cette structure inconsciente à la fois agissante et cachée, de la signification qui permet la science » 6. Philippe Sabot démarque alors ce projet archéologique aussi bien d’une phénoménologie (puisque Foucault ne se pose pas dans ce travail la question de la fondation subjective de la connaissance) que du marxisme (car les discours étudiés sont pris comme valant pour eux-mêmes et non en référence à une infrastructure qu’ils recouvriraient et à l’aune de laquelle ils prendraient toute leur signification). Il rapproche ensuite la visée des Mots et des choses de « l’histoire archéologique des sciences » (catégorie reprise de l’Archéologie du savoir) qu’il replace dans le sillage de Canguilhem plus que dans celui de Bachelard, dans la mesure où la validité d’un système scientifique pour Bachelard est mesurée à l’aune d’une vérité, conquise sur les « obstacles épistémologiques » empêchant l’accès immédiat à la scientificité, alors que pour Canguilhem, comme pour M. Foucault, la validité d’un système scientifique est à mesurer en fonction de la constitution historique d’une science, cohérente, structurée par une pratique, des méthodes et des énoncés communs admis. C’est chez Canguilhem et Foucault la cohérence de différentes facettes qui fait d’une science une science, alors que chez Bachelard, c’est son rapport à la vérité. La vérité n’est donc pas pour Foucault, aussi bien dans Les mots et les choses que dans le reste de ses œuvres, la norme constitutive du discours scientifique, mais un effet du savoir constitué comme science à une époque donnée. Dès lors, Les mots et les choses seraient moins une histoire de la vérité dans laquelle on passerait d’une « fausse » vérité, une vérité qui ne correspondrait pas ce qui est vrai selon les critères scientifiques d’une époque réputée plus scientifique que les précédentes 7, qu’une histoire de ce qu’on considérait être la vérité scientifique, et des mécanismes par lesquels on a pu justifier que de telles conceptions de la science étaient légitimes. Pour analyser cette histoire des formes de la science, Foucault se pose la question de la théorie du langage qui découle de ces formes scientifiques et du rapport entre celles-ci et la littérature, conçue comme « pensée du dehors » selon l’expression de Foucault lui-même, qui aide à comprendre le lien entre les discours et les différents systèmes de savoir qui les rendent possibles.
Puis l’auteur s’attache à l’analyse de la Préface qui a pour double objectif de clarifier l’idée de la démarche d’une « archéologie du savoir », avec les notions d’ordre et de discontinuité pour construire les concepts d’a priori historique et d’épistémè ainsi que de spécifier le cadre de l’analyse du livre par rapport à une archéologie des sciences humaines et aux autres archéologies préexistantes. Cette préface commence par une taxinomie hétéroclite de Borges qui suggère de l’impensable. Du coup, le projet de Foucault apparaît comme la mise au jour d’une forme de « table » 8 à partir de laquelle la pensée occidentale fonctionne, classe, définit, pose des ressemblances. Mais, contre Kant dont le geste s’inspire, Foucault n’en pense pas l’universalité, mais la relativité par rapport l’histoire. Ce qui aboutit à une première définition de l’archéologie : « l’archéologie paraît désigner, littéralement, ce travail de mise au jour des structures implicites de notre expérience, (…) en tant que celle-ci est commandée secrètement, et comme en arrière d’elle-même, par une opération fondamentale de mise en ordre des choses. » 9. Il s’agit donc de dégager les conditions de possibilité du connaître. Comme l’explique précisément Philippe Sabot, un savoir n’est possible qu’à condition de s’appuyer sur un ordre des choses qu’il manifeste dans son développement. Pour Kant, l’ordre est dans le regard qu’on porte sur les choses, pas dans les choses elles-mêmes, alors que pour M. Foucault, il y a en quelque sorte rencontre entre notre regard partiellement ordonnant et des choses déjà partiellement ordonnées : le fait a priori est qu’il y a de l’ordre, et l’archéologie cherche à retracer l’histoire des modes d’être de l’ordre. Cette réalité, qu’il y a de l’ordre, est un fait incontournable et s’inscrit dans l’histoire : à chaque époque, l’ordre n’est pas le même, pourrait-on dire. L’ordre est toujours inscrit dans un devenir historique, et le champ d’investigation du livre s’étend du 16ème siècle à nos jours. Pour rendre compte de ces ordres, trois domaines sont étudiés : la vie, le travail et le langage, et l’archéologie foucaldienne vise, comme le dit clairement Philippe Sabot, à rendre compte de « la manière dont l’expérience de l’ordre, dans ses variations successives, a pu fonder des modes de savoir distincts (histoire naturelle et biologie, par exemple) qu’il s’agit à chaque fois de rapporter à leurs conditions historiques de possibilité, soit à des modes d’être de l’ordre différenciés. » 10
L’a priori historique 11 fonctionne comme une historisation du transcendantal kantien et Foucault veut défaire la trame narrative de l’histoire des sciences ou des idées en contestant les présupposés et certains résultats. Pour cela il utilise la forme du récit, c’est-à-dire un certain déroulement narratif et temporel, qui sans être une fresque historique de la Raison, de la Renaissance à nos jours, dépeint ses cadres successifs, dans être continus, de pensées. Ainsi, c’est à une véritable démarche « géologique » 12 que se livre Foucault, cherchant à dresser la carte des savoirs successifs, pour repérer failles, ruptures, discontinuités parfois difficilement explicables. La discontinuité foucaldienne, credo que reprendront plus tard les historiens eux-mêmes, s’oppose à toute homogénéisation de l’histoire qui restituerait l’unité à l’histoire de la raison occidentale, qui ferait de l’histoire des sciences et des savoirs un processus continu et progressif. L’archéologie ne veut pas l’histoire au sein d’un ordre continu et homogène, mais se donne à penser comme l’histoire de l’ordre lui-même, histoire de l’ordre scandée par deux ruptures cruciales : l’avènement de l’âge classique au milieu du 17ème siècle et de la modernité au début du 19ème.
Le plan des Mots et les choses est composé de deux grandes parties symétriques (chapitres I-VI, VII-XII) articulées chacune « autour d’un « seuil » qui définit l’apparition (…) d’un certain mode d’être historique de l’ordre, c’est-à-dire d’une refonte complète des conditions de possibilité de la positivité du savoir d’une époque » 13. M. Foucault ne veut donc pas seulement décrire des histoires du savoir, mais proposer une archéologie des sciences de l’homme, qui sont une forme tardive de savoir dans l’histoire éclatée de la raison occidentale, autrement dit, montrer que l’homme de l’ « anthropologie » n’est ni une réalité première, ni une donnée naturelle. L’effort de Foucault porte également sur la tentative de montrer que les sciences de l’homme ne sont pas le fruit, parvenu à maturité, d’une graine déjà présente dans l’humanisme du 16ème siècle, mais que la possibilité même d’une telle connaissance est récente puisqu’elle dépend de conditions épistémologiques particulières qui n’ont émergé qu’à la fin du 18ème siècle 14. Cet effort permet de comprendre pourquoi le livre est sous-titré « une archéologie des sciences humaines » et ne fait pas un doublon avec le livre important de M. Foucault Archéologie du savoir. Aussi le livre de Foucault veut-il « rendre compte des conditions d’émergence, au sein de la culture occidentale, d’un type de savoir tout à fait particulier, dans lequel l’homme vient occuper à la fois la position de sujet transcendantal de la connaissance et d’objet empirique (vivant, travaillant, parlant) de cette même connaissance » 15, moins pour en faire l’aboutissement d’une continuité que pour montrer les bouleversements dans le champ épistémologique qui ont rendu cela possible.
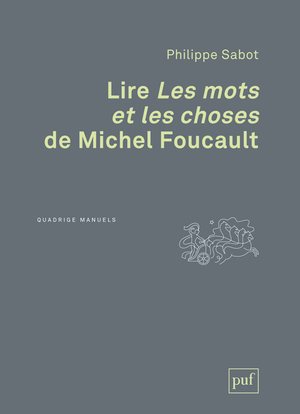
Puis, en neuf pages, Philippe Sabot résume et présente la première partie des Mots et des choses (les chapitres I à VI) qui établit la configuration propre au savoir et à la pensée à l’âge classique 16.
P. Sabot consacre son développement au commentaire plus détaillé de la seconde partie du livre de Foucault, dans laquelle se manifestent les enjeux d’une « archéologie des sciences humaines. » Le problème le plus immédiat est celui des déplacements du « sol » 17 des discours : comment penser le changement sans faire fond sur une continuité fondamentale, mais en prenant en compte la radicalité de l’effacement de ce qui précède (contre l’Aufhebung, conservation/dépassement de Hegel).M. Foucault propose un passage de l’Ordre à l’Histoire pour rendre compte du passage de l’âge classique à la modernité. Comme de la ressemblance à l’Ordre pour rendre compte du passage de la renaissance à l’âge classique.
En effet, c’est l’histoire qui permet d’articuler entre elles les différentes choses et d’être le fond sur lequel s’orchestrent les différents savoirs : « les données empiriques viennent désormais s’ordonner dans l’élément du temps (et de la série dynamique) et non plus dans celui de l’espace (et du tableau statique) » 19. Il propose une analyse en deux phases chronologiques successives (1775-1795 pour le chapitre VII et 1795-1825 pour chapitre VIII) qui met en évidence que le basculement épistémologique consiste en un déplacement et un réagencement des éléments constitutifs du savoir : « au lieu de se rassembler dans l’élément homogène du Discours (de la représentation et du langage), ce savoir trouve désormais son unité dans le thème de la finitude de l’homme historique », comme le remarque Philippe Sabot 20. Un tel examen de la constitution des savoirs particulier permet une réévaluation d’idées admises généralement : la théorie économique de Marx n’est pas fondamentalement en rupture avec celle de Ricardo et l’œuvre de Cuvier rend possible quelque chose comme la théorie de l’évolution. Ainsi, Philipe Sabot montre que le geste archéologique de Foucault est à comprendre aussi comme révision ou contestation de l’histoire « admise » des savoirs. Ce qui apparaît d’abord, c’est l’opposition entre la clôture de l’âge classique et l’éclatement du savoir moderne 21.
Philippe Sabot étudie alors le chapitre VII des Mots et les choses. Il y montre que les œuvres de certains auteurs (Jussieu, Lamarck, A. Smith, Jones ou Vicq d’Azyr) appartiennent d’une certaine façon, par leurs concepts, à la biologie, l’économie politique ou la philologie, tout en restant, filles de leur époque, prisonnières des limites de la représentation. Par exemple, dans le domaine de l’histoire naturelle, Foucault montre qu’avec Jussieu, Lamarck et Vicq d’Azyr, il ne suffit plus pour établir l’importance d’un caractère de comparer entre elles des structures visibles, mais de rapporter au fonctionnement interne de l’être vivant ce caractère. Ainsi Foucault explique-t-il à propos d’un texte de Jussieu « si le nombre de cotylédons est décisif pour classer les végétaux, c’est parce qu’ils jouent un rôle déterminé dans la fonction de reproduction, et qu’ils sont liés, par là-même, à toute l’organisation interne de la plante ; ils indiquent une fonction qui commande toute l’organisation de l’individu » 22. Il faut à présent percer la surface visible pour mettre au jour l’organisation secrète qui conditionne le vivant. Du coup, le règne du vivant se distingue de celui de l’inanimé et la biologie moderne naît de ce geste. C’est avec l’émergence du concept d’organisation que peut prendre corps la biologie. La rupture dans le domaine du langage tient à la prise en compte de l’histoire des langues, ce qui rend possible la phonétique, par exemple, qui étudie comment les sons évoluent les uns en rapport avec les autres et l’idée d’évolution suppose bien celle du devenir. Le geste foucaldien interdit ainsi deux lectures possibles des transformations dans l’ordre du savoir : la lecture habituelle de l’histoire des sciences qui, téléologiquement, ne voit dans les transformations qu’un progrès dans la rationalité, d’une part, et, d’autre part, une lecture plus culturelle qui impute au romantisme un changement de perspective sur le monde qui rend propice à ces découvertes. C’est d’ailleurs dans le sens d’un questionnement sur les limites de la représentation que Foucault lit la critique kantienne. L’auteur écrit ainsi que « Foucault retient donc de Kant ce geste critique du « contournement de la visibilité des choses » 23 qui les fait échapper au jeu interne de la représentation en direction de ce qui, hors de ce jeu, en fournit les règles » 24
Dès lors, à partir de Kant, Foucault décrypte le retournement de l’épistémè classique construite sur l’analyse de la représentation en une nouvelle qui s’appuie sur le « décalage entre l’être et le rapport à la représentation » 25. Et comme l’entreprise kantienne, la recherche foucaldienne vise à rapporter le savoir à ses conditions de possibilité a priori.
Dans son étude du chapitre VIII, sur les figures fondamentales du savoir moderne, Philippe Sabot montre comment Foucault achève l’analyse de la mutation du savoir qu’il avait entamé au chapitre VII. Il s’agit d’envisager la seconde phase de cette mutation, qui au début du XIXe siècle accomplit véritablement la rupture archéologique entre deux expériences historiques de l’ordre. L’économie politique, la biologie et la philologie ne s’inscrivent pas dans la continuité de l’analyse des richesses, de l’histoire naturelle ou de la grammaire générale, mais elles obéissent à un autre apriori historique, celui précisément qui renvoie leur constitution épistémologique à la dimension verticale de l’histoire et à l’horizon de la finitude humaine.
En faisant passer la coupure constitutive de l’éco politique entre Ricardo et Smith, Foucault récuse une lecture marxiste de celle-ci, il agit de la même façon pour l’histoire de la biologie avec la coupure entre Cuvier et Lamarck. L’apport de Ricardo par rapport aux analyses de Smith – et à l’analyse classique des richesses, réside dans la profonde modification du statut du travail. Selon Foucault, l’apport décisif de Smith était de faire du travail la mesure constante de la valeur d’échange. Mais, chez Smith, la limite est que les biens produits par le travail humain n’ont de valeur que s’ils sont intégrés dans le système représentatif (Foucault semble considérer cela comme le tribut de Smith à son épistémè) des échanges, autrement dit l’activité de production est assimilée à une marchandise échangeable, à acheter ou à vendre. Chez Ricardo, les choses ne tiennent plus leur valeur économique du fait qu’elles peuvent être échangées, vendues ou achetées, mais parce que les hommes les ont produites. Là est la césure capitale entre les deux réflexions sur le travail et, partant, sur l’économie. Le travail n’est plus une valeur d’échange, mais il fonde la possibilité de tout échange, sans être lui-même une valeur d’échange. De là découle le changement de statut de la rareté ; dans l’analyse classique des richesses, la rareté ne renvoie plus au décalage entre le désir naturel des hommes et sa satisfaction, mais elle définit désormais une « carence originaire » liée à « l’avarice croissante » 26 de la nature. Comme le commente Philippe Sabot, « Selon ce renversement complet de perspective, le travail humain résulte donc directement de cette insuffisance première des ressources naturelles et ne consiste plus tant à prélever, au gré des besoins, des richesses sur une nature généreuse qu’à tenter de surmonter leur fondamentale rareté » 27. Sans l’effort continu de l’homme, il serait voué à la mort. Ce renversement insiste sur dimension d’historicité et de finitude de l’homme, comme traits fondamentaux de changement d’ épistémè. Consécutivement, contre les marxistes, Foucault tente alors de réduire les positions de Marx et Ricardo à un simple choix d’options sur fond d’un système épistémologique commun et partagé. Ils appartiendraient à la même épistémè, même si leurs positions singulières divergent. Placée sous le signe d’une rareté fondamentale, l’histoire prend un sens différent chez ces deux auteurs. Chez Ricardo, le développement de l’histoire tend à compenser la finitude humaine en estimant que par la stabilisation démographique, la rareté se stabilise d’elle-même par l’exact ajustement du travail aux besoins (autrement dit la répartition déterminée des richesses). Chez Marx, en revanche, l’histoire accroît le décalage, la pression du besoin, parallèlement à la baisse du salaire des ouvriers, ce qui engendre un accroissement du profit, responsable de la naissance du prolétariat. Cela entraîne la prise de conscience par les travailleurs que leur aliénation n’est pas naturelle, et donc l’émergence d’un esprit révolutionnaire. Ricardo et Marx ne tiendraient pas le même discours, mais deux discours complémentaires sur le rapport entre histoire et finitude anthropologique. Mettant ainsi les analyses « bourgeoises » et marxistes de l’économie sur le même plan, cette relecture de l’histoire de l’économie prend une dimension polémique 28, renforcée par les formules par lesquelles Foucault enferme de façon provocante la pensée marxiste dans les bornes d’une épistémè ce qui prive de légitimité toute tentative d’actualisation de cette pensée 29. Avec la formule « aucune coupure réelle », Foucault semble rendre ses distances avec la thèse d’Althusser sur la « coupure épistémologique » grâce à laquelle Marx passerait de l’idéologie (dont le concept d’aliénation serait encore tributaire) à la science des transformations historiques des modes de production. Peut-être que c’est la tentative sartrienne de refondation du marxisme à partir de 1960, notamment dans la Critique de la raison dialectique 30 de Sartre qui est également visée.
Sur le même modèle, contestant aussi un discours admis et consacré, Foucault montre à propos de la biologie comment l’œuvre de Cuvier affranchit la subordination des caractères à leur fonction taxinomique – donc écart par rapport à l’âge classique. A partir de là, va se développer le thème d’une « historicité propre à la vie » qui est au cœur de la biologie moderne. Or, en insistant sur le rôle de Cuvier dans la rupture entre le savoir classique et la biologie moderne, Foucault revient sur le rôle de « précurseur » traditionnellement accordé à Lamarck dans la reconstitution historique de la théorie de l’évolution. A partir de Cuvier, la notion d’organisation qui était au cœur des travaux et de la méthode de ses prédécesseurs, et qui étaient utilisées pour classer, pour insérer un être vivant dans l’espace taxinomique, renvoie au rapport qui lie la structure organique à sa fonction. La diversité des structures renvoie à de grandes unités fonctionnelles, comme la respiration, la digestion qui animent le vivant et permettent de le différencier. De nouveaux rapprochements font sens. Par exemple, certains organes qui diffèrent quant à leur structure visible (les branchies et les poumons peuvent se ressembler du point de vue de leur fonction (la respiration). Cela induit des changements dans la notion même d’identité. Alors que l’histoire des sciences présente souvent le « transformisme » de Lamarck en rapport avec l’évolutionnisme de Darwin, en s’appuyant sur leur ressemblance, et en rejetant du même coup le « vieux fixisme » 31 de Cuvier, comme obsolète et dépassé, Foucault réévalue les apports respectifs de Cuvier et de Lamarck, en montrant que le second reste pris dans les limites d’une pensée du continu (Lamarck ne pense les transformations d’espèces que pour combler les écarts entre les extrémités du vivant), tandis que le premier s’affranchit de ce cadre en mettant en évidence la diversité et l’hétérogénéité des modes principaux d’organisation du vivant entre eux. Et d’après Foucault, cette prise en compte de la discontinuité est la condition nécessaire d’un pensée évolutionniste, puisque comme le dit l’auteur, « ne nouant le vivant sur ses propres conditions d’existence, elle ouvre la perspective d’une « historicité propre à la vie »32 »33.
L’analyse de l’évolution de l’étude du langage montre que ce dernier a cessé, à partir de la fin du XIXème siècle, d’être l’instrument du savoir empirique pour être à son tour « objet de la connaissance parmi tant d’autres » 34. La difficulté provient de ce que l’impensé du langage est en jeu dans la transformation par laquelle advient la philologie. Le langage ne se réduit plus à dire, de façon rigide et fixe, voire fixiste, l’être des choses, mais il acquiert un être propre déployé de façon temporelle. Il n’est plus un instrument au service de la représentation, mais un objet possédant son être et ses lois propres de fonctionnement et d’évolution (comme l’atteste l’importance de l’historicité du langage, comme de tous les nouveaux savoirs au XIXème siècle). La découverte du rapport fondamental de l’histoire au langage permet de renouveler la théorie des racines. Alors qu’on recherchait à remonter à une langue originale pour connaître le vrai nom des choses, l’étude du langage, vise à analyser non plus le lien qui permet au mot de représenter quelque chose du monde, mais l’altération des formes du point de vue de leur histoire particulière. La racine était auparavant envisagée comme ce qui était en quelque sorte le cri originel, prélinguistique, le radical est considéré comme « cette individualité linguistique isolable, intérieure à un groupe de langues et qui sert avant tout de noyau aux formes verbales. »35 Reprenant les analyses de Foucault sur la phénoménologie et le structuralisme – ainsi que le rôle de la figure de Nietzsche, l’auteur montre comment est rendue possible la « littérature », comme mode d’être du langage au-delà de son mode d’être significatif ou représentatif. « Contre-discours », comme la nomme Foucault, la littérature énonce l’être négatif du langage. Elle est ce qui rend possible à l’unité perdue du langage depuis la dissolution du discours classique. Pour Foucault, l’œuvre littéraire renouvelle le pensable 36. Comme le montre Philippe Sabot, la mise en perspective de Foucault à la fin du chapitre VIII clarifie les enjeux des deux derniers chapitres dans lesquels se trouve la thèse du livre sur les conditions d’apparition dans le domaine du savoir moderne de la figure de l’homme sur fond de disparition du discours dans le déclin de la représentation à l’âge classique.
Le chapitre IX (« l’homme et ses doubles ») met en place l’alternative entre le langage et l’homme, liée archéologiquement à la « mutation de l’analyse du discours en une analytique de la finitude » 37. L’auteur découpe en trois moments cette analyse.
D’abord Foucault souligne la fonction transitoire et intermédiaire de l’homme dans le cadre de l’ épistémè moderne. L’homme se donne comme figure qui trouve sa condition d’apparition dans la rupture de l’ordre classique du langage. Après la dislocation du langage dans le passage du Discours à la constitution de la philologie, l’homme vient occuper la place laissée vacante par la dislocation du jeu classique de la représentation. Du coup, on peut prédire que l’homme disparaîtra quand le langage retrouvera son unité, ce que la littérature, réunifiant le langage tend à opérer. C’est le cas de la situation actuelle, période dans laquelle la « mort de l’homme » et le « retour du langage » adviennent. L’homme n’est donné comme pensable en tant que tel que dans les limites de l’épistémè moderne, c’est-à-dire, comme le révèle le forage archéologique du philosophe, entre deux états du langage. Foucault écrit ainsi : « jamais dans la culture occidentale l’être de l’homme et l’être du langage n’ont pu coexister et s’articuler l’un sur l’autre. Leur incompatibilité a été un des traits fondamentaux de notre pensée » 38. Le projet d’une science de l’homme suppose la séparation de l’être et de sa représentation, dans l’héritage du criticisme kantien, « l’homme » n’existait pas avant le XVIIIème siècle. Cette assertion provocatrice s’explique, comme l’expose Philippe Sabot, si on l’entend précisément : dans l’ épistémè classique, l’homme n’a pas de place attitrée au sein du système de représentations. A l’image de la place du roi laissée vide dans le tableau de Vélasquez qui ouvre le livre, la place d’un sujet connaissant est, dans l’épistémè classique en dehors du champ. C’est seulement avec le savoir moderne qu’est rendue nécessaire la présence de l’homme comme intériorité, sujet, origine et fondement de tout savoir possible.
Puis l’analyse caractérise de manière positive cette figure moderne de l’homme et de son mode d’être. Dans le savoir moderne, l’homme se constitue comme pôle à partir duquel la vie, le travail et le langage peuvent accéder à leur représentation. C’est parce que l’homme peut se donner des représentations, en tant que sujet, qu’il devient objet d’étude. Le problème, c’est que si l’homme ne peut se penser qu’à partir de son être, tel qu’il lui est donné immédiatement dans l’expérience, il s’expose, comme le dit Foucault à être le « lieu de sa méconnaissance », car, écrit Philippe Sabot, « cet être empirique qu’il se propose d’élucider dans le mouvement de sa réflexion forme simultanément le socle impensé de cette réflexion » 39 C’est-à-dire que l’idéal cartésien, celui d’une transparence de soi à soi dans le geste du cogito ne fonctionne plus dans un monde postkantien dans lequel l’homme est en quête de conditions de possibilité de sa pensée. Montrant l’impossibilité de réactualiser le geste cartésien, Foucault pointe du doigt l’impasse de la phénoménologie, dans la version husserlienne, qui prétend réunifier le cogito et le motif transcendantal. Cette dernière, tentant d’élucider les fondements implicites de la subjectivité opérante ne fait finalement que confirmer la nécessité de « penser l’impensé » 40.
La fin du chapitre termine ce développement en comparant cette figure de l’homme avec ce qu’on en trouvait dans le langage classique et ce qu’on en trouve dans le questionnement contemporain, qui sert de base à la critique générale des « sciences humaines » qui se trouve dans le chapitre suivant.
Utilisant les analyses précédentes, Foucault questionne, au chapitre X, l’épistémologie des sciences humaines et leur prétention à fonder un discours vrai sur l’être empirique de l’homme. Critique, Foucault va montrer en quoi ces « sciences humaines » ne sont pas, à proprement parler, des sciences – et comment, en marge de celles-ci, se développent des formes de savoir et des formes d’expérience qui mettent en avant les conditions de la disparition de la dissolution de la figure de l’homme. En effet, pour Foucault, l’apparition de ces « sciences humaines » n’est pas due à l’achèvement des méthodes scientifiques pour connaître un objet déjà préalablement constitué, mais à une « redistribution générale de l’épistémè » 41 qui est étudiée depuis le chapitre VII. Ces sciences humaines ne sont pas réellement structurées par un tout unifié et homogène, mais procèdent d’une structure éclatée et dispersée autour d’axes directeurs que sont les sciences déductives, les sciences empiriques et la pensée de la finitude de l’homme. Les sciences de l’homme pour Foucault redoublent et parasitent les sciences de la vie, du travail et du langage, puisque ce qu’elles étudient, ce n’est plus ces objets ou ces processus, mais « la manière dont l’homme se représente ces fonctionnements (les lois vitales, les lois de l’échange, les lois linguistiques) à travers lesquels il s’apparaît à lui-même comme un être fini » 42. Dès lors, ce n’est ni l’homme en lui-même « ni ses purs fonctionnements (…) qui forment le champ d’analyse spécifique des sciences humaines, mais précisément l’homme en tant qu’il est capable de se représenter ses propres fonctionnements d’être fini » 43. Du coup, ces « sciences humaines » se définissent moins par leur objet qui serait l’homme, que par leur forme, celle d’un « redoublement », comme le dit le philosophe, de savoirs constitués qu’elles reprennent dans la dimension de la représentation. Parce qu’elles sont en retrait par rapport aux savoirs positifs, comme elles s’attachent à la représentation de ces derniers, elles ne sont pas à proprement parler des sciences. Elles sont sans objet positif, à la différence des sciences positives qui peuvent objectiver l’homme. Elles n’arrivent donc pas à se détourner du schème de la représentation, ce que les sciences objectives avaient réussi à faire.
Trois grandes régions correspondent au redoublement de la biologie, de l’économie et de la philologie : la psychologie, ou plutôt, une « région psychologique », qui correspond à la possibilité pour l’être vivant de se représenter ; « région sociologique », c’est-à-dire quand l’homo oeconomicus se donne la représentation de la société dans laquelle ce savoir contribue à objectiver son activité. Et enfin une région vouée à l’analyse des mythes et de la littérature.
La constitution de « contre-sciences » structurales, dont la particularité est qu’elles ne reconduisent plus le savoir à l’homme (leur objet impossible), mais à la dimension inconsciente de normes, de règles et de systèmes, est aussi expliquée par Philippe Sabot qui écrit : « C’est en effet dans la mesure où l’inconscient constitue la limite fondatrice de la représentation qu’il est à la fois au principe et à l’horizon de l’entreprise de dévoilement des sciences humaines » 44. Les sciences humaines vont du conscient à l’inconscient sans quitter la dimension de la représentation. Le rôle de la psychanalyse est tout à fait particulier, car elle achève et conteste du même geste l’entreprise des sciences humaines 45. La psychanalyse a une fonction critique au sein des sciences humaines, car se donne pour tâche de libérer l’analytique de la finitude de la sphère de la représentation. Elle a aussi une tâche de contestation car elle reconduit les sciences humaines à leurs propres limites, celle d’une anthropologie de la finitude qui cherche à se faire passer pour une science empirique de l’homme. De la même manière, l’ethnologie, sur laquelle s’appuie Foucault, celle principalement de Levi-Strauss, fait apparaître l’historicité comme l’impensé des cultures. Le problème de l’ethnologie n’est pas tant de rendre compte des représentations que les individus ont ou se font de leurs fonctionnements (biologiques, économiques, linguistiques) que de montrer à quelles conditions de telles représentations sont possibles, et par conséquent, sous quelles contraintes d’ordre inconscient (au sens non freudien d’un au-delà de la conscience qui fait que la conscience n’est que l’effet de cette structuration, d’un inconscient « culturel » en quelque sorte) et historique se déploie chaque manifestation culturelle, de telle sorte que le savoir ethnologique met en lumière l’historicité propre des cultures qu’elle analyse dans leur mode de structuration interne. Autrement dit, c’est toujours de l’intérieur d’une culture donnée, et en relation avec des objets historiquement déterminés que peuvent s’appliquer les sciences humaines. Du coup, la psychanalyse et l’ethnologie occupent une place à part au sein des sciences humaines, elles permettent de montrer comment les prétendues « sciences humaines » ne sont pas vraiment des sciences.
Dans le final des Mots et des choses, Foucault questionne le rôle de la linguistique structurale, qui loin de pouvoir prétendre achever les sciences de l’homme, invite au contraire, une nouvelle fois, à les déborder en les reconduisant à un autre « impensé » : un impensé du côté de l’apriori mathématique. Foucault montre que « la linguistique ne parle pas plus de l’homme lui-même, que la psychanalyse ou l’ethnologie » 46, mais qu’elle vise à mettre en évidence un inconscient par voie d’une formalisation. Aussi la « mort de l’homme » thème hérité de Nietzche, évoqué dans les dernières pages de l’œuvre et qu’on a particulièrement retenu du livre de Foucault, prend la forme d’une absolue dispersion imposée par le nouveau mode d’être du langage « tel que le réfléchit, sur le plan de l’expérience, la littérature contemporaine et tel que l’analyse, sur le plan formel, la linguistique structurale » 47.
En conclusion, Philippe Sabot voit Les Mots et les choses comme un livre de rupture. D’abord, P. Sabot relève la fonction critique du livre déterminé par un certain nombre de refus (thématiques et méthodologiques) : contre ce qu’il appelle l’ « anthropologisme » (figure omniprésente de l’homme dans les sciences humaines, mais que ces dernières sont incapables de fonder), contre l’histoire des sciences et le présupposé d’un progrès continu des sciences vers la vérité ; progrès lié à un mouvement historique de rationalisation d’une objectivité préexistante et stable (par opposition à l’épistémè). Puis, P. Sabot précise comment l’archéologie devient le point de départ d’une nouvelle façon de philosopher chez Foucault, au sens où la question de la vérité relative à une épistémè, est reprise dans l’ « ordre du discours ». Comme l’écrit Philippe Sabot, avec Les Mots et les choses, on glisse « d’une archéologie des savoirs et de leur constitution intradiscursive vers une analyse généalogique des pratiques (discursives et non discursives), de leur transformation. » 48
L’ouvrage ne finit pas à la conclusion, puisqu’il propose un résumé de la seconde partie des Mots et des choses, un Glossaire de sept termes importants et d’abondantes et précises indications bibliographiques. Il est à noter que Philippe Sabot nourrit de véritables débats sur tel ou tel point précis en notes de bas de pages, contre telle ou telle interprétation, dans un contexte expliqué et justifié. Si le parti pris de ne s’intéresser précisément qu’à la seconde partie de l’ouvrage est discutable – puisque la première est également philosophiquement remarquable – l’explication en est détaillée dans une visée à la fois pédagogique (puisqu’on comprend ce que Michel Foucault dit précisément, pourquoi il le dit et ce qu’il tente ainsi de prouver) et universitaire, puisqu’il inscrit les analyses de Foucault dans leur contexte politique, voire polémique, et montre les difficultés et les ambiguïtés d’interprétation. Si l’on devait trouver à redire à propos de l’ouvrage de Philippe Sabot, on pourrait regretter l’absence de réflexion sur l’héritage des Mots et des choses. Il étudie tout à fait précisément ce livre, en montrant pourquoi et comment ce qui est écrit l’est, mais il n’ouvre pas sur la suite du parcours philosophique foucaldien, sourd, en cela, à la « généalogie » qui remplacera rapidement l’archéologie — les différences entre les deux méthodes auraient pu mieux permettre de voir ce qui faisait la singularité de l’archéologie, et aux différents échos que rencontreront les thèmes qu’il aborde dans Les Mots et les choses dans ses cours au Collège de France.
- Philippe Sabot, Lire Les mots et les choses de Michel Foucault, PUF, Quadrige manuels, avril 2014 pour la seconde édition.
- On trouve un résumé thématique dans grand nombre d’ouvrages qui se veulent une présentation faisant ressortir la cohérence de la pensée de Foucault, insistant aussi bien sur la continuité de la pensée (Michel Foucault et l’histoire du sujet en occident, Franck Evrard, Bertrand-Lacoste 1995, Paris) ou sur sa discontinuité (Judith Revel, La pensée du discontinu : introduction à la lecture de Foucault, Mille et une nuits, 2010)
- Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 1966.
- Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 1969
- Philippe Sabot, Lire Les mots et les choses de Michel Foucault, PUF, Quadrige manuels, avril 2014 pour la seconde édition, p. 5.
- F. Evrard, Op. cit. p. 29.
- L’histoire comme progrès, comme marche vers un savoir de plus en plus vrai et de plus en plus scientifique.
- Au sens de la « table » kantienne des catégories dans l’analytique transcendantal Critique de la Raison pure.
- Philippe Sabot, op. cit. p13
- Ibid. p16.
- Que Philippe Sabot définit ainsi précisément dans le Glossaire en fin d’ouvrage comme « l’ensemble des règles qui conditionne, pour tous les discours d’une époque donnée, la formulation de leurs objets, la définition de leurs concepts, l’élaboration de leurs méthodes ainsi que la forme de leur vérification. »Ibid. p. 205.
- Philippe Sabot Ibid. p. 20
- Philippe Sabot Ibid. p. 23
- Ce que Foucault lit comme le retrait du savoir en dehors de la représentation
- Philippe Sabot, Ibid. p. 27
- Qu’on peut ainsi résumer : L’analyse commence par une étude du tableau des Ménines de Velasquez au chapitre I qui montre qu’une épistémè ne peut jamais réfléchir sur ses propres conditions de possibilité. Elle se poursuit au chapitre II avec l’analyse de l’épistémè de la Renaissance. Elle se définit par quatre modalités du savoir de la ressemblance. Ce qui est capital, c’est que l’homme occupe une position centrale à l’intersection des microcosmes et des macrocosmes. Il s’agit de lire le livre de la nature, le langage comme chose naturelle. Aux chapitre III, IV, V, VI : « représenter », « parler », « classer », « échanger », Foucault analyse l’épistémè classique qui associe à des ordres empiriques, langage, nature et échange des positivités identifiables : grammaire générale, histoire naturelle, analyse des richesses. On passe ainsi de la Renaissance à l’âge classique, de la quête des similitudes à la mise en ordre et à l’analyse des différences : il s’agit d’assurer la transparence des choses aux mots qui les nomment, de penser histoire naturelle comme articulation discursive de la structure visible et classification des êtres naturels comme une « langue bien faite » et de mettre à l’œuvre une correspondance entre le domaine du langage et le domaine des richesses : la monnaie peut représenter plusieurs choses équivalentes, comme un nom a le pouvoir de représenter plusieurs choses ou le caractère taxinomique celui de représenter plusieurs individus, plusieurs espèces, plusieurs genres.
- Philippe Sabot, Ibid. p45
- Ibid. p46. L’histoire désigne à présent la loi intérieur du développement des choses et plus seulement altérations et accidents extérieures aux choses. L’histoire a dans la modernité un double statut : elle est d’une part une science empirique comme les autres et de l’autre un mode d’être fondamental de l’empiricité, c’est-à-dire un élément transcendantal de tout savoir possible. Foucault s’attache d’abord à faire apparaître les mutations qui touchent les différents savoirs empiriques lorsque ces derniers deviennent soumis au mode d’être de l’histoire, avant de montrer la manière dont ces savoirs eux-mêmes sont pris dans une équivoque qui tient à la position ambiguë de l’homme, « cet être tel qu’on prendra en lui connaissance de ce qui rend possible toute connaissance » 18Ibid. p. 48
- Ibid. p49
- Le « nous » dans le livre signe d’appartenance historique de Foucault. Il ne surplombe pas son sujet, mais s’ancre dans son analyse.
- Michel Foucault, Les Mots et les choses, Op. Cit. p240
- M. Foucault, Ibid. p. 253
- Ph. Sabot, Op. Cit, p. 68.
- M. Foucault, Ibid. p. 258
- M. Foucault, Ibid. p268
- Ph. Sabot, Ibid. p80
- Foucault écrit ainsi (Ibid. p273) : « Mais peu importe sans doute l’alternative entre le « pessimisme » de Ricardo et la promesse révolutionnaire de Marx. Un tel système d’options ne représente rien de plus que les deux manières possibles de parcourir les rapports de l’anthropologie et de l’Histoire, tels que l’économie les instaure à travers les notions de rareté et de travail. »
- « Au niveau profond du savoir occidental, le marxisme n’a introduit aucune coupure réelle ; il s’est logé sans difficulté (…) à l’intérieur d’une disposition épistémologique qui l’a accueilli avec faveur (…). Le marxisme est dans la pensée du XIXème siècle comme un poisson dans l’eau : c’est-à-dire que partout ailleurs, il cesse de respirer. » Foucault, Ibid. p274
- J.-P. Sartre, Critique de la raison dialectique, Gallimard, Paris, 1960
- M. Foucault, Ibid. p. 287.
- M. Foucault, Ibid. p. 288
- Ph. Sabot, Ibid. p. 96
- M. Foucault, Ibid. p. 309
- M. Foucault, Ibid. p. 308
- Philippe Sabot insiste tout particulièrement sur l’importance de la littérature pour montrer les limites du savoir chez Foucault ; en cela il distingue le geste nietzschéen qui assigne au langage la possibilité de mettre en évidence les limites d’un système, quand, chez Kant, cherche les conditions formelles de la validité de son universalisation. Voir en particulier : Lectures de Michel Foucault, sur les Dits et Ecrits volume 3, ENS éditions, 2003, « la littérature aux confins du savoir : sur quelques dits et écrits de Michel Foucault », Philippe Sabot, tout particulièrement p23.
- M. Foucault, Ibid. p350
- M. Foucault, Ibid. p350
- Ph. Sabot, Lire les mots et les choses de Michel Foucault, Op. Cit. p. 134.
- Ph. Sabot, Ibid. p. 338. De la même façon, l’auteur montre comment pour Foucault Heidegger remplit le programme de la pensée moderne comme celui d’une élucidation du fondement de l’origine, dans la mesure où le Dasein rend compte de par sa structure et son mode d’être du rapport de l’être au temps.
- M. Foucault, Ibid. p. 356
- Ph. Sabot, Ibid. p. 154
- Ibid.
- Ph. Sabot, Ibid. p. 164
- Philipe Sabot écrit ainsi : « « d’une représentation consciente des significations du langage, elles remontent donc à la représentation du système-inconscient qui la rend possible. L’inconscient, c’est en quelque sorte tout ce qui fait que la représentation consciente s’échappe à elle-même mais du dedans d’elle-même : c’est l’élément de ce qui est représentable sans être actuellement représenté. »Ibid. p. 165
- M. Foucault, Ibid. p. 393
- Ph. Sabot, Ibid. p182
- Ph. Sabot, Ibid. p191







