Les éditions PUF viennent de publier un ouvrage de philosophie appliquée à la sphère de la médecine concrète, dans la collection Quadrige, essais et débats1. Le premier thème abordé concerne la médecine et la place donnée à la relation humaine dans le milieu médical ; l’ouvrage réalisé sous la direction collective de Daniel Couturier, Georges David, Dominique Lecourt, Jean-Daniel Sraer et Claude Sureau, et intitulé La mort de la clinique, offre une succession d’interventions prononcées lors d’un « séminaire de réflexion sur le devenir de sciences contemporaines dans la tradition française qui unit histoire et philosophie des sciences, sans oublier éthique, juridique et politique »2, interventions qui eurent lieu au centre Canguilhem à l’Université Paris Diderot et à l’Académie de Médecine. A travers ce colloque, les différents intervenants, au nombre de neuf, exposent leur vision de la place aujourd’hui accordée à la clinique – soit à la complexe relation entre le soignant et le soigné – dans une médecine moderne, révolutionnée par l’apparition, voilà 60 ans, des examens complémentaires.
A : Emergence de la clinique
La primauté de la clinique – cette relation médecin-malade indispensable à tout soin – est mise en avant par l’ensemble des intervenants et ce, quel que soit leur métier ou leur spécialité médicale. L’étymologie du mot clinique, kleinen, signale d’abord qu’ « il s’agit d une activité qui s’exerce au chevet du lit du malade »3 ; ainsi, « elle est une activité totale, une réponse à un appel qui est la source de la vocation de la médecine »4. L’histoire de la clinique, retracée à plusieurs reprises, nous rappelle que, si la clinique est pratiquée depuis Hippocrate, elle ne prend une place vraiment importante en médecine qu’au XIXème siècle, lors de la révolution médicale de l’école de médecine de Paris où, pour la première fois, des autopsies sont réalisées afin de relier symptômes et dommages d’organes, le tout permettant d’obtenir « l’analyse objective des causes des symptômes que présentent les malades »5
Dans un même temps, l’invention du stéthoscope par Laennec en 1817 fit basculer la médecine dans un nouvel univers rendant soudain l’intérieur du corps accessible. Ces nouvelles connaissances arrachèrent le médecin à ses suppositions, encore trop hypothétiques, pour l’amener vers une vérité plus élaborée ; ce n’est donc pas avant le XIXème siècle que la clinique est apparue comme une valeur indissociable de la médecine, et indispensable à son exercice. Simultanément, la clinique apparaît comme « indissociable de la thérapeutique ». En plus de cet historique, certains des Professeurs Universitaires et Personnels Hospitaliers (PU-PH), responsables par ce titre de l’enseignement dispensé aux externes et internes, rappellent la formation suivie par chaque étudiant en médecine, formation qui prouve que la clinique est au cœur de la médecine : commencée des la seconde année par un stage infirmier et des stages de sémiologies, « première approche clinique de l’étudiant »6, elle se poursuit par trois années de stages hospitaliers, sanctionnées a chaque fois par des épreuves pratiques et théoriques… L’internat, lui, se compose de six à dix semestres, ce qui fait au total que chaque médecin, quand il arrive à son poste de senior (médecin thèsé), a pratiqué un minimum de huit ans de clinique.
B : La clinique aujourd’hui
L’évolution historique de la clinique, ainsi que la situation contemporaine, démontrent qu’il est absurde de parler de « la mort de la clinique » dans l’exacte mesure où la formation de l’étudiant est aujourd’hui fondée en grande partie sur ladite clinique. On ne saurait dire non plus que le jeune médecin ne sait plus interroger ou écouter, dans la mesure où, au cours de ses quatre premières années de formation, son rôle se limite justement à apprendre à interroger et à entendre la plainte du malade, même si certains des intervenants constatent que l’interrogatoire moderne, mécanique et réducteur, limite la parole et impose au malade une autocensure, celui-ci ne cherchant plus à décrire ses symptômes mais simplement à répondre aux questions posées. « Que signifie le terme d’interrogatoire, se demande ainsi Alain-Charles Masquelet, quand il s agit, pour un individu, de répondre à une sollicitation imposée, sans possibilité réelle de s’exprimer ? »7
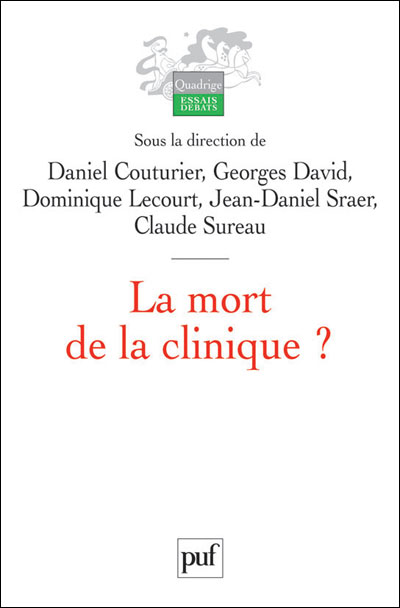
Il apparaît donc que, pour la majorité des auteurs de ce livre, de droit la clinique ne saurait disparaître, en dépit de certaines erreurs de fait qui ont pu être commises, et qui ont amené, aux yeux de certains, la clinique au bord du précipice. Toutefois, chacun considère qu’elle est en droit indissociable de la médecine et de l’offre de soins ; aujourd’hui, peu de médecins iront établir un diagnostique grave par le simple regard ou le toucher (les cinq sens qui, autrefois, étaient seule source du diagnostic), non par incapacité mais tenus par l’obligation d’offrir les meilleurs soins possibles sans faire perdre les chances de guérison à leur patient ; le patient lui-même serait choqué si aucun examen ne lui était prodigué ; et le simple regard extérieur, la description à la troisième personne, ne peut expliquer le mal intérieur, beaucoup de symptômes n’étant spécifiques à aucune maladie, ce qui rend impossible la discrimination par la simple observation. L’absence d’examens complémentaires reviendrait à traiter la maladie du patient de manière aléatoire et donc à faire perdre des chances de survie et de guérisons à ce dernier. Il est indiscutable que la clinique demeure la base de la médecine ; elle permet de distinguer les urgences, d’orienter vers un diagnostic précis, et c’est elle qui, également, détermine les examens complémentaires à mener par la suite, examens qui sont évidemment orientés par la sémiologie clinique8 et non pas menés au hasard. « Cette médecine par les preuves est fondée par des décisions diagnostiques ou thérapeutiques à partir de preuves objectives »9
C : Le patient au cœur des examens complémentaires
Depuis 1950, l’apparition des examens complémentaires est dénoncée comme étant responsable de la disparition de la relation de confiance entre le soignant et le soigné, le médecin considérant désormais que la parole du malade est trop subjective et sans valeur par rapport à l’objectivité des examens biologiques et liés à l’imagerie. Pourtant, en y regardant mieux, les examens complémentaires ne font pas disparaître la clinique mais la renforcent ; c est elle qui guide les choix des examens à mener, c’est elle qui oriente, amène les décisions, fait agir dans l’urgence ou permet de différer les soins et de réorienter vers un généraliste en ville : c’est pourquoi, « la clinique repose sur ses deux jambes puissantes que sont l’imagerie et la biologie »10
L’imagerie médicale – Radio, IRM, TDM, Echographie – et l’ensemble des examens biologiques, permettent de poser un diagnostic plus précoce, plus précis, et parfois aussi d’agir dès l’origine de la maladie, avant que celle-ci ne se déclare par des symptômes importants, rendant ainsi traitement et guérison plus accessibles… Loin de supplanter la relation entre le médecin et le malade, ils donnent davantage de chances au patient de guérir ; ainsi un cancer peut être repéré et / ou traité sur une simple modification du marqueur biologique ; un cancer devenu bruyant, c’est-à-dire cliniquement visible, sera comparativement, toujours plus lourd et long à guérir. De même, les nouveaux moyens de communications permettent d’obtenir un plus grands nombre d’avis de spécialistes pour une maladie donnée ; n importe quel malade pourra être soigné par les meilleurs médecins en exercice : « la télé-manipulation nous aide à mieux faire, n’en déplaise aux traditionnalistes en mal de passé glorieux »11. Mais, par la suite, aucun examen ne vaudra la relation de confiance qui s établit avec le malade… La clinique n’est perçue par beaucoup que comme la simple relation entre deux individus alors qu’elle s inscrit au contraire dans l’ensemble du processus thérapeutique, et irrigue de ce fait un champ bien plus vaste. Il faut ainsi renoncer à l’idée d’examens secondaires faisant du malade un être sans âme ou sans valeur pour le médecin ; bien au contraire, loin d’être un simple objet de soins, le malade devient, grâce aux examens secondaires, objet d’un certain bien-être ; bref, « d’objet de soin, l’homme devient sujet de sa santé et de son bonheur »12
La clinique de l’individuel est l’outil majeur pour étayer les stratégies de soins; sans elle, le processus de prise en charge médical ne pourrait se faire de manière satisfaisante ; il est donc a priori hors de propos de parler de sa disparation.
En somme, au cours de ce colloque, la majorité des intervenants expliquent que, à leurs yeux, la clinique n’a pas disparu mais s’est modifiée et a évolué afin d’intégrer les examens biologiques et l’imagerie médicale, offrant ainsi au patient une médecine de pointe ; la clinique a évolué pour se limiter en urgence à une simple anamnèse permettant d’orienter le médecin et de décider des examens complémentaires nécessaires, qui ne viendront la plupart du temps que confirmer l’hypothèse-diagnostic émise grâce à la sémiologie ; mais actuellement, plus aucun diagnostic grave ne pourra se passer des examens complémentaires, non par incompétence du médecin, mais par obligation liée au code de déontologie médicale. Les soins donnés doivent être la plus performants et en accord avec les progrès de la science médicale13.
Conclusion
En conclusion, je dirai que la clinique, en tant que relation médecin-malade, « discussions, intimité et écoute », a toujours lieu. Si les nouveaux examens médicaux ont appris à nous appuyer sur les examens, il nous a été enseigné tout au long de notre formation l’importance de l’écoute du patient, comme celle du dialogue. Instaurer une relation de confiance est primordial dans le déroulement des soins. Un médecin optimiste et confiant obtiendra de meilleurs résultats qu’un médecin peu à l’écoute, distant, et pessimiste. Il n’y a donc pas de véritable éloignement du médecin par rapport au lit du malade et l’interrogatoire demeure le premier geste pratiqué devant tout patient ; la mort de la clinique apparait être une simple question rhétorique pour les spécialistes issus du milieu médical ; il est indéniable qu’elle a changé, évolué, mais on ne peut comparer la clinique et la médecine d’avant guerre, celle-ci étant le plus souvent un simple accompagnement palliatif, celle-là ayant été révolutionnée par les antibiotiques, les vaccins et autres drogues pro biotiques. Il ne faut pas oublier que cette notion de « clinique » est récente puisqu’elle est apparue en 1969 ; on peut donc renoncer à ce terme sans que, pour autant, dans la pratique, cet abandon ne soit effectif. Le regard et l’interrogatoire constituent une part essentielle de la consultation médicale et cela est bien antérieur à l’utilisation du terme même de « clinique ».
Si l’ancienne médecine, fondée sur les cinq sens, a permis d’offrir des découvertes réelles, elle a durant des siècles simplement pallié la maladie ; la compréhension du corps humain dans son entier, la fin de son opacité et les dosages biologiques ont certes modifié et raccourci ce temps de l’interrogatoire, mais ont permis de guérir, de prévenir et d’accompagner le malade dans toutes les étapes de la maladie, et de limiter le risque de rechute ou de récidive. La clinique est loin d’être morte, la relation entre le soignant et le soigné aura toujours sa place en médecine, particulièrement en psychiatrie ou aucun médicament ne permettra de guérir par lui-même. Le malade demeure un individu à part entière, il n’est pas écrasé par le développement des nouvelles techniques médicales et conserve sa place centrale au cœur du processus médical.
Ce collectif s’avère donc de bonne tenue, mais on regrettera toutefois l’aspect parfois excessivement normatif de certains discours d’auteurs pourtant extérieurs à la pratique médicale, affirmant de manière par trop théorique le primat de la parole au détriment des soins ; saluons néanmoins l’initiative du dialogue entre médecins et philosophes autour d’un sujet aussi décisif que celui de la clinique, dialogue permettant de mesurer la difficulté de parler d’un même objet selon les différentes disciplines, mais aussi d’évaluer le besoin pour les philosophes d’acquérir une connaissance de la pratique médicale afin d’éviter tout discours purement rhétorique, et pour les médecins de réfléchir leur propre pratique à l’aide de concepts opératoires.
- Daniel Couturier, Georges David, Dominique Lecourt, Jean-Daniel Sraer, Claude Sureau (dir.) : La mort de la clinique ?, PUF, coll. Quadrige, 2009
- Ibid. p. 7
- Ibid p. 30
- Ibid.
- Ibid. p. 66
- Ibid. p. 128
- Ibid. p. 33
- Ensemble des signes cliniques menant vers un syndrome.
- Ibid p. 66
- Ibid. p. 119
- Ibid. p. 68
- Ibid. p. 80
- Il faut également tenir compte de l’apparition du « Dr Google » transformant au quotidien l’attente du patient lorsque ce dernier se présente face à son médecin ; en effet, beaucoup d’entre eux estiment savoir ce dont ils souffrent, et réclament certains examens précis, bouleversant ipso facto les rapports entre soignant et soigné.







