Gérard Bensussan : Autour de Les deux morales (partie 1)
AP : Vous soulignez l’importance de l’extrapolitique et de l’extra-philosophique dans vos travaux et vos réflexions. Vous évoquez la lecture de Dickens comme prise de conscience de votre judaïsme dans une de vos interventions sur Heidegger, vous citez Philip Roth sur cette même question du judaïsme, et vous avez, très récemment, consacré un livre à Proust (L’écriture de l’involontaire. Philosophie de Proust, Classiques Garnier, 2020). Quelle est l’importance, pour vous de la littérature ? Quel rôle peut-elle jouer pour la philosophie ? Est-ce en voyant Hegel, notamment dans ses Cours d’esthétique, inclure et intégrer des œuvres littéraires immenses et incontournables, que vous avez cherché dans la littérature de quoi, à nouveau, sortir de Hegel ?
GB. On peut déterminer la relation qu’entretient la philosophie, telle ou telle philosophie, et même tel ou tel philosophe, à la littérature de multiples façons que je ne peux pas exhaustivement examiner ici. La question est gigantesque, et elle a à voir avec la façon dont la philosophie se rapporte à ce qui n’est pas elle, la politique, nous en avons parlé, la science, l’art, etc. Pour essayer de vous répondre je m’arrêterai sur un biais, qui est loin d’être le seul ni forcément le meilleur. Mais je m’y arrête parce qu’il m’importe particulièrement, parce qu’il révèle quelque chose de mes propres positions philosophiques, quelque chose que j’en ignorais moi-même et qui s’énonce dans des textes qui n’ont rien à voir avec la philosophie, selon une hétérogénéité qui n’est pas sans rappeler celle du grec et du biblico-hébraïque selon Levinas, du logos et de la narration.
Je dirais la chose suivante, en manière de thèse générale : la littérature fictionne le réel selon une mimétique « réelle » du réel, en excès sur son « sens ». La littérature n’a jamais à faire qu’à des événements, réels ou fictifs, le plus souvent réel-fictifs -on peut se rapporter aux débats ouverts il y a une cinquantaine d’années autour de S. Doubrovsky et de l’« autofiction ». Son élément, c’est le mentir-vrai d’Aragon ou ce que Proust appelait d’une formule saisissante « le romanesque vrai ». La littérature n’a jamais à faire à des possibilités logiques, sauf à les traiter à leur tour comme des événements extra-logiques, chez Borgès par exemple. La « dure réalité » de la fiction fait événement -dans le roman en particulier, et ce faire-événement n’est pas soumis à la simple dichotomie du réel et de l’inventé, du vrai et du faux. Il précède l’analytique qui, après-coup, pourra en fournir les, ou des, significations. Sans compter que parfois cette analytique fait elle-même corps avec la narration. Ce que j’appelle ici événement recoupe ce que j’ai déterminé ailleurs, s’agissant plus précisément de Proust, comme « involontaire ». Cette subordination du sens à ce qui le détermine, événement, involontaire, corps, pulsion, affects, mémoires, le roman en montre les innombrables combinaisons chimiques, selon l’idée goethéenne d’affinité élective. Les écritures romanesques, il faudrait dire les choses autrement pour la poésie, encore que Proust rangeait ces attractions et affinités sous la rubrique de ce qu’il appelait « connaissance poétique », mais au sens large -l’écriture littéraire, donc, décrit l’effet, elle le montre, l’inscrit, l’ex-scrit, sous toutes ses coutures, avant la cause – mais il ne s’agit plus alors ni d’un effet ni d’une cause, toute causalité linéaire est invalidée, et toute explication « psychologique » aussi, dans la foulée. Qu’on se souvienne de la première phrase d’Albertine disparue : « Comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie ! ». Cet entraînement vers un plus-loin-que est la marque de la littérature. Souvent, elle va aussi plus loin en philosophie que la philosophie.
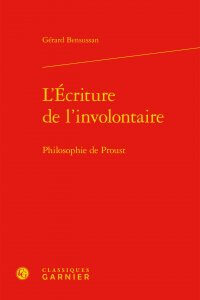
La littérature, l’art en général, vient avant la philosophie, tout comme le réel vient avant sa possibilité. La tradition métaphysique, depuis Aristote, détermine le réel comme actualisation du possible. Ce qui est logique. Logiquement, le réel semble présupposer un possible qui le précèderait. En réalité, c’est l’inverse. Le réel est proprement impossible avant d’être, car il précède toute possibilité, il la pré-vient, il la sur-prend, il forme une « effectivité qu’aucune possibilité ne précède », un « exister imprépensable », selon les mots de Schelling. C’est cela, l’événement qui est le matériau de la littérature, des histoires, mythologies, révélation, aggadoth, récits en tous genres qui traversent l’espèce humaine en entier et depuis toujours. Ces histoires ne sont pas anticipables, elles ne s’expliquent pas, elles se montrent, elles se racontent et sur-prennent toute prise par le concept.
il n’y a pas de causalité dans l’écriture d’un roman, les choses, les affects, les personnages, leurs relations, se présentent selon un ordre qui est celui des perceptions, des sensations et des impressions, partielles, latérales, multiples. Comme dans nos existences, que la philosophie entend souvent purger, les illusions de tel protagoniste, ses croyances, ses erreurs de jugement, ses entêtements et sa bêtise, ou bien au contraire sa subtile intelligence des choses et des êtres, tout cela, ce chaos bariolé de différences, de nuances ou d’énormités, n’est pas causalement élucidé, logiquement exposé, soumis aux concaténations de la clarification démonstrative. Les obscurités jouent un rôle qui n’est jamais inférieur à celui des grandes clartés. L’opacité ne nuit pas au roman, elle en épaissit la vérité.
Car il y va en fait de la vérité, de son statut et de son essence. Elle forme les multiples inter-facettes, si je peux me permettre ce mot-valise, du philosophique et du littéraire, entre vérité neutre des énoncés dogmatiques et vérité douloureuse des affects. Une pensée peut être fausse. Une sensation jamais, une impression du corps non plus. Contrairement à ce que prétend la tradition philosophique dominante, les sens ne mentent pas dans un roman, « jamais de la vie ». Ils peuvent bien amener à errer, à se perdre, mais ces chemins et labyrinthes sont véridiques. C’est qu’il n’y a de vérité qu’individuelle, ce qu’on peut lire chez d’innombrables écrivains, Rousseau, Stendhal, Flaubert, Dostoïevski, Proust – d’où la nécessité du roman, en quelque sorte. Cette proposition, elle-même très générale, n’invalide en aucune façon la vérité universelle, la vérité des philosophes. L’écriture romanesque permet à la fois de s’y adosser comme à son être, sans avoir à l’interroger, et de montrer, de décrire, comment son apparaître ne relève pas d’une dogmatique générale, ce qui serait « mensonge » -mais d’une polyphonie, d’une dissémination, voire d’une prolifération, parfois « chaotique ». L’énigme est la règle. Par exemple, Alvan Hervey, dans Le retour de Joseph Conrad[1], se trouve placé devant une énigme absolue lorsque sa femme, tentée de partir avec un autre homme, revient au domicile conjugal. Ce qu’a fait ou voulu faire sa femme est si étranger à tout ce qu’il sait d’elle, à tout ce qu’il croit savoir de cette créature prévisible et docile, qu’il se sent démuni, confronté à une incompréhension absolue, un abîme, sans avoir jamais pu soupçonner l’existence de cet abîme –qui n’est pas seulement celui de l’incompréhension devant l’infidélité et la trahison, mais l’abîme de l’existence, le vertige de l’altérité incompréhensible, imprenable. « Quoi de plus fantastique et de plus inattendu que la réalité ? », s’exclamait Dostoïevski. Réalité signifie ici événement advenant sans prévenir, prévenant au contraire sa propre possibilité, je le répète.

Quand je dis que la philosophie vient après la littérature, je ne dis pas que la littérature en serait la condition de possibilité, ce qui serait idiot, mais qu’elle nous rappelle qu’il y a foncièrement des « expériences préphilosophiques », comme disait Levinas. Elle est comme le memento du vieux deinde philosophari. Philosopher après, primum vivere : avant le philosopher, vivre, jouir, manger, faire des « expériences » tant heureuses que terrifiantes, aimer, mourir. Cette précession, et la conscience vive qu’en prend l’écrivain, souvent, l’engage dans un travail d’urgentiste. Sa première tâche est de capter, de scripter, de fixer ce qui se présente à lui comme événement unique, irrépétable, voué sans lui à la perte pure et simple, à l’effacement définitif. Le bonheur de l’écrivain est proportionnel à ce qui, de ce réel, est par lui retrouvé, sauvé, ramené au jour – voir la correspondance de Flaubert par exemple. Même lorsqu’il paraît plus systématisé, comme dans Les Caractères de La Bruyère, mais on pourrait dire la même chose du Dictionnaire des idées reçues ou de Bouvard et Pécuchet, ce geste de sauvetage est intimement attaché à la caractérisation de tout ce qui particularise selon la circonstance, l’état social, les relations, les parlers, les paysages et la puissance des noms, les affects bien sûr ; et ces particularisations sont déployées à l’infini de leurs multiplicités, à chaque fois irréductibles. Je crois qu’on peut dire – je suis obligé de parler de façon très générale- que la littérature, dans le réel qu’elle fictionne en le réalisant, dans son avant-la-philosophie, nous met continûment devant des « expériences » de déprise, de relâche, d’involonté, d’abandon, elles-mêmes plus vieilles que toute patience du concept.
Proust décrit toute une série d’expériences de ce type, d’expériences de « laisser aller », dit-il, qui sont autant de formes d’un conatus interruptus – que la littérature permet d’informer. « La tendance de tout ce qui existe à se prolonger », je le cite encore, s’abandonne à une sorte de délectation impulsive, d’involonté, où le moi se défait : on dépense son argent d’un seul coup, on cesse un traitement médical, on ne se prive plus de tout ce dont on se privait, etc. On se laisse aller et c’est un délice. Les interruptions de la persévérance dans l’être font du bien. Que le conatus se laisse interrompre montre qu’il n’y a pas de conatus originaire. L’intérêt de ces descriptions proustiennes de l’involonté, et il est « philosophique » sans jamais être philosophique, c’est qu’elles destituent le conatus de toute naturalité. Ce qui est naturel, c’est de se laisser aller à une force qui va à même le soi inerte : la passivité plus passive que toute passivité est mille fois plus « naturelle » que la persévérance en soi qui est tension, action, effort, comme le dit le mot latin. « il faut », dit Levinas – qu’une justice se reprenne par un effort sur soi dépassant et assumant l’éthique. 0n pourrait dire : il faut le conatus. Mais puisqu’il a été interrompu, il n’est pas le conatus. Il y a le conatus, mais il n’y a pas pas de concept originaire du conatus. Je retranscris et, retranscrivant, je perds la littérature. Mais il me faut bien essayer de vous répondre. Cet effet de dépossession heureuse, ce conatus interruptus, Montaigne en a donné la formule, en en rapportant ce qu’il appelle à son tour les « expériences » les plus diverses : « je m’échappe », écrit-il, mon Je m’échappe et, s’échappant, il retrouve sa liberté en quelque sorte. Je ne dépends pas de moi, de mon moi, de mon conatus. Cela, cette approche, de ce que peut bien être par exemple une liberté hétéronome, comme dit Levinas, la littérature a le pouvoir infini de le transmettre.
AP : Vos exemples sont très clairs, et je vous en remercie. La littérature serait ainsi, si je comprends bien, non seulement un partenaire légitime du dialogue que doit mener la philosophie avec ce qui n’est pas elle, mais aussi, d’une certaine façon ce à partir de quoi la philosophie est possible, et même ce qui toujours témoigne d’une expérience intotalisable, inintégrable à un quelconque système, irréductible aux seules logiques à l’œuvre dans les raisonnements philosophiques, ce qu’Y. Bonnefoy appelle « mensonge du concept en général »[2], qui trahirait la réalité en en effaçant à la fois la singularité et ce que vous avez appelé le « plus loin que » et « l’excès » de l’événement littéraire. Il y aurait alors dans le proprement littéraire l’advenue de ce que le sujet autonome et auto-fondé de la philosophie classique ne peut pas s’approprier, d’un imprévisible sur quoi il ne pourrait avoir de maîtrise, et qu’il ne pourrait faire entrer dans aucune catégorie. Et cela se traduit par un autre conatus que le conatus essendi, classique dans la philosophie traditionnelle, le conatus interruptus, qui fait voir que le modèle classique du conatus essendi, héritée de la physique, et relativement prévisible, est un modèle qui ne rend pas compte de ce qui de la vie réelle n’est pas réductible à une explication philosophique – là où la littérature s’y essaie. Cela expliquerait-il, à votre avis, le travail ou la richesse extraordinaire de la langue des auteurs que vous mentionnez : Flaubert, Proust et Montaigne, mais également Levinas ? Les ébauches de roman de Levinas pourraient-elles être lues comme des témoignages d’une volonté de rendre compte, autrement que par la philosophie, de ces événements littéraires ? Et n’y aurait-il pas quelque chose de comparable dans la langue de Derrida et la construction de ses livres ou le projet de Schelling d’écrire une philosophie narrative ?
GB. Je suis entièrement d’accord avec la façon très juste dont vous reprenez et ramassez mon propos.
Dans notre échange, nous envisageons, vous et moi, et nos lecteurs sans doute aussi, la question du rapport à la littérature vu du côté des philosophes et de la philosophie. Il faudrait aller voir aussi du côté des écrivains, de la littérature elle-même à qui il arrive assez souvent, mais pas toujours, pas nécessairement, car elle n’a pas « besoin » de la philosophie – puisqu’elle vient avant- de se demander pourquoi la philosophie. Je me souviens d’une exclamation de Dostoïevski : « la philosophie me tue … qu’elle aille en enfer ! », ou encore des nombreuses et souvent très ironiques observations de Proust sur l’idéalisme philosophique comme leurre ou comme évitement – du corps. Il y a quelque chose de la philosophie qui « tue » la littérature, sûrement, ou qui lui impose une confrontation à la fois vaine et lourde à ses yeux. Car, comme écrit Bonnefoy que vous citez, « le moindre concept est l’artisan d’une fuite ». L’enfer, la feinte, la fuite – il faudrait s’interroger sur ces points de vue d’écrivains sur la philosophie, sa place, son statut, ses opérations. Je ne l’ai fait avec vous qu’en me plaçant du côté qui est forcément le mien, du côté d’un philosophe. Et ce que vous suggérez, et vous avez raison, c’est qu’il faudrait (je crois l’avoir fait dans mon travail, au moins par intermittences) s’attarder sur l’effet en retour du littéraire sur le philosophique, et tout particulièrement sur la langue des philosophes, et même, de façon plus aiguë encore, sur la philosophie comme langue. La philosophie est une langue, et chaque philosophie l’invention d’une langue. J’ai toujours recommandé aux étudiants qui avaient du mal à lire la Phénoménologie de l’esprit, par exemple, de considérer le texte comme écrit dans une langue étrangère qu’il fallait apprendre mais pour laquelle on ne disposait d’aucun dictionnaire. Au fond, lire Hegel, en l’occurrence, ça revient à se faire son propre dictionnaire, au risque d’erreurs. « Esprit » ne veut pas dire…, mais veut dire … Chaque grande philosophie, et même les moins grandes, crée sa langue, est une langue singulière, un idiome. Dès lors qu’on l’a appris, cet idiome, on se déplace plus aisément dans la langue et la pensée en question.
Et ceci vaut pour l’histoire de la philosophie dans son ensemble, pas seulement pour les philosophes qui ont eu une approche très sensible de ce point de la langue, Schelling, Derrida, Levinas, dont vous rappelez heureusement les noms, mais aussi Nietzsche ou Rosenzweig, et beaucoup d’autres, tous peut-être à quelques exceptions près. J’ai toujours été frappé, pour prendre un exemple, par la facture très « classique », entre Racine et Proust, du style de Tocqueville, très « français », lorsqu’il décrit la façon dont les sociétés, démocratique ou aristocratique, déterminent les mœurs, la galanterie, le libre choix d’un conjoint, les mariages d’inclination, la prostitution, etc., ce qu’il appelle « les manières », « la forme extérieure des actions humaines ». Bajazet à propos de l’entremêlement funeste des passions amoureuses et des crimes politiques, la Recherche, à propos de l’Affaire Dreyfus dans le « monde » et De la démocratie en Amérique s’écrivent peu ou prou de même « façon ». Il s’agit à chaque fois de langue, la langue-Hegel, le style Tocqueville – et à chaque fois le cas est singulier. On peut certes en tirer un principe très général, mais pas de loi. La philosophie est une langue que je peux tenter de m’approprier, d’écrire et de parler pour dire ce que j’ai à y dire, dans sa langue à elle, à nulle autre pareille, et qui serait idéalement parfaitement ajustée à la singularité d’un dit, produit à même le dire de la philosophie. Pastichant Flaubert, je pourrais dire « Hegel, c’est moi ! » -non pas du tout au sens où je serais hégélien, pas plus que Flaubert n’est « madame » « Bovary ». Mais au sens où cette formule circonscrit le principe de toute écriture, romanesque, philosophique.
Écrire, en effet, c’est répéter dans une scription, une trans-scription donc, ce qui fut vécu, éprouvé, ressenti, pensé. Répéter n’est pas le bon mot. Écrire, c’est inscrire pour la première fois, inaugurer, traduire, d’une langue de départ muette, celle des affects pour le romancier, celle de « l’expérience » pour le philosophe, vers une langue d’arrivée introuvable. Traduire non plus n’est pas le bon mot. Écrire n’est pas transcrire, ce n’est pas simplement traduire car celui qui écrit ne dispose d’aucune langue existante. Écrire, c’est trans-férer, trans-figurer, du « « réel » en « rationnel » pour le philosophe rationaliste, dans une « forme » pour l’écrivain pour qui se pose la question du « réalisme » qu’il lui faut trancher par l’écriture. On dit habituellement que l’art est une création de formes ou la philosophie une création de concepts, ce qui est juste, bien que ces formules, me semble-t-il, ne nous disent rien de très précis. La « création », c’est l’in-formation d’une matière (c’est exactement ce qu’on appelle « le style »). Il faut minimalement qu’une matière sensible (la langue, les phonèmes, le brut d’un mot, les sensations, les « idées reçues », la doxa, les « expériences » qui s’y disent) soit in-formée pour qu’une forme apparaisse, pour qu’une idée émerge. Ceux qui s’imaginent que la philosophie serait étrangère, ou rétive, à ce type de questionnements, soi-disant « littéraires », sont naïfs. C’est pour moi le travail même de la philosophie : repérer des strates, des couches, des moments, des instances que la raison est impuissante à déterminer et à circonscrire, parce qu’elle ne préside pas à leur destination ni n’assiste à leur origine, la naissance, la mort, le temps, le dieu pour les Anciens. Héraclite disait à propos de l’Apollon de Delphes qu’il ne s’exprime ni clairement ni obscurément, ni selon le logos ni selon le cryptique, mais selon des signes, comme le dieu caché de Pascal, ni complète absence ni présence manifeste. Ce qui ne tient pas en entier dans un logos, mais se donne dans des signes qui excèdent les concepts ou les frappent de mutisme, n’est-ce pas pleinement ce qui intéresse le philosophe ? Et qui lui donnerait peut-être chance de « parler des couleurs » en connaissance de cause – je songe au mot attribué à Buridan selon lequel le philosophe serait un aveugle qui parlerait des couleurs ? Valéry a très bien observé cette tension. « Qu’est-ce que le cogito, sinon, tout au plus, la traduction d’un intraduisible état », écrivait-il -étant bien entendu, ajoutait-il, que « philosopher est possible à cause de l’impossibilité de noter les intuitions » : la littérature fait profession de cette impossibilité, qu’est-elle d’autre ?, la philosophie le pourrait aussi, Schelling lui assignant la tâche de faire « traduction de l’intraductible ».
Et au fond, toutes les écritures de la philosophie soupçonnées par l’académisme de « tomber » dans le littéraire (voir le cas Derrida, naguère, qui ne s’enseignait à l’étranger que dans les départements de littérature et civilisation françaises !) s’efforcent vers une langue rigoureuse et purgée de l’être, de ses catégories, de ses systématisations, de ses appareils, pour mieux « parler des couleurs », une langue des signes qui ne consisterait plus à dire le sens (Hegel) selon une logique de la référence ontologique, mais à pro-duire comme dit Levinas, là où les intuitions sont impossibles à noter, c’est-à-dire à les laisser venir, sans la contrainte de la démonstration, en en signifiant l’accord fondamental avec la pensée qui en accueille les harmoniques.
Penser de façon radicale, jamais de façon conséquente – telle était la maxime tranchante de Benjamin, laquelle va dans la même direction, je crois. Nietzsche aurait pu la revendiquer pour sa propre écriture de la philosophie. Puisque nous parlons de l’écriture de la philosophie et des philosophes, il faut bien dire un mot, un tout petit mot de Nietzsche. Il a su s’alléger de toute pensée « conséquente », de tout ordre des séquences organisées par le principe de causalité. Il a fait l’éloge de la surface, contre toute fausse profondeur, il se déplace sur une superficie, un plan où se croisent des perspectives et où se disposent des interprétations. C’est un penseur de la légèreté, jusqu’à s’exposer parfois comme un penseur léger, c’est un penseur de la surface jusqu’à se risquer à la superficialité. « La guerre est un caméléon », disait Clausewitz. Dans les guerres qu’il mène sur tous les fronts, Nietzsche emprunte les traits de ses adversaires, les déforme et les rejoue, parés de leurs couleurs : Zarathoustra dit le contraire du Zarathoustra historique sur le dualisme, et en plus il annonce un nouvel Évangile –on s’y perd évidemment, voilà pourquoi chacun s’y retrouve. Je crois que cette question de la langue -dont je n’ai fait que présenter quelques éclats- est essentielle pour qui tient que la philosophie n’est pas simplement le contre-pied de l’opinion, son antidote, un savoir en charge de coloniser la doxa, d’en dénoncer les mirages. La philosophie ne se réduit pas à ce geste à quoi trop souvent on la ramène. Il lui faudrait retrouver un chemin qui remonterait (est-ce seulement faisable ?) en amont de « l’expérience », sans se préoccuper de faire le tri entre sens commun et savoir, en s’efforçant de retrouver un état où toute expérience serait encore à faire, un « autre état » disait Michaux, plus vieux que l’antagonisme simpliste de l’opinion et de la philosophie.
AP : La philosophie est une langue, dites-vous, qu’il faut s’efforcer de se réapproprier à chaque fois que l’on veut philosopher en première personne puisqu’elle n’est pas traductible de façon univoque, et pas simplement faire de la philosophie (comme le dit Kant dans sa Logique). Pourrait-on dire que c’est un idiome au sens de Derrida ? N’est-ce pas comme si on essayait dès lors de briser en quelque sorte le moule du déjà-dit pour faire éclore un nouveau dire, c’est-à-dire s’efforcer toujours davantage de faire coller l’intuition personnelle qu’on éprouve et qu’on veut communiquer avec une formulation qui puisse l’exprimer à chacun ? D’où la difficulté d’hériter de concepts qu’on se sent toujours devoir repréciser ou amender pour se les réapproprier. Cette difficulté de la philosophie à devoir toujours négocier avec la langue ne serait-elle une explication aux tentatives d’écritures extra-philosophiques – ou disons d’une écriture en rupture avec le traité purement argumentatif et qui risquerait de réduire la philosophie à un logicisme – plus ou moins heureuses, des philosophes : ébauches de romans ou romans pour Michel Henry et Levinas, poèmes pour Arendt et Heidegger, théâtre pour Gabriel Marcel et Sartre, par exemple ?
GB. Oui, on revient à la question de la traduction, de la trans-duction, comme expérience philosophique et de la philosophie comme effort pour restituer dans une langue, la philosophie, l’autre langue, sa merveille et son unicité. Pourquoi cette matrice traductive de la pensée, et quel est son intérêt selon moi ? Lorsqu’on traduit, je parle là de l’expérience qui est celle du traducteur, lorsqu’on traduit d’une langue vers une autre, tout se passe comme si la langue qu’il nous faut traduire, la langue de départ, se révélait dans son propre le plus propre, comme si elle n’était constituée tout à coup que de noms propres. Traduire, c’est en quelque sorte passer d’un nom propre à un autre nom propre, car c’est une opération où la langue fait événement. Elle n’est plus un simple instrument, commun, communicationnel, de la production du vrai dans l’adéquation de l’intellectus et de la res, mais elle se fait l’acte même de la production du vrai dans sa singularité irréductible, propre. Dans une traduction réussie, la langue de départ et la langue d’arrivée sont l’une et l’autre des éléments dynamiques de la vérité qu’elles produisent de façon mobile, elles disent vrai, comme un nom propre dit vrai, sans discussion puisqu’il nomme une archisingularité. Et ce vrai de la langue propre est universel sans concept, si je puis pasticher la troisième Critique de Kant, mais à peine puisqu’il s’agit là d’un jugement esthétique et non logique, et qui ne repose pas sur des concepts d’objet. Son universalité est subjective, dit Kant. Or le commun est précisément ce qui est passible du concept, objet d’un jugement téléologique objectif. Le nom commun, pour revenir à mon analogie traductive, est porté par un usage codifié du langage, par une communication, un « partage » au sens kantien, justement, une utilisation, une médiation instrumentale. Le nom commun apparaît comme une idée que j’ai à confronter avec une singularité inflexible. Et philosopher, c’est toujours entrer dans cette confrontation où je m’essaie à nommer une extériorité inappropriable dans sa singularité absolue, par des noms communs, au moyen de concepts, les reflets selon Platon, les idées selon Descartes, les phénomènes selon Kant, etc., comme autant d’instruments pour aller « aux choses mêmes ». Dans la traduction, il s’agirait plutôt de retrouver, d’une langue l’autre, le nom propre perdu, selon une sorte de connaissance du troisième genre, ni confuse, ni abstraite, ni logique ni cryptique, mais soustraite à toute indétermination de principe. Une œuvre à traduire est comme un immense nom propre, justement, absolument singulière. Il faut donc au traducteur cette étrange aptitude qui consisterait à donner à chaque fois à la singularité absolue de la langue, et peut-être à l’absolu lui-même, son nom propre. Et ce que j’appelais tout à l’heure le style ou la « langue », la langue-Hegel par exemple, autrement dit, le philosopher en propre de chaque philosophe à la recherche de ses mots propres, me paraît en bonne part semblable, en tout cas comparable à ce que je viens de dire de la traduction, pour autant que je ne me trompe pas.
Si la philosophie n’était que réduction de l’apparence à la vérité, ou encore de la particularité à la généralité, misère de la philosophie ! Pauvreté et arrogance des philosophes ! A chaque fois que la philosophie procède ainsi, elle tourne en rond, elle ne découvre rien, elle se contente de « situer » comme disait Sartre à propos du marxisme. Elle substitue en sous-main une universalité vide à l’opacité de l’expérience, de l’existence qu’elle est dès lors hors d’état d’élucider. La littérature, souvent, fait au contraire renaître, par la mémoire, par la radiographie des passions, par les analytiques du Moi, c’est-à-dire des Moi, l’objet réel dans sa singularité absolue. Je parle là de façon trop massive de la philosophie en général, soit d’un certain type de rationalisme, mais il est mille et une autres façons de philosopher.
C’est dans cet interlude que se situent toutes les tentatives littéraires des philosophes, plus ou moins heureuses – que vous rappelez et vous avez raison car il faut au moins savoir y lire des symptômes. On pourrait dire, pour les cas que vous mentionnez, qu’elles forment comme l’ombre de leur pensée, indissociable et absente, comme un remords. Leurs écritures de la philosophie, leurs styles, sont dans ces espacements de la forme et de l’ombre, entre ce qui est écrit et ce qui fut tenté. Et qui marque d’une empreinte ineffaçable leurs pensées. Le sommet littéraire de Levinas n’est pas dans ses romans plus ou moins aboutis mais dans Autrement qu’être[3], chef d’œuvre dans la langue à bien des égards, Lacan, je crois, l’a dit. Philosophiquement, ce symptôme, pour garder ce mot, faute d’un autre, le scepticisme, sa revenance, en sont les témoins, Levinas l’a montré. Car le scepticisme a rapport à la question du langage, du mutisme, de l’aphasie. Comment dire sans fixer ce dire dans un dit ontologique ? Comment s’émanciper du discours, du dit, par le discours, par un contre-dit ? Comment, et voilà où ça devient très intéressant, purger la langue, le logos, de son inclination irrépressible vers l’être –de son penchant ontologique. Nietzsche se pose la même question, à propos de la métaphysique, dans le Livre du philosophe, et c’est l’écriture de la philosophie qui s’en trouve bouleversée, à des lieux de la « vérité », des arrière-mondes, du ciel et des Idées. La question est à chaque fois celle de la contradiction, importée dans la philosophie par le parricide platonicien: si le non-être est, comment inventer, se demandent les Sceptiques, des modalités d’énonciation qui en passent par le privatif (in-) ou le négatif (non-), comme dans les théologies négatives médiévales (Dieu tout-puissant, mais non selon la toute-puissance humaine, etc.) ? Comment, pour Nietzsche, écrire la philosophie sans en passer par les antinomies de la métaphysique (le bien et le mal, etc.) que le langage ne cesse de charrier avec lui ? Comment fixer dans un dit l’infini d’un dire, comment faire avec ce trahir du dire dans le dit, avec ce qui se livre et se donne du dire ? Je pense ici évidemment à toute la fin d’Autrement qu’être ? Comment dé-dire ? Au fond Levinas a rendu justice à ce qui s’est joué, de Kant à Hegel, autour de la question de savoir pourquoi l’histoire de la philosophie n’est pas simplement une doxographie, pourquoi l’histoire de la philosophie est elle-même philosophique. Ce qui constitue une sorte de retournement de ce dont nous étions partis. La littérature et la politique, dans leur extériorité à la philosophie proprement dite, si on sait les lire et les comprendre philosophiquement, y font retour selon des modalités médianes et complexes. Elles ne sont pas simplement « organon de la philosophie », comme disait Schelling de l’art. Elles ne sont pas plus « littéraire » ou « politique » – tout en l’étant !- que n’est « historique » l’histoire de la philosophie. Tout est là, peut-être, dans cette césure constante et inamissible.
AP : Permettez-moi de vous poser une dernière question. Vous évoquez et citez souvent Heidegger[4], dont on connaît, à mesure de la publication de ses Cahiers noirs[5] de mieux en mieux la profondeur de l’antisémitisme. Détournant le titre de l’ouvrage de J.-F. Kervégan, j’aimerais vous demander, d’après vous, « que faire de Heidegger » ?
GB : Ah ! Heidegger ! Les Cahiers noirs n’ont en aucune façon révélé son nazisme. Tout le monde savait. Il y a longtemps déjà, j’avais écrit sur « Heidegger nazi Heidegger philosophe » dans un volume collectif allemand. « Que faire » de lui, de Schmitt, mais de proche en proche, de beaucoup d’autres, de la philosophie peut-être, est en effet une bonne façon d’entrer dans la question. Que faire avec ce déchirement ? Il faut déjà être au clair, au vu des appels inconsidérés à vider nos bibliothèques et nos têtes d’Être et temps et de tout le reste, sur ce qu’il convient de ne pas faire de Heidegger. Une « philosophie nazie », proposition qui n’a guère de sens, même si elle procède d’un postulat louable mais fallacieux : Heidegger a été durablement nazi, donc il ne peut pas être un grand philosophe. Postulat que d’autres s’empressent d’inverser : Heidegger a été un grand philosophe, donc il ne peut pas avoir été véritablement nazi. Heidegger fut bel et bien les deux, sans aucun donc, et nazi et philosophe, et les deux pleinement ! Voilà où se tient le difficile à penser, le point douloureux.
Le vice originaire de Heidegger, je crois, c’est d’avoir pensé que le nazisme pouvait accueillir une philosophie, et que le philosophe pouvait lui-même se faire le Führer du Führer, l’éducateur d’une politique de la philosophie que le nazisme aurait porté destinalement. Heidegger a ensauvagé son ontologie fondamentale et fabriqué une politisation catastrophique de l’analytique existentiale, une funeste héroïsation du Dasein et de son « choix », telles qu’on les lit dans le discours de rectorat et les appels de 1933. A ce moment-là, Heidegger conforme le souci, l’angoisse, le néant en les rectifiant par l’héroïsme, en les traduisant dans une langue pseudo-politique. Or on ne peut pas tirer de Sein und Zeit une politique nazie, pas davantage qu’une politique tout court d’ailleurs. Au § 74 d’Être et temps, Heidegger explique que « l’analytique existentiale ne peut pas donner lieu (erörtern) » à ce à quoi se résout la résolution, chaque fois, factivement. Eh bien, ce que l’analytique existentiale ne « peut pas », le nazisme de Heidegger le lui fera pouvoir en transposant de façon aberrante l’idéal d’« authenticité » sur une entité chargé de l’historiciser, le peuple, le peuple historial, le peuple allemand, contre le « peuple de la domination de l’étant », les Juifs, comme il écrit dans les Cahiers noirs.
C’est de cette façon qu’il faut aussi entendre le fameux mot de 1935 sur « la grandeur et la vérité intérieure du mouvement national-socialiste ». On voit bien ce dont il se voudrait se démarquer : l’ontique, c’est-à-dire la politique à proprement parler, lesquels ne furent pas à ses yeux à la hauteur de la grandeur et de la vérité ontologiques du mouvement. L’être du national-socialisme est « grand » et « vrai », son étantité se manifestant par ailleurs, hélas !, comme calamiteuse – tel est l’argument central du sermon heideggérien. Cet argument, philosophiquement très pauvre, est repris sans grand changement dans l’édition de 1953 de l’Introduction à la métaphysique. Il signifie une intention pro domo : ce n’est pas le philosophe Heidegger qui se serait trompé sur le fond, ce qui l’obligerait au moins à s’expliquer, non, c’est le nazisme réel, le « mouvement », qui n’a pas su se tenir à l’élévation où l’exhaussait son investissement par Heidegger philosophe ! C’est la faute à l’étant, somme toute !, ce qu’on retrouve dans un autre énoncé « fameux » qu’on peut lire dans Einblick in das was ist, l’une des quatre conférences de Brême de 1949[6]. L’agriculture motorisée, les blocus, la bombe H seraient « quant à leur essence » « la même chose que la fabrication de cadavres dans les chambres à gaz et les camps d’extermination ». La proposition tient sa complexité, ou sa perversité, du choc moral qu’elle inflige à son lecteur (« la même chose ») en même temps qu’elle lui adresse une question, celle de « l’essence », de l’Occident, de la métaphysique, de la raison. Si le destin de l’Occident s’atteste dans la domination planétaire de la technique et des figures arraisonnantes de l’application de la science, de la motorisation, de la fabrication industrielle, il convient d’en déterminer « l’essence », soit le nihilisme métaphysique. L’hypothèse heideggérienne ouvre une position qui se contredistingue de toute explicitation ou interprétation « rationaliste » du national-socialisme et de la Shoah, d’Eric Weil à Habermas. Et on peut très bien en effet, comme Milner ou Lacoue-Labarthe, considérer le nazisme tout autrement que comme un irrationalisme destructif ou un simple essentialisme archaïque. On peut y déceler l’effectuation historiale d’un certain type de rationalité, mais certainement pas comme le font les Cahiers noirs.

Le plus lourd peut-être fut le silence d’après 1945, plus insupportable encore que l’engagement rectoral. Comme on sait, « das kommende Wort » qu’attendit Celan après la rencontre de 1967 ne vint pas –quand bien même Heidegger crut, en un stupéfiant mélange de ruse et de naïveté, l’avoir délivré dans son entretien au Spiegel de 1966. Après la Kehre, pour dire les choses très vite, la pensée que la métaphysique comme science de l’étant en sa totalité a à se surmonter dans une pensée de l’être fait place à une pensée de l’événement originaire. Ce tournement de la violence herméneutique de la Destruktion, en quelque sorte, vers un laisser-être destinal de l’être s’accompagne de déplacements -de l’activisme vide à la passivité sereine, de l’être-jeté à un destin auquel est restitué à son statut d’événement pur, du souci à l’accueil, de la décision à la parole et au langage – dont Celan admirait la méditation heideggérienne. Ce tournant aurait pu, comme l’espérait sûrement le poète, s’accompagner d’un retour sur l’engagement de 1933 et d’une ressaisie de la question dans la problématique de l’attente et de l’ouverture. Mais la parole à venir ne vint pas. Jusqu’au bout, l’ignominie s’est tenue, dans le retrait, dans l’attente, et le calcul.
A tous ces éléments, il faut certainement ajouter une circonstance aggravante – que les Cahiers noirs font apparaître avec une violence crue. Heidegger impute aux Juifs l’invention d’un « principe de destruction » dont ils pâtissent à présent, et c’est bien fait pour eux en quelque sorte – on trouve quelque chose de voisin dans l’Antéchrist de Nietzsche – et il écrit cela au moment où, à Fribourg, sous ses fenêtres, les synagogues brûlent et les hommes bientôt.
Il est par ailleurs très important selon moi de ne jamais perdre de vue que ce qui s’écrit tout au long des Cahiers noirs, et pas seulement dans les quelques énoncés explicites sur le judaïsme, les Juifs, le Judentum, ce qui par conséquent soutient l’antisémitisme heideggérien, relève en son fond de la pensée philosophique elle-même. Se pose donc d’emblée la question de l’inscription de cet antisémitisme dans une tradition théologique et philosophique plus vaste, de Nicolas de Cues et Luther à Hegel et Nietzsche – je pourrais multiplier les propositions par lesquelles les grands schèmes qui assignent le judaïsme à cette place métaphysique singulière qui est la sienne dans l’histoire de l’être selon Heidegger sont préfigurés, posés, explicités, structurés dans notre histoire depuis les Pères de l’Église. En fin de compte, Heidegger aura exhibé une question plus ancienne que sa pensée de l’être, plus troublante que sa propre détestation de l’« enjuivement » du monde. La philosophie, depuis Platon, veut souvent, trop souvent, se faire redresseuse des torts, si je puis dire ainsi. L’antisémitisme y figure alors inévitablement, à certains moments de cette histoire, le programme de ce qu’il convient de redresser ou d’anéantir, de « supprimer » en tout cas, les Juifs, et ce faisant d’en accomplir l’essence, fût-ce au prix de leurs existences.
Que faire de tout cela ? Essayer de refuser la facilité de la réduction d’une philosophie au nazisme de son auteur, et d’une pensée à la simple auctoritas de qui la pense ; et la facilité de l’indemnisation d’une pensée, fût-elle grandiose, exemptée de son legs d’irresponsabilité. Heidegger ne fut point le résistant au nazisme que d’aucuns ont parfois présenté, est-il seulement besoin de le rappeler ? Il n’en est pas pour autant un idéologue du nazisme, est-il seulement nécessaire de le préciser ? Est-il donc si difficile d’admettre humblement, et tragiquement, que le cas Heidegger fait mal ? Pourquoi ne pas se confronter à la douleur de ce fait, et de tous ses analogues qui pèsent sur l’honorable confrérie des philosophes dont parlait Rosenzweig, de la Grande Grèce à la capitale du Reich ? Un philosophe en effet, et d’une envergure aussi indiscutable que celle de l’auteur de Sein und Zeit, a été aussi un homme capable de se compromettre sans retour avec l’une des plus grandes entreprises de mort qui soient, avec l’antisémitisme au sens que dit Levinas dans l’exergue d’Autrement qu’être, soit avec la haine de tout autre homme.
Mais soyons sérieux : se priver de cette pensée, s’en dispenser, est tout simplement impossible, impensable (la quasi-totalité des penseurs et des écrivains de l’Occident devraient alors connaître le même sort sous les mêmes incriminations !). Ce serait comme empêcher l’intelligence de toute la philosophie du siècle passé. On ne voit pas non plus pourquoi il faudrait taire ou banaliser l’étendue de l’indigne acquiescement du philosophe au crime. Pareille pensée – pour qui veut à son tour la penser – noue sa vérité à son terrifiant contraste. Elle portera toujours avec elle l’ombre du désastre. Toujours, pensant avec Heidegger, avec lui, contre lui, nous éprouverons quelque chose comme une honte de la pensée, une honte d’avoir à accompagner, pensant sa pensée, une souillure. Jamais cependant, entre l’impossible reniement de la dette et l’impossible raison d’oublier, ce sont les mots de Levinas, nous ne pourrons pour autant faire de cette honte un empêchement de penser, ou l’argument d’une trop reposante paix de la pensée avec elle-même[7].
[1] Joseph Conrad, Le Retour, traduit par Georges Jean-Aubry, Paris, Gallimard, « folio », 2008.
[2] Yves Bonnefoy, « Les tombeaux de Ravenne », L’Improbable et autres essais, Paris, Gallimard, 1992, p. 14.
[3] E. Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Paris, LGF, Le Livre de poche, coll. « Biblio-essais », 1990 (1974 pour la première édition).
[4] Voir, pour des textes plus précis, entre autres, « Heidegger : l’introduction de la philosophie dans le nazisme », La règle du jeu, n. 58-59, 2015, p. 81-107 ou « Heidegger entre antisémitisme, philosophie et pensée », Heidegger « Schwarze Hefte » im Kontext, éd. D. Espinet, G. Figal, T. Keiling, N. Mirković, Tübingen, Siebeck, 2018, p. 209-233.
[5] Les Cahiers noirs font l’objet des tomes 94 à 102 de l’édition complète des œuvres de Heidegger. Ils révèlent un antisémitisme violent et leur parution provoque une nouvelle salve de questions sur l’engagement nazi de Heidegger et l’attitude qu’il y aurait à adopter à l’égard de ses écrits.
[6] Reprises en français dans M. Heidegger, Questions III et IV, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1990.
[7] A noter, la parution prochaine de Contre toute attente. Autour de Gérard Bensussan,
Actes des journées d’études en l’honneur de Gérard Bensussan organisées le 4 et 5 mars 2019 à Strasbourg, Sous la direction d’Andrea Potestà, Paris, Classiques Garnier, 2021.







