Pierre Guénancia, professeur d’histoire de la philosophie moderne à l’Université de Bourgogne, vient de rééditer son Descartes et l’ordre politique, augmenté d’une substantielle préface et d’une non moins substantielle postface. Nous l’avons interrogé à la faveur de cette réédition sur son rapport à Descartes, au politique et à la démarche même de l’historien de la philosophie. Qu’il soit ici pleinement remercié pour son amabilité et sa disponibilité. Les propos ont été recueillis par Thibaut Gress.
I°) Questions sur le politique
Actu-Philosophia : Initialement paru en 1983, Descartes et l’ordre politique1 se présente à la fois comme une réflexion générale sur les rapports entre l’individu et la communauté et en même temps comme une tentative de trouver dans la philosophie cartésienne un moyen de résoudre ce rapport que n’aura cessé d’interroger la philosophie politique. Il s’agit donc d’un livre qui s’offre selon une double modalité, celle éternelle du rapport entre le moi et le groupe, et celle plus circonstanciée de l’identité ponctuelle du groupe auquel l’individu risque toujours d’être aliéné. Ainsi, si les années 1980 étaient hantées par le spectre du communisme et de l’idée encore vive d’un homme dont l’essence ne pouvait être que sociale, notre propre époque, tout en rompant, au moins partiellement, avec le prurit soviétique et maoïste, semble s’offrir avec complaisance à une nouvelle forme d’aliénation que sont les appartenances collectives religieuses et, plus généralement, identitaires. « J’aperçois mieux aujourd’hui, écrivez-vous, Pierre Guenancia, après avoir relu ce livre, que son véritable sujet est non pas la critique de la politique, ce qui serait bien abstrait pour ne pas dire bien creux, mais, sous la figure des conceptions organicistes de la politique, la critique argumentée de tout ce qui se présente aux individus comme un tout, comme une totalité, comme la communauté dont ils font partie, dont ils sont les seuls membres. »2 Face à ce danger toujours constant, et d’autant plus perfide que ses manifestations ne cessent d’épouser des formes différentes, Descartes apparaît comme un recours en tant que celui-ci fait de la liberté individuelle le lieu par lequel nous pourrons résister à toutes les aliénations. « Il m’est alors apparu, et je n’ai pas cessé de le vérifier depuis ce temps, expliquez-vous dans la préface de la nouvelle édition, que la philosophie cartésienne procure à la thèse de la liberté individuelle son plus solide fondement, et permet de réfuter l’ensemble des doctrines où l’individu est tout juste bon à servir de membre à un tout, que ce soit un Etat, une Eglise, une communauté en général. »3
Ma première question sera très simple et s’exprimera dans une double direction : Descartes vous semble-t-il être le seul à proposer une thématisation de la liberté telle que l’appartenance au groupe ne puisse constituer l’horizon d’une vie ? Et est-ce cette problématique politique qui vous a décidé à écrire par la suite sur Descartes car, rappelons-le, Descartes et l’ordre politique constitue votre premier ouvrage publié sur l’auteur des Méditations ?
Pierre Guénancia : Sans former des familles de pensée au suffixe « isme » (empirisme, idéalisme, matérialisme, etc.,), les philosophies ne sont pas pour autant des mondes propres, des univers sans rapport entre eux. Une œuvre philosophique n’est pas comme une œuvre romanesque ou artistique qui exprime le génie propre d’un homme et en est inséparable. Entre les philosophes passe tout de même un courant continu de discussion de problèmes qui sont ceux de la philosophie, et non ceux que se poserait de manière idiosyncrasique tel ou tel philosophe. La permanence de ces problèmes qui constitue à mon sens la seule justification d’une discipline comme l’histoire de la philosophie ne permet donc pas que l’on s’en tienne à l’étude ou à la pratique d’une seule philosophie à l’exclusion des autres, simplement parce qu’on y serait plus à son aise qu’ailleurs. La philosophie de Descartes n’appartient pas à Descartes, qui a plutôt édifié et défendu une philosophie que d’autres, avant lui et après lui, ont aussi, à leur façon, élaborée et soutenue. C’est ce que l’on appelle une philosophie du cogito, malgré les différences que ce terme et sa relation aux autres concepts aura par la suite. La conscience de soi comme donnée première et irréductible à toute inclusion d’un élément dans un ensemble ( l’homme est une partie de la nature, ou un citoyen d’un état, ou le rouage d’une machine complexe, etc) ; l’expérience de la liberté de l’arbitre, qu’aucun argument tiré de la nécessité universelle ne peut transformer en illusion de la conscience sur elle-même ; l’idée d’une limite de la connaissance humaine qui tient à la constitution même d’un entendement qui ne peut fonctionner qu’avec des idées, des catégories, des règles, des principes normatifs ; vous aurez reconnu dans ces quelques « thèses » ce qui permet d’unir ( je ne dis pas de confondre) des philosophes aussi différents que Locke, Kant, Husserl, pour ne viser que les sommets. Donc, et pour répondre à votre question, Descartes n’est pas le seul à procurer, par la priorité reconnue au Je pense, un fondement métaphysique à la liberté de l’individu, qui est autant liberté de séparation que liberté d’association, mais le nom propre de Descartes désigne une position philosophique bien déterminée et commune à plusieurs philosophes, par opposition à d’autres positions philosophiques, défendant des thèses clairement contraires à celles d’une philosophie d’inspiration cartésienne. L’important à mes yeux est de savoir ce qui distingue les unes des autres, et de pouvoir justifier le choix que l’on fait.
Pour l’autre partie de la question, tout ce que je peux dire est que c’est la politique qui m’a conduit à la philosophie ( comme beaucoup de gens de ma génération), et que c’est l’étude de la philosophie (et pas seulement celle de Descartes) qui m’a éloigné de la politique, ayant découvert dans cette étude que la philosophie est la vraie politique, politique de la pensée ou politique du jugement, parce qu’on y trouve les instruments pratiques et théoriques qui permettent de résister à la passion du pouvoir.
AP : Je me pose néanmoins une question autour des rapports entre l’individu et la collectivité ; la conception organiciste du politique telle que vous la critiquez ne présente-t-elle pas toutefois l’immense mérite d’accorder à l’individu une orientation décisive quant au sens de sa vie, de sorte que les individus affranchis du groupe ou se croyant tels soient condamnés à éprouver une crise du sens qu’ils sont en réalité incapables de trouver en eux-mêmes ?
PG : Oui, cela rejoint ce que Descartes dit des âmes faibles ou basses : ce sont celles qui croient ne pas pouvoir subsister par elles-mêmes et qui vont chercher des secours au sein de grands corps dans lesquels elles disparaissent comme individualités et ne sont plus que des membres de ces corps qui deviennent de ce fait (i.e. du fait du renoncement à sa liberté et au pouvoir qui va avec) les seules “substances”, i.e. les seuls êtres qui sont par eux-mêmes, tous les autres (les membres) n’ayant d’autre existence et d’autre sens que par leur participation à cet être collectif, devenu paradoxalement le seul être réel. C’est pour cela que j’ai cité, à la fin de la nouvelle préface écrite pour lé réédition de ce livre, cette phrase de Foucault disant qu’il n’y a pas d’autre point de résistance au pouvoir que dans le rapport de soi à soi. Ce qui, dans un langage cartésien, se présente sous la forme de l’estime de soi, fondée seulement sur sa capacité à faire un bon usage (et d’abord un usage) de son libre arbitre. La question du sens passe pour moi par la croyance ou la certitude subjective que « nous avons un libre arbitre », et que c’est seulement son l’usage qui est la source de l’estime de soi (qui me paraît être une chose beaucoup plus importante que la question du sens de la vie).
AP : Ne peut-on pas penser qu’il faudrait dialectiser précisément les rapports de la liberté et du sens ? Dans votre très belle postface, vous insistez en effet sur la générosité comme source de sens pour le sujet, ainsi que vous venez de le rappeler, ce qui revient à dire que l’usage individuel de la volonté qui m’appartient en propre me permet de trouver une satisfaction à ma vie. Plus encore, vous en notez l’universalité : « le désir de générosité s’universalise en même temps qu’il s’éprouve dans le plus intérieur de l’âme et il n’est même pas besoin de savoir que Dieu existe et qu’il est vérace pour savoir que je ne peux pas me sentir libre sans sentir que tous les hommes le sont comme moi, ni plus ni moins. »4 Mais il me semble précisément qu’il ne s’agit là que d’une vérité pour le sujet qui est déjà généreux, c’est-à-dire qui use déjà librement de sa volonté et qui, par analogie, en vient à penser qu’il en va de même pour autrui. Ne pourrait-on pas au contraire imaginer qu’il est des sujets qui, par paresse ou par lâcheté, préféreraient s’en remettre à la loi du groupe ou de la communauté, car cela est bien moins lourd à porter : je trouve déjà dictés dans la communauté des actes à accomplir et des valeurs à adopter, ce qui me facilite amplement la tâche. Ma question est donc la suivante : compte-tenu de la pente qui est la nôtre à céder aisément à la facilité, l’idée d’une aristocratie universelle de l’homme par la générosité peut-elle être considérée comme réaliste ?
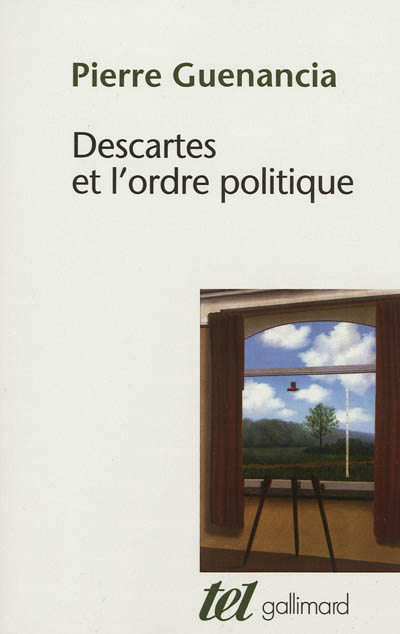
PG : Pour Descartes, l’homme généreux est d’abord celui qui pense ( qui pense et non qui sait) que chacun des autres hommes peut être généreux. Le générosité est d’abord le primat de la confiance sur la défiance, ou la prudence dans le sens un peu mesquin que ce terme a pris et qu’il n’a pas du tout chez Aristote bien sûr, ni chez Descartes et ses contemporains. Il ne s’agit pas d’un postulat de nature anthropologique, comme celui de Rousseau sur l’homme (naturellement bon), mais là aussi d’une relation de soi à soi. L’homme généreux ne se prend pas pour un héros ou un saint, mais pour un homme comme un autre, cette relation de commensurabilité avec les autres interdisant toute posture de nature aristocratique, notamment celle de la “différence” si vantée de nos jours. Il ne croit justement pas qu’il est différent des autres, et que le respect de l’un pour l’autre est respect de sa différence. Il croit au contraire que chaque homme est capable du meilleur comme du pire et qu’il ne faut pas avoir de position a priori sur ce qu’est l’homme. Il faut à l’inverse avoir une représentation de soi qui n’est au fond qu’une sorte d’exigence vis-à-vis de soi qui trace une ligne de démarcation entre deux types d’actes : ceux que l’on n’a pas le droit de faire, et les autres qui se présentent de façon relative, à la différence des premiers. Chacun est capable de faire cette démarcation et de s’y tenir, car il ne s’agit pas de vertus improbables comme le courage et encore moins l’héroïsme mais de cette vertu moyenne qu’est la constance (soi-même et non le même). La générosité est une vertu d’homme moyen, car elle n’exige de chacun que ce que chacun est capable de faire par lui-même. D’ailleurs, aussitôt après avoir défini la générosité, Descartes l’identifie à ce qu’il nomme l’humilité vertueuse, qui consiste à ne pas croire que l’on est au-dessus des autres, à se garder de cette folie douce qu’est la conscience de sa supériorité. Est-ce bien réaliste, demandez-vous ? au sens ordinaire du mot, non, car peu de gens en fait sont capables à la fois de cette grandeur d’âme et de cette humilité, et on ne saurait leur commander d’acquérir cette vertu dans une morale comme celle de Descartes. Mais le réalisme ne doit pas être non plus un impératif pour le philosophe, sinon il lui faudrait fermer boutique. Elle doit poursuivre « avec mesure et discrétion » la tâche d’élévation et d’édification qui depuis Socrate est la sienne.
AP : La communauté, bien qu’elle ne constitue pas la source fondamentale du sens à donner à notre vie, ne saurait pourtant pas être évacuée d’un revers de main. Quelle fonction et quelle place accordez-vous à la communauté en tant qu’elle possède une existence de fait qui, nécessairement, amène à interroger sa fonction de droit ?
PG : Si par communauté on entend le devenir commun de l’être individuel de chacun, si, comme dans l’institution un corps politique selon Rousseau, on cherche à former « un moi commun », alors tout doit être fait pour empêcher la formation de telles communautés dans une république, qui est un espace commun d’existences individuelles. Car ce que les communautés (les exemples ne manquent pas aujourd’hui) exigent de l’individu qu’elles considèrent comme sa chose, c’est qu’il se démette de son moi propre et ne soit plus que le membre docile du “corps” organique qu’elle espère former par la fusion des existences et des volontés individuelles. Il y a plus que des analogies structurales entre ces communautés religieuses, ethniques, et l’organisation des partis politiques totalitaires.
AP : De manière générale, mais ce n’est qu’une impression, il me semble que votre ouvrage, tout en critiquant en permanence l’aliénation de l’individu dans la communauté et, partant, la définition marxiste de l’homme, n’en conserve pas moins une dimension marxienne par laquelle la notion même d’aliénation se trouve utilisée dans une acception somme toute assez proche de celle qu’aimait à conceptualiser le jeune Marx que, d’ailleurs, vous citez. En outre, l’éloge répété de l’individu que vous menez, ne se ramène pas – il s’en faut de beaucoup – à un éloge de l’individualisme. Il me semble donc que votre ouvrage utilise des outils conceptuels marxiens, afin de défendre une thèse plutôt libérale qui, toutefois, ne saurait être identifiée à une défense de l’individualisme. Confirmez-vous cette impression que j’ai fréquemment éprouvée ?
PG : C’est très juste. Le point de départ des réflexions de ce livre est la confrontation entre les analyses hégéliennes de l’Etat et les critiques que Marx en a faites dans des manuscrits qui ont pour moi la fraicheur des commencements, parce que ces critiques (de la religion, du droit, de la politique) reposent, comme on le voit dans les manuscrits de 43-44, sur la conviction que l’individu est le seul absolu ontologique qui puisse être. Pour moi, Marx a été et reste le penseur de l’individu contre toutes les formes d’aliénation collective (y compris celles qui se sont réclamées du marxisme). Mes origines ne se trouvent pas du tout du côté de l’individualisme et du libéralisme, mais du côté d’un marxisme teinté d’anarchisme , si je puis dire, parce que l’individu et la liberté sont ici (comme chez Descartes) des absolus ontologiques.
AP : Il y a eu, en 1996, un ouvrage assez étonnant d’un philosophe libéral, Alain Laurent5, qui prenait fait et cause pour Descartes contre les attaques dont celui-ci faisait l’objet dans ces années-là. Contre Jean-François Revel6, notamment, pourtant libéral lui aussi, Alain Laurent exaltait un Descartes qui constituait une base intellectuelle permettant de résister à l’emprise de la communauté. Insistant dès l’introduction sur l’importance de la morale cartésienne, Alain Laurent faisait l’éloge d’une conduite de vie recherchant sa fondation dans « celle d’une souveraine volonté d’indépendance d’action devant mettre l’individu-sujet en mesure de se préserver des contraintes extérieures de la société après s’en être affranchi au plus intime de soi. »7 Et, fort significativement, l’annonce programmatique de l’ouvrage se proposait d’insister sur le « bon usage du libre arbitre »8 par lequel seul un projet politique était possible. Mais, la conclusion ouvrait sur une annonce très clairement libérale par laquelle les volontés individuelles se transmuaient en une sorte de fait collectif où régnerait la rationalité profitable à tous. Etre cartésien signifierait alors, pour Alain Laurent, « tenir que l’ordre moral est d’abord intérieur, librement choisi et assumé, et que le lien qu’il crée entre les individus-sujets est le meilleur qui soit pour « faire société », puisqu’il est social par l’effet vertueux provenant de la convergence de libres volontés se référant à la commune raison – et non comme produit d’une compulsion grégaire, d’un dressage politique ou d’un conditionnement tribal. »9 Il me semble que c’est précisément sur ce point que vous vous séparez d’Alain Laurent, c’est-à-dire dans ce moment exact où la somme des choix individuels, par une sorte de transformation alchimique, formerait soudainement une société, par laquelle se réaliserait le bien de l’individu.
PG : Tout à fait. L’harmonie post-établie des doctrines libérales s’apparente à la critique pascalienne de la politique en ce qu’elle présuppose un dessein indirect ou inconscient d’où résulte dans un cas l’équilibre des volontés individuelles et dans l’autre cas la duperie nécessaire au bon fonctionnement de la société humaine. Ce sont des théories qui, paradoxalement, rationalisent le politique (au sens freudien de la rationalisation), alors qu’il faudrait plutôt prendre la mesure de la part irréductible (et grande) de l’irrationnel, du désordre, de l’absence de dessein global et final d’une société ouverte. Nous sommes dans la société un peu comme le voyageur perdu dans la forêt : on ne sait pas où on va ni d’où on vient, nous devons donc faire un chemin et tenter de le suivre le plus constamment qu’on peut. Il me semble que de ce point de vue la conception cartésienne de l’ordre social est beaucoup plus rationnelle que celles-ci en ce qu’elle ne cherche pas à rationaliser ce qui ne peut pas l’être, ou à déceler un ordre sous le désordre ou du moins la diversité des choses qui entrent dans la composition d’une grande société. Cette conception qui est au fond celle du sens commun nous protège contre les théologies sécularisées que sont les philosophies du sens de l’histoire mais sans doute aussi les théories de la volonté générale, de l’unité indivisible du peuple, et de la souveraineté populaire. On se rend mieux compte aujourd’hui que ce sont là des fictions qui nous empêchent d’agir localement et au coup par coup, sans dessein d’ensemble et sans en appeler à ces signifiants vides qui privent les individus de l’exercice de leur libre jugement dans des actions qui pour être celles d’un ensemble de gens ne sont pas les actions d’un imaginaire corps collectif.
AP : Qu’est-ce qui, selon vous, permet alors de former une société ?
PG : Je répondrai à la manière de Renan : c’est la volonté, tacite et présupposée par nos actes , de vivre ensemble sans pour autant avoir un projet de vie en commun. Cette coexistence de libertés différentes ne doit pas nécessairement prendre la forme d’un consensus.
II°) Ce qu’il y a de politique chez Descartes
AP : A lire votre ouvrage, Descartes apparaît d’abord comme un antidote à l’aliénation communautaire à partir de l’interprétation de la liberté cartésienne et de la générosité. Toutefois, si l’on regarde les textes eux-mêmes, à l’exception de quelques lettres, il est clair que le politique ne constitue pas une préoccupation majeure des écrits cartésiens ; pourtant, vous interrogez cette absence et en faites quelque chose de signifiant. « Ce vide quasiment total est bien plus singulier qu’on ne l’imagine, car il est rare qu’un philosophe n’ait pas dit au moins quelques mots sur des problèmes qui, dit-on, sont ceux de tout le monde. »10 Pouvez-vous expliquer ce que peut signifier cette absence et établir positivement ce que pourrait être la réflexion de Descartes sur le politique ?
PG Comme c’est à cette question que le livre tente d’apporter une réponse, il m’est difficile d’y répondre en quelques phrases, d’autant qu’une bonne partie du livre (la première moitié) est consacrée à préparer philosophiquement une réponse qui tienne compte de l’ensemble de la philosophie cartésienne et non des quelques fragments portant explicitement sur la politique. C’est une voie longue qui est ici suivie, mais y en a-t-il d’autres en philosophie ?
AP : D’accord ; alors décomposons le problème et suivons vos analyses pas à pas. Comment faut-il entendre la notion d’ordre au sein du titre de votre ouvrage ?
PG : Peut-être à la manière de Pascal : un ordre désigne chez lui un type d’objets circonscrit par la nature de la libido attachée à ces objets. En ce sens l’ordre politique serait celui où dominerait le désir de ou du pouvoir.
AP : Vous évoquez à plusieurs reprises le rapport de Descartes à Machiavel ; comment caractériser cette critique ambiguë de Descartes que celui-ci adresse aux principaux préceptes du Prince ?
PG : Elle n’est pas si ambiguë que cela, car Descartes rejette catégoriquement les préceptes directement contraires aux principes sacrés de la vie humaine et de la société : tromper les hommes, s’en servir de moyens, justifier et occasionner la méchanceté et la violence en les pratiquant soi-même, et même croire que l’on peut éclairer et guider les actions de ceux qui commandent aux autres alors qu’on n’en a pas l’expérience. Ce qu’il approuve chez Machiavel, c’est l’aspect stratégique des maximes destinées à combattre les ennemis. Mais à aucun moment Descartes ne fait de la distinction amis / ennemis le principe de l’action politique en tant que telle. La guerre n’est ni le premier ni le dernier mot de la politique.
AP : Quel rôle la raison peut-elle jouer au sein du politique chez Descartes ?
PG : Un rôle assez analogue à celui qu’elle joue dans la compréhension de l’union de l’âme et du corps. Vous connaissez bien les phrases par lesquelles Descartes déclare à ses correspondants qu’il ne faut pas chercher à comprendre par des raisons tirées de l’entendement seul la façon dont l’âme et le corps agissent l’un sur l’autre. Il suffit de vivre pour le comprendre, ou plutôt, vivre c’est comprendre cette union, de la seule façon qui soit de comprendre dans ce domaine, en en faisant l’expérience quotidienne et certaine. L’ordre politique se présente aussi avec cette opacité pour l’entendement, mais il se pratique et se comprend en suivant des maximes générales de conduite parmi les hommes. D’une certaine manière les « quelques préceptes » de la morale par provision n’ont pas d’autre finalité que de rendre possible la praxis en tant que telle, qui n’est pas une application d’une théorie mais un ordre propre de compréhension. La praxis serait en politique (au sens large) l’équivalent de l’expérience dans l’union de l’âme et du corps. Il faudrait bien sûr développer et justifier ces analogies.
AP : Il ne semble pas y avoir, chez Descartes, de liens entre l’usage de la raison et la révolte ou, plus modestement, la posture de l’indigné. « Descartes n’est certainement pas un homme révolté mais rien ne dit que l’homme révolté soit un homme juste. Par contre en contestant, comme il le fait dans ses maximes, la valeur des institutions et coutumes, en réglant sa conduite mais non son jugement sur elles, Descartes sépare l’obéissance de la foi ou de l’adhésion qui la précipitent dans le fanatisme. Le doute est le principal dissolvant de l’autorité, qui le sait d’ailleurs tellement bien qu’elle lui préfère encore la révolte. »11 Pouvez-vous préciser ce point par lequel vous distinguez affranchissement rationnel à l’égard de l’autorité et refus de la révolte ?
PG : Comme vous le dites bien, il y a bien une « posture de l’indigné » qui n’est peut-être pas sans analogie avec celle de « l’homme révolté ». Dès lors que l’on a sacrifié à ce rituel de la révolte ou de l’indignation, on est accepté dans le cercle des gens qui sont politiquement corrects. Il y a une rhétorique de la révolte et de l’indignation qui ne sert à rien d’autre qu’à se donner bonne conscience (cela fait penser à l’achat des indulgences…). Mais il existe aussi, quoique de façon beaucoup plus discrète, des formes multiples de contestation et de résistance aux multiples abus d’autorité : absurdités technocratiques, comportements de délinquants de gens qui se croient tout permis parce qu’ils exercent un pouvoir sur les autres. Toutes ces formes concrètes, précises, déterminées de résistance aux pouvoirs me semblent beaucoup plus efficaces et lucides que les postures faciles et narcissiques de révolte et d’indignation.
AP : Vous notez que « C’est le rapport du juridique au politique qui disparaît chez Descartes alors que l’effort des philosophies classiques porte précisément sur les jointures de cette relation. »12 Que faut-il entendre par cette disparition et comment l’interprétez-vous ?
PG : Dans les théories politiques qui s’élaborent à l’époque de Descartes (époque cruciale pour la suite des Temps modernes) c’est sur le droit (naturel) qu’est fondé l’état civil. Cela paraît être un progrès dans la rationalité mais c’est surtout une façon “rationnelle” de justifier l’obéissance des sujets à l’autorité. Tout ce que fait le souverain est fait au nom de ceux qu’ils représentent, car il faut présupposer qu’ils lui ont donné l’autorisation de le faire. C’est en très gros la théorie de Hobbes, qui va dominer par la suite. Chez Descartes, le droit semble avant tout être une affaire morale, qui touche aux relations entre les personnes considérées comme des êtres singuliers, et non comme des atomes de la vie sociale. La société (ou l’Etat) est une donnée de fait, et non le produit d’une convention juridique. Elle ne se présente pas chez lui comme une réalité devant être fondée en droit. Le pouvoir politique n’est pas le produit de la volonté de chacun (ce qui le soustrait à toute critique), les individus (les sujets) font face à un pouvoir qu’ils ne fondent pas du fait de leur obéissance, et ont entre eux, par eux-mêmes, en tant qu’hommes, des relations civiles que les lois protègent sans pour autant les engendrer.
C : Questions adressées au cartésianisme
AP : A plusieurs reprises, vous ramenez le problème politique à des éléments de la pensée cartésienne qui, à première vue, n’ont pas de rapports immédiats avec ce dont vous traitez. Si vous le voulez bien, j’aimerais prendre appui sur ces questions pour élargir l’entretien à l’ensemble de l’interprétation que vous proposez du cartésianisme. A cet égard, un des points centraux qui me semblent récurrents au sein de votre lecture, me paraît être l’importance de l’expérience chez Descartes. « Chez Descartes, écrivez-vous, l’expérience n’est absolument pas une notion dévalorisée ni même secondaire. Lorsqu’il récuse le expériences de Galilée ou qu’il critique les physiciens qui bâtissent sans fondement, il récuse avant tout l’empirisme aveugle dépourvu de toute base déductive, d’un ordre et d’une méthode constitutifs du concept même de science. »13 Cette importance de l’expérience se trouve relevée ailleurs, par exemple dans votre recueil d’articles intitulé Descartes, chemin faisant où vous écrivez que « la nouveauté toujours nouvelle de l’entreprise de Descartes c’est d’en appeler à l’expérience, c’est-à-dire à chacun dans le domaine de la réflexion métaphysique, de rendre celle-ci indépendante de la discipline scolaire et même de l’ensemble des autres sciences. »14 Pouvez-vous expliquer en quel sens la découverte de l’ego doit être appelée « expérience » et quelle fonction doit alors jouer celle-ci au sein du politique ?

PG : Descartes a très clairement souligné que le cogito (i.e. la certitude de mon existence comme chose qui pense) n’était pas déduit à partir de prémisses universelles, par un raisonnement de type déductif. Ce n’est pas pour autant une intuition immédiate, comme la durée pour Bergson. Le terme qui convient le mieux est donc celui d’expérience, parce que l’expérience n’est pas un raisonnement déductif d’une part, mais aussi parce que l’expérience est un processus temporel, et non une illumination immédiate. Il faut refaire le chemin que Descartes fait dans les deux premières méditations pour trouver comme lui que mon existence de chose pensante est plus certaine que celle d’aucune autre chose. Cette nécessaire réitération du chemin cartésien montre que c’est un savoir qu’on ne peut acquérir que par une appropriation. Il y a un acte (de pensée ou de langage) qu’il faut faire pour acquérir cette vérité. Il en est de même pour la certitude de l’union de l’âme et du corps – on en parlait plus haut – et pour la certitude d’avoir un libre arbitre en nous.
La fonction qu’une telle expérience peut avoir dans le champ élargi des relations intersubjectives est claire : chacun est l’origine absolue de ce qu’il tient pour vrai ou de ce qu’il éprouve comme bien. Cela ne veut pas dire : à chacun sa vérité ou sa notion de bien, mais que le jugement de chacun est l’unique règle de la vérité de ce qu’il affirme ou nie. La règle de la perception claire et distincte ne signifie pas autre chose : je ne dois me rendre qu’à l ‘évidence, et celle-ci ne peut être trouvée qu’à l’intérieur de mon esprit. Je cite souvent la formule de Koyré qui oppose l’évidence de l’autorité (que ce soit celle de l’institution ou celle de la logique) à l’autorité de l’évidence. C’est pour cela qu’une société d’individus ne peut pas être comparée avec un organisme où tous les membres et organes reçoivent leurs ordres d’en haut…
AP : L’expérience n’acquiert-elle alors pas paradoxalement le sens d’un retrait hors du monde empirique ?
PG : Pour faire court pardonnez-moi de vous renvoyer à mon livre Pierre Guenancia, Le regard de la pensée. Philosophie de la représentation, PUF, 2009, dans lequel je tente de montrer que la condition du jugement dans quelque domaine que ce soit est la transformation de l’objet réel en objet représenté, ce qui implique un retrait de l’esprit du monde des choses afin de mieux les voir comme choses. L’homme n’est pas un être dans le monde, mais un être qui fait face à ce qu’il se représente comme un monde. C’est une corrélation, ce n’est pas une inclusion.
AP : Un autre élément central de votre réflexion porte sur les rapports de l’âme et du corps. Vous faites partie des interprètes qui modèrent le dualisme cartésien – et vous savez combien je partage modestement de telles vues –, à telle enseigne que l’introduction de Descartes et l’intelligence du sensible présentait d’une manière très claire quels étaient les écueils de l’approche dualiste : « On ne peut pas faire plus grave contresens sur la pensée de Descartes, bien qu’on le fasse souvent, aujourd’hui surtout semble-t-il, que de se représenter l’âme et le corps comme deux personnages distincts avec des juridictions propres exerçant à tour de rôle le gouvernement de l’homme. Le dualisme ne fait qu’exprimer l’impossibilité de confondre les mouvements qui se font dans les nerfs et les muscles des jambes avec la conscience de marcher. Que celle-ci soit « causée » (en un sens qu’il faudra préciser) par ceux-là, nul n’en est plus convaincu que Descartes. De tous les philosophes rationalistes, il est le seul à croire à une action réciproque entre le corps et l’esprit. »15 Vous accordez à la question des rapports de l’âme et du corps une portée politique puisque vous l’analysez comme telle en ces termes : l’identité et l’unité de l’homme doivent être, selon vous, « cherchées plutôt dans l’union de l’âme et du corps conçue d’abord comme distinction entre une âme intellectuelle et un corps en extériorité qui reçoit comme toute chose son sens et sa finalité d’une utilisation pratique. Cette conception de la conscience et du jugement comme « donateurs de sens » réfute à notre avis par avance l’idée de finalité objective que détiendraient des totalités telles que l’Histoire, l’Etat, etc. et qui serait insoupçonnée par les individus enfermés dans leur particularité. »16 Pourriez-vous expliquer ce point très précis quant aux rapports qu’entretient l’union de l’âme et du corps avec la conception du politique ?
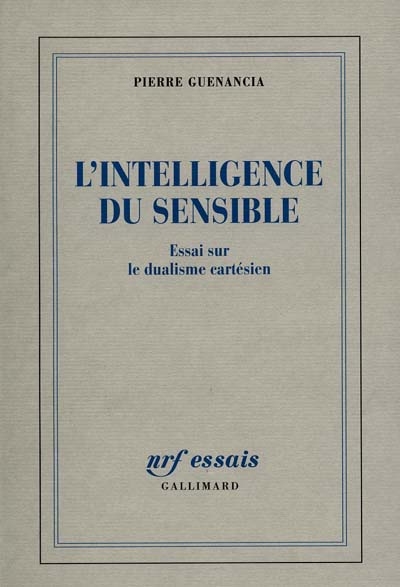
PG : Dans ces deux livres que vous citez, la question de l’union de l’âme et du corps n’est pas appréhendée du même point de vue, ni dans la même perspective. Nous n’allons pas revenir sur l’opposition au modèle organiciste qui court tout au long de Descartes et l’ordre politique : dans ce livre le point de vue de la distinction de l’âme et du corps est plus présent que celui de leur union afin de souligner ce qu’une attitude cartésienne en politique doit à la conception d’une âme considérée comme chose qui pense, comme entendement au sens large, plutôt que comme esprit incarné dans un corps, soumis au mécanisme des passions, comme dans les anthropologies contemporaines du cartésianisme dans lesquelles l’homme est considéré comme une chose parmi les choses, régi par les lois de la nature humaine. Ces préoccupations ne sont bien sûr pas absentes dans L’intelligence du sensible, mais ce livre paru quinze ans après poursuit un autre objectif qui est, en deux mots, de montrer que la distinction rigoureuse de l’âme et du corps, le dualisme ontologique (et non éthique), permet de rendre compte de l’activité de l’esprit aussi bien dans le domaine de la perception dite sensible que dans l’expérience des passions. C’est un livre qui va à contre-courant de la réduction de l’esprit (tout ensemble intelligence et volonté ) à une machine.
AP : Un autre aspect de la pensée générale de Descartes sur lequel je souhaiterais m’arrêter est celui du mécanisme. Dans L’intelligence du sensible, vous pensiez le mécanisme sous l’angle des passions et faisiez du corps humain ce qui avait pour seule fonction d’être uni à une âme ; par cette union, il peut ainsi produire dans l’âme les sentiments, idées ou passions qu’il lui est nécessaire d’avoir. Ainsi, écriviez-vous, « le mécanisme est un équivalent de l’intentionnalité dont il rend manifeste, par cette imitation même, le caractère exclusivement humain. »17 Il semble donc y avoir un lien fondamental entre le mécanisme comme méthode scientifique et quelque chose comme la saisie de l’homme, ce qui paraît se confirmer dans Descartes et l’ordre politique : « Si le mécanisme a pu engendrer un humanisme, c’est d’abord parce qu’il considère que la connaissance d’une chose précède son refus ou son acceptation et les rendent inutiles. Or ce que reprochent Descartes ou Spinoza à la « tradition », c’est d’avoir procédé comme si l’observation de la nature humaine était un prétexte pour en déplorer la condition, l’objet d’une rhétorique de l’indignation. Comme si à la suite de quelque imprudence ou comme sanction d’une mauvaise tenue, l’âme s’était trouvée prise au piège du corps »18
PG : Le mécanisme a l’incomparable avantage de nettoyer le corps (et les corps extérieurs) de toute trace d’âme. En faisant concevoir le corps comme une machine (la célèbre comparaison du corps avec une horloge), Descartes a en quelque sorte dévitalisé l’âme pour en faire un principe distinct du principe corporel. C’est ce principe qu’il nomme et qui sera nommé par la suite conscience qui diffère par son unité, son indivisibilité, son identité de tout ce qu’on conçoit comme corps ou substance, chose étendue. Le mécanisme pousse très loin, le plus loin possible, la réduction des qualités sensibles à des propriétés purement physiques ou matérielles. Mais du coup il permet de faire du sensible une propriété de l’âme i.e. de la pensée, et de se représenter la singularité absolue de l’homme dans la nature. Le mécanisme est le fondement épistémologique d’une morale humaine, une morale qui prend en compte la spécificité de l’homme, à la fois être pensant et union substantielle de l’âme et du corps, être qui se représente le monde et être lié au monde.
AP : Enfin, dans un livre que les étudiants connaissent bien, Lire Descartes, vous notiez en introduction que « Le fil conducteur de la pensée cartésienne, l’idée d’où tout part et où tout aboutit est celle de la liberté. »19 Pouvons-nous dire finalement que c’est à partir d’elle que s’est construite votre interprétation générale du cartésianisme, y compris en son versant politique ?
PG : Ce que Descartes m’a permis de comprendre, c’est qu’avant d’être une question politique, morale, sociale, la liberté est une question métaphysique qui implique une relation de l’homme avec l’infini, au moins sur le mode de l’idée. On ne peut pas défendre la liberté politique (démocratie, liberté d’expression, de circulation, etc.) sans présupposer cette relation avec l’infini qui explique que l’homme ne peut pas être seulement le citoyen d’un Etat, un travailleur, ou que s’il peut se penser comme cela c’est parce qu’il possède une conscience libre, i.e. la capacité de se déterminer pour une chose ou son contraire, de s’associer ou de se dissocier, de s’engager ou de se désengager. La relation avec l’infini est inscrite au cœur de la conscience du possible. C’est comme être métaphysiquement libre que l’homme est un objet de respect et d’estime , ou, en termes kantiens, une fin en soi.
D : Questions d’interprétation
AP : J’aimerais à présent aborder votre méthode de lecture des textes cartésiens. Nous savons que chaque grand commentateur a établi des règles pour aborder les écrits cartésiens, Guéroult privilégiant par exemple une lecture cursive et immanente, Alquié interdisant d’expliquer un texte par un autre texte qui lui fût postérieur, etc. A vous lire, il semble que votre exigence soit guidée par deux mots d’ordre : le premier est indiscutablement celui de la clarté, tandis que le second est celui de l’adhésion scrupuleuse aux textes que vous ne cherchez pas à subsumer sous quelque interprétation fixée a priori.
PG : Ce n’est pas par fausse modestie mais par souci de la vérité que je dois d’abord décliner l’honneur d’être rangé parmi les “grands commentateurs” de Descartes, à côté de figures aussi hautes que celles de Guéroult et d’Alquié. Je n’ai jamais eu en effet l’ambition de mener des études systématiques et, comme on dit aujourd’hui, “scientifiques” sur Descartes (ou Pascal, ou d’autres encore), et de ce point de vue je ne me considère pas comme un historien de la philosophie dont la tâche est de restituer la logique interne d’un système, ou bien sa généalogie, interne ou externe. En fait je ne peux pas m’empêcher de mettre mon grain de sel dans les textes que j’étudie et explique, non pas pour leur faire dire ce que je pense moi, ce serait puéril, mais pour qu’ils m’aident à trouver déjà l’expression exacte du problème qui m’amène à eux. Ce sont les problèmes qui m’intéressent en philosophie, et non la restitution et la contemplation des systèmes de pensée.
La philosophie pour moi a une dimension publique, elle s’occupe des problèmes que les hommes se posent en tant qu’hommes, et elle doit pouvoir apporter des solutions raisonnées et profondes à ces problèmes. Les grands philosophes sont là pour nous aider à comprendre le sens de ces problèmes et à apercevoir les difficultés qu’une approche naïve de ces problèmes, une approche inculte, ignore totalement. Ce qui m’intéresse et me passionne dans l’étude des philosophes c’est justement de pouvoir faire un va et vient incessant entre leurs constructions théoriques et les choses mêmes auxquelles ces constructions tentent d’apporter une intelligibilité meilleure et différente de celles qui ont été déjà données. La philosophie ne peut pas être séparée des choses du monde dans lequel les hommes vivent, ce n’est pas une science refermée sur son objet, et à mon sens on s’égare en voulant la pratiquer comme une science spécialisée. Je ne cherche donc pas tant à interpréter les textes que je lis qu’à comprendre grâce à eux les choses et les problèmes auxquels ils sont liés, lorsqu’ils ne sont pas purement scolastiques (ou universitaires…). Disons alors qu’au concept scolastique de la philosophie, je préfère, et de très loin, le concept cosmique de la philosophie, pour reprendre la célèbre distinction kantienne.
AP : Pouvez-vous alors expliquer quelle relation vous entretenez avec les interprétations heideggériennes qui ont beaucoup essaimé depuis une quarantaine d’années, interprétations que, pourtant, vous évoquez fort peu ?
PG : Si c’est aux travaux de Jean-Luc Marion que vous faites référence, je les lis depuis longtemps (depuis le début) avec grand intérêt et, j’espère, avec profit. Mais, curieusement, j’arrive sans difficulté à séparer la lecture très stimulante qu’il fait des textes cartésiens de l’intrigue (ou de la mythologie) heideggérienne dans laquelle il l’inscrit et qui, personnellement, ne m’intéresse pas beaucoup.
AP : Cette volonté de toujours expliquer de la manière la plus fidèle possible les textes cartésiens fait d’autant plus ressortir la singularité de Descartes et l’ordre politique que cet ouvrage ne peut s’appuyer sur des textes précis qui traiteraient immédiatement du problème qui retient votre attention. En clair, alors que l’ensemble de vos ouvrages consacrés à Descartes semblent chercher à expliquer le texte cartésien, Descartes et l’ordre politique paraît condamné à interpréter la pensée cartésienne en vue de la tirer vers un sens politique. Quelle place occupe alors ce livre dans l’économie de votre lecture générale de Descartes ?
PG : Ce n’est pas de façon désintéressée que je me suis mis à lire vraiment Descartes. Les philosophes vers lesquels j’inclinais au cours de ma formation philosophique étaient plutôt Spinoza et Marx (pour nous c’était un peu la même chose), mais aussi Pascal, pour des raisons que je n’ai jamais vraiment comprises d’ailleurs… C’est en travaillant sur les philosophes du 17ème siècle qui ont élaboré les grandes théories du politique (Hobbes, Spinoza, notamment) que je suis tombé sur Descartes et me suis posé la question de son silence sur la politique. La suite, c’est ce livre dont nous parlons. La lecture de ses textes non métaphysiques (les Règles pour la direction de l’esprit, le Discours, mais surtout les lettres à Élisabeth qui portent sur des questions morales, et le traité des Passions de l’âme), cette lecture a fait sur moi l’effet d’une révélation : j’avais trouvé ce que je cherchais à dire, ce que profondément je pensais et voulais dire. En philosophie, je défends des convictions, pas des interprétations. Du coup, j’ai remonté le fil et ai lu les grands textes antérieurs (Méditations, Principes de la Philosophie) à la lumière de ce noyau moral de l’œuvre, et je n’ai toujours pas fini de le faire… Quand j’y pense – et je n’y aurais pas pensé si vous ne m’y aviez pas incité à le faire –, cette lecture des lettres à Élisabeth a été vraiment déterminante pour la suite de mon travail. Tous les problèmes auxquels je me suis appliqué par la suite se trouvent au cœur de cette correspondance.
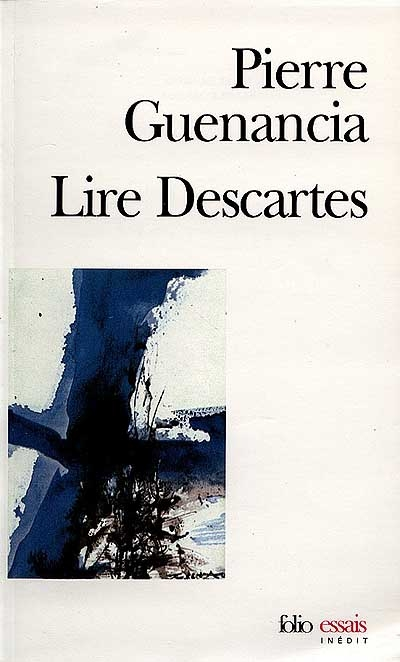
AP : Vous concluiez L’intelligence du sensible par une remarque à mes yeux très profonde à savoir que l’âme de l’homme cartésien relève « d’un jugement esthétique : une grande âme, une âme noble, des actions belles… »20. Pensez-vous qu’une lecture esthétique de l’œuvre cartésienne fait aujourd’hui défaut ?
PG : Non, car il y a déjà le beau travail de Pascal Dumont sur l’esthétique cartésienne. Ce que j’ai voulu dire dans cette phrase est un peu différent. Par jugement esthétique je n’entends pas un jugement désintéressé, mais un jugement qui ne sépare pas la forme et la perfection de l’objet sur lequel il porte. Cela revient donc à inclure l’esthétique (au sens très large) dans l’éthique, et à faire du beau la traduction formelle d’un jugement d’approbation. Être en accord ou en désaccord avec ce que l’on voit ou ce que l’on entend me paraît être la spécificité du jugement moral ; bien plus que l’idée d’une conformité avec la loi morale qui ne peut pas faire droit à la liberté du jugement de chacun et donc aux différences d’appréciation liées à la nature même des choses sur lesquelles porte le jugement moral.
- Pierre Guenancia, Descartes et l’ordre politique, PUF, 1983, rééd. Gallimard, coll. Tel, 2012
- Ibid., p. 375
- Ibid., p. 11
- Ibid., p. 387
- cf. Alain Laurent, Du bon usage de Descartes, Maisonneuve et Larose, 1996
- cf. Jean-François Revel, Descartes inutile et incertain, Paris, 1976
- Alain Laurent, Du bon usage de Descartes, op. cit., pp. 20-21
- Ibid., p. 21
- Ibid., p. 117
- Pierre Guenancia, Descartes et l’ordre politique, op. cit., p. 23
- Ibid., pp. 131-132
- Ibid., p. 143
- Ibid., pp. 83-84
- Pierre Guenancia, Descartes, chemin faisant, Encre marine, 2010, p. 61
- Pierre Guenancia, Descartes et l’intelligence du sensible. Essai sur le dualisme cartésien, Gallimard, 1998, p. 10
- Descartes et l’ordre politique, p. 83
- L’intelligence du sensible, p. 201
- Descartes et l’ordre politique, p. 308
- Pierre Guénancia, Lire Descartes, Gallimard, coll. folio-essais, 2000, pp. 9-10
- Lire Descartes, p. 365







