Il n’est guère aisé de rendre compte du dernier ouvrage de Philippe Nemo, les deux républiques françaises 1, tant la thèse qu’il y déploie s’inscrit à contre-courant de ce que nous pourrions appeler les croyances ordinaires, à travers une très courageuse remise en cause de ce qui apparaît comme une histoire officielle, qui aurait occulté, pour ne pas dire éradiqué, un certain nombre de faits jugés incompatibles avec le logiciel idéologique des forces dominantes. Bien que Philippe Nemo ne s’inscrive pas franchement – c’est un euphémisme – dans les problématiques plus ou moins récentes de dénonciation de la domination, il s’avère pourtant que la totalité de ce livre relate le procès même de l’installation de la domination d’une force idéologique non démocratique, non pas dans les plus hautes sphères de l’Etat, mais dans les sphères les plus stratégiques de diffusion idéologique, au détriment de la bonne marche du processus démocratique. Cette force idéologique et non-démocratique, Nemo la thématise à partir d’une date, hypostasiée en concept explicatif, à savoir 1793. Tout au long de l’ouvrage, « 1793 » désignera, certes, le moment inaugural de la pulsion totalitaire, planant en permanence sur la politique française, mais « 1793 » désignera surtout cette foi religieuse, génératrice de croyances profondément irrationnelles, que Nemo résume ainsi : « « 1793 », (…), est un millénarisme. C’est une religion honteuse, non consciente d’elle-même, puisqu’elle se présente comme un athéisme, un laïcisme et un matérialisme, mais elle n’en fonctionne pas moins, psychologiquement et sociologiquement, comme une religion. J’appellerai cette religion de substitution la « Gauche » avec une majuscule, en prenant le mot non au sens parlementaire ou partisan, mais précisément en son sens spirituel – une mystique qui ne se discute pas, ne s’argumente pas, résiste à toute objection rationnelle basée sur les faits et, le cas échéant, soulève des montagnes. » 2 Il ne s’agit donc pas tant de lutter contre la légitimité de la Gauche, mais bien plutôt d’en révéler la nature intime, les analogies troublantes avec le millénarisme religieux, les armées de diffusion publique ; non pas attaquer mais démythifier afin de présenter ce concept sous son vrai visage, qui est celui du saut dans la croyance au sens le plus désastreux du terme. Une gigantesque entreprise critique se trouve ainsi convoquée, pour mieux interroger les ressorts fondamentaux de « 1793 » dont les effets sont plus que jamais visibles aujourd’hui.
Une précision s’impose : j’adopte, pour des raisons évidentes, le sens des concepts de Nemo, si bien que lorsque j’écrirai Gauche avec une majuscule, il ne s’agira pas des partis de gauche mais bien de cette mystique jacobine, étatiste, antisémite, socialiste ou communiste, ne décrivant en aucun cas les Républicains modérés ni la sociale-démocratie.
I) Les deux paradoxes
Néanmoins, ce texte ne saurait être réduit à la dénonciation de la structure exclusivement fiduciaire de la Gauche ; il propose également, et peut-être même essentiellement, une profonde relecture de l’histoire contemporaine de la France, à travers un déplacement significatif de la grille de lecture idéologique : si nous avons tous appris à lire l’histoire de France comme la lutte du Bien contre le Mal, entendons des Bons Républicains contre les Méchants Royalistes, puis contre la méchante droite, Nemo invite à déplacer le curseur vers un critère désormais immanent à la République elle-même : il n’y a pas la République contre les royalistes, mais il y a des Républiques, profondément antagonistes, et c’est cet antagonisme là qu’il faut interroger et placer au centre des réflexions herméneutiques en histoire. L’effet immédiat de ce transfert interprétatif est fort paradoxal : s’il ne s’agit plus d’accepter ou de refuser la République mais de savoir quelle République on veut, si donc le problème devient immanent à la République elle-même, il n’en demeure pas moins que le critère fondamental nous semble demeurer dans le rapport à la démocratie libérale ; en d’autres termes, cet ouvrage présente le paradoxe d’un recentrage dans la République elle-même qui a pour effet de placer le critère discriminant en dehors de la République, à savoir dans l’acceptation de la démocratie libérale. Il ne s’agit donc plus de lire l’histoire de France comme la lutte du refus et de l’acceptation de la République mais bien plutôt de la lire comme le choix entre plusieurs Républiques, discriminées par leur rapport à la démocratie libérale. Nemo forge un second concept pour qualifier ceux qui reprennent la République libérale, antijacobine, et ce concept, à l’image du premier, est puisé dans une date elle-même conceptuellement hypostasiée : « 1789 ». Ainsi l’histoire de France est-elle cette lutte incessante entre « 1789 » et « 1793 », et non entre 1793 et la réaction royaliste.
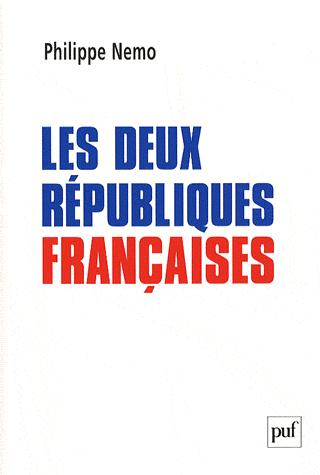
Deuxième paradoxe, lié cette fois au concept de « Gauche » que forge Nemo en conclusion, la notion même de droite et de gauche perd de sa pertinence ; on peut imaginer de la droite réactionnaire ou extrême dans « 1793 » (ce que Sternhell appelle excellemment les « droites révolutionnaires »), tout comme on peut parfaitement ranger une partie de la gauche sous « 1789 » ; il s’agit donc de ne pas se laisser illusionner par le concept de « Gauche » proposé par Nemo, qui ne désigne en rien la réactivation d’une bipolarité droite / gauche, qui serait le sens de l’histoire, mais il convient d’appréhender la « Gauche » comme une Religion, au sens fort, métapolitique, transcendant le débat démocratique, et imposant au destin français la marche historique souhaitée.
Ce paradoxe nous semble stratégiquement risqué, de la part de Nemo : il y a là de quoi nourrir facilement un amalgame qui, n’en doutons pas – si toutefois la Gauche condescend à rendre compte de cet ouvrage –, sera ravageur ; nous entendons déjà les critiques indignées, reprochant à Nemo de ne pas reconnaître la légitimité de la gauche, amalgamant bien sûr la gauche comme force politique, et la Gauche comme idéologie religieuse et millénariste ; nous entendons d’ici les railleries fondées sur l’arroseur arrosé, lequel reprocherait à la gauche son manquement démocratique, lui-même refusant les forces démocratiques en présence ; il est à craindre que la malhonnêteté intellectuelle de beaucoup soit telle que ne soit pas prise la précaution de distinguer la Gauche au sens conceptuel des partis de gauche, et fasse croire que Nemo s’en prend à la légitimité même de ces derniers, faisant de Nemo un antidémocrate patenté sous couvert de la défense de la démocratie libérale. A suivre.
Pour mener à bien pareille entreprise, qui n’est autre que la dénonciation de l’appropriation par la Gauche de l’histoire glorieuse de France comme étant son Histoire, au prix de mensonges parfois grossiers mais toujours efficaces, Nemo se voit obligé de faire preuve d’une grande rigueur historique, et de convoquer un à un les mythes, au sens mensonger du terme, forgés par cette « Gauche », issue de « 1793 », si bien que c’est une gigantesque entreprise de mythomanie qui se trouve ainsi démontée, souvent de manière fort convaincante. Pour ce faire, cinq grands mythes vont être examinés, disséqués, et systématiquement malmenés : « 1793 » aurait été démocrate, la République serait née de « 1793 », « 1793 » aurait été laïque, « 1793 » aurait été dreyfusard, et les adversaires de « 1793 » auraient été nazis. Naturellement, la simple lecture de ces têtes de chapitres suffit à montrer que « 1793 » n’est pas une simple date, mais une idéologie, le jacobinisme, qui court à travers les siècles, et qui structure l’histoire nationale, de façon souvent tragique, dès ce moment inaugural, jacobin, socialiste et étatiste que Nemo définit ainsi : « La conception jacobine se réfère à la Ière République française. Or celle-ci a été un régime totalitaire dont les horreurs ont égalé en nature, sinon en ampleur, celles des régimes nazi ou stalinien du XXè siècle. Il ne s’agit pas de reprocher aux Robespierre, Saint-Just, Billaud-Varenne, Carrier, Turreau et consorts d’avoir pratiqué des assassinats, génocides et autres actes relevant de la définition moderne des crimes contre l’humanité. C’est un fait qu’on ne voyait pas les choses de cette manière à leur époque ; autant reprocher aux Topinambous d’être anthropophages. Mais ce qui pose problème est que certaines forces politiques d’aujourd’hui donnent ce passé détestable comme l’épopée fondatrice du pays, comme son écriture sacrée, comme la source rayonnante de ses valeurs et même comme ce qui constitue la France comme nation. »3
II) Généalogie du crime politique
Une telle entreprise ne peut avoir pour son auteur que deux conséquences : la diabolisation, ou l’occultation. L’hérésie que constitue ce livre se trouve prémunie contre la diabolisation en vertu de ses très nombreuses sources, convaincantes et claires ; il est alors probable que le silence prévaudra, et il n’est guère surprenant que près d’un mois après sa sortie, aucun organe de presse nationale ne s’en soit fait l’écho…
1°) La violence
Les sources, en effet, il y en a ; elles sont fortes, et se dispensent peut-être même de commentaires. « 1793 », nous l’avons dit, c’est à la fois le moment inaugural et le concept antidémocratique par excellence, c’est-à-dire ce besoin de violence et de répression à l’encontre des tenants de l’opinion adverse, au nom, bien entendu, d’idéaux jugés généreux : la lutte contre les « riches », la redistribution des richesses, etc. Ainsi Nemo peut-il citer l’Enragé d’Orléans Taboureau de Montigny, pour lequel « la soif de richesse ne peut s’éteindre que dans des flots de sang »4 ou Jacques Roux, légitimant « l’extermination » de « ceux qui s’approprient les produits de la terre et de l’industrie, qui entassent dans les greniers de l’avarice les denrées de première nécessité et qui soumettent à des calculs usuraires les larmes et l’appauvrissement du peuple »5. Nous sommes ici au cœur, déjà, de ce qui sera le fond invariant de « 1793 », à savoir ce mépris absolu de la vie de l’individu, cette légitimation de la violence révolutionnaire au nom d’une mystique dont la réalisation hic et nunc se veut justifier la mort de milliers – de millions – d’individus. Comment, dans ces conditions, s’étonner que le site internet du Nouveau Parti anticapitaliste bruisse de mille appels au meurtre et à la violence, ainsi que le révèle Maël Thierry dans le Nouvel Observateur : « Il faudra les militaires avec nous pour les épisodes inévitables d’affrontement »6 écrit un militant ; « Si on veut significativement faire progresser la Justice sociale, on s’expose à la violence des capitalistes. Donc le recours aux armes doit être envisagé (…) »7, écrit un autre militant du NPA. Cette continuité de la légitimation de la violence et du meurtre au nom d’ « idéaux » ne peut s’expliquer en effet que par une mystique devant laquelle doivent s’effacer les atrocités du réel commises en son nom.
Il serait trop long de donner la liste de tous les morts, de toutes les victimes de « 1793 », jamais innocentes aux yeux de cette religion puisque retardant de manière insupportable l’accomplissement millénariste souhaité ; il n’est qu’à songer aux journées de 1848 où un général venu négocier avec un drapeau blanc se trouve sauvagement assassiné, à Mgr Affre lui aussi battu à mort par les émeutiers alors qu’il cherchait à s’interposer entre les combattants. Inutile de rappeler ici combien terrible fut la Terreur, le cortège de morts qu’elle entraîna, ou les mesures de police instituées par la Commune, où le blanquiste Rigault restera tristement célèbre pour ses persécutions de tous ordres, à commencer par les fonctionnaires de la ville de Paris, jugés insuffisamment révolutionnaires et démis de leur fonction pour 75 % d’entre eux. La liberté de la presse, établie par le Second Empire, sera abolie, les persécutions religieuses connaîtront leur acmé.
2°) Le déni permanent de démocratie
Fondamentalement, « 1793 » se manifestera par le même procédé : refuser le verdict des urnes et imposer la force d’une minorité agissante. Lorsque Nemo écrit : « Après les élections législatives de mai 1849, l’extrême gauche mécontente de sa défaite, essaie encore d’obtenir par la rue ce qu’elle n’a pas obtenu par les urnes. »8, il semble qu’il délivre là un mécanisme habituel pour la Gauche et « 1793 » consistant à systématiquement remettre en cause un verdict démocratique jugé contraire aux « Idéaux » révolutionnaires. Une série de dénis démocratiques – dont on observe encore aujourd’hui les ravages – auront donc lieu, parfois poussés jusqu’à l’hypocrisie ultime, c’est-à-dire menés au nom de la démocratie. Revue de détail :
Les premières élections post 1789 sont régulières. « C’est ensuite que tout se dégrade. L’élection de l’Assemblée législative dans l’été 1791 est l’occasion de graves irrégularités. Le pire survient lors de l’élection de la Convention, en août-septembre 1792. En effet, ce sont maintenant les acteurs ou les bénéficiaires du 10 août – à savoir, les Jacobins et la Commune insurrectionnelle – qui organisent le scrutin. Or, bien moins démocrates que le roi, ils prennent les mesures de force nécessaires pour que n’y prennent part que la petite minorité des électeurs potentiels qui leur sont favorables. »9 Contrôler le corps électoral, tel est le credo de nos hommes de « 1793 » ; ceux qui ne pensent pas correctement ne devraient pas pouvoir voter ; des individus auto-institués jugent ainsi de qui est apte à voter et surtout de qui ne l’est pas, au nom bien entendu, de la réalisation du Bien. Toutes proportions gardées, on ne saurait éviter de penser à un représentant contemporain de la Gauche, dont l’esprit demeure hélas bien fidèle à cette haine de la pratique démocratique, sans cesse contrariée par la liberté de vote ; le personnage déclarait il y a peu, le plus sérieusement du monde : « Je suis déçu par la démocratie. C’est un système surfait. Comme il y a des permis de chasse, de pêche, de conduire, on devrait créer un permis de voter avec l’obligation de passer un test d’instruction civique avant de glisser son bulletin dans l’urne. Je me verrais bien dans le rôle de l’examinateur ! » Cette déclaration de Guy Bedos n’est pas si innocente qu’il y paraît : partant d’une déception à l’égard de l’exercice démocratique, Bedos en déduit une conséquence profondément non démocratique, à savoir l’attribution du vote en fonction de l’adhésion à ses propres valeurs, délivrées par l’instruction civique chargée, on s’en doute, de diffuser les valeurs du Bien.
Il y a là quelque chose qui peut paraître mystérieux pour quiconque se voue corps et âme à la liberté ; pourtant, l’explication par la dimension religieuse que suggère Nemo permet de lever bien des incompréhensions : à l’origine existe cet impératif de réalisation d’un Bien jugé transcendant ; le vote des électeurs n’a de légitimité que s’il accompagne la réalisation de ce Bien, et se trouve destitué de toute tolérance, dès lors qu’il s’y oppose ; ainsi, ce qui pose problème, c’est à la fois la démocratie et le corps électoral ; dissoudre celui-ci pour mieux abattre celle-là, tel est le triste dessein opéré depuis « 1793 », dessein que l’on retrouve jusque dans les propos d’un humoriste « engagé » en 2007. L’application de ce principe de dissolution d’un corps électoral jugé incompatible avec le sens même de l’histoire, reçoit bien des illustrations :
– le 24 août 1792, afin de prévenir d’éventuels mauvais résultats pour la Convention, Marrans expose sa stratégie en ces termes : « Des curés aristocrates, d’abord dispersés par la crainte, osent déjà rentrer dans leur paroisse et travailler à nous donner de mauvais électeurs. Il faut que la déportation soit signifiée avant le 28 août. »10 Le 11 août, les journaux non jacobins sont interdits ; une liste de 28 000 signataires royalistes exclut de l’élection les signataires. A Paris, où la participation est de moins de 10 %, tous les élus sont des hommes de la Commune. « Dans la façon dont on raconte aux Français la Révolution et l’œuvre de la Convention, il y a donc un extraordinaire mensonge historique. La Convention a prétendu parler au nom du « peuple souverain » et c’est à titre qu’elle s’est arrogé tous les pouvoirs (…). Or, loin de représenter véritablement le peuple, elle a résulté d’un putsch mené paru une petite minorité au mépris de toute démocratie. »11 Le vote pour l’élection de la Convention aura lieu par appel nominal, et à haute voix. Toute ressemblance avec les procédures toujours en vigueur dans les AG universitaires est loin d’être fortuite…
– Songeons également aux journées de 1848. Le 23 et le 24 avril 1848 ont lieu des élections législatives parfaitement régulières. Une majorité démocrate en sort. « L’extrême gauche doit se contenter d’une centaine de sièges. Encore, les socialistes élus ne le sont-ils, le plus souvent, que dans le sillage des Républicains du centre, quand ces derniers les ont accueillis sur leurs listes. »12. Or, fidèle à son habitude, la Gauche, c’est-à-dire l’extrême-gauche politique, ne saurait se contenter d’un tel résultat démocratique. Elle va donc organiser une agitation populaire, et, le 15 mai une manifestation en faveur des Polonais insurgés finit, une fois de plus, en déni démocratique : l’Assemblée nationale et l’hôtel de ville sont envahis. Barbès, Blanqui et Raspail montent au perchoir pour rejeter le résultat des élections, réclamer un nouveau gouvernement, et Huber s’exclame à la tribune : « l’Assemblée est dissoute. », Assemblée élue régulièrement trois semaines plus tôt… Pourrait-on faire preuve de pire déni démocratique ?
– La Commune est, elle aussi, l’occasion de remise en cause du suffrage populaire. Les élections du 8 février offrent à la droite une large victoire à l’assemblée ; à Paris, sur les 20 maires d’arrondissement, seuls deux sont rouges. Contraires aux exigences de l’extrême gauche, les élections vont donc être jugées sans validité, et le 18 mars commence l’insurrection parisienne. Pour contrer les élections municipales régulières, on refait voter le 26 mars de façon irrégulière. Une fois de plus, les modérés sont empêchés de voter, ce que nos historiens rendent en ces termes pudiques : « Les modérés s’abstiennent, et il n’y a que 230 000 votants sur 485 000 inscrits. »13
Pourquoi, devrait-on se demander, la Gauche, ou « 1793 » ont-elles fait preuve de ce permanent déni démocratique, refoulant dans l’infamie tout résultat d’une élection jugé contraire à leurs idéaux ? La réponse de Nemo nous paraît d’une grande acuité : « Je fais l’hypothèse que les mouvements inspirés de « 1793 » obéissent tous, à des degrés divers, à une structure mentale très ancienne, le millénarisme. »14 S’appuyant sur Delumeau, Lubac ou Hermann Cohn, Nemo déconstruit avec bonheur cette étrange croyance, nous amenant au point crucial : « Dans le schéma millénariste apocalyptique originel, si la conduite des opérations est l’affaire des seuls élus, c’est parce que le peuple est essentiellement composé de pécheurs et qu’il ne peut être remis sur la bonne voie que par les saints, qui ne sont qu’une poignée. »15 En d’autres termes, lorsqu’une poignée d’individus se rendent à l’Assemblée, se croyant habilités à la dissoudre contre tout sens démocratique, cela ne peut devenir intelligible que si l’on admet que ces individus se croient détenteurs ou dépositaires d’une Vérité absolue, que rien ne saurait entraver, surtout pas le corps électoral, lequel ne saurait être qu’un corps profondément peccamineux lorsque son vote ne coïncide pas avec le savoir que détiennent ces individus.
Le problème auquel se heurtent les individus de Gauche, au sens de Nemo, c’est au fond celui que décrit Lénine, lorsqu’il se demande si le peuple est en mesure de prendre conscience de ses supposés intérêts ; comment le peuple peut-il voter contre ses intérêts ? « Ainsi, écrit Lénine dans Que faire ?, la question des rapports entre la conscience et la spontanéité offre-t-elle un immense intérêt général et demande-t-elle une étude détaillée. »16 La réponse de Lénine à la spontanéité des intérêts de classes est très claire : elle n’est pas immanente à la classe ouvrière. « L’histoire de tous les pays atteste que, par ses seules forces, la classe ouvrière ne peut arriver qu’à la conscience trade-unioniste, c’est-à-dire à la conviction qu’il faut s’unir en syndicats, mener la lutte contre le patronat, réclamer du gouvernement telles ou telles lois nécessaires aux ouvriers, etc. Quant à la doctrine socialiste, elle est née des théories philosophiques, historiques, économiques élaborées par les représentants instruits des classes possédantes, par les intellectuels. Les fondateurs du socialisme scientifique contemporain, Marx et Engels, appartenaient eux-mêmes par leur situation sociale aux intellectuels bourgeois. »17 Alors que faire ? Il faut éclairer le peuple, pour mener à bien les impératifs de réalisation de la Gauche ; et l’éclairer, cela suppose l’existence de certains élus, de certains êtres supérieurs, totalement affranchis des règles du suffrage, qui auront pour tâche de corriger les errements démocratiques, lorsque le peuple, aveuglé sur ses propres intérêts, aura bêtement voté pour « 1789 » et non pour « 1793 » ; dans ces conditions, le vote sera considéré comme nul et non avenu, l’importance de l’œuvre sera telle que sera légitimé le refus des élections, ainsi que le prouvent largement les actions d’un Blanqui, d’un Raspail, d’un Barbès, autant de boulevards par lesquels Paris, hélas, honore ces tyrans.
III) « 1793 » dans la République
1°) « 1793 » contre la naissance de la République
Contre l’idée reçue voulant que la Gauche ait institué la République en 1870, il convient dans un premier temps que c’est Thiers qui dirige cette IIIème République, « vieillard providentiel plébiscité par la majorité du pays. »18 Or Thiers est conservateur ET républicain. La tentative isolée du comte de Chambord de revenir à une monarchie légitimiste ne rencontre aucun écho à droite. « Les orléanistes et même une partie des légitimistes sont irrités ou découragés par cette prise de position. »19 La droite s’est rangée sous la République, et les principales difficultés proviendront de la Gauche, résolument hostile à la naissance de la IIIème République.
En 1875, les lois constitutionnelles commencent à se faire désirer ; or, cette Constitution républicaine, ce sera la droite, c’est-à-dire les orléanistes pour la majorité, qui la fera adopter ; en effet, « si la restauration de la monarchie s’avère impossible, beaucoup de notables orléanistes préfèrent la République conservatrice à l’hypothèse d’un rétablissement de l’Empire. On revient donc, en somme, au programme de Thiers. »20 La conséquence de tout ceci est que la Constitution va fédérer la droite et les Républicains, de sorte que la droite se convertit de façon définitive à la République. « Un rapprochement s’effectue donc entre le centre-droit et les républicains modérés, notamment dans la commission des lois constitutionnelles. »21. En d’autres termes, comme le synthétise Nemo, « c’est cette famille d’esprit, ces orléanistes ou ex-orléanistes de centre droit, résolument hostiles au jacobinisme, qui élaborent la Constitution de la IIIè République. »22
L’idée même d’un Président de la République est profondément contraire aux idéaux de « 1793 », lesquels préfèreront toujours un exécutif collégial. « De fait, écrit Nemo, si l’on examine les principales institutions qui sont alors mises en place, on s’aperçoit que ce sont, pour l’essentiel, des institutions de démocratie libérale, qui peuvent entrer dans le cadre d’un régime républicain comme celui des Etats-Unis, ou d’un régime de monarchie parlementaire comme celui de l’Angleterre, mais qui ne correspondent en aucune façon aux institutions, et encore moins à l’esprit, de la Ière République jacobine. Les trois points essentiels sont la présidence de la République, l’existence d’une Chambre haute, le parlementarisme. »23 La naissance de la République ne saurait donc être attribuée à la Gauche, au sens conceptuel, et la nature même de sa constitution en fait un produit résolument libéral, et essentiellement incompatible avec « 1793 ». Rien ne serait donc plus faux que de faire de la IIIème République le produit des luttes progressistes, de l’idéal socialiste, elle est un pur produit d’une pensée libérale, de centre-droit et de centre-gauche, auxquels se sont ajoutés les orléanistes.
La meilleure preuve de cette situation est, aux yeux de Nemo, l’année 1889 où, la droite est sévèrement battue, sans que ne se réveille la Gauche, « qui commence à peine à se relever de la répression de la Commune et des poursuites contre l’Internationale. Beaucoup de militants se sont réfugiés en Suisse (anarchistes) ou en Angleterre (blanquistes). »24 Cela veut bien dire que la République a pu se construire parce que la Gauche était exsangue, que la République s’est construite en dépit de la Gauche et non grâce à la Gauche. C’est bien l’apathie de la Gauche qui a rendu possible la naissance républicaine, d’abord assumée par le conservateur Thiers, et concrétisée par les centres et les orléanistes. Il faut ainsi mettre fin à « une sorte de droit de propriété des socialistes et des communistes sur la République. Ce n’est pas eux qui l’ont fondée. Ceux qui l’ont fondée, ce sont, d’une part, les monarchistes constitutionnels – orléanistes, légitimistes libéraux et bonapartistes – et, d’autre part, la fraction des républicains qui, adversaire déterminée des « rouges », a approuvé la répression brutale de la Commune. »25
2°) Persécutions religieuses
Opposant la politique laïque, qui serait une séparation rationnelle des Eglises et de l’Etat au laïcisme, qui serait une religion de substitution, Nemo va exhumer les textes de grands protagonistes de l’époque, afin de prouver que le laïcisme tel qu’il sera mis en œuvre par « 1793 » aura pour objet explicite de créer de toutes pièces une nouvelle religion à laquelle devra se soumettre le peuple français. Quinet, dont l’enseignement du peuple (1850) sert de fil conducteur, peut être appréhendé comme le symptôme le plus manifeste de cette tendance profondément antichrétienne, pourtant mâtinée de millénarisme religieux. Ce qui sera fascinant, ce sera d’observer, une fois de plus, la manière dont ces élus autoproclamés affirmeront la nécessité de sortir de toute légalité, donc de la démocratie, pour prétendument renforcer celle-ci. Ainsi Quinet déclare-t-il que « le despotisme religieux ne peut être extirpé sans qu’on sorte de la légalité »26. On ne saurait mieux dire : certains impératifs supérieurs – mais qui les a décrétés supérieurs ? – ne sauraient être accomplis par le respect des fondements mêmes de la démocratie et supposent de contourner ceux-ci afin d’accomplir la mission de réalisation du Bien, i.e., les « Idéaux » révolutionnaires de 1793. Certes, dira le lecteur sceptique, mais rien ne prouve que ce combat soit d’ordre religieux ; or, page 37 de l’enseignement du peuple, Quinet explique fort bien « la France nouvelle ne doit avoir qu’une seule foi », que le dessein même de son action est de donner à la France une seule et même religion, celle de la France moderne : « la France nouvelle, écrit Quinet, ne doit avoir qu’une seule foi ». « Une seule foi », c’est-à-dire cette foi révolutionnaire, cette foi de « 1793 », cette foi laïciste et millénariste, cette foi en la Gauche, seule religion valable et légitime aux yeux du progrès historique. C’est ce que Leroy-Beaulieu avait fort bien saisi : « Aux yeux de la démocratie radicale, la religion est une rivale dont elle refuse de tolérer la concurrence. La Révolution ne prétend à rien moins qu’à remplacer les vieux cultes et à en tenir lieu. Aussi bien est-ce une guerre de religion (…) qu’elle fait au christianisme. »27 On ne saurait mieux dire.
Si le laïcisme est bien une religion, encore lui faut-il une Eglise ; cette Eglise, aux yeux de Nemo, sera la maçonnerie, véritable bras armé de la République. « Si la franc-maçonnerie est l’Eglise de la République, on devra dire et penser que seuls ceux qui, membres ou non, partagent son credo sont de vrais républicains. Inversement, ceux qui s’opposent aux orientations philosophiques et politiques de la secte pourront être présentés comme des ennemis de la République, ou du moins comme des républicains tièdes ou douteux. Ce qui reviendra, pour la franc-maçonnerie et son bras séculier, le Parti-radical socialiste, à lancer sur la République une véritable OPA. »28 Il est vrai que le triptyque « liberté égalité fraternité » ne se comprend qu’en référence à l’idéal maçonnique, dans son œuvre de substitution aux vertus théologales, « charité foi espérance » ; il serait certainement lacunaire de ne pas voir à l’œuvre une lutte symbolique entre le triptyque chrétien et le triptyque maçonnique devenu slogan républicain, mais peut-être conviendrait-il, ici, d’émettre des réserves : la provenance maçonnique de cette devise n’en exclut pas la validité, ni n’en définit un champ d’illégitimité. Il est à craindre que Nemo verse dans la dénonciation du « d’où tu parles », de l’étude de la nature d’un discours, ou d’une devise, pour mieux en éluder le contenu objectif. En effet, dire que le triptyque « liberté, égalité, fraternité » est d’origine maçonnique ou regretter la mainmise de la maçonnerie sur la République revient à regretter l’origine d’un discours plus que son contenu, quand bien même relierait-on les persécutions religieuses (songeons à la loi de 1901 sur les associations interdisant les congrégations religieuses) à une origine maçonnique. En outre, il n’est pas certain qu’on puisse unifier la maçonnerie à ce point, dont on sait à quel point elle est éclatée, diverse ; peut-être donc faudrait-il parler d’une mainmise du Grand Orient plus que de la maçonnerie sur la République et les persécutions religieuses, afin de ne pas ramener arbitrairement à l’unité un mouvement protéiforme.
3°) Le mensonge à l’œuvre
a) L’affaire Dreyfus
Les parties les plus ahurissantes, à mon sens, de l’ouvrage de Nemo, sont celles consacrées à la Collaboration et à l’affaire Dreyfus ; Nemo exhibe des sources fort intéressantes remettant profondément en cause l’image d’Epinal habituellement répandue par la doxa voulant que la droite soit antisémite, antidreyfusarde et collabo, tandis que la gauche aurait été résistante, dreyfusarde, et républicaine. Lisons par exemple ce qu’en dit le manuel d’histoire contemporaine qu’a lu tout hypokhâgneux et étudiant en histoire à la fac : « L’opinion se divise désormais entre dreyfusards et antidreyfusards. Les premiers invoquent les droits de l’Homme, la liberté individuelle, la recherche de la vérité et la justice. Ils représentent, en gros la gauche politique, non sans hésitations ni réserves. Ainsi les socialistes, les guesdistes surtout, estiment qu’il faut laisser les bourgeois capitalistes se déchirer entre eux. (…). En face, la droite, la majeure partie des catholiques – les laïcs et les congrégations plus que le clergé séculier du reste – et les nationalistes mettent en avant l’intérêt supérieur du pays, l’honneur de l’armée, la raison d’Etat au-dessus des cas individuels. La Ligue des Patriotes (Déroulède), celle de la Patrie française (Barrès), la Ligue antisémite (Guérin) et un peu plus tard la ligue d’Action française dénoncent le complot judéo-maçonnique ou judéo-protestant. »29. Soit, n’en jetez plus, le bien contre le mal est à l’œuvre, la Gauche (au sens conceptuel et politique) incarnant le Bien, la droite incarnant, comme toujours, le Mal. Etrange omission, pourtant, nos deux auteurs ne relatent l’affaire qu’à partir de 1898, alors que tout avait commencé, en réalité, en 1894. Comme si tout n’était pas vraiment bon à dire, pour ne pas salir le mythe de la Gauche éprise de justice contre cette droite sale et ignoble.
Prenant stratégiquement appui sur Léon Blum et ses Souvenirs de l’Affaire, Nemo va démonter progressivement ce mythe d’une Gauche dreyfusarde. Initialement, se rappelle Léon Blum, c’est chez les Républicains modérés, les Orléanistes et les libéraux que Dreyfus trouva ses soutiens. « C’est dans ce milieu composite, écrit Blum, que les dreyfusards trouvèrent d’emblée le plus de partisans ouverts, et surtout plus d’alliés secrets ou discrets. »30 Mieux que cela se souvient Blum, ces fameux milieux catholiques et conservateurs ou royalistes ne semblèrent pas, à ses yeux, farouchement antidreyfusards : « Les Princes, les prétendants, les membres des familles royale et impériale, ne doutaient pas de l’innocence de Dreyfus. L’impératrice Eugénie, par exemple, était dreyfusarde convaincue et résolue. »31 Les hommes d’Eglise ? Etaient dreyfusards « le pape et les plus hauts dignitaires de l’Eglise romaine »32 Voilà qui ne rentre pas aisément dans le logiciel manichéen de l’histoire officielle.
Qui, alors, était antidreyfusard ? Les Drumont, les Barrès, Guérin, Rochefort, et autres nationalistes. Fort bien ; mais qui sont-ils au moment de l’affaire ? Barrès, par exemple, est un député boulangiste depuis 1889, ouvertement de gauche et lu par la Gauche, Blum en premier, car à ce moment très précis, Barrès n’est pas encore cet homme d’extrême-droite nationaliste ; doit-on rappeler que Barrès écrivait dans un Homme libre : « Je vais jusqu’à penser que ce serait un bon système de vie de n’avoir pas de domicile, d’habiter n’importe où dans le monde. »
Drumont, quant à lui, est très loin d’être le conservateur d’extrême-droite que l’on décrit habituellement ; il est d’abord cet anticapitaliste viscéral, ce penseur antilibéral assimilant le libéralisme haï aux Juifs détestés parce que libéraux. Il suffit d’ouvrir la France juive pour y lire à chaque page sa haine de la droite conservatrice et du libéralisme ; ainsi, par exemple, il dit détester « tous ces grands-seigneurs accourus pour faire des courbettes chez les Rotschild. »33 et surtout il se veut être « à l’avant-garde de l’armée socialiste. »34 Quel est son idéal politique ? Il attend un Chef « un homme du peuple, un chef socialiste 35, qui aura refusé d’imiter ses camarades et de se laisser subventionner, comme eux, par la Synagogue, reprendra notre campagne. »36 Ne pas voir que Drumont est avant toutes choses un socialiste qui a en haine la démocratie libérale et les Juifs censés l’incarner, voilà qui relèverait du mensonge historique le plus flagrant.
Faut-il vraiment exhiber les propos infectes d’un Proudhon, socialiste s’il en fut, à l’encontre des Juifs ? « Juifs. Faire un article contre cette race, écrit Proudhon qui envenime tout, en se fourrant partout, sans jamais se fondre avec aucun peuple. Demander son expulsion de France… Il faut renvoyer cette race en Asie, ou l’exterminer. H. Heine, A. Weil et autres que des espions secrets ; Rotschild, Crémieux, Marx, Fould, êtres méchants, bilieux, envieux, âcres, etc., qui nous haïssent… Il faut que le Juif disparaisse… La haine du Juif, comme de l’Anglais, doit être un article de notre foi politique. »37 Faut-il également citer Blanqui pour lequel la République libérale est « l’intronisation définitive des Rotschild, l’avènement des juifs. »38 L’antisémitisme est un phénomène consécutif de l’antilibéralisme, du refus de « 1789 », c’est-à-dire le corrélat logique de la pensée de « 1793 ». Ne pas voir cela, faire croire que l’antisémitisme est consubstantiel à la droite alors qu’il procède de toute évidence de la vieille pensée de « 1793 », c’est répandre un mensonge officiel, occultant la réalité même de l’histoire. Rien de surprenant à retrouver chez ces antisémites patentés les antidreyfusards les plus virulents.
Nous pouvons donc conclure, non pas avec Nemo, mais avec Léon Blum qui écrit dans ses Souvenirs : « Je puis affirmer, sans forcer en rien la vérité, que ceux qui devaient, un peu plus tard, former la base du « Bloc des gauches » étaient alors, en grande majorité, hostiles à la révision. »39 Et pour cause, ceux qui allaient former le bloc des gauches étaient, pour une grande part, nourris de pensée socialiste, de blanquisme, de Proudhon, de Guesdisme pour lesquels le Juif était l’incarnation même de l’horreur libérale. Faut-il ajouter à ce triste spectacle la longue litanie de notables socialistes et profondément antisémites, comme Fernand Grégoire, auteur en 1888 de la Juiverie algérienne et créateur de la Ligue radicale socialiste antijuive.
Il ne s’agit toutefois pas de verser dans le manichéisme inverse et de prétendre que la Gauche aurait eu l’exclusivité de l’antisémitisme, ce qui serait tout aussi imbécile que le manichéisme actuel ; il ne s’agit pas de nier l’antisémitisme d’un journal comme la Croix qui fut vigoureusement antidreyfusarde, mais encore faut-il admettre la complexité du réel, et reconnaître que l’antisémitisme fut théorisé aussi – et peut-être même d’abord – par ces hommes de « 1793 », ces socialistes assimilant le libéralisme aux financiers Juifs, appelant comme Proudhon à exterminer ces derniers, alors que les hautes autorités religieuses catholiques criaient haut et fort leur croyance en l’innocence de Dreyfus ; faut-il rappeler que le Pape lui-même, dans un entretien au Figaro du 15 mars 1899 compara Dreyfus au Christ, tous deux unis dans la même souffrance victimaire ? Faut-il rappeler que sur les 50 000 prêtres français de l’époque, seuls 300 souscrivirent en faveur de la veuve du colonel Henry ? Faut-il rappeler que Dreyfus lui-même fit part des nombreux messages de soutien que lui adressèrent les catholiques lorsque tout le monde l’avait abandonné ? Faut-il rappeler, à l’inverse, que la Dépêche du midi, organe de diffusion radical-socialiste fut entièrement acquis à Drumont et aux antidreyfusards ? Bref, loin d’être la lutte du Bien de Gauche contre le Mal de Droite, cette Affaire polarisa en réalité les libéraux contre les étatistes nationalistes ; le centre, les orléanistes et les catholiques modérés contre les socialistes et les nationalistes. Il nous semble donc que le schème interprétatif proposé par Nemo revêt dans l’Affaire Dreyfus tout son sens, et toute la force féconde d’une lecture nouvelle des antagonismes de l’époque.
Certes, après le fameux coup de canne de Christiani donné à Loubet en 1499, la Gauche modifie sa vision de l’Affaire et vire, pour une grande part dreyfusarde ; il ne s’agit toutefois pas, notent Halévy et Sternhell, de défendre l’honneur d’un officier, mais de défendre l’humiliation d’un homme du peuple, Loubet, contre l’arrogance de l’aristocratie. C’est du reste la thèse que défend également Blum dans ses Souvenirs. Le réveil de la Gauche survient en réaction, le lendemain de ce coup de canne, laquelle Gauche défile le 11 janvier, pour défendre l’honneur du peuple outragé. « Le peuple, dit Halévy, n’est pas entré dans la cause des dreyfusards, mais à côté. Ce qui signifie que, si l’électorat des partis de gauche a changé, ce n’est pas qu’il aurait enfin compris le fond de l’affaire judiciaire et la nature odieuse de l’antisémitisme. C’est que, à cause de cette agression spectaculaire perpétrée par un aristocrate contre l’élu du peuple Loubet, il a l’impression que ce sont les gens de la « haute » qui dirigent le camp antidreyfusard. »40
b) La « droite révolutionnaire »
Nous reprenons à Sternhell cette expression qualifiant les révolutionnaires de « 1793 » passés à droite après l’affaire, c’est-à-dire tous ces socialistes demeurés révolutionnaires, antilibéraux, et antidémocrates, formant cette nouvelle force politique appelée « extrême-droite ». Sternhell, puis Nemo, ont comme thèse le fait que tous les leaders d’extrême-droite nationaliste proviennent en réalité de la Gauche jacobine, de « 1793 » ; c’est évidemment le cas de Barrès qui, en 1897, se dit encore « socialiste et jacobin », mais ce sera aussi, et surtout, le cas de Mussolini, de Déat, de Doriot, d’Henri de Man, en somme de tous les noms de la collaboration avec le fascisme. Les nationalistes, aux yeux de Nemo, sont des hommes de gauche, restés fidèles aux idéaux révolutionnaires, passés tactiquement à droite. Ainsi, « ces Jacobins resteront fondamentalement tels par le tempérament, le langage, et d’abord et avant tout par l’atavisme antilibéral. Ils resteront des révolutionnaires. Au sein du nouveau camp de la droite, ils seront et demeureront des hommes de « 1793 ». »41
Cette thèse, absolument inadmissible aux yeux de la Gauche, mérite d’être étayée par quelques faits indiscutables, tirés à partir de la simple observation de l’identité politique de ceux qui menèrent la France à la honte collaborationniste.
Qui est Darlan ? Comment se définit-il ? « Je suis un homme de gauche » affirme-t-il, ainsi que le rappelle Cointet, que cite Nemo 42. Du reste, Darlan était fort apprécié par les hommes de gauche, pour avoir voulu, avant guerre, organiser une intervention aux Baléares en faveur des Républicains espagnols. Il sera fort logiquement assassiné par un conservateur royaliste qui voyait en lui un socialiste franc-maçon…
Qui est Laval ? Un député socialiste, blanquiste depuis toujours, qui avait négocié une Alliance avec l’URSS en 1935. Provenant de l’extrême-gauche, il sera un des membres les plus actifs de la Collaboration « voulue » avec le national-socialisme.
Qui est Doriot ? Un dirigeant communiste, secrétaire général des Jeunesses communistes. « Le parti, qui approuve les régimes fascistes auxquels il reconnaît le mérite de réaliser l’essentiel des buts du socialisme, devient logiquement collaborationniste sous l’Occupation. »43 Est-ce également un hasard si son Journal, Le cri du peuple, paraissant jusqu’en 1944 autorisé par les nazis, ait comme titre celui de Vallès sous la Commune de Paris ?
Le ministre de l’Intérieur de Vichy, Adrien Marquet, n’est autre que le maire socialiste de Bordeaux. Le ministre du Travail, René Belin, n’est autre que le secrétaire général de la CGT. Paul Marion, secrétaire à l’information de Laval et Darlan, fit ses classes comme responsable de la propagande au PCF. Nous pourrions prolonger ad nauseam la liste de ces socialistes ou communistes passés à la collaboration, la plupart du temps avec un zèle remarquable.
Il convient donc de réfléchir ces faits, indiscutables : pourquoi de tels passages furent-ils aussi nombreux, aussi aisés et aussi systématiques ? Que signifie le fait qu’à l’exception de Pétain, du reste rapidement écarté par Darlan, la quasi-totalité des têtes d’affiche de la Collaboration furent de gauche ? Et pourquoi l’Histoire imposa-t-elle de retenir comme collaborateur du national-socialisme Pétain, le seul qui fût de droite, et non ses successeurs, de Gauche, infiniment plus nombreux ? Pourquoi ne pas rappeler que ce fut une assemblée de Gauche qui vota les pleins pouvoirs à Pétain ? Il ne s’agit pas de dresser des listes noires, mais de se demander rationnellement pourquoi est opéré par l’histoire officielle un tel tri, pourquoi tout homme de Gauche se trouve aussitôt amnistié de ses crimes, tandis que l’homme de droite s’en trouve chargé à vie ; pourquoi tout citoyen français sortant du lycée est-il convaincu que la Gauche fut anti-nazie, et la droite collaborationniste et antidreyfusarde ? « Ce qui importe pour notre propos n’est évidemment pas d’incriminer tel ou tel. C’est de comprendre que la présence de ces excellents « républicains » d’ascendance « 1793 » dans le régime honni ne relève nullement de l’accident ; qu’elle est au contraire, parfaitement dans la nature des choses, dans le prolongement du révolutionnarisme jacobin. »44 En d’autres termes, aux yeux de Nemo, l’attrait pour le national-socialisme n’est réel et possible que pour ceux qui ont déjà intégré le logiciel socialiste de « 1793 », c’est-à-dire la négation de l’individu, le culte de l’Etat, la haine du libéralisme. « Déat, Doriot, Bergery, Belin, Marquet, Marion et consorts étaient jusque-là républicains parce qu’ils entendaient par « République » un régime jacobin, une machine de guerre contre le libéralisme. (…). La raison de fond de leur adhésion est qu’ils savent gré à Hitler d’avoir abattu le capitalisme. (…). Des millénaristes reportant tous leurs espoirs de révolution sur le « socialiste » Hitler, vainqueur de la vieille société bourgeoise corrompue, telle est l’explication de fond de la collaboration, qui n’aura rien été d’autre qu’un nouvel avatar sinistre de « 1793 ». »45
En conclusion, il nous faut rendre un hommage appuyé à cet ouvrage courageux, prenant le contre-pied absolu de la pensée dominante ; contre le manichéisme ambiant, Nemo restitue la complexité des luttes politiques, ce qui suppose de renoncer à ce schème habituel des Républicains contre les Monarchistes pour faire jouer une tension à l’intérieur même des Républicains : il y a ceux qui acceptent la démocratie libérale, en gros « 1789 » et ceux qui la refusent, ceux qui la contournent en permanence afin de réaliser leurs espoirs métaphysiques, religieux, « millénaristes » affirme Nemo, c’est-à-dire « 1793 » pour lesquels la Terreur, les assassinats de masse seront le moyen privilégié d’éradiquer les obstacles matériels à l’accomplissement de leurs idéaux prétendument purs. Ce livre invite donc à penser comment il se peut que toujours aujourd’hui, des individus considèrent comme légitime pour asseoir leurs idéaux censés être généreux, l’assassinat de milliers ou de millions d’individus, comment l’ « idéal » justifie donc l’effacement – au sens premier – du réel, et comment seule une croyance fondamentalement religieuse permet de rendre intelligible une telle folie, un tel aveuglement où la « justice sociale » légitime la suppression physique de milliers d’individus. Il y a là un obstacle auquel se heurte la raison, et auquel seule la croyance millénariste peut apporter une réponse intelligible ; c’est cette réponse que Nemo, à la suite de Lubac, nous semble avoir apportée, en l’étayant de faits précis rigoureux, en montrant de manière convaincante que seul un antilibéralisme forcené pouvait conduire tous ces hommes à embrasser le national-socialisme où ils retrouvaient leurs idéaux étatistes et mortifères, tout en éprouvant l’orgueil de se croire « élus ».
- Philippe Nemo, Les deux républiques françaises, PUF, 2008
- Ibid, p. 248
- Ibid. p. 2
- cité p. 17
- Ibid
- Maël Thierry, Besancenot dans la toile, in Le Nouvel Observateur, 9-15 octobre 2008, p. 68
- Ibid
- Nemo, op. cit., p. 30
- Ibid. p. 34
- Cité p. 35
- Ibid, p. 37
- Antoine Olivesi et André Nouschi, La France de 1848 à 1914, Nathan Université, 1997, p. 24
- Ibid. p. 155
- Nemo, op. cit., p. 46
- Ibid. p. 48
- Lénine, Que faire ?, Editions sociales, Paris, Moscou, 1971, p. 45
- Ibid. p. 47
- Olivesi et Nouschi, op. cit., p. 158
- Ibid. p. 159
- Ibid. p. 163
- Ibid
- Nemo, op. cit., p. 71
- Ibid. p. 72
- Olivesi et Nouschi, op. cit., p. 169
- Nemo, op. cit., p. 88
- Cité p. 101
- Cité p. 105
- Ibid. p. 117
- Olivesi et Nouschi, op. cit., pp. 318-319
- Nemo, op. cit., Cité p. 145
- Cité p. 145
- Cité p. 145
- Cité p. 297
- Cité p. 297
- je souligne
- Cité. p. 297
- Cité pp. 150-151
- Cité p. 151
- Cité p. 148
- Ibid. p. 172
- Ibid. p. 176
- cf. p. 208
- Ibid. p. 209
- Ibid. p. 212
- Ibid. pp. 212-213







