À l’heure où l’interdisciplinarité inonde les discours les plus convenus sur l’ « innovation pédagogique » – Ecole et Université confondues -, le livre1 de Bruno Karsenti permet de jeter un regard pénétrant et inactuel sur le sens d’une véritable pratique interdisciplinaire. Proposant un croisement systématique de la philosophie et des sciences sociales, il nous offre, dans cet ouvrage, un bel aperçu des fruits de son travail de « philosophie des sciences sociales » (p. 13). Avant d’en venir aux douze chapitres qui forment ce volume, précisons d’emblée le sens inédit et engagé que revêt une telle pratique de la philosophie.
La philosophie altérée
Il ne s’agit ni de fonder philosophiquement les sciences sociales ni de pratiquer une philosophie ancillaire des sciences, mais de penser la philosophie et les sciences sociales dans leur altérité constitutive. Ce qui se dit mieux en termes d’« altération » (p.18) dans la mesure où, pour Karsenti , la philosophie se trouve définitivement altérée par l’émergence, à partir du milieu du 19ème, des sciences sociales. De sorte que le diagnostic archéologique de M. Foucault au sujet de l’épistémè moderne doit être radicalisé en ce que celle-ci ne fait pas tant surgir la question de l’homme dans les sciences humaines que celle de la société ou du social comme le sujet propre de notre modernité. Ce serait donc avant tout la société qui fait son apparition avec la modernité, et ce à la faveur de l’émergence d’un nouveau type de savoir : la sociologie.
Aussi, loin de rendre la philosophie soluble dans les sciences humaines, Karsenti la charge, au contraire, d’une nouvelle tâche d’ordre généalogique : comprendre que la naissance des sciences sociales pour notre modernité politique est au moins aussi décisive que la naissance de la philosophie avec Socrate pour la société athénienne, à ceci près que le point de rupture n’est pas ici endogène à la philosophie mais situé en dehors d’elle-même. D’où le sens de l’altération de la philosophie qui consiste à faire la généalogie des sciences sociales pour mieux rompre avec cette sorte d’apoplexie dont souffre la philosophie politique instituée et qui provient, précisément, de son incapacité à se laisser altérer ou penser par le savoir sociologique.
La philosophie relancée
Mais, ce qu’il faut comprendre, c’est que c’est la philosophie qui se trouve aussi bien « relancée » (p. 26) par cette altération. De sorte que la philosophie aujourd’hui ne doit plus se penser in abstracto mais en dialogue constant avec les sciences sociales et c’est à cette condition qu’elle peut retrouver un ancrage dans le « terreau » politique du présent. D’où l’idée de reconstruire le « dialogue des modernes » (sous-titre de l’introduction) qui, loin de se réduire à un simple échange de vues, cherche à établir une communauté d’esprit qui excède la division du travail intellectuel en ce qu’elle se situe dans l’interstice de la philosophie et des sciences sociales. Par où l’on voit que l’interdisciplinarité n’a pas seulement un sens épistémique mais une véritable « teneur politique » (p. 20). C’est en effet en sortant des « ornières de la philosophie politique classique » (p. 136), notamment en France, que Karsenti suggère de pratiquer une autre philosophie politique où ce qui est central, ce n’est pas l’État de droit et ses institutions mais la société et les rapports sociaux. Dans le sillage de M. Foucault, Karsenti milite ainsi pour l’adoption d’une philosophie « hors les murs » (p. 289) qui, dans l’écart constitutif de la « vision sociologique » et de la philosophie, problématise leur plan immanent d’expérience sociale : la modernité politique ou, ce qui revient au même, les sociétés modernes et démocratiques. Où l’on voit que la démarche interdisciplinaire de B. Karsenti implique une sorte de chiasme : faire sortir la philosophie d’elle-même, pour mieux mesurer en retour l’apport philosophique des sciences sociales.
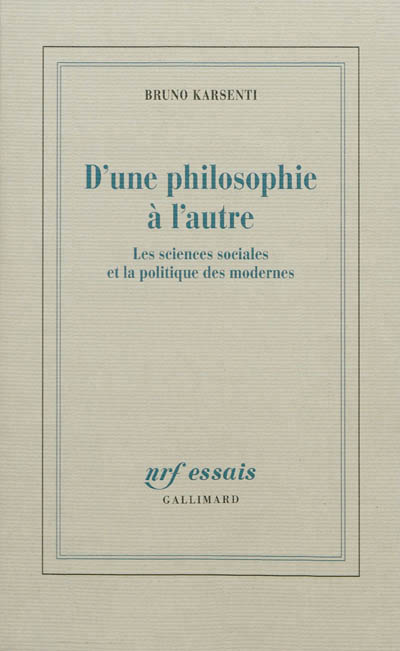
Pour faire apparaître ce plan politique inhérent à la modernité, alternatif et « décalé » (p. 28) par rapport à la politique dite classique, l’ouvrage se présente modestement comme des exercices de « lectures » (p. 31) qui, le cas échéant, reprennent plusieurs articles parus ces douze dernières années et remaniés dans le sens d’une « trame unitaire » (p. 334).
La densité et la diversité des thèmes abordés font qu’il n’est pas toujours facile au lecteur de ressaisir la logique d’ensemble. Pour faciliter notre parcours, nous proposons donc de répartir les douze chapitres en deux axes : d’une part, celui des différentes figures de l’altération de la philosophie par les sciences sociales (chapitre I à VI) et, d’autre part, celui du terrain sociologique, dans la mesure où les chapitres VII à XII se situent davantage « au cœur des sciences sociales constituées » (p. 135).
Trois altérations de la philosophie (chapitres I à IV)
Les trois premiers chapitre peuvent se lire comme trois figures de l’altération de la philosophie qui impliquent, en retour, des « torsions » (p. 64) conceptuelles portant sur les concepts politiques de gouvernement, d’autorité, de souveraineté (populaire) et de démocratie.
Partant de l’intrusion propre à la modernité de l’économie dans la sphère politique, le premier chapitre s’ouvre sur une incertitude entre deux généalogies : faut-il faire une généalogie de la politique « de type économique » comme Marx et, d’une autre façon, comme les sciences sociales (Weber, Durkheim) ou en suivre une autre, plus originale, « de type théologique », comme G. Agamben dans Le règne et la gloire (2007) où il s’agit de dériver l’économie du plan de gestion de Dieu sur les hommes ? Cette dernière tentative radicalise la généalogie foucaldienne du gouvernement en le rapportant non seulement au « pouvoir pastoral » et donc encore à une instance politique mais, plus originairement, à son plan économico-théologique. Sans entrer dans le détail de la relecture, ce chapitre pose de manière sous-jacente une sorte de « mystère » (p. 48) de la politique qui, en retour, permet de dégager l’horizon plus vaste à partir duquel la modernité politique se détache dans « l’oubli théologique » (p. 53) de sa propre origine.
La seconde altération de la philosophie s’opère à partir d’un « détour généalogique » (p. 88) par la pensée contre-révolutionnaire de Bonald. Loin d’être un « égarement théologique » selon la formule de Koyré (p. 65), celle-ci incarne au contraire un esprit sociologique de premier ordre. Comme l’auteur le suggère, la pensée de Bonald représenterait une « matrice » (p. 65) pour les sciences sociales du fait qu’il a su poser le problème politique sociologiquement en déplaçant la question de la souveraineté vers celle de la société et des « relations de pouvoir » qui la traversent.
À travers sa redéfinition du pouvoir comme rapport social pensé sur le modèle de la médiation christique, « l’innovation conservatrice » (p. 66) de Bonald consiste d’une part en la « refondation sociale » de la politique à l’écart des théories artificialiste du droit naturel et, d’autre part, en une anticipation de la sociologie d’un Comte ou d’un Durkheim. Le détour par Bonald a donc ceci d’étonnant qu’il permet de mesurer la « fécondité sociologique » d’une pensée généralement jugée conservatrice et anti-moderne. Or Karsenti insiste, au contraire, sur la dimension proprement moderne de l’approche bonaldienne, réévaluant par là même l’opposition politique convenue entre progressisme et conservatisme, révolution et contre-révolution.
La troisième figure de l’altération se trouve exposée à partir du concept de démocratie que Karsenti propose d’aborder non comme régime politique mais comme « vie sociale » inséparablement liée à notre modernité et à l’émergence des sciences sociales. Rappelons que les sciences sociales sont, pour Karsenti, de « valeur intrinsèquement démocratiques » (p. 24) puisque c’est le plan immanent de la société qui s’y trouve entièrement déployé.
Avant de reprendre les motifs de la critique comtienne de la souveraineté populaire fondée sur l’idéologie du consentement et de la liberté d’examen (chapitre IV), Karsenti propose une relecture très stimulante de Rousseau qui montre que l’auteur de l’Emile fait figure de « seuil » (p. 94) pour la pensée politique moderne. Le problème de la démocratie pour Rousseau se trouve à même la séparation, constitutive dans sa pensée (la « grande condition formelle »), entre la souveraineté et le gouvernement. Karsenti déduit de cette tension un véritable « corps-à-corps politique » (p. 101) entre une volonté particularisée (un gouvernement étant un corps) et la volonté générale (un acte délibératif de la souveraineté). Il s’agit in fine de penser, à travers le rôle du législateur, la volonté générale comme « volonté sociale » (p.108) ; ce qui rapproche, de manière inédite, la philosophie rousseauiste de la sociologie naissant un demi-siècle un siècle après lui.
Dette et distance envers Foucault (chapitres V et VI)
Pour clore ce premier parcours consacré aux différents écarts entre les concepts de la philosophie politique classique (gouvernement, souveraineté, démocratie) et ceux des sciences sociales naissantes (autorité, société, rapport social), deux chapitres sont consacrés à Foucault, ce dernier étant ici relu comme un précurseur dans le « passage d’une philosophie à l’autre » (p. 28-29) tel que Karsenti cherche à le pratiquer.
Au travers d’une relecture de la dernière période de l’œuvre de Foucault (Sécurité, territoire et population et Il faut défendre la société), Karsenti cherche définir les raisons du « tournant » de la gouvernementalité mais aussi à « prendre ses distances » (p. 137) avec la généalogie foucaldienne. Le tournant s’impose dès lors que Foucault « en Cuvier de la politique » (p. 152) ouvre l’Etat sur autre chose que lui-même en en faisant une modalité du gouvernement. Ce démontage de la logique étatique est en même temps un élargissement, puisqu’il suppose de sortir de la philosophie politique classique (théorie de la souveraineté) pour la rattacher à un plan « hétérogène » croisant christianisme et politique et ouvrant sur une autre généalogie à « plus grand angle » (p. 148) de la politique moderne.
Mais, malgré cette percée généalogique, Karsenti montre qu’il est nécessaire de prendre ses distances avec Foucault en raison d’une « absence dans Foucault » (p. 171), celle du plan immanent de la société et d’une science du gouvernement de la société. Absence dont Karsenti propose une périodisation se situant en amont et en aval de Il faut défendre la société (1975-1976). Si l’année 1976 ouvre une brèche en direction d’une pensée sociale, Foucault la referme très vite en subsumant cette dernière sous la notion politique de gouvernementalité et, par la suite, de biopouvoir. Karsenti lit en effet les cours de 1976 dans le sens d’une pensée sociale où l’enjeu caché derrière la généalogie du pouvoir politique est de tracer l’esquisse d’une « généalogie du radicalisme politique » (p. 160) renvoyant dos à dos monarchisme et démocratisme au nom des droits de la société prise comme un tout. Reste que Foucault, dès 1977, délaisse le « motif politico-épistémique de la société » (p. 171) pour celui de population et se prive ainsi du « pivot majeur » (p. 170) de la sociologie pour penser la science du gouvernement de la société.
Comparatisme et modernité (chapitre VII)
Le chapitre VII opère une bifurcation dans la mesure où Karsenti se tourne, dans les chapitres qui lui succèdent, vers les sciences sociales constituées. Ce chapitre a ceci de spécifique qu’il remonte jusqu’à la « généalogie de la généalogie » (p. 183), à savoir celle de la modernité. L’idée de « politique des modernes » qui traverse tout l’ouvrage implique en effet que ce sont les sciences sociales qui représentent « le foyer épistémique majeur » (p. 176) de la modernité et non, comme le croit la politique classique, la philosophie des Lumières. De sorte que ce déplacement a pour conséquence de faire de l’émergence de la société non seulement un nouvel objet épistémique pour les sciences, mais le lieu même d’inscription de la modernité politique.
Prenant appui sur la théorie de la modernité exposée dans Le raisonnement de l’ours (V. Descombes), Karsenti situe l’origine de la modernité dans la sortie des Lumières (milieu 19ème), c’est-à-dire exactement au moment où l’on passe, dans les termes de Descombes, de « l’esprit moderne » (universaliste et humaniste) à la modernité (universalité située historiquement et sociologiquement). De sorte que ce qui caractérise la modernité, ce n’est pas la seule question du présent ou de l’actualité (Foucault) mais l’écart à soi du présent que Karsenti conceptualise sous le terme de « comparatisme » (p. 176). Précisons que le comparatisme désigne au moins deux choses. D’une part, il est la condition épistémique des sciences sociales : « pas de sciences sociales sans comparatisme » (p. 176). Mais, il désigne également une « double distance » définissant notre « appartenance à la modernité » : se savoir appartenir à une époque donnée et, en même temps, à une forme de société comparée à d’autres. Aussi le comparatisme représente-t-il, pour Karsenti et dans le sillage de Descombes, le « levier fondamental de la pensée moderne » (p. 309), ce qui explique qu’on le trouve au cœur de la « confrontation actuelle » (p. 176) entre la philosophie et les sciences sociales.
La philosophie sur le terrain des sciences sociales (chapitres VIII à XII)
Cette confrontation se poursuit ensuite sur le terrain des sciences sociales à travers la relecture de L. Sebag (Marxisme et structuralisme), P. Bourdieu (Esquisse d’une théorie de la pratique), L. Boltanski (Le nouvel esprit du capitalisme et La condition fœtale) et Comte à partir de la question, centrale pour le comparatisme, du « culte des morts ».
Sans reprendre en détail la relecture « philosophique » toujours précise et serrée de ces œuvres de sociologie, nous proposons simplement d’indiquer le rôle moteur (épistémique et politique) que le comparatisme joue dans l’interprétation qu’en propose Karsenti.
Les chapitres VIII et IX cherchent à réinscrire le marxisme dans l’histoire des sciences sociales, montrant comment il s’infléchit dans l’optique structurale (éthno-philosophique) de L. Sebag et dans la « sociologie des structures de la pratique » défendue par P. Bourdieu. Or c’est bien le comparatisme qui permet à Karsenti de croiser ces deux approches somme toute assez antagonistes du marxisme. Le comparatisme de Sebag aboutit à dépasser le « sociocentrisme » marxiste en défendant une science de la société ouverte parce que non totalisable. De sorte que l’objet des sciences humaines, dans l’optique du structuralisme, constitue à jamais un objet « inachevé » (p. 224) et ce, en raison d’un comparatisme ethnologique supposant que le sens ou l’ordre d’une société soit toujours un sens ou un ordre manquant et qui donc ne peut se dire que de multiples manières.
Du côté de la sociologie bourdieusienne de la pratique, son héritage marxiste a ceci de problématique aux yeux de Karsenti que lui manque un comparatisme ethnologique que le concept d’hystérésis de l’habitus rend patent. Relisant l’hysteresis dans le sens d’un « dilemme » de la pratique, c’est-à-dire d’un décalage entre le corps propre et le corps social, Karsenti montre finalement la dépendance de Bourdieu, occultée par son anti-structuralisme, vis-à-vis de l’ethnologie.
Deux ouvrages de L. Boltanski sont ensuite relus, toujours selon un « double regard » (p. 291) : l’un sur le type de sociologie pratiquée (ici la sociologie du capitalisme et celle de l’avortement), et l’autre sur ce que notre société moderne a de problématique et qui porte sur son historicité. Où l’on voit que le comparatisme désigne ici non seulement une « tâche » (p. 267) pour une science sociale conséquente, mais le régime d’historicité auquel notre société se trouve confrontée et sur lequel la sociologie donne une « prise » que la philosophie se doit de ressaisir.
Enfin, le dernier chapitre revient sur ce que Karsenti considère comme le « pivot » du comparatisme, à savoir le « culte des morts » ; l’intérêt de ce thème étant qu’il a connu un tel « bougé » (p. 314) qu’en faire la généalogie consiste, pour Karsenti, à montrer d’abord son émergence dans le contexte post-révolutionnaire (avec F. de Coulanges, ensuite dans la fameuse « querelle des Anciens et des Modernes »), puis sa relève dans l’ethnologie (Mannoni, Lévi-strauss), en passant par la sociologie durkheimienne et surtout comtienne, en laquelle le culte des morts apparaît comme « la pierre angulaire de la religion de l’Humanité » (p. 329).
Régénération sociale de la philosophie
Sans revenir sur le mode de composition du livre qui, en dépit des remaniements proposés, demeure assez difficile à lire en un sens unitaire – mais peut-il en être autrement lorsqu’on sait qu’il s’agit de faire d’une collection d’articles un livre ? – on voit que la force de ce travail généalogique de relecture des sciences sociales consiste à faire bouger les lignes de la philosophie politique. En ce sens, nous pensons que le travail de Bruno Karsenti contribue à cette « régénération sociale » de la philosophie à laquelle on assiste en France depuis au moins une décennie. On pense ici, par exemple et parmi beaucoup d’autres, au philosophe Franck Fischbach qui, contre la philosophie politique dominante, milite pour une philosophie sociale2 ou, plus récemment encore, au sociologue Philippe Chanial qui plaide, quant à lui, pour une « sociologie comme philosophie politique et réciproquement » P. Chanial, La sociologie comme philosophie politique. Et réciproquement, La découverte, Paris, 2011[/efn_note].
En effet, dépassant ce que Foucault nommait encore la « dangereuse familiarité »3 entre la philosophie et les sciences humaines, la tâche qui se dessine pour cette nouvelle génération de penseurs, qu’ils soient philosophes ou sociologues, est de tenter, selon la belle formule de Fischbach, une véritable « politisation du social »4, réinscrivant la politique dans une conception de la société et des rapports sociaux. Dans cette optique, la généalogie de « la politique des modernes » que défend B. Karsenti participe, selon nous, d’un tel transfert en pensant l’altération de la philosophie par la sociologie comme reconfiguration « sociale » de la philosophie politique.
- Bruno Karsenti, D’une philosophie à l’autre. Les sciences sociales et la politique des modernes, Gallimard, NRF, 2013
- F. Fischbach, Manifeste pour une philosophie sociale, La Découverte, Paris, 2009
- M. Foucault, Les mots et les choses, Tel-Gallimard, 1966, Paris, p. 359
- F. Fischbach, Manifeste pour une philosophie sociale, La découverte, Paris, 2009, p. 53 sq.







