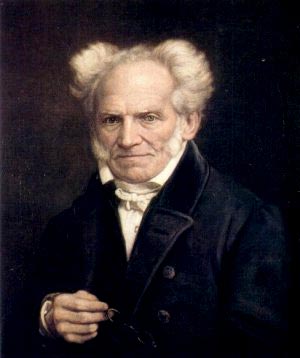Schopenhauer n’est sans doute pas l’auteur le plus aimé, ni même le plus admiré dans la philosophie ; il n’est qu’à voir le mépris dans lequel le confine Heidegger pour s’en convaincre. Il constitue pourtant un maillon essentiel entre la philosophie moderne et, d’une part, les œuvres de Nietzsche, Freud, voire Bergson et, d’autre part, la littérature européenne du XXème siècle, de Thomas Mann à Beckett, de Tolstoï à Kafka, de Pirandello à Céline. C’est là l’immense vertu de l’introduction à sa pensée que vient de publier Christophe Bouriau1 que de souligner l’importance de ce philosophe si singulier, si inactuel et somme toute si décisivement enraciné dans la genèse du XXème siècle. Clair, didactique et précis, le Schopenhauer de Christophe Bouriau, spécialiste de Pic de la Mirandole et de Kant2, se présente d’ores et déjà comme l’une des introductions les plus utiles pour aborder le massif du Monde comme volonté et comme représentation, et naviguer dans les Parerga… sans trop de peine.
A : La chose en soi est-elle le vouloir ?
En bon spécialiste de Kant, Christophe Bouriau inscrit la métaphysique de Schopenhauer dans la continuité du problème de la chose en soi qui, de Schulze à Nietzsche, fit couler tant d’encre. Dès les indications biographiques, l’auteur rappelle que Schopenhauer s’initia à Kant en suivant les cours de Schulze, auteur de l’Enésidème qui soulevait l’impossibilité de penser l’action de la chose en soi sur nos représentations sous une forme causale, la catégorie de la causalité ne pouvant précisément être appliquée qu’aux phénomènes. Schopenhauer hérite de ce problème, et Bouriau, fort justement, en fait le point de départ de son analyse, rendant d’emblée intelligible le titre de l’œuvre maîtresse de Schopenhauer, le monde devant être pensé à la fois comme représentation et en même temps comme phénomène. Disons ici que dès le début de l’ouvrage se manifeste la grande clarté du propos, rendant intelligible même au novice la notion de volonté ou, mieux encore, de « vouloir » : le vouloir est cette force aveugle, essence de tout être, qui se situe hors du temps, donc hors de la corruptibilité et non sujette à la destruction, que Schopenhauer se proposera d’associer à la chose en soi selon des modalités qu’il reste à préciser.
Pour faire comprendre cette notion de « vouloir », l’auteur revient au problème de la causalité et de la nécessité causale reliant un effet à sa cause. Ce qui est mystérieux, ce qui fait la chair intime du monde, c’est moins le fait que tel effet succède à telle cause et que, par conséquent, tel effet soit explicable par telle cause que la force à l’œuvre dans les phénomènes et qui noue l’effet à sa cause. Nous inférons la présence de forces à partir de l’observation des phénomènes mais leur nature demeure pour nous un mystère, c’est-à-dire que nous présupposons la présence de forces à partir de l’observation de leurs effets. L’ambition de Schopenhauer est dès lors très clairement présentée par C. Bouriau, il s’agit de découvrir la nature intime des forces à l’œuvre dans les phénomènes offerts à notre représentation, ce qui revient à dire que le phénomène porte en lui la manifestation de la chose en soi, et c’est en vertu de cette manifestation que nous pourrons remonter à elle. « Découvrir la signification des phénomènes du monde, commente l’auteur, ce n’est pas se contenter de les expliquer par leurs causes elles-mêmes phénoménales. C’est élucider le type de force qui est à leur origine. »3
Toutefois se pose immédiatement une difficulté logique, celle que Kant avait jugée insoluble et qui l’avait incité à renoncer à juger les choses en soi connaissables en tant que choses en soi : si nous y accédons, les choses en soi deviennent pour nous, et ne sont pas connues indépendamment de la manière dont nous les connaissons ; le simple fait de les connaître les rend relatives à notre manière de les connaître et interdit de maintenir l’affirmation selon laquelle il s’agirait de choses en soi – à moins d’être hégélien et de considérer qu’il relève de la nature de l’être de se manifester, auquel cas il n’y aurait plus de sens à maintenir la distinction. Cette détermination de la chose en soi comme étant vouloir parvient-elle à résoudre la difficulté logique inaugurale ? « Le vouloir est-il la même chose que la « chose en soi » ? Schopenhauer semble hésiter. Il déclare à plusieurs reprises que la chose en soi est le vouloir, mais il est parfois plus précis, en avançant que le vouloir nous conduit « au plus près de la chose en soi ». »4 Bouriau montre très clairement que si le vouloir se conquiert par introspection, il demeure tributaire du temps, donc d’une forme a priori de la sensibilité, quand bien même eût-il échappé à l’espace. De ce fait, le vouloir s’apparente à une approximation de la chose en soi, plus qu’à la chose en soi elle-même ; il est dans le temps « presque nu »5 mais pas intégralement nu, c’est-à-dire absolument intuitionné indépendamment des formes de la sensibilité. C’est donc toujours pour nous que se révèle le vouloir, à travers le temps. « En toute rigueur, il faut dire que le vouloir est la manifestation la plus nette de la chose en soi, celle qui nous la révèle le mieux, certes, mais pas entièrement. »6
B : Originarité du vouloir, impossibilité d’un Intellect pur
Après avoir exposé la manière dont nous pouvons intuitionner le vouloir comme approximation la plus aboutie de la chose en soi, Bouriau va montrer, là encore de manière remarquablement claire, comment cela a pour effet de rendre inepte la conception d’un Intellect se soutenant lui-même, d’un Intellect auquel serait dévolue la primauté ontologique. Cette impossibilité résulte à la fois de la nature même du Vouloir et en même temps de sa manifestation corporelle. « On peut dire que nos comportements sont les phénomènes ou manifestations extérieures de la chose en soi qu’est le « vouloir », dont nous percevons la puissance à l’intérieur de nous-mêmes. La perception intérieure et la perception extérieure de notre corps offrent ainsi deux points de vue complémentaires sur une même réalité, le vouloir. Le corps propre (Leib) devient avec Schopenhauer l’objet privilégié de l’enquête métaphysique, centrée sur l’origine de ce qui apparaît. Ce point est original, en rupture avec une tradition qui au contraire demande au métaphysicien de se détacher du monde corporel et sensible pour accéder aux objets privilégiés de la métaphysique que sont l’âme et Dieu. »7 Sans la manifestation corporelle au cœur de laquelle nous saisissons le vouloir, nous ne pourrions pas accéder à ce dernier, qui ne se laisse appréhender que dans un corps. C’est grâce au corps, très paradoxalement, que nous pouvons accéder à la source non phénoménale quoique phénoménalement manifestée des phénomènes. « Parce que nous sommes un corps vivant, nous percevons que nos comportements procèdent d’une force active en nous, qui s’exprime à travers eux. Tout acte de notre vouloir, souligne Schopenhauer, est en même temps un acte de notre corps. »8
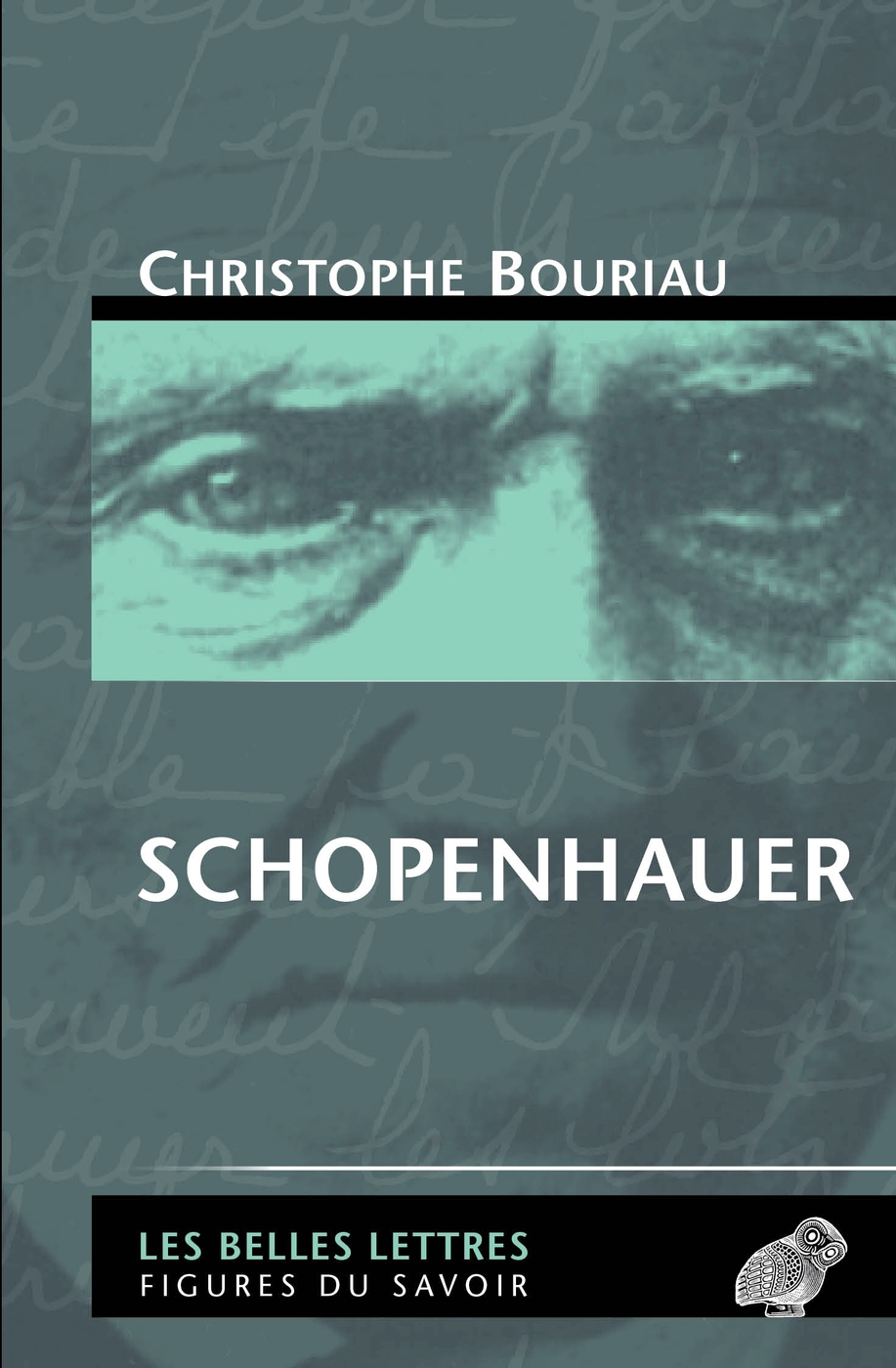
La conséquence d’une telle appréhension du vouloir est double : d’abord, l’homme ne peut plus se définir par ses fonctions cognitives puisque ce qui est essentiel, c’est le vouloir, ce qui a pour effet de considérablement déchoir l’Intellect et la cognition de leur primauté. Ensuite, Schopenhauer en vient à récuser fort logiquement une intelligence créatrice car l’intellect ne se supporte pas lui-même – sous entendu : sans le support du vouloir – et ne peut être posé comme principe de l’être. « En définitive, la condition ultime de l’expérience est pour Schopenhauer le sain fonctionnement du cerveau, siège physiologique de nos facultés intellectuelles. C’est le corps qui est premier ! »9 Par cette conséquence, c’est l’entièreté de la théologie concevant Dieu comme Intellect ou comme Intelligence pure qui se trouve évincée car dénoncée comme non-sens. L’intellect ne peut pas être le principe de la vie organique, ne peut pas lui être antérieur, puisque pris indépendamment de ses conditions organiques d’apparition et de fonctionnement (cerveau, système nerveux) et attribué à une personnalité désincarnée, le terme d’intellect ne possède aucun emploi légitime. Schopenhauer brandit alors une analogie restée fameuse : un être pensant sans cerveau est aussi absurde qu’un être digérant sans estomac. Et une telle analogie a ceci de terrible qu’elle vaut aussi pour Dieu, comme si Schopenhauer déplaçait l’habituelle querelle portant sur la nature de l’esprit – l’esprit est-il réductible au cerveau qui le supporte ? – à la nature même de Dieu : puisqu’aucune intelligence ne saurait être désincarnée, l’idée classique d’un Dieu conçu comme Intelligence pure se trouve affranchie de toute forme de signification possible.
C : Une redéfinition du mal
Le deuxième axe d’étude et de présentation que retient l’auteur n’est autre que la question du mal ; la réflexion sur le vouloir est aussi une réflexion sur le mal, donc un appel à la moralité redéfinie en fonction du sens qu’il convient au vouloir. Percer au-delà de la surface des choses, au-delà du monde tel qu’il s’offre extérieurement à notre représentation ordinaire ne constitue pas seulement un geste métaphysique, il s’agit également d’une percée destinée à saisir la force à l’origine du mal. De la même manière, soulever la question du mal reviendra, nous le verrons, à nous demander si nous pouvons nous libérer de l’emprise du vouloir.
Mais il faut poser la question première, la question augustinienne par excellence, unde malum ? D’où vient le mal ? Schopenhauer, qui est athée, ne peut évidemment rendre compte du mal à partir d’un texte de nature théologique ni et encore moins y voir une origine peccamineuse. La nature du mal doit être affranchie de l’habituelle convocation du péché originel, donc de la faute pour être référée désormais à la réalité même du monde, donc au vouloir. Le mal consiste dans l’acte métaphysique primordial du vouloir qui, en s’incarnant dans l’espèce humaine, inflige aux individus les tourments de l’existence. « La libre objectivation du vouloir dans les êtres humains est l’équivalent sécularisé du péché originel. »10 A vrai dire, il nous semble qu’il s’agit là du seul point sur lequel l’ouvrage de C. Bouriau est un peu décevant : s’il explique très bien ce qu’est le mal et d’où il provient, il nous est apparu moins prolixe lorsqu’il s’est agi d’expliquer pourquoi l’incarnation du vouloir générait de la souffrance, pourquoi l’espèce humaine ne pouvait avoir affaire qu’au mal dès lors qu’elle était parcourue du vouloir. S’il nous est permis d’émettre une réserve, elle porte sur ce point traité à nos yeux trop rapidement par l’auteur : pourquoi le vouloir, en tant qu’il s’objective dans l’espèce humaine, octroie-t-il à celle-ci une condition souffrante ? Pour y répondre clairement, il aurait sans doute fallu étoffer quelque peu la manière dont nous luttons contre une atomisation des volontés, contre des forces qui se sont individualisées et qui ont occulté l’unité originaire, conduisant le vouloir à s’affronter lui-même selon les individualités rencontrées.
D : Les « voies de la libération »
Quoi qu’il en soit, l’auteur expose avec une grande clarté ce qu’il appelle « les voies de la libération », c’est-à-dire les moyens de résister au mal, moyens qui prennent précisément la forme d’une libération puisqu’il s’agit de s’affranchir de la tyrannie du vouloir-vivre. La logique de la pensée de Schopenhauer exige de finalement lutter contre le vouloir, non pas en tant que vouloir mais bien plutôt en tant que vouloir-vivre, c’est-à-dire en tant que vouloir individualisé. Affirmer le vouloir-vivre – forme sous laquelle le vouloir se manifeste chez les êtres vivants –, c’est se condamner à souffrir, puisque c’est se subordonner à la tyrannie des désirs qui, une fois satisfaits, cèdent la place à l’ennui qui, pour être chassé, fera appel à de nouveaux désirs. L’auteur expose ainsi trois voies majeures chez Schopenhauer destinées à suspendre le vouloir-vivre, à le mettre entre parenthèses, soit durant quelques éphémères moments, soit sous une forme plus durable.
La première forme de libération est associée à l’expérience esthétique, dont Schopenhauer reprend la forme désintéressée de Kant. Le jugement esthétique est de type négatif : il consiste dans le sentiment de libération ou de soulagement dû à la suspension du vouloir-vivre, à la mise entre parenthèses de mes aspirations pratiques en général. Nietzsche analysera non sans acidité la continuité Kant-Schopenhauer organisée autour du refus de l’intérêt, c’est-à-dire autour du refus de trouver une satisfaction morale, sensible ou existentielle dans l’œuvre d’art ; cela reviendrait, pour Schopenhauer, à nous ramener au vouloir-vivre dont il s’agissait précisément de se déprendre. Plaçant sa réflexion sur l’esthétique schopenhauerienne au cœur des idéaux ascétiques, Nietzsche y trouva l’appui nécessaire pour faire de celle-ci le symptôme même de la méthode et du fonctionnement de son ancien maître.
« Et nous voilà revenus à Schopenhauer, qui était tout autrement proche des arts que Kant et qui cependant n’est pas parvenu à échapper au charme de la définition kantienne : comment cela s’est-il fait ? Les circonstances en sont assez étonnantes : il interprétait la formule « sans intérêt » d’une façon toute personnelle à partir d’une expérience qui a dû être chez lui monnaie courante. Il y a peu de choses que Schopenhauer aborde avec autant d’assurance que l’effet de la contemplation esthétique : il lui attribue la faculté d’agir justement contre « l’intérêt » sexuel, pouvoir semblable à ceux de la lupuline et du camphre, il ne s’est jamais lassé de glorifier cette libération-là de la « volonté » comme le grand avantage et la grande utilité de l’état esthétique. »11
Perfide, Nietzsche ira jusqu’à se demander quelques lignes plus bas si l’usage « désintéressé » de l’art ne serait pas l’indice d’une souffrance sexuelle à laquelle toute sa philosophie, fondée sur le refus du vouloir-vivre, ne constituerait pas une certaine forme de réponse symptomatique. Quoi qu’il en soit de la pertinence des analyses nietzschéennes, la présentation que propose Bouriau de l’art est ici excellente, et permet de comprendre le difficile et délicat sens des Idées dans le cadre esthétique, Idée ne renvoyant qu’aux manifestations du vouloir, et dont la contemplation permet de conférer à l’esthétique une extension inouïe : est belle toute chose au sein de laquelle se laisse contempler la manifestation du vouloir. « Il s’ensuit, note Clément Rosset dans un court article, que le beau ne désigne pas, chez Schopenhauer, un objet particulier considéré comme esthétique, mais n’importe quel objet pourvu que celui-ci soit objet de contemplation. »12
L’expérience esthétique au sens élargi du terme apparaît donc comme une voie efficace mais ponctuelle de la libération. « Le grand art nous libère du vouloir en nous transformant en spectateurs désindividualisés, provisoirement oublieux de nos intérêts individuels. Dans la contemplation esthétique, nous ne sommes plus les jouets du vouloir-vivre, mais de purs contemplateurs des Idées suggérées par l’œuvre. »13 Bour le dire toujours avec les mots de Bouriau, la contemplation esthétique est un éphémère répit dans le diktat du vouloir. Plus inscrite dans la durée sera l’élaboration d’une morale, anti-kantienne au possible, car fondée dans les sentiments et la passivité du sujet. En nous libérant du moi égoïste, la morale nous permet d’agir pour le bien d’autrui à travers la compassion.
Enfin, l’ultime voie de la libération est décrite avec l’ascétisme ; là encore, l’opposition de Nietzsche sera radicale et sans merci, faisant de la Généalogie de la morale l’espèce de pendant dialectique de la morale schopenhauerienne, ce dont Nietzsche est d’ailleurs parfaitement conscient : « Il s’agissait pour moi de la valeur de la morale, – et à ce sujet j’avais presque exclusivement à m’expliquer avec mon grand maître Schopenhauer auquel ce livre, avec sa passion et sa contradiction secrètes, s’adresse comme à un contemporain (- car ce livre était lui aussi un « pamphlet »). Il s’agissait en particulier de la valeur du « non-égoïste », des instincts de pitié, de déni de soi, de sacrifice de soi, instincts que Schopenhauer avait si longtemps auréolés, divinisés et projetés dans l’au-delà, jusqu’à demeurer finalement à ses yeux comme « valeurs en soi » sur lesquelles il se fondait pour dire non à la vie ainsi qu’à lui-même. »14 Nous voyons bien ici ce qui différencie l’ascèse schopenhauerienne de celle de Nietzsche : pour celui-là, l’ascèse est renoncement au vouloir-vivre, alors que pour celui-ci elle est renoncement à la vie, retournement de la volonté contre soi ; une telle différence s’enracine, note Bouriau, dans leur métaphysique respective : selon que l’on considère le vouloir-vivre (forme que prend le vouloir dans le domaine du vivant) comme une tendance aveugle et douloureuse ou comme une tendance positivement orientée vers la créativité et vers la joie, l’interprétation de l’éthique et de l’art change du tout au tout.
E : De Schopenhauer à Freud, la question de l’inconscient
L’auteur consacre de longues et belles pages à la question de l’inconscient. Il est clair que Bouriau cherche à appuyer le fait que Freud a lu Schopenhauer bien plus qu’il ne voulut bien l’avouer, et le prouve à l’aide des nombreuses contradictions relevées dans les textes et la correspondances de Freud. La troisième partie semble donc moins destinée à présenter la pensée de l’inconscient pour elle-même qu’à prouver les emprunts massifs qu’aurait effectués Freud, ce qui s’écarte sans doute quelque peu des objectifs d’un ouvrage de simple présentation, sans pour autant gâcher celle-ci.
Avant de mesurer les emprunts, il faut rappeler quelles sont les innovations accomplies par Schopenhauer dans le domaine de l’inconscient, et il faut reconnaître à Bouriau une grande capacité à pointer l’originalité de l’auteur qu’il présente, et à marquer sa singularité par différenciation d’avec ses prédécesseurs, ce qui confère, tout au long de l’ouvrage, une impression de redécouverte d’un philosophe apparaissant somme toute injustement méconnu ou réduit à quelques slogans. « L’originalité de Schopenhauer, par rapport à certains de ses prédécesseurs, consiste à prêter un caractère constant et systématique à l’action non consciente du vouloir sur nos opérations conscientes. »15 Pascal, La Rochefoucauld, Chamfort avaient déjà vu que passions et affects interféraient sur nos jugements, mais c’étaient pour eux des accidents ; pour Schopenhauer, l’exception devient la règle. A l’aide d’une belle et convaincante comparaison avec Leibniz, l’auteur montre que pour Schopenhauer, la situation est à l’exact opposé des petites perceptions leibniziennes : ce qui échappe à notre conscience, c’est le vouloir orientant en coulisse nos opérations conscientes. L’inconscient est du côté de l’Un, pas du multiple. Cette unité fondamentale qu’est le vouloir est ce qui nous pousse à unifier les perceptions dispersées que notre conscience prend du monde extérieur. « Ce qui est tout à fait nouveau dans la perspective de Schopenhauer, c’est l’idée que les fonctions dites supérieures de l’esprit humain (la mémoire, la conscience, l’intellect, la raison), toutes engagées dans la représentation que nous nous formons du monde externe, sont entièrement conditionnées par les fins primitives du vouloir que nous venons de citer. C’est ce conditionnement qui échappe à notre conscience. »16
Mais c’est après que le lien avec Freud devient assez troublant et que l’on redécouvre la puissance d’anticipation de Schopenhauer quant aux phénomènes inconscients17 Schopenhauer développe l’idée d’un veto du vouloir (ancêtre du refoulement), et l’idée d’une processus inconscient conduisant à ce que l’on nomme aujourd’hui les lapsus, ou aux erreurs volontaires du jugement. A cet égard, l’auteur défend l’idée selon laquelle il est sans doute faux que Freud n’ait lu Schopenhauer qu’à partir de 1919 : « on peut sérieusement douter de cette affirmation. En effet, dans de nombreux passages de son œuvre antérieure à cette date, Freud fait référence à Schopenhauer. Il devait donc bien en connaître les thèses d’une manière ou d’une autre. »18 De fait, l’Interprétation des rêves contient des références aux Parerga et Paralipomena et, mieux encore, en 1914, il affirme dans une lettre qu’Otto Rank lui a fait lire le Monde comme volonté et représentation. « Comme l’observe justement Peter Welsen, conclut Bouriau, il existe un écart entre l’affirmation de Freud selon laquelle il aurait lu Schopenhauer tard dans sa vie, c’est-à-dire à partir de 1919, et les références à Schopenhauer dans de nombreux / textes antérieurs à l’époque où il prétend l’avoir lu. »19
F : Introduire à Schopenhauer sans dévotion
Pour finir, nous aimerions souligner une vertu supplémentaire de l’ouvrage qui réside dans le fait que cette présentation de la pensée de Schopenhauer ne vaut pas soumission : il est fréquent de lire des introductions à la pensée d’un auteur qui sont d’abord une sorte de « défense et illustration » de celui-ci, sans qu’aucune distance philosophique ne soit réellement adoptée. Ce n’est pas le cas ici, Bouriau marquant à plusieurs reprises ce qui lui semble être une difficulté logique ou conceptuelle dans le texte de Schopenhauer.
La première réserve adoptée par l’auteur porte sur l’idée même de vouloir, donc sur l’ontologie de Schopenhauer. « Premièrement, la manière dont Schopenhauer construit son ontologie nous est apparue problématique. Alors qu’il prétend fonder cette ontologie sur l’expérience, nous avons vu qu’en étendant le vouloir à l’ensemble des êtres de l’univers, il contrevenait à cette prétention. Si nous avons bien l’expérience de forces en nous qui nous poussent à vivre et à désirer, forces que Schopenhauer regroupe sous le terme « vouloir », en revanche nous n’avons aucune expérience des forces censées mouvoir les autres corps. En attribuant le vouloir à tout l’univers, au-delà de l’espèce humaine, Schopenhauer ne respecte pas cette condition de la connaissance qu’il revendique pourtant : le contrôle du jugement par l’expérience. »20 Et Bouriau de poursuivre ainsi : « Schopenhauer prétend découvrir sa proposition métaphysique fondamentale, celle du vouloir comme principe de l’univers, par une perception interne des tendances abritées par notre corps. De là, cependant, il passe à l’affirmation selon laquelle le vouloir est le principe éternel du monde en général. Or cette dernière affirmation ne saurait reposer sur une intuition de type empirique. »21 La conquête d’une ontologie du vouloir procède donc d’un saut logiquement délicat que l’auteur n’hésite pas à souligner, ajoutant à la clarté du propos une probité bien venue.
Une seconde réserve, moins décisive, certes, mais toutefois intéressante, porte sur la nature de la morale schopenhauerienne : jusqu’à quel point est-elle réellement désintéressée, c’est-à-dire, jusqu’à quel point n’est-elle pas indexée à la recherche d’un certain bonheur ? « Bien qu’il s’en défende, note Bouriau, il semblerait que la morale de Schopenhauer s’inscrive elle aussi dans une perspective eudémoniste, le bonheur étant pris ici en un sens négatif, celui d’une libération, d’une déprise de soi salutaire. L’agir compassionnel peut en effet s’interpréter comme une suspension de la souffrance générée par l’affirmation égoïste des désirs, mais encore comme un effort pour atténuer la souffrance que je ressens en m’identifiant à autrui. »22 Libre au lecteur de poursuivre la réflexion à travers les textes de Nietzsche raillant la croyance au désintéressement moral, et dont Schopenhauer serait ici un symptôme aveugle.
Conclusion
Christophe Bouriau a fourni une excellente introduction à la pensée de Schopenhauer qui vient combler un vide relatif sur le sujet ; il existe certes le beau livre de Christophe Salaün23 mais il lui manque sans doute la distance critique dont Bouriau fait un usage à la fois modéré et bienvenu. En outre, la discussion finale sur la question des influences postérieures, notamment autour de la question de l’absurde, permet d’introduire aux débats initiés par les réflexions de Clément Rosset notamment à travers son classique Schopenhauer, philosophe de l’absurde24 pour lequel l’absurdité du Vouloir est un fait premier. Ce dernier justifie souvent son interprétation par l’absence de finalité du monde25, critère dont Bouriau met en doute le bien-fondé pour évaluer l’absurdité du monde.
Concluons donc avec l’auteur : « L’originalité de la philosophie schopenhauerienne consiste d’une part, à l’encontre de toute une tradition de penseurs optimistes qui interprètent le mal comme une simple apparence ou comme la condition nécessaire d’un plus grand bien, à affirmer la positivité du mal, à identifier sa source et à proposer des voies pour s’en libérer. Certes, son enseignement est terrible : le vouloir est notre essence, et c’est cette essence même qui nous gâche notre existence. Le fait d’être une manifestation individuelle du vouloir, et, dans le cas de l’homme, d’un vouloir utilisant les facultés dites supérieures (intellect, mémoire, raison) pour assouvir les pulsions de conservation et de reproduction, semble nous condamner à vivre comme des esclaves malheureux, égoïstes et mauvais. »26
- Christophe Bouriau, Schopenhauer, Les Belles Lettres, coll. Figures du savoir, 2013
- cf. Christophe Bouriau, Lectures de Kant. Le problème du dualisme, PUF, coll. Philosophies, 2000, ainsi que le Kant, Hachette, 2003, et la variation sur le jugement réfléchissant dans Le « comme si ». Vaihinger et le fictionalisme, cerf, 2013
- C. Bouriau, Schopenhauer, op. cit., p. 27
- Ibid., p. 46
- Ibid., p. 47
- Ibid., p. 48
- Ibid., p. 41
- Ibid., p. 42
- Ibid., p. 39
- Ibid., p. 62
- Nietzsche, Généalogie de la morale, III, § 6, Traduction Eric Blondel et alii, GF, 1996, p. 119
- Clément Rosset, « Remarque sur l’esthétique de Schopenhauer », repris dans Clément Rosset, Faits divers, PUF, 2013, p. 145
- C. Bouriau, Schopenhauer, op. cit., p. 72
- Nietzsche, op. cit., avant-propos, § 5, p. 30
- C. Bouriau, Schopenhauer, op. cit., p. 101
- Ibid., p. 104
- Pour plus de précisions, cf. Christophe Bouriau et alii, Schopenhauer et l’Inconscient. Approches Historiques, Métaphysiques et Epistémologiques, PUN, 2011
- Ibid., p. 127
- Ibid., pp. 128-129
- Ibid., p. 59
- Ibid., p. 59
- Ibid., p. 77
- Christophe Salaün, Apprendre à philosopher avec Schopenhauer, Ellipses, 2010
- cf. Clément Rosset, Schopenhauer, philosophe de l’absurde, PUF, coll. Quadrige, 2013
- C. Rosset peut ainsi décrire la « conception schopenhauerienne d’un monde absurde car dénué de fondement comme de finalité. », cf. Clément Rosset, Faits divers, op. cit., p. 135
- Ibid., p. 151