En 2007, les éditions Ellipses ont édité un excellent ouvrage dédié à la perspective, conçue comme pont entre la perception sensible et la pensée mathématique ou, pour le dire avec les termes des deux auteurs, il s’agit de se poser la question suivante : « Comment la représentation et la géométrie se sont-elles emparées d’un objet purement lié à la vue ? C’est ce que nous désirons raconter dans ce livre. » 1 Pourquoi a-t-on assisté à l’investissement mathématique d’un problème d’ordre visuel, telle est la question qui se trouve proposée dès la première page et qui recevra un traitement approprié et convaincant.
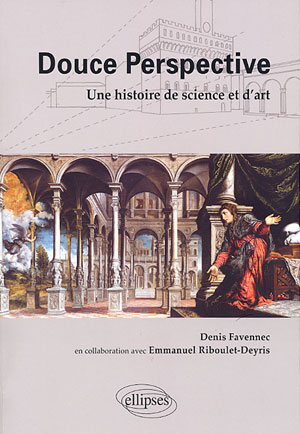
Plutôt que de proposer une lecture linéaire de l’ouvrage, je vais en proposer les points qui me paraissent véritablement pertinents, indépendamment de leur ordre d’exposition. Le premier mérite de cet ouvrage me semble être celui de la clarté : les auteurs exposent dans un premier temps les principes mathématiques de la projection, particulièrement ceux de la projection centrale, et n’importe quel lecteur, quelles que soient ses compétences mathématiques, sera en mesure de comprendre précisément la méthode de construction la plus couramment utilisée ; cela semble un détail, mais peu d’ouvrages traitant de la perspective ont su présenter avec une telle économie de mots la réalité constructiviste de la perspective et cet aspect mérite à lui seul une grande considération. Le plan au sol, la projection centrale, la projection orthogonale, autant de possibilités mathématiques offertes à la représentation, pour satisfaire l’œil, que l’ouvrage aborde avec bonheur.
I : Une question philosophique : l’objectivisme de la perspective
Un des points forts sur lesquels les auteurs insistent également me semble être le fait que la perspective ne cherche en aucun cas à mimer la vision, mais bien plutôt des objets visibles ; en d’autres termes, il ne s’agit pas de savoir comment l’œil fonctionne, mais il s’agit de penser la manière dont des objectités déjà existantes peuvent être reproduites sans que cela ne choque particulièrement l’œil ; il est bien question de la représentation et non de la vision en tant que telle. Ainsi les deux auteurs contournent-ils un écueil fort menaçant, à savoir celui de l’abstraction : en insistant sur le fait qu’il s’agit de proposer une méthode mathématique de reproduction d’objets déjà visibles, ils évitent le problème de la profondeur ou des surfaces pures et abstraites ; revenant à quelque chose rappelant le geste aristotélicien, ils supposent l’espace toujours déjà rempli par l’objet. Par conséquent, et c’est là une thèse forte – peut-être contestable – la profondeur n’est pas conçue comme étant perçue, la profondeur ne se voit pas, ne procède pas de la visibilité même de l’objet et se trouve à cet égard abolie par la vue. Et de même que la profondeur est abolie par la vue, de même la perspective dite artificielle se doit d’être abolie dans le tableau ; en d’autres termes, la perspective n’est pas perçue en tant que telle dans l’œuvre, de même que la profondeur n’est pas perçue comme telle dans un cadre naturel.
Dès lors, la question de la perspective prend un tout autre relief : comment représenter ce qui est destiné à n’être pas thématisé comme tel ? Comment se fait-il que le problème majeur de la représentation se confonde précisément avec ce qui doit échapper à l’individuation de la perception ? Là se joue un véritable questionnement philosophique, au sens où « si l’on veut voir selon la perspective, on ne voit pas comment elle procède : seul le résultat est visible. S’il y a quelque chose qu’on ne peut pas voir en perspective, qui pourtant fait tout voir, c’est la perspective même. »2 Bref, l’objet même de l’interrogation picturale s’identifie aussitôt aux moyens de sa dissimulation.
Ainsi problématisée, la question de la perspective se trouve singulièrement relevée : non pas une simple méthode qu’il suffirait d’appliquer, mais une sorte de défi redoutable, inlassablement présent dans le travail de l’œuvre. Cela a pour conséquence de prendre le contrepied d’une opinion souvent répandue voulant que la perspective soit tributaire d’un point de vue, de sorte donc que le peintre impose un point de vue ou une focalisation de surcroît monoculaire à sa peinture ; or cette opinion devient difficilement tenable si l’on admet les présupposés de nos auteurs ; en effet, si la perspective n’est plus qu’une question de technique mais se pourvoit en problème d’effacement de la structure, alors chaque œuvre impose un traitement singulier de la perspective, si bien que chaque tableau déploie un traitement de l’espace perspectif qui lui est propre. Et de la singularité de cet espace perspectif, il faut en déduire que ce n’est pas le regard qui dicte la perspective mais inversement la perspective qui détermine le regard. « Sommé par le point de fuite, le spectateur constate que dans le tableau quelque chose est là, déjà, qui l’attend. En vérité, contrairement à un préjugé répandu, la perspective ne soumet pas la représentation à la tyrannie du point de vue : plutôt, le sujet de la perspective se voit engendré par le tableau. Loin d’être la cause finale de la représentation, il n’en est qu’un effet. Ce qui n’est pas sans susciter un certain malaise : car cet engendrement s’accompagne d’une mise à distance, voire d’une expulsion du sujet hors du champ du tableau. De sorte que la fonction de la perspective n’est pas tant de former des images, que de pointer ce nœud : tout tableau invoque un sujet qu’il renvoie au point de vue. »3
Cette conséquence, tout à fait logique dans l’économie du propos des auteurs, est en réalité révolutionnaire : elle fait éclater la doxa voulant que la Renaissance ait engendré la naissance du sujet, préfigurant ainsi la célèbre révolution copernicienne kantienne ; il est en effet courant de lire que la perspective marque la décision subjective, soumettant l’objet à la subjectivité de son propre point de vue ; c’est ainsi du reste que, philosophiquement, Merleau-Ponty thématise cette question, à l’aide du corps propre assumant pleinement le rôle de la subjectivité, « le degré zéro de la spatialité » à partir duquel la subjectivité corporelle reconstruit l’espace et la profondeur. 4 Inversement, les auteurs de Douce perspective interprètent la question de la perspective et de la profondeur non pas comme cela même qui a été engendré par la subjectivité, mais comme l’objectité structurant le regard subjectif. Ce n’est pas le regard qui construit la vision, c’est inversement l’objet qui décide du regard, auquel cas se trouve destituée la primauté de la subjectivité que beaucoup croyaient première.
Cette thèse mérite toute notre attention ; elle suppose en réalité que le regard du spectateur se laisse guider par la structure objective du tableau ou, pour le dire en des termes différents, que c’est le tableau qui décide de la manière dont se comporte le regard lui-même. Le mérite de cette thèse est d’attirer l’attention sur un point précis : le point de vue du spectateur est moins libre que celui du peintre. Si le peintre impose en effet son point de vue – ce qu’escamotent un peu vite nos auteurs –, il n’en va pas de même pour le spectateur qui reçoit une œuvre déjà structurée et pour laquelle sa propre subjectivité n’intervient pas. De ce fait, ce à quoi incitent à penser Favennec et Riboulet-Deyris, c’est que la fameuse naissance de la subjectivité à la Renaissance ne saurait être un postulat partagé par l’acteur et le spectateur, au sein du cadre artistique : il y a une intrinsèque passivité du spectateur, soumis à un quasi-objectivisme de l’œuvre. Voilà qui permet de nuancer bien des thèses consacrées à la Renaissance en établissant une dichotomie entre créateur et spectateur.
Cette thèse d’ordre philosophique est suivie de considérations, assez classiques cette fois, sur la manière dont la perspective suppose une rupture catégorique avec l’infini aristotélicien, et comment elle s’insère dans les pensées néoplatoniciennes de Denys et Plotin.
II : La perpsectiva artificialis ou la dichotomie du regard et de l’objet
Un autre point fort de cet ouvrage me semble être la description méticuleuse de l’utilisation du panneau, à partir des indications de Brunelleschi : le miroir renvoyant l’image spéculaire du panneau est admirablement analysé, et une fois de plus la passivité du spectateur reçoit une confirmation désormais indubitable. Le point de fuite est la projection du point de vue sur le tableau, dans l’exacte mesure où le trou du panneau est situé au point de fuite ! « Le dispositif assigne de plus l’œil à une position fixe, au revers du point de fuite, tandis que le miroir s’ajuste : voilà qui retourne la situation classique où le spectateur se déplace par rapport au tableau pour déterminer le point de vue. Ici, point de vue et point de fuite sont déterminés ensemble. » 5 De ce fait, le spectateur se trouve à la fois au plus près de la peinture et au plus loin : au plus près parce qu’il fournit un effort certain pour organiser son propre regard, mais au plus loin car il n’en perçoit qu’un reflet, de sorte que le miroir établisse une dichotomie presque infranchissable entre le spectateur et la représentation.
De ce fait, il convient de différencier les conséquences de la perspective médiévale, fondée sur une vision immédiate de la chose, de celles de la perspective artificielle, discriminant entre l’objet et le spectateur. Issue du réalisme médiéval, la perspectiva naturalis modélise une connaissance directe de l’objet, directement perçu, et directement retranscrit ; nulle médiation ne semble s’installer entre le regard et l’objet. En revanche, la Renaissance place le spectateur à distance de ce qu’il regarde, « en introduisant une médiation entre sujet et objet, la perspectiva artificialis dévalue le toucher comme modèle fondateur de la connaissance, et lui substitue la vue. Ce faisant, la vision n’est pas seulement promue au rang de sens principal, elle est proprement réinvitée par la perspective. » 6 Ce point est capital : la perspective au sens renaissant du terme, quelles qu’en soient ses différentes modalités, est une œuvre de médiation, par laquelle la vue se trouve révélée comme telle ; en d’autres termes, bien voir devient le résultat et l’achèvement d’une médiation de nature technique. Ce résultat, teinté d’un hégélianisme certain, me semble être un des temps forts de notre ouvrage.
La suite s’avère moins originale, les deux auteurs se bornant à reprendre des analyses de Daniel Arasse, toujours plaisantes à redécouvrir, mais n’apportant rien de spécifiquement nouveau. Toutefois, deux excellents chapitres consacrés à Léonard et à l’anamorphose viennent conclure le troisième chapitre.
On appréciera enfin, tout particulièrement, les belles analyses consacrées à Desargues, théoricien somme toute fort oublié de la perspective classique, qui fut pourtant l’interlocuteur de Pascal, Descartes et Fermat. Un excellent ouvrage, donc, qui peut servir d’initiation à cette passionnante question de la rencontre de la mathématique et de la vision, mais qui, en proposant également des analyses philosophiques fortes en première partie, féconde une spéculation sur la naissance de la subjectivité renaissante que l’on pouvait croire un peu trop figée.







