André Stanguennec, professeur émérite à l’Université de Nantes, est peintre et philosophe. Dans ce dernier domaine, il est l’auteur d’une vingtaine de livres. Après une thèse, Hegel critique de Kant 1, dirigée d’abord par Jean Hyppolite, puis par Jacques d’Hondt, et devenue depuis un classique incontesté en la matière, il a publié plusieurs livres d’histoire de la philosophie se centrant sur l’idéalisme allemand, le romantisme et l’herméneutique. Il développe ensuite sa propre philosophie dont il présente les fondements herméneutiques dans un ouvrage en trois volumes, La dialectique réflexive 2. Sa pensée développe une ontologie du soi qui montre, entre autres, comment celui-ci se constitue réflexivement à partir des totalisations éthiques, juridiques, politiques, esthétiques et scientifiques de son époque. Un ouvrage collectif « Herméneutique et dialectique » 3, a été publié en hommage à ses travaux.
Nous le remercions d’avoir aimablement accepté de répondre à quelques questions concernant son dernier ouvrage et le champ de réflexion dans lequel celui-ci s’inscrit.
Actu-Philosophia : Tout d’abord, avant de nous centrer sur votre dernier livre, L’humanisation de la nature4, pourriez-vous brièvement nous présenter votre itinéraire philosophique. Vous vous faites connaître en philosophie avec votre thèse sur Hegel, critique de Kant. Comment qualifieriez-vous aujourd’hui votre rapport à Hegel ? et à Kant ? Quelle serait leur influence sur votre œuvre monumentale qu’est la dialectique réflexive ? Pourriez-vous par ailleurs nous présenter dans les grandes lignes en quoi celle-ci consiste ?
André Stanguennec : J’ai toujours mené trois sortes de recherches, histoire de la philosophie, philosophie de l’art (en particulier de la poésie et de la peinture), métaphysique (ontologie de la réflexion). Ces trois orientations ne sont pas cloisonnées, mais j’ai cherché à faire en sorte qu’elles puissent, sans confusion, se féconder mutuellement. C’est ainsi que j’ai toujours maintenu, en m’appuyant sur la lettre et l’esprit de la philosophie critique kantienne, la vocation métaphysique-critique de la philosophie transcendantale, que Kant a renoncé à nommer « ontologie », car ce titre « pompeux » (sic) était celui d’une ontologie dogmatique leibnizio-wolfienne auquel il souhaitait substituer celui, plus « modeste », d’une Analytique transcendantale. C’est cette méthode critique et transcendantale de la métaphysique que j’ai essayé de prolonger dans mon travail, d’abord à partir de ma thèse d’histoire de la philosophie, « Hegel critique de Kant », puis de mes travaux personnels en métaphysique dont j’ai fait la synthèse dans les trois volumes de « La dialectique réflexive ». J’y ai tenté ce que certains jugeaient (et jugent encore !) une « union impossible ». Je suis parti de la conviction kantienne que la philosophie vise une sagesse des limites impliquant toutefois que la pensée de la finitude implique bien, logiquement et ontologiquement, celle d’un infini théologique en acte qui donne son sens et son orientation à la finitude même (ce que, par-delà leur différences d’évaluation du statut de l’infini, affirment également Descartes, Kant, Fichte et Hegel lui-même) ; de là, j’en suis venu à la conception kantienne de l’analogie exigée par le jugement de réflexion de sa théologie critiquement pratique (« en nous permettant un anthropomorphisme symbolique qui, en fait, ne concerne que le langage et non l’objet lui-même », Kant, Prolégomènes, § 57) ; ensuite, il m’a semblé possible et nécessaire de convertir cet usage moralement pratique de l’analogie anthropomorphe (entendement et volonté divine) chez Kant en un usage spéculatif et dialectique d’un « tout se passe comme si » herméneutique et théologique pour comprendre par réflexion les nouvelles données épistémologiques et éthiques de notre modernité contemporaine ; enfin, pour penser par analogie la sur-existence de l’entendement divin comme « sens » (non comme connaissance) du Tout à notre point de vue, il m’a semblé que la Logique dialectique hégélienne, interprétée comme l’auto-réflexion la plus pure à laquelle parvient l’esprit humain, pouvait seule convenir en vertu du principe que c’est par analogie avec le plus haut de notre esprit que nous devons penser ce qui est plus haut que notre esprit. Mais tandis que la Logique dialectique était pour Hegel la réflexion de la pensée infinie de Dieu se pensant (« avant la création du monde », écrit-il) dans notre esprit fini se pensant lui-même, elle est selon moi seulement une auto-réflexion conceptuelle supérieure de la raison humaine que celle-ci peut toutefois prendre comme un analogon subjectivement nécessaire de la pensée de soi de Dieu. La logique dialectique n’a plus le statut encore métaphysiquement dogmatique qu’elle a chez Hegel, mais elle a bien un statut dépassant celui de la simple logique transcendantale de la finitude à laquelle s’est arrêté Kant.
A-P : Vous n’êtes pas seulement philosophe, vous êtes aussi peintre. Le fait de peindre influence-t-il votre regard sur le monde ? Plus généralement, comme vous le montrez dans Peinture et Philosophie 5, la peinture n’est pas sans lien possible avec la philosophie. Comment situeriez-vous ces deux démarches de la philosophie et de la peinture (et des arts en général) ?

A-S : En effet, en tant qu’élève du peintre et professeur de Lycée, Jean-Yves Couliou, je fus encouragé par lui à faire plus tard des études d’arts plastiques et à préparer les concours de professorat de dessin. Mais ma découverte en Classe terminale et mon intérêt devenu prépondérant pour la philosophie ont motivé mes études universitaires dans cette discipline ; toutefois, comme j’en avais donné l’assurance à mon maître Couliou en quittant le Lycée, j’ai toujours continué à dessiner et à peindre en parallèle, en exposant parfois en amateur. Mes recherches sur les romantiques allemands, Hegel, et Cassirer m’ont convaincu de la convergence de visée spirituelle entre les pratiques artistiques (y compris de la poésie que j’ai commentée chez Mallarmé) et de la philosophie. Il y a, lorsqu’elles sont pratiquées les unes et les autres d’une manière critique et réflexive, une étroite parenté entre elles : une critique des apparences et des illusions perceptives de la doxa, en matière de « réalité » naïvement figurée et rassurante ; une reprise et une « reformation » (ou « reformulation ») des contours de cette réalité humaine dont on a dégagé et exposé les invariants, le plus souvent inquiétants (en philosophie j’ai souligné que « l’inquiétude » est une constante affective de la conscience humaine) ; le soulignement de ces « défections » invariantes (J. Bosch, F. Goya, V. van Gogh entre autres) impliquant le manque douloureux d’une perfection visée au-delà, mais jamais donnée ni « révélée » . Il y a là quasi-identité de démarches entre un certain genre de peinture et une philosophie phénoménologique et critique, mais certes, seulement en rapport avec une certaine tradition picturale dont je me sens solidaire : la mienne est souvent plus liée au dessin proprement dit (satirique, caricatural, voire humoristique et socialement critique) qu’à la peinture et à la couleur, mais sans l’exclure, puisque l’illustration des « Horreurs du monde » 6, par exemple, était une peinture, celle d’un attentat à la voiture piégée à Bagdad. J’éprouve aussi le besoin de faire des « pauses » avec des peintures plus sereines et distanciées, paysages, nus, portraits, souvent en Afrique du nord et en Egypte, mais je reviens vite à des formes plus ou moins « inquiétantes ».
A-P : Comme pour Les Horreurs du monde, la couverture de votre livre est une de vos œuvres. Cette illustration, « Le travailleur », l’avez-vous réalisé pour l’occasion ? De façon générale, comme l’a montré Marx, par exemple, le travail participe à l’anthropogenèse de l’homme, il est aussi une façon de se rapporter à la nature. Pourriez-vous nous parler de cette illustration et de son lien à votre réflexion sur l’humanisation de la nature ?
A.S : « Le travailleur » fait partie d’une déjà vieille série – jamais « exposée » – de dessins et d’encres illustrant les « détresses de la ville », c’est après coup que je l’ai proposé en illustration de couverture. Cette série de dessins, commencée lorsque j’étais étudiant à Rennes, visent à montrer l’ambivalence « progressive-régressive » des constantes comportementales, typiquement humaines en milieu urbain, telles qu’en effet le travail, l’amour, la consommation, attitudes qui, dans un certain contexte favorable, peuvent manifester un « progrès » de l’homme vis-à-vis de l’animal (création d’œuvres, sentimentalité et érotisme, art culinaire du « cuit » (cf. Lévi-Strauss), mais qui, dans un contexte social dégradant, entraînent une « régression » : aliénation du travail, misère, prostitution, alcoolisme, etc. Travail aliéné-misère-prostitution-alcoolisme, ce quaternaire sinistre a déjà été évoqué par Marx lui-même dans quelques passages de son œuvre. L’exposition actuelle de mes peintures, dessins et textes, intitulée Folies de moines (Bibliothèque Universitaire, 2013, Université Permanente de Nantes, 2015) s’inscrit dans cette approche des contextes extrêmes, possiblement dégradants. Je l’ai traitée en référence à S. Brant, J. Bosch, Erasme, Luther, Goya, et aussi à l’écrivain Lewis auteur du fameux roman « Le moine » (1796), ainsi qu’au film qu’il a inspiré à Dominik Moll avec Vincent Cassel dans le rôle du moine (2011). Le contexte d’extrême isolement et de « renoncement » de la vie monastique a longtemps favorisé des démesures et des « folies » compensatoires de toutes sortes, révélatrices, pour le philosophe et le peintre, des pôles opposés de sublimité et d’abjection de l’existence humaine. Hegel avait déjà montré – après et avec Luther – dans ses Leçons sur la philosophie de l’histoire que l’isolement monastique et les privations extrêmes entraînent contradictoirement le retour monstrueux du « refoulé » : « les cloîtres et autres institutions, auxquels était imposé ce vœu de renoncement, étaient tout à fait tombés dans la perversion du monde » 7.
A-P : Venons en maintenant à votre nouveau livre, « L’humanisation de la nature », lequel essaye de penser « l’unité d’une humanisation de la nature et d’une naturalisation de l’homme » (165). De façon très stimulante, il nous montre comment on peut comprendre l’homme comme le fruit d’un devenir de la nature et comment l’homme ayant exploité une tendance inhérente à la systémique naturelle se constitue un univers culturel, dans lequel une humanisation technique de la nature et corollairement une humanisation morale et juridique de la nature émergent nécessairement. Après des analyses techniques visant à comprendre la logicité du vivant, votre livre au terme d’un parcours remarquablement bien articulé s’ouvre ainsi sur des problèmes relatifs à l’éthique environnementale, qui lui confèrent une actualité indéniable. A mon sens, le problème écologique constitue un enjeu majeur de notre siècle qui reste encore trop peu thématisé. Si dans les milieux anglo-saxons, les environmental studies font l’objet d’une activité non négligeable, elles occupent un champ encore marginal dans le milieu académique français. A quoi attribueriez-vous cette frilosité des philosophes, voire ce dédain, face à un problème pourtant criant ?
A.S : Cette « frilosité », pour reprendre votre terme, est néanmoins relative : je pense en particulier en France aux articles et livres de Georges Chapouthier (cf. la page 149 de mon livre), Catherine et Raphaël Larrère, Philippe Descola et Jean-Yves Goffi, tous évoqués. Mais il est vrai que cette recherche n’a pas acquis l’ampleur qu’elle a prise dans la philosophie anglaise et américaine en particulier. Pourquoi ? Sans doute parce que les deux courants actuellement dominants de la philosophie « continentale », la philosophie analytique et la philosophie herméneutique, se préoccupent d’avantage de philosophie théorique du langage que de philosophie pratique du moins relativement à l’environnement ; la philosophie pratique elle-même, lorsqu’elle est développée par des auteurs comme Habermas, Apel, Honneth, n’outrepasse guère la sphère d’une pratique interne à la sphère sociale et peine à s’ouvrir à la relation société-environnement.
A-P : Quand on s’ouvre cependant à la relation société-environnement, on a souvent tendance à verser dans le tragique. C’est le cas de Hans Jonas et de son heuristique de la peur. On montre alors la rupture consommée de l’homme avec son monde et on tend à y remédier de façon quelque peu artificielle par un élargissement du concept de responsabilité. Mais à trop insister sur l’opposition, on voit mal comment on va pouvoir réconcilier l’homme et la nature. Votre position par rapport à ce que seraient les deux écueils épistémiques, celui d’un humanisme dénaturalisé et celui d’une naturalisation déshumanisante est à cet égard exemplaire et mérite d’être soulignée. Je me permets de citer un passage de la conclusion de votre livre qui en résume bien l’esprit : « Les développements qui précèdent nous semblent avoir amplement confirmé l’hypothèse selon laquelle l’absorption naturaliste ou matérialiste de l’homme dans la nature, non moins que son arrachement ou sa différence irréductible d’avec elle, sont des positions antinomiques qu’il faut à présent abandonner. L’humanisation de la nature ne se comprend que si l’on admet que l’homme est dans et par la nature, de même que réciproquement, la nature est dans et par l’homme, dans et par ses pratiques autant que dans et par ses théories, notamment scientifiques et techniques » (163-164). En fait, comme vous l’indiquez plus loin, il s’agit pour vous de penser conjointement la rupture et la continuité entre l’homme et la nature. Contre les dualismes présidant à la modernité, vous essayez dès le premier chapitre de votre livre à fonder la rupture qui aurait donné lieu à la culture au sein même d’un dynamisme inhérent à la nature. Il s’agit alors de montrer comment on passe du systémique naturel au systématique humain. Le ressort de cette transition repose sur une certaine dialectique processuelle que vous mettez en relief à partir de différents penseurs ayant essayé de conceptualiser le devenir de la nature (Simondon, Bertalanffy, Varela et Maturana). Par là, votre nouveau livre s’inscrit, par sa façon de penser un rapport dialectique entre l’homme et la nature, dans un champ de réflexion qui prolonge vos travaux antérieurs. Comment le situeriez-vous par rapport à ceux-ci et en particulier par rapport à votre « dialectique réflexive » ?
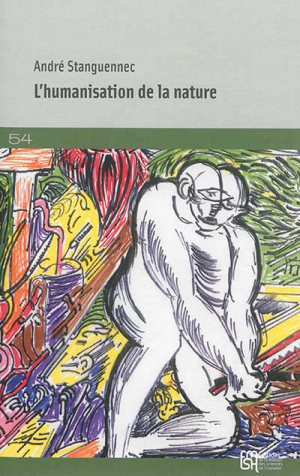
AS : L’humanisation de la nature est un livre qui, ainsi que je l’indique dans l’Introduction, intentionne une recherche complémentaire de celle développée dans Les horreurs du monde. Celle-ci concernait essentiellement une phénoménologie de nos affects historiques extrêmes (de joie et d’horreur), tandis que la seconde vise à articuler la recherche sur la relation culture–nature, sans perdre de vue la dimension affective et émotionnelle des « épreuves » que nous expérimentons au sein de « l’univers ». Dans les deux livres, je cherche à mettre en œuvre une méthode phénoménologique impliquant que notre relation immanente à l’histoire comme à la nature consiste en une « donation de sens » intentionnelle qui a toujours deux dimensions, une dimension cognitive, certes, mais indissociable, sinon par abstraction, d’une dimension émotionnelle qui motive et de plus approfondit souvent la première. C’est en ce sens aussi qu’une dialectique y est à l’œuvre, la dimension affective prolongeant notre identité avec la nature, tandis que la dimension cognitive et symbolique, toujours plus ou moins présente, exprime notre négativité et notre rupture relative avec elle. Une identité qui se maintient à la faveur d’une autodifférenciation est, en effet à mon sens, une relation pleinement dialectique. Par rapport à La dialectique réflexive, I , Lignes fondamentales d’une ontologie du soi, le livre Les horreurs du monde représente dans mon esprit un prolongement de la Première Partie de l’ouvrage (« l’Idée pratique ») qui propose une interprétation dialectique et réflexive de l’éthique en direction du droit, de la morale et enfin de l’histoire que Les horreurs du monde concrétisent et approfondissent dans le sens d’une phénoménologie des affects extrêmes, comme je l’ai dit tout à l’heure. L’humanisation de la nature, lui, me semble concrétiser et approfondir complémentairement plutôt la Seconde Partie de cette ontologie fondamentale («L’Idée cosmologique ») où est déjà proposée une interprétation des données de l’épistémologie des sciences physiques et biologiques contemporaines dans le sens d’une certaine téléologie réflexive et critique des phénomènes naturels et de l’accès à la fonction symbolique.
A-P : Commentant Spaemann, vous parlez de la culture comme de l’accomplissement d’une « virtualité tendancielle » (40). Vous parlez ensuite du fait que certaines difficulté inhérentes à l’équilibre métastable de la nature aurait fournit comme une « chance » (45) d’autodétermination pour le vivant. De façon générale, toute votre interprétation me paraît pouvoir être lue en termes de modalité. La nature dans son devenir dialectique fournirait la possibilité de la culture, laquelle réflexivement au sein de son discours symbolique ferait de la possibilité son centre de gravité qu’elle identifierait avec la nécessité dans une démarche fondationnelle qui serait comme une forme faible du principe anthropique (il ne s’agit pas de montrer que l’univers est fait pour l’homme, mais de montrer qu’il ne peut prendre sens que pour l’homme), voire comme une forme forte du principe fondée sur l’idée de fondée d’une finalité interne de la nature analogue à celle de l’homme. Si l’on considère la façon dont le possible se définit par rapport aux autres modalités aléthique, il resterait à le concevoir dans son rapport aux catégories modales de la contingence et de l’impossibilité, dont le phénomène sensible serait la mort. Vous en parlez certes, en passant, à plusieurs endroits, mais j’aurais voulu votre opinion de façon plus détaillée sur le sujet. Certains auteurs, je pense notamment à Unamuno, qui a beaucoup insisté sur le sentiment tragique de la vie, font de la conscience de la mort le maître mot de ce qui caractérise l’existence humaine et plus généralement l’accession à la culture. Comment situeriez-vous la mort dans votre devenir humain de la nature ?
AS : Le livre résume brièvement d’abord l’argument de la « forme faible » du principe anthropique, tout en constatant sa limitation au seul plan d’une épistémologie prudente et critique; mais du point de vue philosophique, le livre argumente de plus en faveur d’une version de la « forme forte », non pas à partir d’un présupposé religieux (l’univers fait pour l’homme) ce qui serait la modalité « dogmatiquement théologique » de cette forme forte, mais à partir d’un présupposé qui est celui du jugement de réflexion au sens kantien, consistant à « penser » de façon argumentée, non à connaître bien sûr, la présence d’une finalité interne et autonome de la nature que l’homme envisage rétrospectivement comme « analogue » – non spécifiquement identique – à la finalité de son « soi » subjectif final, bien qu’il ne s’agisse pas d’attribuer de façon déterminante un « esprit » ou une « âme » à la nature en évolution. J’insiste pourtant sur l’idée que cette analogie est une « analogie de l’être », selon le titre du dernier volume de La dialectique réflexive, III, une analogie de « l’être essentiel » et non une analogie inessentielle, accidentelle et contingente, simple similitude métaphorique. Chez Kant, l’analogie réfléchissante du concept de finalité ne concernait dans la troisième Critique que l’évolution comme développement orienté de l’individu dans son rapport à l’espèce, tandis qu’une interprétation que l’on nomme parfois « néo-finaliste » critique peut concerner à présent l’évolution comme transformation des espèces, voire la transition du physique au biologique, comme j’essaie de l’argumenter.
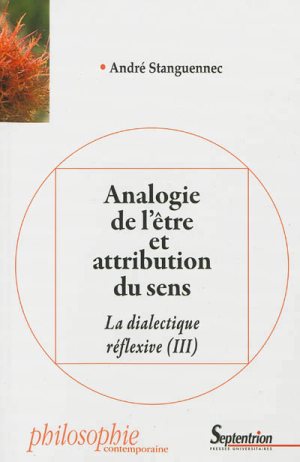
Les modalités aléthiques du « possible », du « non-possible » et du « probable » sont en effet importantes pour cerner mon argumentation, comme vous le notez. Pour une interprétation rationnelle du principe anthropique comme la mienne, il est impossible (« non-possible ») que la finalité « scopique » (ou du « projet ») propre à l’intelligence humaine soit un « don miraculeux » émanant de la transcendance divine : cette non possibilité relève de la contradiction interne aux yeux d’une raison argumentée. A l’opposé de ce non-possible, il est « possible », mais à mon sens très peu « probable », que notre finalité scopique d’humains soit l’effet évolutif mécanique et aveugle d’un phénomène entièrement non finalisé. On ne comprend en effet que très difficilement comment une nature totalement dépourvue de finalité aurait pu donner effet à un phénomène auto-finalisé comme le projet humain. Ainsi entre le « non-possible » (finalisme dogmatique) et le « possible peu probable » (mécanisme non finalisé), la dialectique réflexive propose une voie moyenne, celle d’une hypothèse dont la possibilité de vérité est « le plus probable » : celle d’une finalité interne naturelle minimale tendant à se développer dialectiquement dans certaines « lignes d’univers » et ayant pu y réussir sur terre. Mais il ne faut pas confondre cette forte probabilité comme qualité estimée de mon hypothèse interprétative (entre l’impossible et le peu probable) comme si elle reflétait la grande probabilité de l’émergence du contenu du phénomène final humain lui-même, au contraire : les conditions objectives, physico-chimiques, de cette émergence étaient en effet fort « peu probables » et « peu favorables » à cette émergence dans l’objet lui-même, et c’est là mon accord quant au contenu avec l’argumentation « scientifique » de la « forme faible » du principe anthropique. La plus grande probabilité aléthique concerne la forme ou démarche de mon argument.
Je pratique peu la pensée d’Unamuno, mais il me semble qu’il insiste en effet sur la fécondité du sentiment tragique de la mort au sein de la vie, expérience la plus radicale de notre finitude, féconde, car mobilisant le désir d’un sens visant à dépasser cette finitude même. L’animal ayant des instincts dispose d’un savoir-faire l’empêchant de prendre conscience de cette finitude mortelle et lui permettant de remédier de façon spontanée aux « infirmités » que j’ai nommées dans la dialectique réflexive les aspects de notre « défection ontologique » de notre « être-en-défaut » au regard d’un « être-sans-défaut » dans La dialectique réflexive, III, pour un argument posant la « sur-existence » (non « l’existence » car l’« existence » proprement dite est, dans la sémantique kantienne que je reprends, une modalité spatio-temporelle) d’un sens transcendant et infini en acte que les religions et les métaphysiques nomment Dieu. Notre « désir de sens » (anhelo de finalidad, Unamuno) stimulé par l’inquiétude de la mort mobilise en effet la fonction symbolique, la raison discursive et métaphysique, car c’est une de nos défections ontologiques. Dialectique encore : négation seconde d’un négatif mortel.
A-P : Vous parlez de la néoténie, de l’ « être en défaut » de l’homme comme d’une chance en quelque sorte. Corrélativement à cette chance, il y a toutefois un danger, c’est que l’homme échoue à se réaliser dans la fonction symbolique, dans la raison discursive. L’homme ne serait pas à la hauteur de son possible. Dans le devenir rationnel de l’homme, il y a alors la possibilité de la déraison. Hegel en parle comme d’un privilège de l’homme. La folie est un thème important de vos Leçons sur le rationnel et l’irrationnel[A. Stanguennec, Leçons sur le rationnel et l’irrationnel. Métaphysique, critique, pratique, Paris, Ellipses, 2014 et cf. la recension de ce livre à [cette adresse [/efn_note], comment la situeriez-vous dans le devenir humain de la nature ?

A.S : J’ai évoqué plus haut mon traitement pictural du thème de la « déraison », en vous parlant des excès et démesures du « spécifiquement humain » en contexte aliénant. La folie (ou la psychose) est évidemment l’expérience d’une situation-limite de l’horreur affectée par l’effondrement du monde vécu, dont la joie est selon moi le contraire vécu, ce qui permet de les comprendre phénoménologiquement l’une en fonction de l’autre. C’est, à mon sens, et en rapport plus direct avec l’enseignement de la psychanalyse, la perte des « instincts » animaux en régime de « savoir-faire » régulateur pour la reproduction sexuelle et la socialisation face aux agressions ; c’est la perte quasi totale de ces instincts, encore présents chez les primates sociaux, qui a réduit leurs énergies sous-jacentes à l’état de simples « pulsions » d’autant plus intenses qu’elles sont devenues initialement sans « objet » instinctivement déterminé, et d’une extrême labilité chez l’enfant humain. L’éducation et la contrainte du refoulement de certaines de leur formes de satisfaction se sont substituées à l’instinct régulateur, entraînant, comme Freud l’a montré à mon sens définitivement, la possibilité du trouble mental (névrose, voire psychose) lorsque les voies substitutives du rêve et de la sublimation ne peuvent plus être empruntées. Toutefois, et c’est sur ce point que je m’éloigne de Freud pour me rapprocher de Hegel et de Sartre, la perte des instincts n’a pas seulement fait émerger l’indétermination inquiétante des pulsions, mais, corrélativement, l’indétermination de la conscience de soi humaine qui n’est plus, comme elle l’est chez l’animal, une simple et faible accompagnatrice de l’instinct qui la détermine. C’est la conscience de soi, inquiète de son propre « néant » de prédétermination comportementale, qui a précisément pu (et dû !) s’auto-déterminer par le libre-arbitre et la fonction symbolique, deux dispositions rendues possibles par cette perte. Les formes culturelles de l’éducation, de la contrainte et du refoulement, ne sont pas les données mécaniques d’un inconscient « primaire », mais des produits signifiés et signifiants de la conscience collective humaine, même si leur intériorisation individuelle les font fonctionner comme un « sur-moi moral » devenu habituel et peu « réfléchi » consciemment. De cette genèse, Freud nous parle très peu en termes de dialectique originaire de la conscience (du Moi) et de l’inconscient, c’est d’ailleurs ce que lui reprochera son disciple C.G. Jung qui, lui, admet explicitement une approche dialectique de cette relation dont il fait le titre d’un de ses ouvrages (La dialectique du Moi et de l’inconscient, 1928). De plus, c’est le « projet fondamental » d’être un soi concret – l’« individuation » dans les termes de Jung – c’est-à-dire une synthèse heureuse d’universalité libre et de particularité pulsionnelle socialement conditionnée qui, montre Sartre à propos de Flaubert, est à l’origine aussi bien des névroses que des œuvres qui les dépassent et en en sublimeant la dimension pulsionnelle (« œuvres » au sens large : d’art ou d’amour, d’engagement moral, politique ou intellectuel). Comme l’a montré avant lui Hegel, la folie est une possibilité essentielle de ce devenir « individué », « singulier » de l’individu, synthèse de l’universel concret, particularisé, en marche vers la conscience de soi unifiée. Elle advient lorsque celui-ci en reste à une « fixation » solidifiée (Festwerden c’est l’expression de Hegel, dans son Anthropologie), à une dimension pulsionnelle « particulière » de son moi, sans pouvoir s’en distancier ni la mettre librement au service de sa dimension « universelle », celle d’une conscience autonome de soi, réfléchie et auprès-de soi dans l’altérité d’un objet qu’elle a contribué à « faire » ou à « œuvrer ». « Faire, et en faisant, se faire », telle est la phrase de J. Lagneau, répétée par Sartre ici : c’est ce à quoi ne parvient pas le « fou » et ce qui – car ne soyons pas trop sûrs de nous, restons inquiets – risque toujours de se « défaire » follement dans une vie humaine…
A-P : Penser la folie à partir du devenir humain de la nature, c’est éviter de faire du fou un être situé hors des marges de la nature humaine. C’est, par là, montrer notre responsabilité vis-à-vis du fou. Dans l’intéressante réhabilitation, contre Spencer, de Darwin par Tort, il y a, comme vous le montrez, cette idée de la prise en charge des plus faibles. A partir de là, on pourrait élaborer une nouvelle forme de darwinisme social fondé non plus sur l’élimination des faibles, mais sur leur protection. On dira alors que plus une société est forte, plus elle est à même d’intégrer ses éléments plus faibles en un tout harmonieux. Le problème comme vous le notez, c’est que si le darwinisme et son « effet réversif » (qui fait que la sélection naturelle est elle-même soumise à son propre mécanisme et n’est plus sélectionnée) rend compte de l’émergence d’un nouveau type de fonctionnement sélectif, il ne rend nullement compte de son adoption pratique. Selon vous, le passage de la continuité naturelle à la discontinuité ne serait pas le fruit aveugle d’un mécanisme, mais le fruit d’une orientation téléologique minimale au sein de la nature. Même si vous proposez une interprétation différente du devenir humain de la nature, il y a quelque chose de commun entre votre position et celle de Darwin qui consiste à essayer de rendre compte des droits et devoirs humains à partir du devenir humain de la nature. Comme vous le montrerez plus loin, c’est aussi sur base de ce devenir humain de la nature que se fonde en quelque sorte l’idée d’une morale élargie à la nature. Alors que la plupart des écologistes insistent sur l’idée du futur pour défendre l’idée d’une éthique plus englobante, vous vous attachez à retrouver des tendances morales universalisables dans un passé (voire un passif) naturel de la culture. Comment vous positionnerez-vous cependant par rapport à l’idée du futur ? Peut-on faire du futur une norme éthique ? Si non, pourquoi ?
A.S : Pour répondre adéquatement à votre question, je dois faire un assez long détour et revenir à mes positions de principe relatives aux rapports entre « éthique » et « morale », tels qu’esquissés dans les Leçons sur le rationnel et l’irrationnelà propos d’E. Weil, et surtout telles que je les avais développées dans ma Conférence de Louvain, « Liberté personnelle et rationalité de l’éthique », lors de ma réception du Prix Cardinal Mercier, et publiée dans la Revue Philosophique de Louvain 8. Effectivement, le point commun avec l’entreprise darwinienne consiste à inscrire la « morale » au sein d’un système téléologique proprement humain que je nomme « éthique », c’est-à-dire un système de moyens élaborés rationnellement et de façon autonome, libre, pour un but final pratique qui est posé comme la valeur suprême, ou le « bien ». De plus, ce système est analogue – seulement analogue – aux systèmes comportementaux des animaux qui développent eux aussi un éthos comportemental spécifique, à la fois temporalisé et spatialisé de façon finale. Mais l’analogie s’arrête là et je m’éloigne de Darwin en me rapprochant à nouveau de Hegel d’abord, et de Kant ensuite. Chez Hegel, c’est la volonté libre, non naturellement déterminée comme je l’ai rappelé dans la réponse précédente, qui projette le système éthique de ses fins et j’y vois une « relève dialectique » (Aufhebung) de l’éthos animal non-libre à partir d’une rupture évolutive d’ailleurs absente chez Hegel (qui était « fixiste » et rejetait catégoriquement les premières hypothèses évolutionnistes). Or, à la différence de Hegel qui n’envisageait que le système de la vie éthique de la liberté raisonnable, et en reprenant l’analyse de l’alternative éthique chez E. Weil cette fois, je pose que l’homme peut faire le libre choix entre deux sortes d’éthiques, les unes où ce sont les fins universelles de la raison et de ce qui l’accompagne en matière d’art, de religion ou de science qui sont le but final du système, les autres, diamétralement opposées, où ce sont les fins particulières (sociales, psychologiques, dogmatiquement religieuses, notamment) qui constitue la valeur finale de l’éthique, qui, du coup, se constitue en un particularisme, voire un « intégrisme » ou un « fanatisme » ou bien encore un « racisme » violent, particularisme violent que l’ on voit sans cesse réapparaître dans l’histoire humaine et encore très récemment en Europe. Mais la violence peut bien avoir son éthique, opposée à celle de l’universalisme : car elle a sa cohérence, et sa conséquence interne, elle fait usage de techniques, de propagande, etc., même si pour elle, la raison (universelle) lui sert de « moyen » pour des fins qui excluent la raison (la contradiction performative ne saurait la gêner, puisque la rationalité n’est pas sa valeur première conditionnant toutes les autres).
J’en viens alors à la morale : pour moi elle réside dans l’intériorisation des règles « juridiques» de l’éthique (je n’ai pas le temps de le développer ici, mais le violent « éthique » a aussi sa « morale »). Celle-ci implique en effet – et je reviens positivement à Hegel- que les volontés éthiquement libres construisent d’abord les règles de droit de leurs rapports en s’autolimitant (Kant) et se promouvant réciproquement (Hegel). Ce n’est donc pas la morale qui est, selon le beau titre de Kant, « le fondement métaphysique des mœurs » et donc du droit, c’est l’inverse : les règles morales sont l’intériorisation, tout particulièrement « éducative », des règles de droit en contexte éthique social (Hegel). Le respect pour la loi morale, c’est-à-dire pour l’obligation intériorisée découlant du droit éthique, n’est pas supprimée mais il est le dernier moment de cette genèse dialectique (éthique alternative, droit, morale). J’en viens enfin à votre question : ce n’est pas la théorie de l’impératif catégorique que je reprends de Kant (je critique cette théorie de la même façon que Hegel : c’est l’éthique du droit ou le droit fondé éthiquement qui fonde à son tour la conscience intérieure des impératifs de la moralité). Mais j’essaie de faire travailler plutôt ici la théorie kantienne de la Typique du jugement moral : il est en effet possible de faire de la « loi naturelle » au sens large, envisagée comme système téléologique de vie régulé, nécessaire pour une espèce vivante donnée, un « modèle » ou un « type » formel pour un jugement « moral » au sens de Kant, c’est-à-dire pour de libres consciences singulières en dialogue, respectant moralement la règle d’universalité que chacune a intériorisée pour soi et cherchant à l’appliquer à des cas difficiles, problématiques, comme ceux de la régulation environnementale. Puisque l’éthique a déjà été envisagée comme un dépassement dialectique du système-éthos animal par l’espèce humaine, il y a déjà eu, dans le passé évolutif, une communauté « génétique » partielle, pourrait-on dire, entre éthos animal et éthique humaine ; mais cette communauté – hypothèse théorique du philosophe – vient à se renforcer sur la base et à l’intérieur de l’éthique formée cette fois, du point de vue de la « moralité » qu’elle a engendrée dans les consciences et qui implique une « reprise » morale dans le présent et pour l’avenir de cette communauté dans les discussions entre consciences (individus) devant décider en commun des mesures à prendre pour leur avenir. La typique devient donc un « opérateur d’avenir », si je puis dire, pour une communauté éthique envisagée cette fois, non dans sa « pré-histoire », mais au cœur de son histoire en cours.
A-P : Dans la deuxième partie de votre livre, L’humanisation de la nature, vous vous intéressez à l’humanisation technique de la nature. L’homme ayant pris en charge la possibilité que lui offrait la nature dans sa processualité instable décide d’étendre le champ du possible à la nature dont il fait son monde. La fonction symbolique, dont le possible est un centre de gravité, joue comme vous le montrer dans l’usage technique un rôle capital. Vous parlez alors de la « présence opérante du langage humain » (71) qui sert à organiser la technique sous les préceptes d’une intentionnalité. Je pense qu’il s’agit d’un trait important que vous relevez et j’aurais voulu savoir ce que vous pensiez du langage formel qui partant d’axiomes limités peut produire – toute une série de résultats sans que ceux-ci soient vraiment pensés, ainsi que Derrida, par exemple, le faisait apparaître dans son célèbre article sur la sémiologie de Hegel. Ce langage formel ne serait-il pas une forme hybride entre le langage symbolique qui inscrirait la technique dans une volonté pensante et la technique elle-même ?
AS : En effet, le langage logico-formel d’abord puis celui des formalismes logico-mathématiques est de nature opératoire, et ses développements informationnels et informatiques, en font explicitement une médiation entre le langage encore « réflexivement pensant » dans sa fonction d’échange pragmatique et l’opération technique matérielle. Le danger est que le développement lui-même technicisé de ces formalismes se coupe de toute réflexivité compréhensive et limitative dans le champ social et communicationnel (pragmatique), comme J. Habermas l’a amplement montré dans ses travaux.
A-P : Après avoir montré comment l’homme se situe dans le prolongement de la systémique naturelle, vous faites apparaître comment l’homme entend humaniser la nature par sa fonction symbolique et par la technique. Vous discutez alors de la technique chez Bergson, Heidegger et Marx. Vous montrez comment le fait d’agir sur la nature et de lui imprimer durablement des projets humains entraîne nécessairement un nouveau champ de responsabilité pour l’homme. Vous traitez alors de l’éthique de la responsabilité de Hans Jonas et vous en montrez les faiblesses argumentatives, notamment au niveau de l’instanciation dialogique de son éthique. Vous abordez également Tort, Serres et la deep ecology. Dans la discussion de tous ces auteurs, vous essayez de concilier la moralité propre à l’homme en tant que se déterminant hors de la législation de la nature et l’éthique environnementale liée au respect de ce qui constitue l’habitat de l’homme. Pour vous, c’est en réfléchissant sur la continuité de l’homme à la nature, en faisant preuve d’un « anthropocentrisme réflexif » (160) qui rompt avec le dualisme cartésien, que l’on pourrait fonder un droit indirect du vivant. L’enjeu serait de constituer « indirectement » l’éthique environnementale en resituant la moralité humaine dans le devenir humain de la nature.
Au niveau théorique, il y a là quelque chose de très concluant et subtil. Ma question porte plutôt sur le niveau pratique. Comment pourrait-on concrètement implémenter un système de droits indirects ?
AS : Le philosophe comme tel a malheureusement peu de moyens d’intervention dans le champ pratique des institutions juridiques, bien qu’on commence à lui demander son avis dans certaines d’entre elles. La notion de droits indirects et analogiques de l’animal (pp.161-162 du livre) reste une notion relevant d’une théorie éthique-morale argumentable ; si l’animal est un sujet analogique de droit, c’est aussi parce qu’un sujet immédiat de droit peut les exercer et les revendiquer lui-même, ce qui n’est pas le cas de l’animal ; la traduction de ces droits dans les faits d’institution juridique ne pourrait s’expliciter qu’au niveau d’obligations juridiques renforcées dont le citoyen humain demeure le sujet agissant et défenseur : or les nouvelles propositions de loi relatives au droit de l’animal en France, lui reconnaissant un droit à la protection de sa vie et à la consommation spécifique (limitée) d’espèces, n’ont malheureusement pas obtenu d’entrer très largement en débat législatif, au-delà d’une reconnaissance par amendement « d’êtres vivants doués de sensibilité » (se substituant au statut de « biens meubles »), cela en raison des résistances anticipées de nombreux praticiens de l’élevage et de la chasse ! Ce qui me semble à éviter aussi bien en théorie que dans les faits juridiques – c’est dans ce sens que va l’argumentation du livre – ce sont les extrêmes opposés de droits antispécistes quasiment illimités (et théoriquement inconsistants) de l’animal du côté de certains courants de la deep ecology et, de l’autre côté, de droits animaux purement formels, non matériellement assortis d’un lourd appareil de contrôle et de sanctions pénales (pour des raisons de ménagement économique et électoral de la part des politiques).
A-P : Ernst Kapp dans sa philosophie de la technique 9, la première qui porte d’ailleurs ce nom, développait l’idée de l’Organ-Projektion, à savoir que la technique serait un moyen de prolonger nos organes, d’augmenter en quelque sorte son soi, avec pour contrepartie qu’une fois que l’homme ne se reconnaîtrait plus dans ses productions techniques, il faudrait considérer celles-ci comme mauvaises. En exploitant l’opposition romantique entre organique et mécanique, Kapp se proposait de normer la technique en y projetant une normativité relevant de l’organicité vivante propre à la nature. Dans une telle perspective, ce ne serait pas seulement l’homme instrumentant la technique qui se comprendrait dans un devenir humain de la nature, mais la technique elle-même qui aurait à se comprendre à partir d’une logicité naturelle sous peine de produire des dualismes. On aurait alors une façon de fonder la normativité naturelle, bien différente de la « deep ecology » qui tend à projeter sur la nature des propriétés humaines. Que pensez-vous d’une telle façon d’aborder les problèmes ?
AS : Sans avoir nommé Kapp et son livre, j’ai développé l’hypothèse de la néoténie évolutive, de sorte que, en effet la technique humaine se substitue à l’absence de défenses organiques pour y suppléer tout en reconnaissant que l’instinct animal est déjà un « savoir-faire » qui fournit des schèmes imitables (dans le domaine de l’habitat, de l’organisation sociale, de l’outillage notamment). Toutefois, selon moi, c’est l’accès, sans doute lui-même progressif, à la fonction symbolique et au langage « proprement » humain qui a fondé la possibilité intelligente de la « technique » au sens spécifiquement humain. De sorte que la technique humaine, comme le langage, continue par d’autres moyens qualitatifs ce que la nature amorçait avant elle.
A-P : Par rapport aux problèmes de l’articulation entre nature et culture, vous parlez relativement peu des remodelages de ces notions à travers les débats sur l’anthropotechnique que prônent les transhumanistes. Quelle serait votre position à cet égard ?
Enfin, j’aurais voulu savoir ce que vous pensez de certaines positions qui consistent plus à dissoudre le problème écologique qu’à le résoudre. Du côté des technophiles, qu’ils soient transhumanistes ou non, par rapport au problème de l’environnement, se dessine ainsi une position, peut-être moins fantaisiste qu’il n’y paraît, et qui consiste à mettre plus d’espoir dans l’idée de créer une atmosphère artificielle hors de la terre (sur la lune ou ailleurs) que dans celle d’inscrire notre rapport à la terre dans une perspective durable. On se situerait ici aux antipodes de l’idée propre à Serres d’un contrat naturel avec la terre que vous discutez. Plutôt que de tabler sur l’aspect continuité du rapport de l’homme au monde, il s’agirait de tabler sur les moyens techniques qui continueraient d’accentuer l’indépendance par rapport au milieu immédiat. On peut trouver chez des auteurs comme Hottois des arguments allant en ce sens. « Le véritable corrélat de la technoscience et de la civilisation technoscientifique est le cosmos, l’univers, pas la Terre, qui est son berceau. C’est dans l’espace extraterrestre que les technosciences sont conduites à donner toute leur mesure. La prise en compte de ces ressources cosmiques potentielles relativise fortement tous les discours sur l’épuisement de la Terre comme devant sceller nécessairement le destin de l’espèce humaine » 10. Que pensez-vous d’une telle position ?
AS : Je crois que sous une étiquette commune et commode, le « transhumanisme » recouvre des opinions et des idéologies bien différentes et parfois même conflictuelles. Dans Les horreurs du monde (Ch.X, Les valeurs libérales d’un corps délibéré) vous vous souvenez sans doute que j’ai étudié les projets transhumanistes américains Génome, Artificial Life, Biosphère II (à quoi fait allusion votre dernière question) à la lumière de leur critique argumentée par L. Sfez ; de même que, plus longuement, les thèses de « l’eugénisme libéral » et leur analyse critique par J. Habermas. Dans la perspective complémentaire de L’humanisation de la nature à ce propos, je vois, dans ces excès techno-biologiques du transhumanisme, la volonté et le danger de supprimer de façon aliénante toute différence signifiante homme-nature, tantôt au profit d’un technicisme « sur-humaniste » utopiquement généralisé, tantôt d’un naturalisme fictionnel non moins confus et non moins dangereux. J’ai également formulé des réserves dans le premier livre (pp. 226-227) sur les positions de G. Hottois quant à « la régulation symbolique des sociétés qui s’articulent autour de la recherche et du Développement Technico-Scientifique (RDTS) » (cité p.227), de même que, dans le présent livre, sur l’ambiguïté d’une « culture de la transcendance symbolique (art, religion, philosophie) » qui se contenterait de fonctionner comme « conscience accompagnatrice » ne faisant que modérer « l’urgence et la frénésie » techno-scientifiques (G. Hottois, cité, pp. 164-165). A mon sens les trois grandes formes de la culture de la transcendance symbolique ont un autre rôle à jouer que celui de « conscience accompagnatrice modératrice et freinante » : celui d’une justification tantôt par l’image, tantôt par le sentiment, tantôt par le concept, de ce que la techno-science et ses modèles ne sont que des moyens et ne doivent pas être pris comme des fins dernières suffisantes de l’existence humaine.
A-P : Ne pensez-vous pas que l’on est dans une civilisation qui insiste de plus en plus sur les moyens au détriment des fins. N’y a-t-il pas là une urgence de l’éducation ? Quel serait le rôle de l’éducation dont Kant, faisait la tâche la plus importante pour l’humain, eu égard aux formes de la culture de la transcendance symbolique (art, religion et philosophie) en général et de l’écologie en particulier ?
A.S : J’ai déjà fait plus haut allusion au rôle fondamental de l’éducation dans le passage de l’éthique d’un droit encore extérieur et contraignant, à la moralité proprement dite en tant qu’intériorisation des règles, intériorisation affectant un sentiment spécifique que Kant a génialement décrit comme ce respect qui nous élève au-dessus de notre simple animalité et nous rabaisse en même temps dans nos prétentions et pulsions particulières (et particularistes). Il va de soi que, pour cette éducation à des valeurs universelles concrétisées dans une œuvre qui nous élève tout en prenant naissance dans un contexte culturel singulier, l’art et la religion orientés vers l’universel et la reconnaissance, tolérante et réciproque, peuvent avoir un rôle également essentiel à jouer selon les projets fondamentaux que chacun est libre de rejoindre. Je me permets de développer cela en citant un passage de ma conférence de Louvain qui concernait, il est vrai Fichte, mais ce dernier ne faisait, comme vous le savez, que reprendre sur ce point les analyses décisives de Kant : « …Fichte souligne dans l’éducation l’interaction des libertés par la médiation du discours de la loi, la puissance de solliciter la liberté de l’enfant pour un respect moral de la loi, qu’étant adulte il pourra fonder philosophiquement pour soi, en toute indépendance…Le philosophe doit lui aussi éduquer les êtres dont il a la responsabilité au respect juridique et moral de la loi, en leur expliquant le sens de l’alternative fondamentale qu’ils auront à trancher personnellement le moment venu. La fonction éducative et morale de la société familiale, et plus extensivement de l’éducation dans la sphère publique et dans la sphère associative, a ici un rôle fondamental à jouer pour le philosophe qui doit donc aussi s’y engager personnellement »(op. cit., p. 623)
- A. Stanguennec, Hegel, critique de Kant, Paris, PUF, Collection « Philosophie d’aujourd’hui », 1985.
- A Stanguennec, La dialectique réflexive, I, lignes fondamentales d’une ontologie du soi, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2006. A. Stanguennec, Etre, soi, sens, les antécédences herméneutiques de la dialectique réflexive. La dialectique réflexive II, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2008. A. Stanguennec, Analogie de l’être et attribution du sens. La dialectique réflexive III, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2013.
- P. Billouet (éd.), Herméneutique et Dialectique, Paris, L’Harmattan, 2013.
- A. Stanguennec, L’humanisation de la nature. Les épreuves de l’univers, Paris, Editions de la maison des sciences de l’homme, 2014.
- A. Stanguennec, Peinture et philosophie, un essai de phénoménologie comparée, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011.
- A. Stanguennec, Les horreurs du monde. Une phénoménologie des affections historiques, Paris, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2010.
- Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, trad. Gibelin, Paris, Vrin, 1963, p.305.
- A. Stanguennec, « Liberté personnelle et rationalité de l’éthique » in Revue philosophique de Louvain, août 2013, pp. 603-624.
- E. Kapp, Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Entstehungsgeschichte der Kultur aus neuen Gesichtspunkten, Braunschweig, Verlag George Westermann, 1877.
- G. Hottois, Philosophies des sciences, philosophies des techniques, Paris, Odile Jacob, 2004, p. 192.







