Claude Romano est un phénoménologue contemporain, proposant depuis plusieurs années une herméneutique événementiale. Dans Au coeur de la raison, la phénoménologie, il se propose de refonder le projet phénoménologique au regard de la tradition analytique.
Les propos ont été recueillis par Thibaut Gress.
A : Questions de méthode
Actu-Philosophia : Au cœur de la raison1 est un livre énorme qui paraît au milieu d’une grande actualité pour vous puisque parallèlement ont paru un cours sur la couleur2 et trois essais sur le temps intitulés l’aventure temporelle3 ; ce livre, Au cœur de la raison… de plus de mille pages, se présente en deux parties ; une première intitulée « Confrontations » où vous confrontez philosophie analytique et phénoménologie, et une seconde intitulée Transformations. Je commencerai par une question très matérielle : pourquoi avez-vous publié un seul volume au lieu de deux qui auraient pu, chacun, correspondre aux parties évoquées ?
Claude Romano : Parce qu’il s’agit d’un seul et même livre et d’un seul et même projet. En réalité, la première partie s’appelle « Confrontations » et la seconde « Transformations » mais on pourrait dire que la transformation commence très nettement dès la première partie, et que la confrontation de la phénoménologie avec d’autres courants majeurs du XXème siècle n’est nullement achevée à la fin de cette première étape. Certains aspects de ce dialogue se poursuivent de manière plus souterraine dans la seconde partie. Autrement dit, il s’agit bien pour moi d’un seul et unique projet, mais c’est un projet qui commence, si l’on peut dire, avec une sorte de dialectique transcendantale et qui s’achève avec une analytique des principes. L’inversion de l’ordre par rapport à l’ordre kantien tient au fait que si l’on veut justifier la pertinence philosophique d’une méthode comme la phénoménologie, on ne peut pas le faire de manière simplement immanente, en tenant pour acquis les présupposés philosophiques qui sous-tendent cette méthode elle-même ; il faut pouvoir la confronter avec des approches concurrentes et il faut surtout pouvoir montrer qu’elle est à la hauteur de cette confrontation ; de là cet aspect de mon enquête « dialectique » au sens aristotélicien du mot : la où les problèmes sont trop universels pour relever d’une science déterminée, là où ils touchent aux principes, il n’y a plus qu’une manière dialectique de procéder, c’est-à-dire une manière qui procède à travers la mise en question et le dialogue. Dans le cas qui m’occupe : là où il n’y a pas acccord entre les philosophes sur une méthode partagée, il faut partir des objections les plus fortes que l’on puisse adresser à un mouvement philosophique, à la phénoménologie en l’occurrence, et tenter d’y répondre.
AP : Est-ce cette unité que vous venez d’évoquer que vous thématisez lorsque vous énoncez une bipartition dans l’avant-propos de manière assez claire ; je vous cite : « le présent livre est à la fois une introduction à la phénoménologie (au sens d’une introduction dans la phénoménologie, d’une autoprésentation de cette dernière) et une transformation de la phénoménologie, la tentative d’une meilleure justification de ses thèses fondamentales – une présentation de la phénoménologie à partir d’elle-même en tant que sa propre transformation. »4 Est-ce que donc ce que vous venez de décrire correspond au « lien interne entre méthode et justification »5 ou est-ce un problème parallèle ?
CR : C’est légèrement parallèle, car il y a la méthode, et il y a la justification de la méthode, mais les deux problèmes sont néanmoins étroitement liés. Une méthode, ce n’est pas simplement une démarche que l’on suit ni une manière de faire. Une méthode, c’est littéralement un chemin meta è hodos, une manière d’avancer ou de procéder, à ceci près qu’il y a nécessairement dans le concept de méthode un élément normatif : une méthode, ce n’est pas seulement une manière de procéder, c’est la manière correcte de procéder. C’est pourquoi, quand on se penche sur la méthode, la question de la justification n’est jamais loin : pour pouvoir dire que c’est une méthode au sens fort du terme, il faut que vous puissiez dire pourquoi c’est la bonne manière de procéder et donc aussi en quoi elle est la plus fondée pour parvenir au but que vous vous êtes fixé.
AP : Et pensez-vous que cette réflexion sur la méthode comme étant intrinsèquement liée au développement même de la philosophie est spécifiquement liée à la phénoménologie ?
CR : Il y a deux niveaux du problème. Il y a la phénoménologie et sa méthode considérée en elle-même et il y a ce dont je parle dans le livre. Du point de vue de la phénoménologie « historique », il est vrai que les problèmes de méthode lui sont en quelque sorte consubstantiels. Par exemple Heidegger dit que la phénoménologie, c’est un Methodenbegriff, un « concept de méthode ». La phénoménologie a ceci de propre que ce sont les choses mêmes qu’elle décrit qui prescrivent leur mode d’accès et par conséquent la méthode permettant de les décrire. Cela c’est le premier niveau ; mais il y a le niveau du travail que je mène dans ce livre ; et dans ce livre il ne s’agit pas uniquement de faire de la phénoménologie (même si j’en fais, notamment dans la seconde partie, assez abondamment), mais il s’agit aussi et d’abord de poser la question des conditions de possibilité d’une phénoménologie au moment où nous parlons, au début du XXIème siècle, en s’adressant à un philosophe qui ne serait pas d’emblée acquis à l’idée qu’il s’agit d’une méthode viable et qui est au moins aussi rigoureuse que d’autres méthodes qui ont pu être proposées au XXème siècle.
AP : Cette volonté de justifier la phénoménologie pour celui qui n’y est pas acquis est donc à la base du style très argumentatif utilisé dans le livre.
CR : Oui, bien sûr. Ce livre s’adresse aux philosophes en général et pas du tout aux seuls phénoménologues !
AP : Est-ce que, bien que ce ne soit pas mentionné comme tel, cette volonté de proposer un style « principalement argumentatif »6 constitue une forme de dialogue avec des phénoménologies contemporaines qui ont quitté ce style argumentatif, notamment pour décrire l’inapparaissant, où l’on est davantage dans un style lyrique voire l’incantatoire ?
CR : Il ne s’agit pas à proprement parler d’un dialogue parce que mon intention dans ce livre a été de ne retenir, dans la phénoménologie, que ce qui pouvait illustrer mon propos. Je cite dans une note ce passage où Michel Henry dit que la phénoménologie est contraire à toute méthode7. A ce moment-là, Michel Henry ne peut pas m’aider dans le projet qui m’importe. Bien sûr, je ne nierai pas que ce livre est aussi une façon de prendre position par rapport à une certaine évolution de la phénoménologie qui s’est cristallisée en France ; cela n’est pas vrai pour la phénoménologie allemande ni pour celle qui a émigré aux Etats-Unis. Il y a une tendance à penser que la phénoménologie, c’est d’abord un style, une manière de faire, ce que disent Levinas, Henry, Merleau-Ponty aussi parfois. Assurément c’est un style ; mais c’est plus qu’un style.
AP : Pour rester dans le cadre de la discussion, on peut constater qu’un certain nombre de chapitres recoupent des préoccupations de phénoménologues français contemporains, par exemple avec le « concept de concept » que vous interrogez, ou toute la discussion sur l’a priori matériel que vous thématisez, et la fin de votre livre où vous évoquez « une raison qui, par-delà les plaines arides de la logique et de son formalisme, des mathématiques et plus généralement des sciences exactes, retrouve l’oasis de la sensibilité où l’être, indéfiniment se ressource. »8. Ces trois préoccupations philosophiques majeures que vous thématisez sont également abordées par Jocelyn Benoist9 si bien que je souhaiterais vous demander si vous entretenez dans ce livre un dialogue avec les œuvres de ce dernier ou s’il s’agit de deux réflexions qui demeurent parallèles malgré leurs problèmes communs.
CR : Je n’entretiens pas dans ce livre de dialogue spécifique avec Jocelyn Benoist, mais nous sommes de la même génération, ce qui veut dire que nous nous sommes trouvés confrontés à une même situation, à un même paysage intellectuel. Nous nous sommes intéressés à des questions voisines mais de façon assez différente. Chez Jocelyn Benoist, ce qui a dominé, tout au moins dans la première phase de son travail, c’était un souci historique. C’était la question de l’origine commune de la philosophie analytique et continentale, comme on les appelle, et notamment de leur enracinement dans la philosophie autrichienne, bolzanienne et post-bolzanienne. Jocelyn Benoist a restreint son enquête principalement sinon exclusivement à la phénoménologie husserlienne, et encore, à celle qui précède le tournant transcendantal et qui trouve sa formulation canonique dans les Recherches logiques. Cette approche historique a de nombreux mérites et elle était probablement indispensable, surtout en France où ces ramifications étaient mal connues et peu étudiées, contrairement à ce qui était le cas dans le monde anglo-saxon grâce aux travaux de Barry Smith ou de Kevin Mulligan. De mon côté, j’essaie de défendre dans ce livre une approche qui est d’abord philosophique : je pars à chaque fois d’un problème bien déterminé et j’essaie de montrer à partir de là comment s’articulent différents types de réponse, sans méconnaître la dimension historique des problèmes, mais en prenant position philosophiquement par rapport aux réponses à leur apporter. Le résultat est donc la phénoménologie telle que je crois qu’on peut la défendre ou telle que je la conçois moi-même. Je me suis aperçu chemin faisant, que, contrairement à une idée reçue, il n’y avait aucune difficulté à faire dialoguer philosophie analytique et philosophie continentale. Il n’y a pas de difficulté parce que, même si elles s’expriment dans des lexiques différents, elles parlent souvent de la même chose. On peut le voir exemplairement dans le débat qui se noue autour de la couleur au tournant des années trente entre Husserl, Schlick et Wittgenstein. Le problème du genre de nécessité qui appartient à certaines propositions portant sur les couleurs leur est commune. Ce qu’on entend un peu partout, c’est qu’il y aurait entre philosophie « analytique » et « continentale » un gouffre infranchissable, et même une totale impossibilité à se comprendre et, après avoir écrit ce livre, cette thèse me paraît totalement fausse.
AP : Mais cette idée est justement défendue par Jocelyn Benoist depuis un certain temps.
CR : Oui, mais ce que je fais ne s’en tient pas à l’approche historique qu’il privilégie. A ma connaissance, il n’a pas écrit un livre où il dise de manière systématique et principielle ce qu’il doit en être à ses yeux de la phénoménologie. Outre l’aspect systématique de mon propos, je crois, contrairement à lui, que la phénoménologie, y compris celle des successeurs de Husserl, Heidegger et Merleau-Ponty en tête, reste aujourd’hui une possibilité pleinement vivante, même si l’on peut en discuter beaucoup d’aspects. Dans sa phase actuelle, il me semble que Jocelyn Benoist s’est converti au paradigme analytique. En tout cas, c’est ce qu’il me semble avoir compris. Pour en revenir à votre question, en faisant ce travail, j’ai pu constater qu’il n’y a pas plus de distance entre Schlick et Husserl qu’entre Hume et Kant, et sans doute moins.
AP : Oui, c’est le problème commun qui ouvre à plusieurs possibilités.
CR : Voilà. Plusieurs voies s’ouvrent à partir d’un problème commun, des voies différentes et identifiables, mais les philosophies qui en sont issues parlent, si l’on peut dire, le même langage.
B : Essences et lois d’essence
AP : Alors rentrons dans le vif du sujet ; à vous lire, j’ai vraiment pensé que tout votre livre revenait à élucider cette phrase inaugurale de la Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, à savoir « La phénoménologie, c’est l’étude des essences, et tous les problèmes, selon elle, reviennent à définir des essences. »10 Est-ce une surinterprétation de ma part, ou y a-t-il un constat partagé avec Merleau-Ponty quant à ce qui est réellement important dans la phénoménologie ?
CR : Il dit cela, sauf erreur de ma part, dans l’avant-propos à la Phénoménologie de la perception et cet avant-propos, ce n’est pas le lieu où Merleau-Ponty fait preuve de la plus grande originalité, car dire que la phénoménologie, c’est l’étude des essences, beaucoup d’autres l’ont fait avant lui. Donc cette idée n’a rien de spécialement merleau-pontienne. En revanche, je dirai que l’insistance de Merleau-Ponty sur l’antéprédicatif est un des lieux où je me sens très proche de son diagnostic sur la nature de l’entreprise phénoménologique. Le concept d’essence peut jouer différentes fonctions dans une stratégie philosophique, et celle que j’entends lui faire jouer est celle d’une critique d’une forme de nominalisme – ou de ce que j’appelle « nominalisme » – qui prévaut dans la philosophie analytique. Ce nominalisme consiste à dire que posséder un concept, c’est avoir la maîtrise de l’emploi d’un mot. Et donc cela implique que tout ce qui est d’ordre conceptuel viendrait de la maîtrise du langage en premier lieu et que, si la philosophie doit être une analyse conceptuelle, elle devrait analyser en premier lieu des emplois linguistiques. Un tel nominalisme me paraît en partie inconséquent. Et c’est la raison pour laquelle j’en viens à défendre une certaine conception des essences. Si vous prenez l’analyse du langage elle-même, il faut bien, à un moment donné, que vous vous interrogiez sur quelque chose qui ne soit plus seulement une convention ou un emploi. Par exemple, si vous vous demandez : « qu’est-ce que la signification ? » et que vous répondez que « dans un grand nombre des cas, la signification d’un terme, c’est son emploi dans le langage », à ce moment-là vous n’êtes plus en train de noter une convention à propos de l’emploi du mot « signification », vous êtes en train de chercher une essence. Je pense que même Wittgenstein ne peut pas totalement échapper à cela. La philosophie ne peut pas entièrement se passer d’une interrogation sur les essences réelles, elle ne peut pas se confiner à l’intérieur des limites du langage et de l’analyse des emplois linguistiques.
AP : Comment pourrait-on définir très simplement une essence en phénoménologie ? Qu’est-ce qui différencie une essence au sens platonicien définie comme « être véritable » dans le Phédon d’une essence au sens phénoménologique ?
CR : Effectivement, il faut se poser cette question. Je récuse un certain nombre de thèses qui ont été défendues par Husserl concernant les essences. Husserl dit que les essences sont d’abord des objets possédant une identité, susceptibles d’un mode de saisie déterminée, celui que procure l’intuition eidétique, idéaux (par opposition aux objets sensibles), supratemporels ou omnitemporels, etc. ; il caractérise donc les essences comme étant des objets. Il y a à mes yeux un noyau défendable dans la théorie de Husserl et d’autres aspects plus critiquables. Le noyau qui me paraît non seulement défendable mais hautement original est l’affirmation selon laquelle une définition purement modale de l’essence n’est pas tenable. On ne peut pas définir l’essence en simples termes de nécessité. Il ne suffit pas qu’une propriété soit nécessaire pour qu’elle appartienne à l’essence de quelque chose, il faut qu’elle soit nécessaire pour l’identité de cette chose, ou, comme le dit Husserl, qu’elle soit nécessaire « pour qu’une chose soit ce qu’elle est ». Cela conduit à toute une réflexion sur le statut de cette nécessité particulière, et donc sur le type d’universalité qu’elle possède. En suivant cette suggestion de Husserl, je crois qu’on peut développer une conception non-platonicienne des essences, qui refuse d’en faire des objets idéaux, et qui préfère parler de « descriptions d’essence » que d’ « essences ». Les descriptions d’essence ainsi entendues ont un rôle spécifique dans l’enquête phénoménologique qui est de fournir un point de départ à l’analyse et non un point d’arrivée ; à partir du moment où certaines nécessités d’essence de départ ont été dégagées, il reste en phénoménologie une place considérable pour l’interprétation, et celle-ci repose sur des présuppositions historiques et doit s’efforcer d’interroger ces présuppositions. En ce sens, la phénoménologie ne peut pas être une « science rigoureuse » au sens de Husserl, elle ne peut pas être une pure science d’essences, elle doit être comme toute philosophie une discipline historiquement conditionnée.
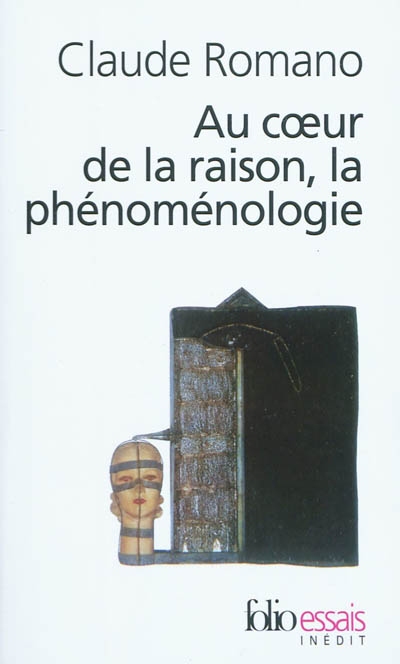
AP : Vous évoquez très longuement les lois d’essence appelées par Husserl a priori matériels : c’est un a priori fondé dans la nature même des contenus d’expérience susceptibles de l’exemplifier. Or, ce qui est a priori ne dépend pas de l’expérience ; comment ces lois d’essence peuvent-elles être fondées dans les contenus d’expérience sans en dépendre ? Je prends un exemple très simple qui est le vôtre : une loi d’essence pourrait être ceci : « toute couleur a une saturation. » Pourquoi ? Parce que je ne peux pas imaginer qu’une couleur n’ait pas de saturation ; de la même manière, toute couleur est étendue, parce que ne peux pas imaginer que ce ne soit pas le cas. Vous expliquez remarquablement du reste ce que signifie une loi d’essence lorsque vous dites qu’il s’agit d’une proposition dont je ne peux même pas imaginer ce qui serait le cas si cette proposition était fausse. Mais quand je dis que je ne peux pas imaginer qu’une couleur ne soit pas étendue, qu’est-ce que je désigne concrètement ? Est-ce que je désigne une structure de ma conscience, liée aux limites de mon imagination, ou est-ce que je désigne une propriété objective de la couleur ? Ou est-ce que je désigne l’identité entre la structure de ma conscience et la structure du monde ?
CR : La réponse se trouve dans cette petite phrase de Husserl où il dit « le ne-pas-pouvoir-concevoir-autrement est un ne-pas-pouvoir-être-autrement. » Ce qui ne peut pas être conçu autrement ne peut pas être autrement. C’est, si voulez, la vieille identité parménidienne entre être et pensée. Vous me direz que c’est un lourd présupposé et que l’on peut très bien ne pas être d’accord avec Husserl. Il faut revenir un petit peu en arrière pour bien comprendre : si je dis que toute couleur possède une clarté, une teinte et une saturation, est-ce un énoncé empirique ou un énoncé apriorique ? Quel genre de nécessité possède-t-il ? Et qu’est-ce qui nous permet de trancher ? Il faut se pencher ici sur le problème de la possibilité que nous avons ou non de concevoir – laissons de côté l’imagination – un contre-exemple. Prenons un énoncé manifestement empirique : « dans les conditions normales de pression atmosphérique, l’eau bout à 100° C » ; ici, il paraît facile de concevoir un contre-exemple, il suffit d’imaginer une expérimentation au cours de laquelle nous découvririons que, dans les conditions de pression terrestre, l’eau bout à 200°C ou 300°C. Dans le cas de la proposition sur les couleurs, justement, vous ne pouvez pas concevoir de contre-exemple ; et vous ne pouvez pas le concevoir parce que vous ne savez pas quoi concevoir. C’est exactement la formule qu’emploie Wittgenstein quand il parle des nécessités grammaticales. Le point commun, ici, entre Husserl et Wittgenstein, c’est d’admettre qu’il y a des nécessités inconditionnelles ayant un statut totalement différent des nécessités d’ordre empirique qui reposent sur une généralisation à partir d’hypothèses.
AP : Et pourtant, comme vous le dites, ces nécessités sont malgré tout conditionnées par des éléments matériels. Il faut, par exemple, que le monde dont on parle, ait des couleurs, ce qui veut dire que vous apportez une restriction à leur validité : « Que toute chose spatiale ne puisse être perçue que par silhouettes n’est vrai que pour un monde où il existe des objets spatiaux : dans un univers composé uniquement de vide, ou uniquement de gaz, une telle proposition matérielle n’est ni vraie ni fausse, car rien n’y correspond à l’expression « chose spatiale ». »11 Bref, il faut qu’il y ait des couleurs dans le monde pour que cet énoncé – toute couleur a une teinte, une saturation et une clarté – ait un sens.
CR : Absolument, il faut qu’il existe quelque chose comme des couleurs. C’est pourquoi Husserl ajoute que ces lois sont enchaînées à une certaine facticité, enchaînées au monde tel qu’il existe de fait. Mais cela ne veut pas dire qu’elle reposent sur une généralisation qui pourrait admettre des contre-exemples.
AP : Vous distinguez donc l’a priori matériel de l’a priori formel pour lequel il n’y a pas de limitation par les objets visés : « les vérités analytiques valent pour tous les mondes possibles, sans restriction d’aucune sorte : « 2 + 2 = 4 » est vrai même dans un monde où il n’y aurait que le vide, où aucun objet ne pourrait être dénombré. »12
CR : Oui, l’a priori formel a comme illustration classique : « il n’y a pas de tout sans parties » ou des propositions de ce genre.
AP : Mais dans le cas des mathématiques, avec l’exemple du « 2 + 2 = 4 », j’avoue que je suis un peu dubitatif parce que « 2 + 2 = 4 » n’a de sens que dans un monde qui contient des objets numériques ; pourquoi les nombres ne seraient-ils pas des objets qui pourraient, eux aussi, faire défaut ?
CR : Les nombres ne sont pas des types d’objets qui seraient liés à la facticité de ce monde-ci. Dans n’importe quel monde pensable, les mathématiques s’appliquent ; ce n’est donc pas la même chose que des couleurs, parce que les couleurs sont liées à ce monde-ci et à notre appareil perceptif. On peut imaginer un monde vide qui serait un monde sans couleurs. On peut imaginer un monde où il n’y aurait que des gaz, sans source lumineuse, et là il y a une facticité.
AP : Mais quand vous dites que la mathématique s’applique partout, on pourrait aussi considérer que les lois sont relatives. Par exemple une addition de vecteurs ne fonctionne pas comme une addition numérique.
CR : Oui mais quel est le rapport avec le monde ?
AP : Ce que je veux dire, c’est que l’on pourrait imaginer un monde entièrement vectoriel quant à sa structure et où les lois de l’arithmétique ne s’appliqueraient plus et où 1 + 1 feraient un.
CR : Tout dépend du sens que vous donnez aux nombres et aux mathématiques en général. Si vous considérez que les mathématiques sont un ensemble de conventions arbitrairement édictées, vous pourrez considérer que ces conventions pourraient être autres dans un autre monde.
AP : Non, ce que je voulais dire c’est que l’on peut imaginer un monde sans arithmétique comme l’on peut imaginer un monde sans couleurs.
CR : Mais les objets dont vous parlez demeurent des objets mathématiques ; l’espace vectoriel n’est pas lié à ce monde-ci, sauf peut-être pour le fait contingent de sa découverte, si bien qu’il n’est pas lié à la facticité de ce monde-ci. Tel modèle mathématique nous permet de comprendre tel aspect de ce monde ; mais ce même modèle mathématique peut aussi ne nous permettre de comprendre aucun aspect de ce monde parce que nous ne lui avons encore trouvé aucune application, par exemple aucune application en physique. Sinon, vous avez une vision des mathématiques très « mimétique » : les mathématiques reflèteraient quelque chose du monde. En réalité, il me semble que ce que nous apprennent les géométries non-euclidiennes et beaucoup de grandes découvertes du XXème siècle, c’est justement que les mathématiques ont leur propre domaine de validité et que ce domaine n’est absolument pas indexé sur des aspects factuels du monde, même si elles permettent de les penser.
AP : Alors revenons à l’a priori matériel dont vous dites que, sans lui, aucune œuvre phénoménologique ou presque n’aurait été possible : « Premièrement, la doctrine de l’a priori matériel supporte tout l’édifice de la phénoménologie, non seulement chez Husserl, mais – qu’ils le reconnaissent ou non expressément – chez la plupart de ses successeurs : Scheler, Heidegger, Fink, Merleau-Ponty, Sartre, Patocka et de nombreux autres. »13 Est-ce à dire que l’a priori matériel est une constituante presque substantielle de la phénoménologie et pouvez-vous, par exemple chez Heidegger dans Etre et temps préciser ce qui relève de l’a priori matériel bien que l’expression ne soit pas celle de Heidegger ?
CR : Il y a dans Etre et temps cette affirmation on ne peut plus claire : « l’apriorisme est la méthode de toute philosophie scientifique qui se comprend elle-même » ; et Heidegger dit aussi que c’est Husserl qui nous a permis de découvrir le sens authentique de l’a priori. Chez Heidegger, les existentiaux sont des caractères d’essence aprioriques du Dasein. Mais c’est plus largement toute la phénoménologie qui est liée à l’a priori matériel. Les structures d’essence de toute expérience sont des a priori matériels. Or, ce que s’efforcent de faire Scheler, Sartre, Merleau-Ponty, Patocka et d’autres, c’est précisément découvrir des structures d’essence de la phénoménalité. Prenons un exemple simple : si je dis « je ne pourrais pas avoir le sens de la différence de la droite et de la gauche si je n’étais pas pourvu d’un corps propre qui, lui-même, était pourvu d’un sens de la latéralisation », je dis quelque chose de très simple, d’élémentaire, mais il s’agit là de quelque chose de nécessaire qui fonde toute description phénoménologique de la spatialité du corps propre, de la possibilité pour lui de s’orienter dans un espace qui n’est ni homogène ni isotrope, qui est un espace qui a des propriétés particulières, puisque c’est l’espace vécu et non l’espace de la géométrie euclidienne. Donc tout le travail de ces phénoménologues se centre sur ces structures nécessaires de la phénoménalité, même s’ils ne thématisent pas toujours cette dimension. Pour Sartre, on pourrait dire la même chose de beaucoup de ses analyses. Il pratique une phénoménologie qui essaie de dégager des essences ; par exemple, la liberté, telle qu’il la définit, est bel et bien définie comme quelque chose qui a certaines propriétés essentielles : pour lui, l’infini est un trait d’essence de la liberté.
AP : Et vous pensez que Sartre accepterait le terme d’essence pour qualifier sa propre pensée ?
CR : Sartre parle d’essence ; il dit que « l’existence précède l’essence ».
AP : Ce n’est pas tout à fait dans le même sens que celui que vous indiquez.
CR : C’est une phrase fameuse que je citais pour montrer qu’il utilisait le terme, mais il l’emploie à d’autres moments. Est-ce qu’il accepterait entièrement cette caractérisation husserlienne ? C’est un problème parce qu’il entre assez peu dans le détail de ces questions, il n’envisage guère la « technicité » de l’a priori matériel, si bien qu’il est difficile de vous répondre. Mais mon idée, dans ce livre, c’est de dire que le noyau des différentes entreprises phénoménologiques consiste à poser qu’il y a des structures immanentes à la phénoménalité en tant que telle, nullement issues de nos manières d’en parler, du langage que nous employons pour décrire cette phénoménalité. Je pense que c’est un présupposé qui est partagé par l’ensemble des phénoménologues. Ensuite, ils peuvent bien sûr diverger sur le statut à donner à ces essences et, pour certains d’entre eux, ils ne disent quasiment rien sur ce sujet.
C : Discussions
AP : Puisque vous mettez les essences au centre de votre réflexion, on se doute que les critiques de Wittgenstein vont également porter sur ces dernières. Chez ce dernier, la grammaire se substitue à la phénoménologie classique à la condition de mettre fin à la description des essences au profit des conditions de possibilités de la description elle-même, donc au profit d’une étude des conditions linguistiques de la description phénoménologique. Cela revient à dire que l’essence, loin d’être une structure du monde, est exprimée par la grammaire14 : or, j’ai l’impression que c’est contre cette thèse que vous déployez les arguments les plus puissants et les plus subtils, notamment par la médiation de la question des couleurs, qui deviennent ainsi le paradigme du débat entre phénoménologie et philosophie analytique. Mais parfois j’ai l’impression, particulièrement dans les cours consacrés à la couleur, que la réfutation des thèses de Wittgenstein suffit à valider la phénoménologie ou plutôt comme s’il n’y avait que deux possibilités et que l’invalidation de l’une entraînait la validation de l’autre.
CR : Non, je ne crois pas que je procède comme ça. Wittgenstein est présent tout le long du livre, et je n’entretiens pas seulement avec sa pensée des rapports critiques, il y a aussi des éléments que je retiens. Dans la partie plus spécifique où je m’oppose à un certain nombre d’aspects de sa pensée, mon propos peut se résumer en deux points. Premièrement, j’essaie de montrer que Wittgenstein est en fait très proche de la phénoménologie, et cette proximité peut en effet se comprendre à partir du problème des couleurs. A propos des propositions nécessaires sur les couleurs (telles « toute couleur est étendue » ou encore « il n’y a pas de vert rougeâtre ») on peut soutenir ou bien que ces énoncés sont empiriques, ou bien au contraire que ce sont des « tautologies », comme le dit le cercle de Vienne, donc qu’ils se ramènent à des lois logiques, et ces deux affirmations semblent insuffisantes toutes les deux. Et puis, il y a une troisième voie qui consiste à leur donner un statut particulier, à leur assigner d’abord une nécessité inconditionnelle – ils ne peuvent être falsifiés par aucune expérience –, sans que cette nécessité soit pour autant celle de tautologies : et ce serait le point d’accord entre Husserl et Wittgenstein. Là où ils se séparent, c’est sur le statut de cette nécessité, puisque Husserl pense qu’il s’agit d’une nécessité d’essence, tandis que Wittgenstein la conçoit comme une nécessité grammaticale. Mon premier souci était de montrer qu’il y a bien un problème commun à Husserl et à Wittgenstein, et que leur position est finalement assez proche – ce que révèle aussi le fait qu’il y a eu ce que l’on appelle un « moment phénoménologique » dans la philosophie de Wittgenstein où, en effet, il s’approche très près de l’idée d’a priori synthétique, que finalement il rejette. Ou pour être plus précis, il s’approche très près d’une idée qu’on pourrait formuler en termes d’a priori synthétique d’un point de vue phénoménologique. Donc mon propos est de dire qu’il y a un problème commun et que, finalement, Wittgenstein est bien plus du côté de la phénoménologie que du côté du cercle de Vienne dans la solution qu’il apporte à ce problème. Le second point, qui est davantage critique, consister à évaluer la possibilité de défendre la grammaire de Wittgenstein jusqu’au bout ; il s’agit de savoir si cette grammaire peut donner à la philosophie une méthode telle qu’elle permettrait d’atteindre une « clarté totale » (c’est sa formule), de telle sorte que les problèmes philosophiques seraient totalement dissous. Or – et c’est là le nerf de ma critique –, le propos de Wittgenstein repose sur des thèses philosophiques substantielles qui ne peuvent pas être mises au compte de la simple analyse grammaticale ni de la simple thérapie philosophique. J’en énonce deux qui demeurent tout au long du parcours de Wittgenstein, la première étant que « toute nécessité est d’ordre logique », et la seconde que « dans le monde, tout est hasard », pour reprendre la formule du Tractatus : il n’y a pas de nécessité au sens fort dans les choses. Or, pour que la méthode grammaticale puisse être totalement convaincante, il faut que Wittgenstein ne soutienne aucune thèse philosophique ; parce que, dans le cas contraire, ces thèses sont passibles d’une discussion et d’une réfutation, elles appellent une justification argumentée et relèvent, dans cette mesure, des procédés classiques de la philosophie ; en somme, s’il avance des thèses, Wittgenstein ne développe plus une pure et simple analyse grammaticale qui pourrait conduire à une dissolution pure et simple des pseudo-problèmes issus de l’incompréhension du langage ordinaire par le philosophe. A partir du moment où l’on trouve chez lui des thèses substantielles, la « pureté » présumée de l’analyse grammaticale devient très problématique. Et l’on peut alors se demander jusqu’à quel point la « grammaire » est simplement découverte, et dans quelle mesure elle n’est pas toujours aussi en partie inventée pour les besoins de la stratégie de Wittgenstein.
Mon propos n’est donc pas de dire que si Wittgenstein a tort, la phénoménologie a raison : mon propos est plutôt de souligner une certaine proximité, tout en disant que certains aspects de la « pureté » présumée de l’idée de grammaire sont discutables et qu’il se pourrait tout à fait que les nécessités ici visées soient, pour certaines d’entre elles, des nécessités d’un autre ordre, des nécessités d’ordre essentiel. Je prends l’exemple des couleurs, notamment, pour défendre cette idée.
AP : Ce que je voulais dire, c’est que vous aviez besoin de passer par ce moment presque négatif de la philosophie analytique pour justifier en creux la possibilité et la légitimité d’aller étudier la phénoménologie, comme si donc vous aviez besoin d’établir les insuffisances de la philosophie de Wittgenstein pour justifier l’actualité de la phénoménologie.
CR : Cela tient à ce que je vous ai dit au début : vous ne pouvez pas justifier une méthode philosophique en adoptant dès le départ les présupposés de cette méthode. Si vous voulez convaincre un interlocuteur que la méthode phénoménologique est aussi rigoureuse qu’une autre, vous devez le montrer par le biais d’une discussion serrée. En outre, comme mon propos était de montrer non seulement la rigueur mais aussi la place de la phénoménologie dans le XXème siècle, il fallait montrer qu’elle se consacre à un ensemble de problèmes qui lui sont communs avec d’autres courants philosophiques.
D : Transformations
AP : Vous défendez donc la phénoménologie mais vous lui apportez également des transformations. Il me semble qu’il y a trois moments dans ces transformations : d’abord en finir avec une espèce de cartésianisme qui fait de la conscience une région de sens différente de celle du monde, mettre en crise l’intentionnalité, et retrouver l’évidence du monde dans une sensibilité pré-rationnelle qu’éluciderait une herméneutique.
CR : Je n’emploierais pas l’expression de « pré-rationnelle » puisque le propos du livre consiste à dire qu’il y a plusieurs conceptions de la raison : une qui avance un concept étroit de « raison » et qui fait de la logique, des mathématiques et des sciences empiriques le paradigme pour la penser, et une autre, celle que défend la phénoménologie, qui s’efforce au contraire de mettre en évidence un concept « large » de raison, une « raison au grand cœur » qui s’oppose à une « enghertzige Rationalität », comme l’écrit Husserl dans la Krisis. Une telle raison ne s’oppose plus à la sensibilité, à la fois dans sa dimension peceptive et émotionnelle, mais l’intègre. Elle repose sur un domaine d’ a priori matériels qui structurent la sensibilité et qui relèvent de ce que Husserl appelé le « logos du monde esthétique ». Il ne s’agit donc pas, avec la phénoménologie, de revenir en deçà du rationnel, au pré-rationnel : il s’agit au contraire de montrer que la rationalité commence dès la sensibilité, dès notre engagement corporel et pratique dans le monde, et dès l’intelligence pré-intellectuelle qui s’y fait jour.
En ce qui concerne les trois moments que vous relevez, je ne formulerais pas les choses exactement de la même manière : ma tentative pour sortir du « cartésianisme » traverse en fait toute la seconde partie du livre et va jusqu’à la contrepartie positive que je formule : ce que j’ai appelé « holisme de l’expérience ». Toute cette seconde partie est en effet une tentative pour repenser l’intentionnalité et pour montrer au moyen d’une argumentation serrée pour quelles raisons il est nécessaire de passer d’une conception de l’intentionnalité perceptive de type husserlien à une conception de l’être-au-monde qui n’est plus d’ailleurs exactement celle de Heidegger. Au lieu de laisser entendre, comme c’est souvent le cas, qu’entre la position de Husserl et de Heidegger il n’y aurait au fond qu’une différence de point de vue, pour ne pas dire de sensibilité philosophique, j’entends établir au moyen d’une justification argumentée que le passage du concept d’intentionnalité perceptive à celui d’être-au-monde n’a rien de facultatif. On pourrait dire aussi que je me propose de fournir une justification d’un point pourtant archi-central, mais qui est présenté dans Être et temps comme un simple point de départ. Ou plutôt, pour être plus juste avec Heidegger, il faudrait dire que Heidegger avance bien le concept d’être-au-monde au terme d’une critique d’ordre ontologique, mais que la reconstitution rationnelle que je propose ne fait fond sur aucune adhésion particulière à la perspective de l’ontologie, fût-elle « fondamentale ».
Voilà pour le cartésianisme et l’intentionnalité ; il y a également ce thème que vous évoquez, qui est déjà présent dans la première partie, celui d’une phénoménologie qui est herméneutique. Quand je critiquais tout à l’heure le fait qu’il y ait des thèses implicites chez Wittgenstein, je procédais de la manière dont procède l’herméneutique, c’est-à-dire que je m’interrogeais sur certains présupposés inélucidés et ininterrogés qui sous-tendent la pensée de Wittgenstein (y compris dans sa manière de faire de la philosophie) et qui assignent à cette pensée sa situation historique.
AP : Et dans tous les cas, il est également question d’en finir avec une subjectivité transcendantale à partir de laquelle serait fondée la science, et la phénoménologie en son entier.
CR : Absolument. Il s’agit de rompre avec le paradigme transcendantal pour avancer un paradigme que j’appelle « relationnel ». Il faut entrer un tout petit peu dans le détail. Le propre de l’intentionnalité, telle qu’Husserl la conçoit, est d’être traversée par une tension de fond puisque, d’un côté, l’intentionnalité, depuis la doctrine médiévale de l’objectum et de l’esse objective, a partie liée avec la question de la représentation – l’objet intentionnel, c’est l’objet représenté, c’est l’objet mental –, ce que reprend Brentano, mais que, d’un autre côté, Husserl entreprend de faire dire à l’intentionnalité tout autre chose : il s’agit de mettre l’intentionnalité au service d’une philosophie qui veut rompre avec l’idée même de représentation. L’objet intentionnel, c’est alors la chose elle-même telle qu’elle existe hors de l’esprit. En somme, Husserl retrouve par-delà la scolastique ce qu’Aristote disait de l’âme, à savoir que l’âme est « d’une certaine façon toutes choses », qu’elle est ouverture même à la totalité de l’étant. Or, dans cette tentative même pour accomplir une percée hors d’une philosophie de la représentation, Husserl reste malgré tout cartésien, puisqu’il maintient une différence de principe entre ce qui est donné dans une évidence indubitable et ce qui demeure sujet au doute. L’extériorité, l’objet transcendant et même le monde comme tel ne possèdent qu’une existence douteuse, donc « présomptive », tandis que certains contenus de conscience, eux, sont certains parce qu’ils sont immanents. En faisant fond sur cette distinction d’origine cartésienne, Husserl adhère au problème sceptique, il maintient que ce problème est bien posé. Or, il se pourrait que ce problème soit un faux problème qui procède d’une méprise totale sur la nature même de la perception, ou comme je préfèrerais le dire, de notre ouverture pré-théorétique et pré-linguistique au monde. Le scepticisme méconnaît la constitution « holistique » de notre expérience, c’est-à-dire le fait que quelque chose ne peut être une perception que s’il s’intègre au tout de la perception, et donc s’il ne menace pas la cohésion fondamentale de ce tout. Nous avons là, formulé grossièrement, le motif principal pour lequel l’intentionnalité husserlienne reste insuffisante : elle prétend en quelque sorte rendre compte de cette ouverture à chaque fois totale au monde comme une addition de vécus partiels évaluables isolément en termes de vérité et de fausseté (ou d’évidence et de non-évidence) et reliés entre eux par des principes d’association de synthèse. C’est en vertu de cet atomisme que la perception de Husserl ne rejoint jamais l’objet qui demeure un X situé à l’infini d’un processus téléologique.
AP : Oui, vous dites dans le livre que si le doute cartésien porté contre le monde est provisoire, l’épochè, elle, est définitive. « C’est sur elle, écrivez-vous, que repose toute description phénoménologique après le tournant transcendantal, de sorte que cette opération doit être constamment réitérée aussi longtemps que la description se prolonge. »15 Et donc vous pointez le problème de la permanence de l’épochè qui n’en finit jamais.
CR : L’épochè est « définitive » au sens où elle est l’élément dans lequel s’accomplit toute description phénoménologique : jusque là, il s’agit simplement de la position de Husserl. La question que je soulève est la suivante : avons-nous besoin de pratiquer l’épochè pour faire de la phénoménologie ? Et ma réponse est « non ». L’épochè appartient au dispositif transcendantal, et c’est ce dispositif tout entier qui entre en crise si les objections que je formule ont une portée. La réduction phénoménologique, chez Husserl, ne se laisse pas séparer de son épistémologie « fondationnaliste » : il y aurait une science fondamentale, la philosophie, qui procurerait un fondement à toutes les autres. C’est la reprise de l’arbre de la philosophie de la lettre-préface des Principes de Descartes. C’est parce que Husserl demeure fondationnaliste, parce qu’il croit que tout l’édifice de la connaissance repose dans des certitudes apodictiques évaluables les unes indépendamment des autres, qu’il souscrit aussi au cogito dont la vérité s’impose à partir d’elle-même. Car si la connaissance est seulement dans le tout, pense Husserl, elle n’est nulle part. La connaissance se monnaie donc en une multiplicité de certitudes ou d’évidences. Et ce modèle s’applique aussi à la perception, en dépit de tout ce que dit Husserl sur la forme universelle de la synthèse passive, l’association, la temporalité immanente du flux de la conscience. Contre cela, mon propos est de soutenir qu’en réalité la perception du monde n’est pas la somme des perceptions individuelles qui se confirmeraient sans cesse – et donc, qui pourraient aussi ne pas se confirmer – mais que toute perception partielle est prélevée sur une saisie du monde qui la précède et en fonde la possibilité. Le monde doit exister et être perçu pour que tel ou tel aspect de ce monde puisse être une « perception », en tant qu’aperçu partiel prélevé sur lui. Le monde n’a donc absolument pas une existence « présomptive ». C’est ce que je voulais dire en disant que quelque chose n’est une perception que si elle s’intègre au tout de la perception – et cela définit par essence ce qu’est une perception. Le problème sceptique qui reposait sur l’inférence implicite « si on peut toujours douter de quelque chose, on peut toujours douter de tout », se révèle ici un faux problème en vertu de cette constitution holistique de notre expérience perceptive. C’est ainsi, je crois, qu’on peut sortir de l’intentionnalité husserlienne, pour avancer un certain concept d’être-au-monde qui n’est plus transcendantal.
AP : Et ce holisme est la raison pour laquelle vous remettez en cause le concept d’être-au-monde heideggérien, puisque chez Heidegger l’ouverture au monde est toujours pensée à partir de mon projet, donc à partir de moi, si bien que l’altérité du monde n’est jamais véritablement pensée.
CR : Oui, c’est-à-dire qu’il y a chez Heidegger, jusqu’aux années 30, une persistance de certains schèmes transcendantaux : le Dasein, par sa compréhension de l’Être, détient l’ouverture à l’étant en général, il est la condition de possibilité de la révélabilité de tout étant. L’idéalisme, dit aussi Heidegger à ce moment-là, est la seule position philosophiquement acceptable. Bien sûr, ce n’est pas l’idéalisme de Husserl, mais il reste quelque chose du dispositif transcendantal dans l’idée que le Dasein « projette un monde », ou encore que l’ouverture au monde a le mode d’être du Dasein. J’essaie de montrer, au contraire, que l’ouverture au monde dépend de l’unité structurelle que forment un sujet inclus dans le monde par son corps et ce monde auquel il est ouvert, unité en deçà de laquelle il est impossible de revenir. Ce n’est pas un étant, le Dasein, qui par lui-même projetterait un monde ; on ne peut ressaisir l’être-au-monde que comme une structure relationnelle, c’est-à-dire comme quelque chose qui dépend par essence de chacun de ses termes.
AP : Ce que vous appelez « réalisme descriptif », c’est donc la possibilité, en raison du holisme, de ne plus douter de ce monde avec lequel nous sommes en relation ?
CR : Oui. Ce que j’appelle « réalisme descriptif », c’est une forme de réalisme qui découle du holisme que je défends. Souvent le réalisme est une position qui est liée à un naturalisme. On est réaliste parce qu’on croit qu’il est possible de rendre compte du phénomène de la perception en termes causaux. Le contenu de la perception se réduirait à l’impact causal que le monde physique exerce sur nos sens. Je suis aux antipodes de ce type d’approche. Le réalisme que je défends découle du fait que le problème sceptique est un problème mal posé. C’est un réalisme purement descriptif au sens où il ne fait aucune hypothèse sur une éventuelle « nature causale de la perception », ou même sur les soubassements causaux qui sous-tendent la perception ; il dit en substance que si l’on veut décrire correctement celle-ci, on ne peut partir que de cette cohésion structurelle entre un sujet corporel et le monde dans lequel il est situé, et on ne peut pas revenir en-deçà de cette relation primordiale. De ce point de vue, puisque cette cohésion structurelle du sujet et du monde est un trait de leur description et ne repose sur aucune hypothèse auxiliaire, le réalisme que je défends ne tombe dans aucun des travers que Husserl et Merleau-Ponty dénonçaient quand ils critiquaient le naturalisme.
AP : Mais n’est-ce pas là tout simplement la position du bon sens ? Si l’on demande à n’importe qui n’ayant jamais fait de philosophie, n’importe qui répondrait que le monde a une existence évidente, que j’existe, et que je suis en relation biunivoque avec le monde.
CR : Si vous voulez, mais il y a de nombreuses manières de déterminer ce qu’il faut entendre ici par « monde », de caractériser la « relation » en question, et ainsi de suite. Le travail philosophique commence quand on essaie d’élucider tout cela.
AP : Alors disons que c’est une réflexion sur une position qui est accessible au bon sens.
CR : Elle n’est pas en opposition farouche avec le bon sens, à supposer que quelque chose de tel existe. La phénoménologie pourrait bien être une tentative pour rejoindre une « naïveté seconde » qui s’oppose à une naïveté première, et de la rejoindre par le détour de la réflexion et de l’analyse. La phénoménologie, disait Husserl, doit nous ramener aux choses, et nous ramener aux choses, c’est souvent nous reconduire depuis des problèmes faux ou mal posés jusqu’à des vérités que tout le monde, s’il s’en donne la peine et les moyens, serait forcé de reconnaître. Mais je ne suis pas sûr qu’il soit utile de faire intervenir le concept si discutable, si vague de « bon sens ». Le « bon sens », si cela a du sens d’en parler, n’a aucune conception bien déterminée portant sur ce genre des choses : il faut déjà beaucoup élaborer les problèmes philosophiquement pour parvenir à une conclusion philosophique quelle qu’elle soit, y compris à celle que je propose. Plutôt que de dire que l’idéalisme choque le bon sens, tandis que cette position que je défends ne le choque pas, je préfèrerais formuler les choses en disant que la réflexion que je mène, si elle est justifiée, montrerait l’urgence qu’il y a à réfléchir sur notre appartenance au monde, sur le lien indéfectible qui nous unit corporellement à lui – un problème que la philosophie, notamment d’inspiration idéaliste, a négligé ; un problème qui nous est rappelé chaque jour à une époque où les équilibres écologiques sont bouleversés et où notre propre habitation sur Terre est en péril.
AP : Quelle définition pourriez-vous alors proposer de l’expérience en général ?
CR : J’ai eu l’occasion de développer deux concepts d’expérience qui ne se situent pas au même niveau. Le premier renvoie à l’expérience « normale », celle que nous faisons en permanence ; le second est rattaché au problème de l’événement et n’est pas directement thématisé dans ce livre. Je laisse donc de côté l’expérience de l’événement et je m’intéresse à l’autre. L’expérience, telle que j’en parle, n’est pas constituée de vécus, d’Erlebnisse intérieurs. C’est l’expérience unitaire et indivise du monde, des autres, de nous-mêmes, ce qui la caractérise d’abord c’est qu’elle n’a pas d’étoffe propre. C’est ce que Heidegger essaie de rendre par l’image de l’ouverture : elle n’est pas une interface entre le monde et le nous, elle n’est rien d’autre que le mode de donnée des choses pour nous. Pour prendre un exemple concret, ce bureau m’apparaît sous des profils changeants ; si je me déplace dans la pièce il m’apparaîtra sous un angle, puis sous un autre, etc. Or, on pourrait concevoir ces profils comme des apparitions-du-bureau intérieures à ma conscience, comme des Abschattungen au sens de Husserl, et l’objet comme tel serait alors pensé comme quelque chose qui transcende ces profils. De mon côté, j’affirme que ces profils ne sont rien d’autre que l’objet lui-même, mais l’objet tel qu’il est pour nous en fonction de notre propre situation dans l’espace. Ses modes d’apparition ne sont pas d’autres « choses » – des intermédiaires mentaux, des interfaces –, mais le bureau lui-même selon une perspective. Et donc l’expérience est quelque chose qui, dans sa structure même, est relationnelle.
AP : Est-ce qu’à partir de ce concept d’expérience relationnelle, il demeure possible de fonder une théorie de la connaissance ?
CR : Fonder, je serais sceptique.
AP : Dériver, peut-être, alors.
CR : Tout dépend de ce que vous entendez par « théorie de la connaissance ».
AP : Est-ce que l’on peut comprendre ce qu’est la connaissance comme connaissance scientifique et universelle, à partir d’une description phénoménologique ?
CR : Bien sûr, mais à partir de ce moment-là, il faut mener un travail spécifique. Par exemple, un travail de phénoménologie des mathématiques : c’est ce qu’a fait Desanti et, avant lui, Oskar Becker. Cela relève d’une phénoménologie appliquée à des problèmes bien déterminés.
AP : Donc, pour vous, la possibilité existe ?
CR : Bien sûr ! Il n’y a aucune impossibilité à cela ; pourquoi est-ce qu’il y en aurait une ?
AP : Précisément parce que le concept d’expérience que vous proposez semble ramener l’objet au vécu, puisque l’objet n’est rien d’autre que le profil, si bien que cela ne tend pas à assurer une connaissance objective de l’objet.
CR : Mais non, l’expérience n’est pas faite de vécus ! Le « vécu » (une sensation, une rêverie, une douleur) n’est qu’un cas particulier d’expérience.
AP : Oui, j’ai bien compris, mais malgré tout vous rabattez l’objet sur la manière dont il se donne à moi, donc sur la manière dont je le perçois : l’objet est ce que je perçois. Comment peut-on, à partir de cela, parvenir à une connaissance objective ?
CR : Là aussi, il faut être précis. L’ « objet » dont je parlais précédemment, c’est la chose telle qu’elle est ressaisie dans le monde de la vie, ce n’est pas l’objet scientifique. Cette « chose » est la même pour vous et pour moi parce que nous vivons dans le même monde. Elle possède son universalité propre. Après, il reste à comprendre comment on passe de la chose donnée quotidiennement et appréhendée à la lumière de nos pratiques naïves aux idéalisations scientifiques qui reposent sur une praxis d’un tout autre ordre : mesures exactes, expériences de pensée, formalisation mathématique.
AP : Voilà, c’est ma question.
CR : Alors, comment passe-t-on de l’un à l’autre ? C’est là où il faut une phénoménologie spécifique, qui dépasse le propos de mon livre. Mon propos était de montrer le cadre à partir duquel la phénoménologie comme telle peut se déployer. Dans cette perspective, je défends le concept de « monde de la vie » de Husserl mais en proposant de lui apporter certains correctifs. Je pense qu’il y a un noyau fondamental qui demeure tout à fait valable dans la manière dont Husserl thématise la Lebenswelt, et qui réside dans l’idée selon laquelle il n’y a pas de conflit entre le monde tel qu’il est ressaisi du point de vue de notre expérience quotidienne et le monde dont nous parle la science, car ils sont situés sur deux plans différents. La vérité de l’un n’implique pas la fausseté de l’autre, et vice versa. Par conséquent, il n’y a aucun besoin de « choisir » entre eux, en affirmant par exemple que le monde de la physique est le seul « vrai » et que le monde de la perception est illusoire. Non seulement, il n’y a pas lieu de choisir, mais toute idée d’un tel choix, comme par exemple l’affirmation que l’on trouve chez Sellars que seule « l’image scientifique du monde » est vraie, se révèle, à l’examen, extrêmement aporétique. L’aspect moins défendable de la théorie de Husserl, c’est le cadre transcendantal à partir duquel le concept même de monde de la vie est pensé.
E : Le prélinguistique
AP : Pour finir, j’aimerais relier tout ce qui vient d’être dit à la question de l’antéprédicatif. Au fond, la question qui parcourt tout le livre est la suivante : toute expérience est-elle nécessairement contemporaine de l’expression linguistique ? A cette question vous répondez nettement dès les premières pages : « Ce livre défend ensuite dans toutes ses ramifications ce qu’on pourrait appeler une thèse phénoménologique : il y a bien une autonomie de l’ordre prélinguistique, de l’expérience « antéprédicative », comme aurait dit Husserl, vis-à-vis des formes supérieures de la pensée et du langage. L’expérience possède un logos immanent que la phénoménologie a précisément pour but de mettre au jour. »16 Comment pourriez-vous relier l’expérience telle que vous venez de la thématiser à l’antéprédicatif ?
CR : J’emploie « antéprédicatif » comme synonyme de « prélinguistique » (ce qui n’est pas exactement l’usage de Husserl). Le lieu natif de l’antéprédicatif, c’est justement l’expérience quotidienne du monde. L’expérience elle-même n’est pas structurée par des schèmes conceptuels qui proviendraient du langage, elle n’est pas non plus mise en forme par des catégories comme le néokantisme a eu tendance à l’avancer – que ces catégories soient pensées comme des « formes symboliques », culturelles, ou autrement – mais il y a justement un logos du monde esthétique et c’est cela que le terme « antéprédicatif » a pour but de saisir. Il y a un sens qui affleure dans les choses, qui est immanent à l’ordre sensible, en vertu duquel se déploie une intelligence corporelle, pratique, perceptive, qui précède l’intelligence discursive et logique, celle qui trouve son déploiement dans le travail scientifique, par exemple. Cette antériorité est une antériorité de droit et non de fait. Bien sûr, en fait, parce que nous avons appris le langage, notre perception et notre sensibilité sont informées et transformées par lui. Mais cela ne contredit nullement l’idée d’une antériorité de droit de l’ordre pré-linguistique.
AP : Cela revient donc à dire que le linguistique a du pré-linguistique. C’est ce que vous écrivez d’ailleurs : « Sans cette dimension prélinguistique du langage lui-même en vertu de laquelle il prolonge la perception, l’expérience que nous faisons d’un geste ou d’un visage, ce qu’il y a de proprement linguistique dans la signification et dans la compréhension verbales demeurerait pour nous, à jamais, lettre morte. »17
CR : Voilà. Absolument.
AP : Pour finir, j’aimerais à nouveau citer une de vos phrases, page 895 : « l’herméneutique phénoménologique ne peut se formuler elle-même de manière cohérente que si elle admet le niveau pré-herméneutique d’une compréhension spontanée à l’œuvre dans l’expérience elle-même, une expérience perceptive non médiée par des signes. » Ce que vous appelez « compréhension spontanée à l’œuvre dans l’expérience », est-ce bien le sens immanent à l’expérience saisi à même la sensibilité ?
CR : Oui.
AP : Concrètement, quel type d’expérience correspond à la saisie du sens dans cette sphère pré-linguistique ?
CR : Toute expérience. Si vous regardez un visage, vous y « lisez » des émotions, des dispositions générales, des intentions, des attentes, une franchise ou une fermeture, un genre de sensibilité, une infinité de nuances que vous seriez même incapable d’expliciter dans le détail. Vous n’en êtes pas conscient de manière thématique ; vous n’avez pas formulé cela linguistiquement et n’avez nul besoin de le faire. Mais c’est là, et ça baigne nos relations humaines. Il s’agit bien d’un sens qui ne provient pas uniquement de l’application de schèmes langagiers mais qui fait que l’expérience est un ordre de sens autonome.
AP : Est-ce qu’on ne pourrait pas parler ici pour qualifier ce que vous désignez d’inconscient cognitif ?
CR : Oui, on pourrait, bien sûr. L’inconscient cognitif décrirait une partie de ce que j’entends par là, parce que beaucoup de ces significations sont aussi parfaitement conscientes. Mais bien sûr on pourrait employer d’autres lexiques.
L’idée dans le passage que vous citez, c’est de lutter contre une certaine tendance de l’herméneutique, notamment chez Ricœur, à élire comme paradigme quasi exclusif le texte et à identifier toute compréhension véritable avec une interprétation au sens fort. Or je pense que l’herméneutique doit admettre justement un niveau de significations latentes et proprement expérientielles de ce type pour pouvoir aussi rendre compte du niveau auquel se situe l’interprétation d’une œuvre de pensée, d’un texte ou d’une œuvre d’art. Il faut donc, je pense, que l’herméneutique concède à cette intelligence non-intellectuelle, corporelle et pratique, le droit qui est le sien pour pouvoir penser des modalités de compréhension beaucoup plus élaborées que l’on peut rassembler sous le terme d’ « interprétation ».
- Claude Romano, Au cœur de la raison, la phénoménologie, Gallimard, coll. Folio-essais, 2010
- cf. Claude Romano, De la couleur. Un cours, La Transparence, Chatou, 2010
- cf. Claude Romano, L’aventure temporelle. Trois essais pour introduire à l’herméneutique événementiale, PUF, coll. Quadrige, 2010
- Claude Romano, Au cœur de la raison…, op. cit., p. 18
- Ibid.
- Ibid. p. 19
- cf. note 11, p. 997
- Ibid. p. 949
- cf. respectivement Jocelyn Benoist, Concepts. Introduction à l’analyse, Cerf, 2010 ; L’a priori conceptuel. Bolzano, Husserl, Schlick, Vrin, 1999 ; Sens et sensibilité, Cerf, 2009
- Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, avant-propos, Gallimard, coll. Tel, 1976, p. I
- Ibid. p. 64
- Ibid. p. 65
- Ibid. p. 213
- C’est là la formule célèbre du § 371 des Recherches philosophiques de Wittgenstein : « l’essence est exprimée dans la grammaire. »
- Ibid. p. 515
- Ibid. p. 12
- Ibid. p. 726







