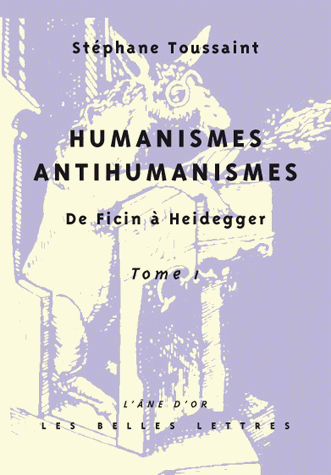A l’occasion de la parution de Humanismes, antihumanismes, de Ficin à Heidegger1 dans la collection l’âne d’or des Belles Lettres, Actu-Philosophia a rencontré Stéphane Toussaint, chercheur du CNRS au Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance
de Tours, lequel a fort aimablement accepté d’évoquer avec nous son dernier ouvrage. Le texte que nous présentons ici constitue la première partie de l’entretien et s’articule autour de la notion d’humanisme ; une seconde sera consacrée à la rentabilité, dont on trouvera déjà quelques évocations dans cette première discussion.
Propos recueillis par Thibaut Gress.
Actu-philosophia : Avec Humanismes, antihumanismes, de Ficin à Heidegger, vous venez de publier un ouvrage résolument polémique, s’inscrivant tout à la fois dans un débat avec l’antihumanisme né de Heidegger mais aussi avec le néohumanisme kantien incarné, entre autres, par Ferry, Renaut, et Philonenko ; vous combattez, dans une seconde partie fort bien informée, la rentabilité mercantile, poussant à la disparition des humanités en raison même du manque de débouchés ou d’ « employabilité » pour reprendre un terme que vous thématisez, disparition que vous jugez dramatique dans la mesure où les humanités constituent cela même qui humanise l’homme. Ainsi, c’est avec le constat de la mort certaine des humanités que s’ouvre votre livre, lequel affirme d’emblée : « le point culminant d’une crise de l’humanisme et des humanités semble atteint désormais. » Savoir comment on a pu en arriver là, tel me semble être le dessein principal de votre ouvrage, qui s’aventurera aussi bien dans les textes philosophiques que dans les directives européennes afin de révéler un processus étrange de destruction de l’homme par le biais d’une mise à bas de ce qui lui permettait jadis de tendre vers sa pleine humanité.
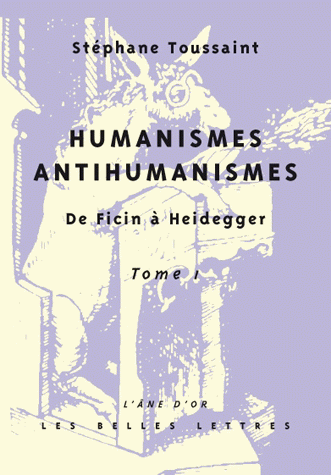
Ma première question portera sur le titre ; il n’a échappé à personne que vous avez choisi de placer un pluriel à « humanismes » tout comme à « antihumanismes » ; ce pluriel me semble fondamental, en ceci qu’il suggère d’emblée la pluralité des humanismes, tout comme la pluralité des antihumanismes. Or, il apparaît au cours de votre ouvrage que la thématisation moderne – kantienne ? – de l’humanisme comme sujet autonome se donnant à lui-même la loi de ses actions et de la connaissance, est une thématisation fausse. Vous écrivez en effet page 15 ceci : « Postulat fondamental : il est possible de distinguer historiquement le contenu de l’humanitas humaniste de la conscience fausse qu’en prennent les Modernes. » Ma question est alors très simple : si l’humanisme moderne procède d’une « conscience fausse », faut-il comprendre que cet humanisme erratique se trompant sur ce qu’il est relève, en réalité, d’une des multiples formes de l’antihumanisme ?
Stéphane Toussaint : Votre question est centrale. Beaucoup d’humanismes se sont succédé depuis l’Antiquité, fort peu d’humanismes ont pleinement incarné le concept d’humanitas. Première constatation tirée des textes : l’humanitas ne représente pas un principe anthropologique intemporel. La notion très vague du « propre de l’homme » ne permet pas de la définir véritablement, malgré la réverbération forte entre l’humanitas et les différents «principes d’humanité» – raison, autonomie, droits de l’homme – mis en avant par les néohumanistes.
Deuxième constatation : on doit distinguer anthropos et humanitas, anthropologie et humanisme, contre les confusions de la conscience commune. Vous voulez savoir, maintenant, si l’humanisme authentique de la Renaissance ne relèguerait pas tous les humanismes modernes dans l’antihumanisme. Ce serait un paradoxe. Certes, si l’humanisme italien, florentin en particulier, se pose en archétype, la raison tient à la plénitude de son humanitas, triple concept de douceur, d’érudition et d’unité humaines. Sommet rarement atteint par la suite. Remarquons, en passant, que la centralité anthropologique de la raison humaine, tant détestée des heideggeriens et consorts, n’était pas, autrefois, tout ce qui définissait exclusivement l’humanité, dont les humanistes avaient une conception équivoque, au sens aristotélicien, et donc très complexe. Mon résultat dépend, par conséquent, d’une méthode de recherche consistant à définir l’humanisme par l’humanitas . Nous savons à peu près ce qu’est un humaniste, notamment grâce à Kristeller, mais nous avons oublié ce qu’est l’humanitas au sens le plus précis du terme. Beaucoup plus qu’à un vague principe d’humanité anthropologique, l’humanitas aboutit, au Quattrocento, à un savoir humain sous forme d’art philosophique. Ou, comme le disait Garin, à une pensée sub specie hominis. C’est ainsi que Dominique Couzinet a intitulé d’ailleurs son riche recueil d’études, inspiré de Garin, Etudes sur le savoir humain au XVIe siècle. Indubitablement, cet art philosophique s’est appauvri au cours des siècles. En voulez-vous une preuve ? De nos jours, le mot humanisme désigne tout et n’importe quoi. Cependant, cette fuite d’idées n’est pas inexplicable. Je montre qu’elle est cyclique au moins depuis le XIXe siècle. Elle se prête à l’analyse historique de certaines dérives philosophiques. Mais pour entrer dans votre propos de manière plus détaillée, la conscience moderne de l’humanisme fondée sur le sujet rationnel, libre, indépendant de la nature et de Dieu, est un fait indiscutablement vrai. Il reste à savoir ce que recouvre l’histoire de sa notion. C’est un procédé commun aux professeurs de philosophie que de décréter périodiquement la naissance du sujet à telle ou telle époque. S’agit-il d’un sujet psychologique, logique, intuitif, juridique etc., et encore, plusieurs théories du sujet ont-elles vu le jour sans jamais se recouper dans cette grande genèse subjective ? L’idée d’homme, d’espèce humaine, de sujet, de personne n’a jamais suivi une évolution unique et linéaire. De même, l’histoire de l’humanitas est-elle pleine de sauts et de cahots. Soyons plus précis. Vous conviendrez avec moi que l’autonomie de l’homme s’est accentuée de bien des manières différentes de Kant aux néokantiens : sa puissance logique a fini par dominer parfois sa puissance morale. L’espèce humaine rationnelle kantienne, noumène sans cesse repoussé sur l’horizon de la raison pratique, fera place un jour à l’individu libéré par son jugement scientifique, du moins si l’on suit Cohen et Natorp. Cassirer, néo-kantien de Marbourg lui aussi, fortement marqué par la pensée du Cusain, de Pic et de Bovelles, n’intitule pas par hasard son ouvrage sur la Renaissance : Individu et cosmos. Observez le croisement contradictoire de ces évolutions avec l’humanisme renaissant. Ficin affirme sa foi dans l’idée d’humanité comme espèce, de manière quasiment prékantienne, mais les néokantiens insisteront davantage, après Dilthey et parfois sous l’influence de Burckhardt, sur la dimension prométhéenne de l’intelligence individuelle créatrice, par exemple dans la Théologie platonicienne. Résumons et concluons. La fausse conscience moderne se trompe lorsqu’elle prétend accomplir et achever l’esprit de la Renaissance dans un idéal rationnel purement scientifique ou dans une philosophie idéaliste de l’histoire, tout comme lorsqu’elle réduit l’humanitas à un humanitarisme universel. Mon travail donne, je crois, assez d’analyses précises de textes néohumanistes méconnus, pour ne laisser subsister aucun doute sur le fait que, par exemple, la constitution philosophique du sujet humaniste, vers 1800, s’opère dans l’oubli de la triple humanitas renaissante. Quant à assimiler le néohumanisme moderne (mais, là encore, je soulignerais l’existence de plusieurs néohumanismes depuis 1800) à quelque forme d’antihumanisme, c’est le raccourci que j’ai choisi d’éviter autant que possible. Sauf sur un point capital, je vous l’accorde : la rentabilité. Exemple : lorsque Luc Ferry, pourfendeur de Foucault et d’une pseudo-pensée 68, devenu ministre, imposa les réformes universitaires destructrices voulues par Claude Allègre et par Jack Lang – véritable destruction de l’éducation par la marchandise parée de jactance démagogique – son action fut plus antihumaniste que ne le fut celle de Foucault. Errance d’un néohumanisme au pouvoir, sans conscience philosophique de sa généalogie. Kant, Niethammer et Humboldt sont autre chose.
AP : D’accord ; j’ai voulu commencer par cette question car si le sous-titre de votre ouvrage est « De Ficin à Heidegger », il me semble que le point de départ de votre investigation historique ne remonte guère en-deçà des Lumières ; à part quelques remarques allusives consacrées à l’antihumanisme pascalien ou au sujet cartésien, nulle thématisation du Grand Siècle n’y apparaît clairement et votre réponse évoque à l’instant Kant, bien entendu, Niethammer, Cohen, Natorp et Cassirer, soit le néokantisme. Le XVIIè siècle fera-t-il l’objet d’un second tome dans cette vaste fresque que vous préparez, ou jugez-vous que la question de l’humanisme et de l’antihumanisme se situe dans le prolongement des acquis de la Renaissance, sur fond de ce que vous appelez « l’affirmation éthique d’une perfection de l’homme » (page 95), ce qui dispenserait d’une conceptualisation spécifique de ce moment philosophique ?
S T : « De Ficin à Heidegger » indique surtout deux polarités philosophiques. Je n’aspire pas à peindre une fresque historique, où je me serais donné pour but de marquer d’un chapitre chaque auteur ou chaque épisode considérés ‘humanistes’ et ‘antihumanistes’. Mon travail se laisse comparer à celui, très artisanal, d’un restaurateur de tableau : je dissipe patiemment les couches d’ombre incrustées sur l’humanitas et sur son savoir humain. Notez, je vous prie, que le XVIIe siècle comprend aussi Coménius, que je cite. En outre, je remonte aussi en arrière, vers l’Antiquité gréco-romaine, en m’appuyant sur des travaux souvent méconnus en France, comme ceux de Schneidewin et de Rieks. A présent, ce que vous nommez Grand siècle est en partie l’âge de la rhétorique, en partie l’âge de la pédagogie chrétienne, celle des Jésuites et des Protestants, et surtout l’âge de la Révolution scientifique. L’érudition, la philanthropie, le problème de l’unité humaine et enfin l’esprit composite de la Renaissance, mi-métaphysique, mi-symbolique, déclinent dans la grande lutte que se livrent la théologie d’une part, la science nouvelle et les philosophies épicuriennes d’autre part. Henri Busson avait très bien saisi ce tournant. Quoiqu’il en soit, si j’avais à traiter des prolongements difficiles de la triple humanitas sur cette période, disons de 1600 à 1750, je ne choisirais pas forcément la France et me tournerais vers les Platoniciens de Cambridge, vers Grotius et Vossius, vers Vico et ses précurseurs, vers Coménius aussi. Et, pourquoi pas, vers Hume. Auteurs auxquels je ne m’interdirai pas de recourir, peut-être, dans le second tome de mes recherches.
J’ajoute que la catégorie même d’antihumanisme, que vous évoquez à propos de Pascal, à la suite d’Henri Gouhier, n’est pas toujours péjorative, loin de là. L’antihumanisme se profile dès lors que l’homme aspire à dépasser l’homme ou bien à s’anéantir en Dieu. Devenir Dieu ou mourir en Dieu. Déification ou annihilation, extrêmes opposés du mysticisme prométhéen et de la servitude mystique ! Et l’on repère ces aspirations contradictoires chez Ficin et chez Pic comme chez beaucoup de métaphysiciens. L’antihumanisme devient, par ailleurs, totalement nihiliste lorsqu’il prétend ne plus vouloir de l’homme et s’arracher entièrement à son humanité. Etre plus que l’homme et ne plus être homme sont deux désirs que la philosophie interroge depuis l’origine.
AP : Vos précisions quant à ces deux directions invitent alors à revenir vers la définition de l’humanisme véritable que vous cherchez à réhabiliter aussi bien contre sa déformation kantienne, que contre les formes contemporaines d’antihumanisme avoué ; vous définissez l’humanisme par une triade : studia humanitatis, charitas et unitas hominum. C’est là la triade ficinienne, que vous évoquez un peu plus bas, de la connaissance, de la douceur et de l’unité. Mais en quel sens faut-il entendre l’unitas hominum ? Est-ce l’unité de l’homme comme sujet, ou l’unité humaine comme espèce ?
ST : Permettez-moi d’observer qu’il y a moins de « déformation » de l’humanisme par les néohumanismes, kantien, hégélien ou marxiste, qu’une déstabilisation croissante du concept d’humanitas. A partir du moment où l’eruditio, la philanthropia et l’unitas ne sont plus accordées entre elles, ne font plus dialectique mais s’excluent réciproquement, le processus de démembrement est en place, qui ouvre les rivalités de l’humanitarisme et de l’humanisme classique, de l’égalitarisme et de l’élitisme, de l’unité de l’espèce et de la singularité du docte. Or, au sens philologique, parfaitement précis sur le plan conceptuel, l’humanitas latine, puis florentine, demeure triple, comme dans la lettre de Ficin à Tommaso Minerbetti, que je cite et que je traduis pour ce motif. Trois sens y sont réunis. L’homme est humain en étudiant l’humanité des livres, en aimant l’humanité de ses frères et en pensant l’humanité unique de son espèce. Mais cette dernière unitas n’est pas tant idéaliste, au sens d’un sujet universel se pensant à travers l’histoire, qu’idéale, en ceci que tous les hommes sont frères, je cite Ficin, dans l’idée unique de l’homme. Au point, d’ailleurs, que l’idée de l’homme est elle-même un immense être humain. Ficin annonce ici le grand Sebastian Franck plus que le néokantisme. Sa conception, soulignons-le, se compose d’une forte part d’hermétisme. Entrerait ici en scène le mythe de l’homme céleste dans l’Asclepius.
AP : Vous proposez une belle et substantielle analyse de la pensée de Niethammer, contemporain de Kant, Fichte et Hegel, et vous en faites le point de départ d’un néohumanisme cherchant à poser ses fondations dans le soleil antique. La Grèce doit redevenir le modèle de l’humanité, modèle dont la condition de possibilité s’avère être celle du langage, si bien que la langue grecque devient le vecteur de ce néohumanisme issu des Lumières. « Au fond, dites-vous page 77, sans qu’il le confesse jamais, le grec remplit, chez Niethammer, le rôle fécondant de l’hébreu dans les sciences théologiques. » Vous faites par ailleurs de Jaeger un héritier de Niethammer, particulièrement dans la série des Paideia ; il est manifeste que cette forme de néohumanisme ne répond pas à l’humanisme ficinien ou pichien que vous appelez de vos vœux ; en quel sens jugez-vous que le retour aux Grecs constitue un obstacle à l’humanisme véritable ? Et, en guise de corrélat, en quel sens les sources de Ficin et Pic qui sont chaldéennes, hébraïques et hermétiques, assureraient-elles le fondement d’un humanisme plus fécond ?
ST : Au fond, je n’appelle aucun « retour en arrière » de mes vœux. Nous ne sommes plus au Quattrocento. Je tente simplement de comprendre ce qui demeure incompris, sans vouloir diriger les consciences. Il me suffit de comparer des idées, des textes et des faits afin que chaque esprit libre, instruit par des concepts clairs, juge ce que doit être son humanisme. Ou son antihumanisme. La notion de vocation humaniste compte beaucoup plus, à mes yeux, que toute définition canonique de l’humanisme. La vocation est la bonne voix démonique de notre intériorité. Le canon classique est une fiction académique. Le père des études grecques au XXe siècle, Wilamowitz, ne croyait pas au classicisme. Par conséquent, ce qui est érudit et philologique dans ma recherche philosophique ne deviendrait canoniquement classique, pour le lecteur, qu’à contre-sens.
Ensuite, les Grecs ne représentent pas toujours un obstacle, mais ils ont bien, à un moment donné, fait écran entre l’humanitas et les humanistes modernes, comme, plus tard, entre les humanistes modernes et leurs adversaires. J’ai tiré Niethammer de l’oubli où il gisait en France avec quelques autres (malgré la citation obligée de son Humanismus dans toutes les vulgarisations sur l’humanisme que vous pourrez lire) parce qu’il incarne le grand tournant grec, après Winckelmann et dans un tout autre domaine que lui, en pédagogie et dans l’éducation des peuples. Jaeger, un autre grand oublié, ne dépasse pas Niethammer sur ce plan, mais il accomplit son projet en le dématérialisant à force de l’idéaliser. Le modèle de Jaeger est le mariage de Faust et d’Hélène de Troie ; entendez de l’âme allemande et de la beauté hellénique. Pour le dire métaphoriquement : Hélène se dresse devant la Vénus de Botticelli. Car Jaeger reniait précisément la Renaissance italienne au nom des Grecs, comme Heidegger rejettera à son tour la latinitas. Et ce sera au nom des Grecs, ironie suprême, que Heidegger s’opposera à Jaeger et à sa revue Die Antike. En effet, la Grèce de Heidegger est censée provenir d’Héraclite et de Parménide, celle de Jaeger, d’Homère, de Platon et d’Aristote. Néanmoins trop de philosophes contemporains, peu instruits des textes renaissants, voyez un Lacoue-Labarthe, sont convaincus que l’humanisme de la Renaissance, source de tous nos maux, se réduit à l’éternel retour éthnocentrique de la Grèce. Grave erreur. A partir de Ficin se produit une hybridation intellectuelle sans précédent, dont Pic est le prototype et dont Athanasius Kircher marque l’éclosion baroque, où les traditions hébraïques, arabes, égyptiennes se mélangent à la pensée dite occidentale. Cette hybridation met plus de germes d’universalité dans l’humanitas que n’en met l’image rationnelle des Grecs avec son classicisme abstrait. On pourrait en débattre, mais l’héraclitisme de Heidegger ne me semble pas plus généreux et je lui oppose volontiers l’orphisme de Ficin. La rencontre de l’Orient et de l’Occident, essentielle pour un Ficin comme pour un Postel, voilà ce que les philosophes européens n’ont plus assumé grosso modo depuis Descartes – à part quelques exceptions comme Creuzer ou Schelling – parce qu’elle représentait, dès le XVIIe siècle, (pour des motifs impossibles à cerner ici) la confusion de l’irrationnel et du rationnel, de l’hérétique et de l’orthodoxe. L’orientalisme devint alors l’affaire des linguistes, des éthnologues, des théologiens et des érudits, sur le modèle de Pococke père et fils. Pour répondre d’une phrase à votre interrogation : oui, le renouvellement de l’humanisme passe par une réflexion sérieuse sur cette hybridation perdue.
AP : J’en viens à la dernière question portant sur la notion d’humanisme que vous développez dans ce livre, et qui me paraît capitale : il y a un présupposé à la fois fort et délicat, qui est celui d’une humanisation de l’homme par les humanités. L’esprit du temps – je me fais l’avocat du diable – toujours prompt à dénoncer les marques d’élitisme, ne risque-t-il pas de voir en vos thèses l’idée voulant qu’il y ait des degrés d’humanité, dont seuls les lettrés parviendraient à atteindre les plus élevés ? Par ailleurs, si les humanités permettent à l’homme d’atteindre sa pleine humanitas, il nous faut impérativement penser celles-ci de façon telle qu’elles rendent possible une transformation de l’individu, tant il est vrai que l’on ne saurait admettre que ce qui permet à l’homme de tendre vers son essence ne soit qu’une technique d’apprentissage parmi d’autres. Ma question est donc la suivante : puisque l’on ne peut plus admettre que les humanités ne soient qu’une simple érudition, comment définiriez-vous celles-ci, sachant qu’elles induisent une transformation ontologique de l’homme ?
ST : Je m’étonne un peu que vous me tendiez ce piège amical. Que l’homo devienne humanus au terme d’une éducation libérale, voilà un lieu très commun depuis l’Antiquité. Mais d’aristocratique il s’est, pour ainsi dire, progressivement démocratisé durant la Renaissance. Le grand pédagogue Vittorino da Feltre, au Quattrocento, partageait les dons de ses élèves riches avec ses élèves pauvres. Voilà une petite révolution. J’ai dit clairement ce que je pensais d’une conception capitaliste des élites, en rapportant les propos savoureusement sacrilèges de Forster et de Readings. Mon exemple d’Eugenio Garin et du cordonnier – où le grand philosophe italien de l’humanisme retrouve l’un de ses élèves devenu cordonnier, ayant conservé pourtant sur son établi les Histoires d’Hérodote que Garin lui avait lues quarante ans plus tôt dans un petit lycée professionnel – montre exactement ce que signifie la culture classique révolutionnaire, ouverte et généreuse, à l’inverse d’un humanisme réactionnaire, avare et clos. Tous ont vocation à connaître les belles lettres, voilà une conviction chevillée à l’humanisme italien des origines. Où le problème me semble faussé, la question mal posée, intentionnellement ou non, c’est quand on fait des belles lettres une faculté de nantis, et de là, un luxe inutile. Les humanités, pas plus que l’humanité, ne sont inutiles. Les humanités inutiles ? Demandez-vous pourquoi les castes dominantes encouragent ce préjugé destructeur. Au départ, rien n’est plus antiaristocratique que l’humanisme renaissant. Il fut une revanche de l’homme d’étude, d’origine souvent médiocre, contre les élites de sang et de fortune. Les bonae litterae furent fondamentalement libératrices. Les travaux de Paul Oskar Kristeller, de Cesare Vasoli, de Riccardo Fubini, de Jean-Claude Margolin, de Ugo Dotti, de Christophe Carraud et de tant d’autres savants l’ont bien établi à propos de Pétrarque, de Salutati, de Bracciolini, de Valla, de Bruni, d’Alberti, d’Erasme. À vrai dire, je n’écris nulle part qu’il faille revenir à un élitisme clos, à un capitalisme intellectuel, pour paraphraser Bourdieu. Les bonae litterae sont une condition nécessaire mais non suffisante pour étendre la communauté humaine, et d’abord entre les esprits du passé et les hommes actuels. Les lettres sont un medium permettant d’entrer dans l’assemblée des esprits defunts depuis des siècles, en réalité toujours vivants puisque vous dialoguez avec eux. Les bonae litterae sont ensuite un vecteur d’harmonie entre les vivants. Un bain de douceur intellectuelle, dont est sortie la République des lettres. Sans la philanthropia, elles ne sont rien. Tout un pan de mon livre traite, pour cela même, de la philosophie du don et des Grâces. Ce sont trois divinités chères aux humanistes florentins. L’humanitas reste ainsi une dialectique et reste en dialectique sur trois fronts : érudition, compassion et unisson de l’humanité. En outre, le problème n’est plus, et depuis longtemps, qu’il faille moins d’élitisme lettré, parce que les vraies élites intellectuelles sont totalement mortes. Soyons réalistes, l’esprit égalitaire de ce temps, dont vous me parlez, n’est pas un Zeitgeist, c’est un trompe l’oeil de masse : c’est le faux égalitarisme sous lequel les castes médiatiques cachent le privilège de nous faire subir leur domination et leur ignorance. Le lettré d’élite, créature ombrageuse, instinctivement rétive envers le pouvoir, a disparu après 68. Hocquenghem l’a parfaitement dit. Le lettré de race, en mourant sous la marchandise médiatique, emporta dans la tombe la qualité de son aristocratie morale. Il existe désormais, pour parler de culture authentique et non de journalisme intellectuel, d’humbles amis des livres, des amateurs de poésie, des bibliothécaires sans argent, des profs prolétarisés, des chercheurs précarisés, des étudiants livrés à eux-mêmes, qui luttent contre le mépris dont on les abreuve. Tout ce qu’il nous faut obtenir, ce pour quoi il faut combattre en définitive, c’est que l’on ne dissuade pas les gens de lire – et de lire Aristote, Platon, Plotin, Proclus, ou Dante, Pétrarque, Ficin, Pic, Campanella – sous le prétexte, alourdi par une mauvaise presse, que ce sont là des auteurs « pour élite ». La France, malheureusement, est un pays qui cultive une insupportable routine intellectuelle et artistique. Pays asphyxié de conformisme. Mot d’origine fasciste, je vous le rappelle.
En résumé, le paradoxe de l’humanitas des humanistes italiens fut d’avoir eu une vocation universelle étrangère « aux masses » que l’on manipule facilement. Ce qui compte pour le pédagogue de la Renaissance n’est pas forcément que tous sachent écrire le latin ou le grec, mais que tous sachent suffisamment lire et penser pour devenir écrivain, architecte ou marchand, au gré de chacun. L’utilitas des lettres, voilà le fin mot de l’histoire. Je donne l’exemple de Francesco Patrizi da Siena, auteur d’un De utilitate litterarum, mais il y en aurait bien d’autres. Cette utilité consiste, pour nous maintenant, à donner une conscience critique aux peuples, à forger les instruments d’un jugement collectif, et dans le pire des cas, à sauver les individus pensants de la massification. Il faut entièrement opposer une telle utilitas à l’utilitarisme de la rentabilité, fausse valeur au nom de laquelle le pouvoir assassine aujourd’hui les humanités. Je vous réponds donc : le lettré n’est pas ontologiquement supérieur, il est supérieurement utile à la communauté en cultivant un don naturel, ou démonique à la Renaissance, dans une société qui tend idéalement à la complémentarité des métiers. Fait notable, l’essor de la dignité des professions date, en gros, du XVIe siècle. Tout en croyant à la dignité de la philosophie, Ficin traduit ainsi certaines œuvres, comme son De amore ou les traités d’Hermès Trismégiste, pour des marchands, des artistes, des artisans. J’ai retrouvé, à ce sujet, dans les archives toscanes, certains manuscrits en langue vulgaire ayant appartenu à d’humbles florentins, où cette influence philosophique et hermétique avait pénétré.
Finalement, l’eruditio humaniste est originellement éloignée de ce que nous nommons érudition en pensant, de fait, au pédantisme hautain. Le mot eruditio signifie simplement le dégrossissement moral, l’initiation à la culture, assez comparable à la taille d’une pierre brute en forme humaine. Elle est l’éducation totale de l’esprit. Tout homme naturel devient spirituellement humain par eruditio. L’homme non érudit, le grossier, le rustre, est homme par nature et non par culture ; de même que l’homme par la chair n’est pas l’homme par l’esprit. En 2000 ans, ce vieux concept païen s’est christianisé puis laïcisé. Il demeure. Plus que de perfectionnement d’essence ou de perfection anthropologique, parlons d’un approfondissement de l’humanitas qui jamais ne s’épuise et qui toujours s’ouvrira à d’autres humanités, à d’autres cultures par la porte d’or de l’éducation, de la paideia. Vous me parlez d’ontologie. C’est entendu. Je vous réponds, avec le décalage voulu : attention aux pièges de l’ontologie ! La profondeur et l’hybridation de l’humanitas sont ce que Heidegger interdit radicalement de comprendre. L’humanitas est au-delà de l’existence. L’humanitas s’avère par la culture. Et seule sa culture sauve son existence.
Entretien avec Stéphane Toussaint : Autour d’Humanismes et antihumanismes (partie 2)