François Rachline, professeur d’économie, mais aussi essayiste et romancier, a fait paraître en 2018 un remarquable petit essai, Un monothéisme sans Dieu[1] venant couronner une trilogie visant à aborder le judaïsme à partir des textes originels – la Torah en priorité – tout en adoptant une audacieuse perspective de double démembrement : sont mis de côté non seulement l’aspect social et cultuel mais aussi les élaborations théologiques ultérieures, le tout permettant une forme de retour au texte comme tel, vidé de sa surcharge sociale, historique et théologique. Se dessine de la sorte une sorte de « philosophie du judaïsme » ou, plus exactement, une philosophie des Hébreux, qui prend le contrepied des lectures traditionnelles où priment la Loi et l’élaboration d’une pratique conforme à cette dernière.
Outre la perspective singulière que retient l’auteur, doit être saluée la modestie du propos ; en soulevant de très délicates questions – la prononciation inconnue du Tétragramme, la pluralité des Elohîm sujets de verbes au singulier, mais aussi l’absence d’affirmation de l’unicité de l’Elohîm appelé YHVH –, l’auteur ne prétend nullement y répondre, mais simplement en rappeler l’existence mais aussi proposer quelques voies de réflexion visant à assumer ce que dit le texte et peut-être surtout ce qu’il ne dit pas. Un des grands mérites de l’ouvrage réside ainsi dans sa capacité à nous rappeler combien nous ne lisons pas les textes ou, plus exactement, combien nous croyons y lire ce qui ne s’y trouve aucunement, croyant trouver ici l’affirmation de l’unicité de Dieu, là l’affirmation du monothéisme et partout la présence de Dieu. Or, montre Rachline, il n’est jamais fait mention du caractère « unique » de YHVH, et il n’est d’ailleurs jamais significativement question de Dieu comme tel, le terme n’étant jamais véritablement présent dans les textes sacrés.
S’il est des points qui n’emportent pas tout à fait la conviction – pour une raison de logique interne au propos sur laquelle nous reviendrons –, nous devons dire combien ce petit livre concluant le cycle de La Loi intérieure et de Au commencement était le futur est stimulant et riche de remarques parfois très subtiles, nourries d’une analyse de détails – la question de la supposée élection des Hébreux est un cas d’école – d’une grande rigueur.
A : Le problème des Elohîm ou l’Un parmi d’autres
La majorité des problèmes que soulève l’auteur ne sont pas inconnus et font même l’objet depuis des siècles de tentatives d’explications plus ou moins satisfaisantes aussi bien dans les milieux religieux que dans les études savantes. Le premier élément est le mot Elohîm dont chacun sait qu’il est au pluriel, et dont chacun mesure les problèmes gigantesques qu’il soulève dès lors que la pensée à laquelle il est accolée est censée être monothéiste.
Le problème est ancien, et déjà Schelling dans la 7ème leçon de son Introduction à la philosophie de la mythologie avait bris à bras-le-corps le sujet, ramenant la distinction entre la pluralité des Elohîm et la singularité de YHVH à celle de l’absolu et du relatif : un Dieu ne peut être relatif que relativement à l’absolu. A cet égard, Elohîm était pensé comme le dieu ramené au contenu de la conscience, tandis que YHVH procèderait d’une différenciation, serait un Dieu différencié, de sorte que les deux termes renverraient à l’indistinction et à la distinction par différenciation. Et Schelling de commenter cette interprétation :
« Tant que la première génération humaine vénéra, en toute ingénuité et certitude, dans le premier Dieu, le Dieu vrai, il n’y avait aucune raison de différencier le Dieu vrai comme tel. Lorsque ce premier dieu commença à devenir incertain du fait de l’intervention d’un Dieu subséquent, alors seulement l’humanité chercha à fixer en lui le Dieu vrai, apprenant ainsi à le différencier[2]. »

Fin lecteur, Schelling connaissait le problème de la pluralité des Elohîm et des verbes au singulier associés à ce substantif pluriel. Une sorte de tragédie interne à l’évolution de la conscience humaine se trouvait ainsi restituée, et Schelling pouvait ainsi reconstruire ce que visait la conscience selon les termes employés, contestant d’ailleurs le reste de polythéisme dans la Torah :
« Cela vient du fait que Dieu, en tant que Yahvé, est assurément toujours unique, tandis que, en tant qu’Elohim, il est celui qui est encore exposé aux sollicitations de la pluralité, et en outre également du fait que, pour la conscience qui s’accroche à l’unité, il devient effectivement une pluralité, mais toujours réprimée. Ce n’est pas un polythéisme plus ancien, mais le polythéisme ultérieur, aux atteintes duquel Abraham par exemple n’était pas soustrait, qui se fait jour ici[3]. »
Quoi qu’il en soit de l’interprétation de Schelling, on voit que les problèmes lexicaux mais aussi grammaticaux étaient déjà bien connus et établis dans la première partie du XIXè siècle, et que « l’étonnement » dont parle Thomas Römer[4] quant à la pluralité / singularité des Elohîm est une vieille histoire. Dans ce contexte, la première thèse forte de François Rachline consiste à montrer qu’il y a une sorte de cohérence interne à deux étages de la Torah et dont nous restituons ici le premier : la pluralité des Elohîm doit inciter à penser que si YHVH est l’un d’entre eux, alors il n’est pas le seul des Elohîm. Mais alors apparaît l’objection de l’affirmation de l’unicité de YHVH, certes très rare, mais en tout cas fondée au moins sur Deutéronome VI, 4 : « Ecoute, Israël : Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé » (traduction de la Bible de Jérusalem). Là-contre, F. Rachline propose une analyse de détail du texte hébraïque et cherche à établir que le sens littéral de celui-ci diffère des traductions habituelles :
« Stricto sensu, il faudrait écrire : « Écoute, Israël, YHWH notre Elohim, YHWH un ! » sans deux fois le verbe être, mais celui-ci, en hébreu, ne se conjugue pas au présent. Dans le verset, il est donc implicite de dire « YHWH est notre Elohim, YHWH est un ». Cela dit, même sans le verbe être, le verset tient debout sans problème. À dire vrai, la formulation française occulte une bonne partie de la difficulté qui nous occupe. « Notre Elohim » traduit l’hébreu Eloheynou, qui est un pluriel. Non pas, donc, « notre Elohim », mais « nos Elohim ». De sorte que ce verset devrait plutôt être traduit ainsi : « Écoute, Israël, YHWH sont nos Elohim, YHWH est un »[5]. »
On le voit, la subtilité de l’auteur consiste à distinguer ce qui est un de ce qui est unique ; on peut dire de YHVH qu’il est « un », mais il n’en est pas pour autant mécaniquement tiré qu’il est unique ; l’unicité ne découle pas de l’unité, et par analogie F. Rachline rappelle que l’on peut dire de la République qu’elle est « une et indivisible » sans que cela ne signifie qu’il n’y a qu’une seule République – qu’elle est unique.
Par cette argumentation se trouve construit le premier étage, à savoir que la pluralité des Elohîm doit être assumée comme telle, et que la Torah en parle bien au pluriel, YHVH étant l’un d’entre eux. Mais deux éléments emportent l’étonnement ou la réserve. Le premier est que le passage de Deutéronome IV, 35 où se trouve niée l’existence d’autres Elohîm que YHVH n’est pas analysé ; le texte est pourtant explicite : « C’est à toi qu’il a donné de voir tout cela, pour que tu saches que YHVH est le vrai Dieu et qu’il n’y en a pas d’autre. » On ne peut que regretter que ne soit pas analysée plus avant cette affirmation monothéiste dialectisant quelque peu les thèses de l’auteur. On peut en outre s’étonner de la prudence de ce dernier à l’endroit de l’argument du « pluriel de majesté » ou du « pluriel d’excellence » brandi par les défenseurs de la LXX ou de la Vulgate, puisqu’il semble admis que le pluriel d’excellence n’existait pas à l’époque de la mise par écrit du texte de la Torah. L’impossibilité linguistique autant qu’historique du pluriel d’excellence ou de majesté n’est pourtant pas signalée par F. Rachline, peut-être en raison du second étage de son argumentation que nous aborderons ultérieurement, alors même que cette impossibilité sert assurément son propos.
A l’appui de sa thèse, l’auteur revisite également le célèbre passage de Exode XX, 3 contenant une seconde affirmation monothéiste, souvent traduite par « tu n’auras point d’autre dieu que moi. » ou encore par « Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi. » (Traduction de la Bible de Jérusalem). Naturellement, F. Rachline, par sa fine analyse de détail du texte, va montrer de manière convaincante que le texte n’est pas tant une affirmation monothéiste qu’une invitation relative à un peuple :
« À regarder de plus près le texte de la Torah, ce n’est pas exactement cela qui est affirmé. L’assertion hébraïque est ainsi rédigée : « Lo yhihé lékha Elohim akhérîm ‘al panaï. » Ce qui veut dire, littéralement : « Il n’y aura pas pour toi des Elohim autres sur mes faces/intérieurs. » Pour mettre en évidence l’écart entre les deux formulations, il faut faire appel à la syntaxe hébraïque. D’abord, il n’est pas écrit « tu n’auras point », mais « il n’y aura pas pour toi […] ». Certes, au premier coup d’œil, la distinction ne s’impose pas d’évidence. Pourtant, le point essentiel est ce petit lekha, qui précède Elohim dans le verset. Ce mot veut dire « pour toi ». De sorte qu’il peut exister de nombreux autres Elohim, mais pas pour toi, si tu adhères à la loi mosaïque, la Torah. Ce précepte n’est nullement une vérité universelle, opposable d’emblée à tous les êtres humains, mais un appel individuel. Il n’est pas question d’interdire universellement, mais d’inviter personnellement. Cette nuance témoigne en réalité d’un abîme entre deux conceptions irréductibles. Pour l’instant, notons que cette Parole prescrit à celui qui l’entend (qui la comprend, l’assimile et l’adopte) de renoncer aux multiples dieux qui peuplent l’univers humain. Cet abandon, elle ne l’exige de personne d’autre, ce pourquoi, soit dit en passant, le judaïsme n’a jamais cherché à convertir quiconque. Et, il faut y insister, nulle part n’est affirmé qu’il n’y aurait qu’un seul Elohim, qu’un seul dieu[6]. »
Ici se retrouvent nombre d’analyses de la Loi intérieure, étayées par le décorticage strict et rigoureux du texte hébraïque. L’ambition n’est pas tant de fournir une métaphysique universellement vraie que de proposer une relation circonscrite qu’il conviendrait de ne pas hypostasier en Absolu ni même en Singularité universelle. Comme le notait d’ailleurs déjà Jean Bottéro, YVHV est moins celui par qui est proposée une métaphysique universelle que celui par qui se trouve établi un contrat avec un peuple, lequel est « sa propriété privée en quelque sorte[7]. »

A cet égard, en circonscrivant la question à celle de l’appel individuel, F. Rachline biffe mécaniquement le problème de la relation entre les Hébreux et les Nations/Gentils, et s’il établit « deux conceptions irréductibles », il n’en déduit pas leur caractère conflictuel, et ce en vertu de l’indifférence hébraïque à l’endroit des autres cultes. On est ici aux antipodes des thèses d’un Jan Assmann pour qui la singularisation d’un dieu pour un peuple et l’introduction du monothéisme conduisent nécessairement à « la destruction des dieux interdits et déclarés idoles, du fait de l’antagonisme violent et théoclaste généré par la « distinction mosaïque » entre vérité et non-vérité » dans la religion[8]. »
B : Singularité de YHVH
Le second étage de l’argumentation de F. Rachline consiste à dialectiser la première affirmation selon laquelle YHVH est un Elohîm et à singulariser YHVH pour l’extraire du commun des Elohîm. Pour le dire de manière paradoxale, l’auteur va chercher à montrer que YHVH est un Elohîm et ne l’est pas.
Afin d’étayer cette thèse paradoxale, F. Rachline va chercher à interroger le caractère imprononçable du Tétragramme, et chercher à penser l’ordre causal qu’il contient. Partant d’un fait certain, à savoir l’absence explicite de la vocalisation du Tétragramme, il interroge le sens de cette absence : faut-il y voir une lacune, un manque dommageable ou, bien au contraire, le signe d’une affirmation ? A cet égard, l’auteur propose une inversion de la lecture habituelle et choisit la seconde option :
« (…) ce n’est pas parce que la divinité des Hébreux possèderait un nom imprononçable qu’elle serait singulière ; c’est parce qu’elle est singulière qu’on lui attribua un terme de quatre lettres imprononçable[9]. »
Autrement dit, il ne faudrait pas penser que la divinité des hébreux disposerait d’un nom dont le mode de vocalisation ferait défaut ; il faut aller jusqu’à penser que la divinité des hébreux est singularisée par son absence de nom prononçable, la non-vocalisation de celui-ci étant en réalité le signe de son absence. Une présence incomplète se trouve ainsi transmuée en signe de l’absence singularisante de YHVH. Bref, « que le tétragramme soit innommable n’est pas une particularité grammaticale mais une singularité philosophique[10]. » En découle une sorte d’artefact volontairement déficient : afin de nommer la singularité, il fallait qu’elle ne fût pas nommable, et tel aurait été le défi de Moïse qui créa un concept littéralement imprononçable.
La thèse est séduisante, permet en effet à partir de la question du nom de singulariser YHVH qui, de la sorte, verrait sa singularité affirmée au regard des autres Elohîm, sans que ne soit pour autant niée la pluralité textuelle de ces derniers. Elle peut toutefois être discutée, ne serait-ce que par l’accentuation peut-être excessive de l’impossibilité de prononcer le Tétragramme. Ainsi que le rappelle Thomas Römer, « les textes bibliques gardent les traces d’une prononciation du nom divin. A côté du tétragramme Yhvh, dont la vocalisation massorétique renvoie au substitut « Seigneur », existent de nombreuses attestations d’une forme brève Yhw qui se trouve notamment dans des noms propres théophores, des noms construits avec un élément divin tels que Yirmeyahu (Jérémie), Yesa’hahû (Esaïe), Yehônatan (Jonathan), etc. Ces noms suggèrent que la forme courte du nom divin se prononçait « Yahu » / Yahou »[11]. » Et, de fil en aiguille, Römer peut reconstituer la prononciation probable du tétragramme, au point d’affirmer que la plupart des attestations plaident « en faveur d’un « Yahû » ou « Yahô »[12]. »
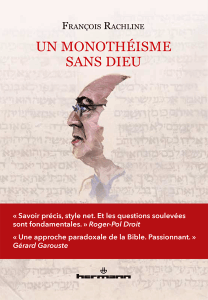
Ainsi, en supposant que le nom fût imprononçable, beaucoup d’indices concourent à penser qu’il était pourtant prononcé ; de surcroît, la prononciation de « Yahvé » retenue par les chrétiens ne semble pas être la bonne, affirmation n’ayant de sens que si l’on dispose de la prononciation correcte identifiée à Yahu ou Yahô. Là se rencontre peut-être l’une des limites de l’ouvrage de F. Rachline qui, voulant ne s’en tenir qu’au texte seul et biffant l’historicité de la prononciation, construit une thèse par trop théorique, quoique stimulante.
C : YHVH est-il incorporel ?
Néanmoins – et tel sera l’objet de la dernière partie – il est un élément qui ne laisse pas d’être surprenant dans la lecture immanente que propose F. Rachline du texte de la Torah et, plus particulièrement, de la nature de YHVH. Refusant avec raison de plaquer les approches religieuses – cultuelles – et même théologiques ultérieures sur le texte, il lance une entreprise de retour au sens originaire et n’élude à ce titre aucune difficulté lexicale ou grammaticale qui se présente au lecteur de bonne foi. Pourtant, il est un point sur lequel l’auteur semble s’écarter de son exigence initiale, ce qui l’amène à s’engager dans une voie inattendue au regard du programme de départ. Ce point, c’est celui de la matérialité de YHVH. A de très nombreuses reprises, F. Rachline considère en effet comme allant de soi que YHVH serait une entité non-corporelle, dénuée de toute apparence, et tout en intériorité. Ce présupposé engage aussi bien l’interprétation de l’homme fait à l’image des Elohîm mais aussi celle du « face à face » de certains hommes avec YHVH, le refus principiel de la matérialité divine ou, à tout le moins, de sa forme corporelle, rejaillissant quant au sens possible de ces deux passages canoniques.
Or il y a là, nous semble-t-il un présupposé qui contredit l’exigence de départ ; en effet, rien dans le texte de la Torah n’indique de manière explicite la non-corporéité des Elohîm en général ou de YHVH en particulier. Autrement dit, un retour au texte pur ne permet aucunement de présupposer la non-corporéité de YHVH qui relève d’une projection théologique rétrospective et gâte le propos.
Mieux encore, beaucoup d’éléments laissent à penser que les Elohîm et YHVH sont corporels, et disposent même de sens conformes à ceux que nous connaissons pour les humains. Dès Genèse I, 2, le terme de ruah, abusivement traduit par « esprit » en raison de l’ambiguïté grecque du terme pneuma, renvoie selon les meilleurs traducteurs à la matérialité du souffle ou du vent, établissant dès le départ le caractère physique des Elohîm dont il va être question. De la même manière, et sans même quitter la Genèse, la sortie de l’Arche s’accompagne immédiatement d’un holocauste des animaux purs et des oiseaux purs ; et le texte d’affirmer : « Yahvé respira l’agréable odeur » (Genèse VIII, 21). On peut certes critiquer l’anthropomorphisme du texte mais si l’on souhaite faire retour à ce dernier, force est de constater l’affirmation explicite d’une faculté olfactive de YHVH que détaillera d’ailleurs le Lévitique, notamment en I, 9 où il sera dit que « l’holocauste sera un mets consumé en parfum d’apaisement pour Yahvé. ». On voit en outre, toujours dans le Lévitique, que YHVH dispose d’une esthétique olfactive, certains parfums lui plaisant au sens le plus esthétique du terme – nicochâ.
Il n’est jusqu’aux Psaumes qui ne rappellent la matérialité des Elohîm et, partant, leur corruptibilité, le Psaume 82 affirmant que l’assemblée divine des Elohîm est mortelle. A cet égard, le retour au texte plaiderait plutôt pour une corporéité sensible des Elohîm en général, et de YVHV en particulier dont le Lévitique révèle de manière explicite l’extrême sensibilité aux parfums et fumets de la viande grillée. Il est tout à fait possible d’y voir des projections anthropomorphes mais une telle perspective n’est justement pas celle de F. Rachline qui n’évalue pas la nature du propos mais cherche au contraire à en retrouver une certaine littéralité qui, d’ailleurs, seule, permet de donner sens à certains passages comme celui de Genèse XXXII, 2-3 où Jacob, croisant des malakhim, reconnaît le « camp des Elohim » qu’il appelle Mahanaïm, ce qui signale à la fois la pluralité des dieux mais aussi la nécessité d’une localisation physique pour des êtres dotés d’un corps physique.
Dans ces conditions, il nous semble que, au regard de la lecture immanente que propose l’auteur, il faut refuser l’excessive intériorisation à laquelle il procède, bien que celle-ci s’inscrive dans la continuité de la Loi intérieure. On note d’ailleurs que, refusant cette apparence formelle et corporelle de YHVH, F. Rachline est condamné à introduire la contradiction au cœur même du texte – sans relever qu’il s’agit d’une contradiction. En effet, analysant le « face à face » (panîm al panîm) aussi bien de Jacob (Cf. Genèse 32, 31) que de Moïse avec YHVH, il lui faut nécessairement interpréter la face comme n’étant pas une face matérielle, comme n’étant pas une apparence extérieure afin d’exclure la possibilité d’une présence idolâtre. A cet effet, l’auteur rappelle d’abord qu’il s’agit d’un pluriel, donc d’un « faces à faces », mais cela l’amène à supposer que chacun est comme confronté aux différentes facettes de lui-même, et donc à la pluralité constitutive et même irréductible dans la rencontre. Le problème est que cette lecture vient contredire toute la subtile analyse destinée à distinguer le Dieu un du Dieu unique : dire, en effet, que l’on ne peut rencontrer Dieu que faces à faces, donc que la rencontre ne puisse s’effectuer que dans la pluralité, semble difficilement compatible avec une lecture dont l’un des enjeux majeurs est d’affirmer par la littéralité du texte le Dieu un contre le Dieu unique. Pour le dire autrement, la pluralité des facettes que contiendrait panîm et dont le terme affirmerait l’irréductibilité ne s’accorde guère avec le rappel du Dieu un auquel procède le début de l’ouvrage.
En outre, le présupposé de la non-corporéité de YHVH engage l’interprétation de l’image et de la ressemblance dont les hommes seraient porteurs. Si YHVH n’a pas de corps, pas d’apparence, alors quel sens cela peut-il avoir de dire de l’homme qu’il est à son image et porteur de ressemblance ? Et, plus encore, n’est-ce pas problématique de raisonner ainsi lorsque le passage à examiner mentionne non pas YHVH mais les Elohim et que, de surcroît, dans ce passage précis, tout est au pluriel ? Rappelons en effet que les Elohîm parlent ici d’eux-mêmes au pluriel et évoquent la nécessité de façonner un homme à leur image, le pluriel de majesté n’étant pas attesté à l’époque de la rédaction du texte, tandis que le verbe associé à Elohîm est présentement au pluriel.
L’auteur a le mérite d’affronter cette question et de rappeler la difficulté de traduire le Tsélem. F. Rachline rappelle un fait connu, à savoir que, traditionnellement, l’image ou la ressemblance se disent par une sorte de préfixe, be ou ki, ici distribués pour tselem et demout. Or, la manière même dont sont formulés les textes amène à penser que, d’une part, le terme « image » est excessif et, d’autre part, qu’il vaudrait mieux traduire par « comme notre ressemblance » plutôt que par « à notre ressemblance. », ce que propose d’ailleurs la Bible de Jérusalem.
Ainsi ne faudrait-il pas lire que l’homme est à l’image des Elohîm ni qu’il leur ressemble mais plutôt qu’il y aurait une analogie entre l’homme et les Elohîm et que cette analogie autoriserait de considérer qu’il y a « comme une ressemblance » à l’endroit de ces derniers. Quel serait alors l’élément spécifique des Elohîm et analogiquement contenu en l’homme qui justifierait d’y voir comme une ressemblance à leur endroit ?
« Le texte nous dit que ce dernier fait l’homme comme « quelque chose » qui lui ressemble. Or, l’être humain, comme Elohim, est lui aussi capable de concevoir, de mettre en œuvre un projet, de créer des choses et des êtres qui portent sa marque. Depuis la nuit des temps, de la grotte Chauvet ou celle de Lascaux à nos jours, depuis les premiers outils de pierre jusqu’aux imprimantes 3D, l’être humain n’a cessé d’inventer des moyens d’expression artistique et des dispositifs de plus en plus élaborés pour affirmer sa présence, produire de la réalité, prolonger son corps, augmenter sa puissance, démultiplier ses capacités d’action. Par surcroît, depuis la nuit des temps, l’homme et la femme donnent naissance à des êtres qui leur ressemblent[13]. »
Cette lecture est très étonnante ; d’une part, parce qu’elle se clôt par une ressemblance entre humains précisément d’ordre physique et matériel – la reproduction –, d’autre part parce qu’elle introduit des abstractions là où il n’y en a pas. Le tselem n’est pas un pouvoir ni une potentialité abstraite, il renvoie à une réalité concrète, souvent en lien avec l’idée de coupure ou de scission ou, plus exactement, en lien avec l’idée d’une réalité concrète séparée de l’élément de départ mais conservant l’image de celui-ci ; quelque chose de concret, de matériel, issu des Elohîm semble donc abstrait de ces derniers pour être conféré à l’homme si bien que l’on pourrait traduire non pas par à l’image des Elohim mais plutôt par avec l’image des Elohîm. Rien n’interdit de penser que ce quelque chose est un élément physique de transmis ou de partagé avec l’homme, élément physique qui, engageant la corporéité ou la structurelle physique de YHVH, permettrait de comprendre au sens littéral la possibilité d’un dieu qui parle, voire qui irradie ainsi qu’en témoigne la rencontre avec Moïse. Rien n’indique en effet que la parole de YHVH soit d’un ordre autre que celui de la parole humaine, et ce simple fait textuel devrait inciter à penser la corporéité même qu’il présuppose. Enfin, cela permettrait de comprendre l’interdit de sculpter l’image de « ce qui est dans les cieux là-haut » (Deutéronome, V, 8 / Exode, XX, 4) car on ne comprendrait guère comment pareil interdit pourrait être sensé si Moïse et les hébreux n’avaient pas été confrontés à des modèles corporels qu’ils auraient pu sculpter ni pourquoi cet interdit arriverait aussi tôt dans le Décalogue si les Hébreux n’avaient pas vu un certain nombre de choses relevant d’un régime commun de corporéité partagé avec les étants terrestres et maritimes sur lesquels plane le même interdit.
Conclusion : le switch inattendu et la possibilité de l’athéisme
Ce petit ouvrage contient de nombreuses vertus : stimulant, parfois instructif, il présente l’immense mérite de rappeler l’exigence de revenir au texte, d’apprendre à lire ce qu’il contient et non d’y projeter ce que l’on croit y lire ; en isolant la Torah de la question religieuse, historique et théologique, il propose une plongée immanente dans un texte fascinant, complexe, déroutant, dont il restitue les nuances parfois infimes.
Le revers de la médaille est que la méthodologie retenue limite parfois la gamme argumentative ; ainsi, la question de la prononciation du Tétragramme ne nous semble-t-elle pas pouvoir être séparée de la factualité historique de la prononciation, et il paraît difficile d’affirmer le caractère absolument non-prononçable en droit du Tétragramme sans chercher à déterminer s’il fut de fait prononcé. Par ailleurs, on peut regretter que l’exigence initiale ne soit pas tenue pour la non-corporéité de YHVH que rien n’atteste dans le texte auquel prétend pourtant revenir l’auteur de manière scrupuleuse.
En dépit de ces réserves, il nous faut saluer un essai qui couronne avec succès une entreprise érudite et profonde, qui fait preuve de courage en présentant des thèses parfois iconoclastes et qui creuse un sillon singulier au point, d’ailleurs, de conclure sur une sorte de retournement final inattendu : à l’aide d’une subtile analyse grammaticale, l’auteur considère en effet que si le sens évident de Genèse I, 26-27 consiste à penser un façonnement par les Elohîm de l’homme, l’inverse ne saurait être exclu par le texte lui-même dont une des lectures possibles serait que ce sont les Elohîm qui seraient façonnés à l’image de l’homme. Et François Rachline de conclure :
« Pour l’exprimer autrement, YHWH dépasse, déborde, excède le monothéisme. Il en est pour ainsi dire un au-delà, où peut se loger, aussi, l’athéisme[14]. »
Être et ne pas être un Elohîm, telle est la condition paradoxale de YHVH qui, en fin de compte, est et n’est pas, ouvrant donc la possibilité de l’athéisme, d’un « monothéisme sans Dieu », expliquant du même geste l’absence du terme « Dieu » au sein de la Torah, El étant non pas le nom générique de Dieu mais le nom propre d’un dieu du panthéon cananéen, signifiant « puissance ».
[1] François Rachline, Un monothéisme sans Dieu, Paris, Hermann, 2018.
[2] Schelling, Introduction à la philosophie de la mythologie, 7ème leçon, Traduction du GDR Schellingiana (CNRS), sous la direction de Jean-François Courtine et Jean-François Marquet, Paris, Gallimard, p. 152.
[3] Ibid., p. 167.
[4] Cf. Thomas Römer, L’invention de Dieu, Paris, Seuil, coll. Points, 2017, p. 38.
[5] François Rachline, op. cit., p. 25-26.
[6] Ibid., p. 48.
[7] Jean Bottéro, Au commencement étaient les dieux, Paris, Hachette, coll. Pluriel, 2012, p. 188.
[8] Jan Assmann, « Le traumatisme monothéiste », in Ce que la Bible doit à l’Egypte, Paris, Bayard, 2008, p. 96.
[9] Rachline, op. cit., p. 21-22.
[10] Ibid., p. 82.
[11] Römer, op. cit., p. 41.
[12] Ibid., p. 45.
[13] Rachline, op. cit., p. 60.
[14] Rachline, op. cit., p. 89.







