Louis A. Sass1 s’attaque à l’exercice de style redoutable de la compréhension de l’expérience schizophrénique à travers le cas Schreber (illustre cas de schizophrène, ayant écrit sur son mal), il relève le défi d’une herméneutique sans zone d’ombre, niant le postulat de l’incompréhensibilité irréductible du vécu expérientiel du schizophrène, et opposant une lecture immanente et conceptuelle au modèle neurologique et au modèle psychanalytique. Non que ces deux modèles n’aient pas de pertinence, mais parce qu’il y a dans le discours du schizophrène la parole d’une conscience réflexive folle, qui dit bien quelque chose de son rapport à la réalité, et il y a dans l’expérience du schizophrène une manière d’être, et non seulement une folie subie. Le but est donc d’interpréter tout le discours de l’expérience schizophrène : point d’indicible ou d’irrationnel auxquels la raison n’aurait pas d’accès, refus du naturalisme psychologique comme modèle exhaustif pour expliquer les troubles psychiques et refus du modèle psychanalytique comme compréhension de l’expérience schizophrène en tant que déficit de l’épreuve de réalité et régression infantile et libidinale. En somme, le but est de restituer une intelligibilité propre à l’expérience schizophrénique, fondée sur la conscience aiguë des individus touchés par ce mal, ce qui va à l’encontre des présupposés de toutes les conceptions, à savoir qu’il n’y a pas de logos propre à la folie, car précisément celle-ci est irrationnelle et illogique. Pour Louis A. Sass, psychologue frotté et formé à la phénoménologie et à la philosophie de Wittgenstein, la symptomatologie schizophrène peut être comprise à l’aune des paradoxes de la conscience réflexive, c’est-à-dire de la conscience moderne aux prises avec sa structure même et le risque inhérent du solipsisme. Il s’agit d’être attentif à ce qui est décrit et dit de l’expérience schizophrénique et de penser à quel type d’expérience commune cela peut se rapporter.
Se plaire à la contemplation, à l’introspection, au détachement conséquent de toute vie pratique pour s’observer soi, se surprendre constituant peut-être le réel, voire opérer une réduction transcendantale, s’étonner en somme d’être un sujet, sujet risquant à chaque instant de redevenir un objet englué dans l’expérience, sitôt qu’il cesse le surplomb réflexif ; voilà en quoi l’attitude du schizophrène vis-à-vis de l’objectivité appelle un traitement philosophique. Comprendre les symptômes et lesdits délires schizophréniques comme troubles de la conscience, c’est donc chercher le sens de la folie dans son discours même, et non dans l’agir d’un inconscient ou d’une physiologie neurologique. Cela n’exclut pas une analyse plus longue et plus complète de la schizophrénie, s’essayant à discriminer les apports et apories de chaque modèle, mais tel n’est pas l’objet du présent ouvrage de Sass ; il suffira de garder à l’esprit que l’aspect polémique n’est pas dogmatique et à prétention d’exhaustivité, mais anti-réductionniste et herméneutique. La volonté est de pénétrer le sens de cette manière d’appréhender le réel, de ne pas renvoyer le fou à l’Autre et laisser ce phénomène nous échapper, comme ce qui ne peut être compris, ce qui est hors rationalité et signification, infra-rationalité infantile et régression.
Les armes sont donc wittgensteiniennes, parce que dans le solipsisme ce dernier voit le nœud principal de l’âme philosophique, cette âme qui se torture de sa condition réflexive. C’est toute l’ambition de Wittgenstein que de la soigner, que de montrer les paradoxes de la réflexion et les apories devenues. Il s’agit pour Wittgenstein de montrer l’absurdité de la position solipsiste et de ses corrélats intellectuels et expérientiels, position que le schizophrène se plait à emprunter comme attitude existentielle. Invoquer Wittgenstein pour interpréter la schizophrénie à la lumière de ce que celui-ci appelait la maladie du solipsisme, c’est aussi aborder cette philosophie sous son jour le plus fort dans l’histoire de la philosophie. Car si Wittgenstein entend assainir l’état de la philosophie, c’est qu’il a observé les effets sur lui des problèmes qui tissent l’histoire de cette discipline, c’est qu’il a détecté dans la conscience moderne des germes de folie, folie qu’il a toujours redoutée pour lui-même et qui rendrait malade l’esprit tout autant que le corps. Le prisme existentiel de l’analyse de Sass montre un Wittgenstein particulièrement percutant et dont les métaphores et autres subtilités d’écriture s’éclairent, comme par exemple cet autre avec qui Wittgenstein parle constamment, qu’il interpelle et dont les thèses et objections ne sont pas simplement logiques, mais aussi incarnées par le dialogue et donc par des attitudes existentielles conséquentes tout aussi critiquées. Si l’alliance est d’abord surprenante entre la philosophie de Wittgenstein et la schizophrénie, elle s’impose lors de la lecture dès lors qu’est incarnée la position solipsiste.
Tout comme la philosophie wittgensteinienne, le questionnement philosophique de ce texte de Sass est vertigineux, la schizophrénie est un état complexe, comme la condition d’un être de conscience l’est : que faire de la conscience réflexive, de ses questions propres, doit-on lutter contre l’intellectualisme, contre les tendances métaphysiques et solipsistes, y a-t-il là atomisation antisociale de l’individu et risques de folies de la pensée égarée, l’animal a-t-il perdu tout instinct comme garde-fou ; cependant, ne touche-t-on pas aussi à la grâce de la contemplation, à la puissance du réflexif, à ce qui arrache à l’animalité par l’hyperconscience de soi et ne touche-t-on pas finalement à certaines questions fondamentales ? Schreber, comme la tradition philosophique, demande si, hors du sujet, le monde existe bel et bien, sa question devenant folle dans l’attitude de vie adoptée en conséquence de cette question. Si la thèse de Sass est de montrer que la schizophrénie doit être interprétée, de manière immanente, comme trouble de la conscience enfermée dans le solipsisme, si le solipsisme et les autres traits schizophréniques liés au solipsisme sont une impasse philosophique que Wittgenstein permet d’éviter, ces troubles de la conscience indiquent pourtant une puissance du réflexif. La philosophie n’est-elle utile que contre le philosophe qui est en nous ? 2
1. Le délire de l’œil de l’esprit : Wittgenstein et le solipsisme
Sass commence par rappeler la compréhension de la schizophrénie dans différents domaines de recherche. La définition même des systèmes diagnostiques de l’Association américaine de psychiatrie (DSM III et DSM III-R) présuppose une norme, comparant la croyance du schizophrène à « l’opinion très généralement partagée ». Mais comment comprendre les croyances du schizophrènes, désignent-elles la réalité telle que nous la définissons, celui-ci est-il vraiment pris au piège de ses croyances, quel est leur statut pour lui ? Le schizophrène parle-t-il de l’expérience commune ? Sass vise ici une compréhension transcendante de la schizophrénie pour y opposer son interprétation immanente à venir : il s’agit de comprendre comment le schizophrène considère ses croyances et la réalité dite délirante qui est la sienne et non d’y opposer comme son exact contraire la réalité normale.
Ensuite, il présente la compréhension psychanalytique qui est le modèle principalement visé dans l’ouvrage : peut-on comprendre la pensée schizophrène comme régression archaïque, retour à un stade du développement infantile ou archaïque ? « Conformément au modèle freudien de la psychopathologie en termes de régression et de fixation, on interprète les délires schizophréniques, ainsi que ceux des autres psychoses, comme des reviviscences pathologiques de « l’histoire infantile originaire » – une forme d’expérience magique dominée par une satisfaction hallucinatoire du désir. » 3 Sass remettra en cause doublement cette compréhension : le schizophrène est-il dupe de son expérience, peut-on comprendre son rapport à ses troubles comme relevant d’une croyance ferme ou d’une incroyance, son rapport au réel n’est-il pas plus complexe et ambigu qu’une épreuve dite déficitaire du réel ? D’autre part, comment expliquer une régression présupposée de la pensée à un stade archaïque de développement et l’hyperréflexivité du schizophrène ?
Sass ne veut pas esquiver la complexité et entendre la schizophrénie come une démence dont le contenu ne mérite pas une attention pleine. Au contraire, la condition schizophrène est complexe et contradictoire. La croyance du malade dans ses délires n’est pas une croyance pleine, celui-ci ironise sur ses croyances et est capable de les mettre à distance, il y a la distinction de la réalité commune et objective et de sa propre réalité. Pour autant, il y a maintien de sa réalité comme ayant une existence propre. Ce que l’on appelle la « comptabilité en partie double » : le schizophrène sait distinguer réalité objective et réalité propre. Ces expériences ont un contenu qui ne se réduit pas à la satisfaction de souhaits ; le fou, le schizophrène est moins celui qui se prend pour Napoléon que celui qui a des « délires métaphysiques », selon le mot de Jaspers, c’est-à-dire celui qui croit constituer par sa seule conscience la réalité, celui qui pense que la réalité peut disparaitre d’un moment à l’autre, etc. Sass s’intéresse à cet aspect de la schizophrénie, c’est-à-dire à la dimension métaphysique et existentielle de celle-ci, à son questionnement ontologique. Bien sûr, on a là un biais, un choix parmi les symptômes, un accent qui est mis sur certains troubles. Sass lui-même de dire qu’une étude plus exhaustive serait souhaitable, mais l’objet du présent ouvrage est de comprendre ces troubles à la lumière du solipsisme et de montrer que la plupart des troubles, mais non tous, sont mieux expliqués ainsi.
Le choix de lire l’expérience schizophrénique comme un délire métaphysique se justifie par la condition du schizophrène, qui pourrait se résumer par la découverte de la relation mystérieuse du sujet et de l’objet. De plus, la condition schizophrénique a une atmosphère très particulière que le terme d’Irréalité peut résumer : le monde est emprunt d’une dimension métaphysique que la perception retranscrit, tout tremble de fragilité et tout est étrange, tout est finalement signé du sceau de la conscience et apparait donc comme plus fragile que ne l’est l’objectivité brute du réaliste. La conscience elle-même et ses pensées deviennent comme concrètes (ce qu’on appelle la « concrétude fantôme), on réifie la subjectivité, quand au contraire la réalité devient plus abstraite et construite par le sujet. C’est donc cette expérience complexe, très intellectualisée, d’une conscience aiguë, dont il faut rendre compte ; pour Sass la conception psychanalytique ne rend pas compte de cette expérience et ne s’occupe que du contenu des délires.
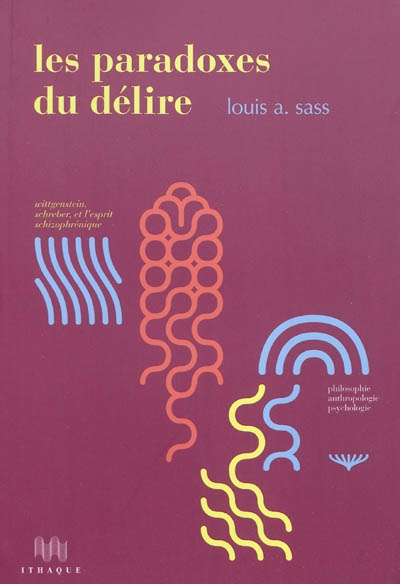
Sass part des écrits de Schreber pour étayer ses propos, il les recoupe avec d’autres écrits de schizophrènes ou avec des comptes-rendus de psychiatres et de psychanalystes. Le cas Schreber est particulièrement intéressant en sa précision, son intelligence et son caractère paradigmatique. A chaque trait schizophrénique décrit à l’aide du cas Schreber correspond une analyse wittgensteinienne éclairant l’intelligibilité de ce qui semblait irrationnel à première vue. Ainsi à l’affirmation de Schreber de voir apparaitre parfois un buste féminin en lieu et place du sien, Sass privilégie l’analyse du voir-comme de Wittgenstein. Plutôt que de supputer une hallucination de Schreber qui se verrait devenir femme et y croirait fermement, Sass montre que l’extrême attention, en l’occurrence à soi, permet d’infléchir une perception. Wittgenstein dans les Recherches philosophiques décrit cette étrange expérience qu’est « l’apparition soudaine d’un aspect » d’un phénomène observé, apparition soit spontanée, soit provoquée par la pensée pour lire le réel d’une certaine manière. 4 Ici, Sass déconstruit la compréhension habituelle des hallucinations, celles-ci apparaissent plus complexes et nuancées qu’une simple croyance en une perception analogue aux autres. Le schizophrène, en réalité, dit distinguer une perception de la réalité commune à tous d’une perception qui lui est propre, de type apparition d’un aspect ou même audition de voix (plus loin, Sass expliquera que ce type d’hallucinations auditives semble être le discours mental que l’individu se tient à lui-même avec une impression d’extériorité ; les voix sont ressenties comme des pensées et non comme ce que l’on entendrait). D’autre part, les délires ne sont en général pas motifs d’action, le point a son importance, car quel statut ont des croyances à partir desquelles on n’agit pas ? En bref, on ne peut comprendre l’expérience schizophrène en termes de déficit de l’épreuve de réalité, le jeu entre le réel et l’imaginaire est plus complexe que la simple confusion.
Une fois montré que l’analyse en termes de déficit de l’épreuve de réalité n’est pas pertinente et bien trop pauvre pour rendre compte de l’expérience schizophrène, Sass propose un schème de compréhension alternatif : la vision solipsiste est ce qui explique la perception de la réalité de Schreber. Cette hypothèse sera testée jusqu’à la fin de l’ouvrage, Schreber sera le cas paradigmatique de l’expérience schizophrénique afin de mesurer l’efficace de cette hypothèse. Le vécu expérientiel du solipsisme est l’impression d’Irréalité du monde perçu, comme si le monde n’advenait qu’une fois la conscience de l’individu intentionnellement dirigée vers lui, qu’une fois une attention porté aux objets. Schreber écrit : « Je me demandais donc si je ne devais pas tenir les rues de la ville de Leipzig où je passais pour des décors de théâtre » 5 « Dans un autre passage digne d’être noté, Schreber se décrit assis dans un parc, où des guêpes et d’autres insectes apparaissent répétitivement devant ses yeux. Il était persuadé que ces apparents insectes surgissaient du néant à l’instant même où il posait ses yeux sur eux, et qu’ils disparaissaient quand il détournait le regard. » 6 Les délires de Schreber ne semblent pas être des déficits de l’épreuve de réalité, c’est-à-dire « une perception objectivement inadéquate (…) tenue réelle par le patient »7, mais une expérience subjectivée, c’est-à-dire une expérience qui se sait ou se sent être constituée par le sujet, jusqu’à prendre le sujet constituant comme unique centre constituant de la réalité, c’est-à-dire comme seul sujet. La condition du schizophrène apparait comme celle d’une conscience prise au piège du solipsisme ; se réfléchissant, elle se découvre constituante et se déduit seul centre subjectif face à l’apparence du réel et des autres sujets. « Wittgenstein parle du solipsisme comme (…) d’une maladie métaphysique à laquelle il avait été lui-même enclin ». 8 Sass rapproche alors les caractéristiques de l’expérience de Schreber de l’attitude expérientielle du solipsisme : l’absence d’action ; l’hyperconcentration afin de faire advenir « l’expérience de l’expérience »9, c’est-à-dire pour le schizophrène de sa réalité propre, cet aspect de la réalité que son regard décide de voir ; le retrait du monde et le repli sur son intériorité. Le schizophrène a une attention suraiguë de ce qu’il perçoit, il lui semble qu’il ne faut pas arrêter son activité réflexive sous peine de voir disparaitre le monde. Ainsi nait ledit délire d’être le centre constituant de la réalité. Tout apparait subjectivé, c’est-à-dire coloré par le sujet et constitué par lui, son regard et sa concentration donnent une consistance à l’expérience (d’où l’attitude parfois prostrée du schizophrène, concentré à faire exister le monde), sa réflexivité le met à distance des objets, comme si ce qu’il percevait était une réalité advenant par l’action du sujet et non une réalité dont il participe. Le schizophrène s’arrête donc sur ce type d’expériences, ce type de rapport au réel pour tenter d’en comprendre le mystère. Cet état de quasi réduction transcendantale ou cet état de nausée (pour reprendre les termes de Sartre et en rajoutant à l’analyse de la nausée comme saisie vertigineuse de la contingence, une compréhension radicale de celle-ci comme contingence qui n’a de sens que si la constitution du sujet l’origine et lui donne sa réalité) est pris pour révélateur d’une réalité révélée. Plutôt qu’hallucination ou délires infra-rationnels, on a là des délires métaphysiques et mystiques, un délire que l’on peut appeler solipsiste, c’est-à-dire prenant à la lettre l‘expérience de pensée solipsiste.
Avant de clore ce chapitre, Sass s’attaque aux caractéristiques laissées dans l’ombre par les autres conceptions rendant compte de la schizophrénie, afin de montrer la pertinence de son hypothèse, hypothèse qu’il appelle le quasi-solipsisme du schizophrène. L’expérience schizophrénique révèle un paradoxe de taille : les croyances délirantes ont un statut contradictoire, à la fois distinguées d’une autre réalité, celle de la communauté des autres, et sans conséquence pratique, le schizophrène les tient, pour autant, comme vraies et au-dessus de toute preuve contraire. Schreber, pour désigner ses expériences singulières, utilise l’expression d’œil de l’esprit, ainsi on peut comprendre cette apparente contradiction comme une distinction de statut entre deux réalités, la subjectivation de l’expérience du schizophrène parle d’une réalité provenant de l’œil de l’esprit, donc de la conscience. Cette réalité n’a pas le même statut ontologique que la réalité commune et objective ; il s’agit d’une réalité dont le sens n’est pas littéral, qui a une qualité subjective, c’est-à-dire ne se confond pas avec la réalité objective. Face au monde commun, le schizophrène oppose un monde de l’esprit, un monde où l’esprit a ses lois, mais qui se sait monde subjectivé et sans efficace pratique. A l’origine de cette tendance à la subjectivation de l’expérience, il y a l’habitude au détachement réflexif, donc à la distanciation du monde naturel vis-à-vis du sujet. Pour Sass, agir sous l’impulsion d’un délire est une exception et non la règle (par exemple, se taillader, agir comme Napoléon, etc.), on ne peut en conclure une confusion totale et structurelle entre le réel et l’imaginaire. Cette exception peut être comprise comme une confusion entre les deux réalités provenant de la déréalisation. Comme le monde apparait déréifié et déréalisé, c’est-à-dire lointain et sans substance, sans nécessité, le schizophrène peut le confondre avec la réalité que l‘œil de l’esprit crée, cette réalité subjectivée, métaphorique, imagée10.
Car en fait, ce n’est pas tant le contenu de l’expérience que le schizophrène veut changer, il ne veut pas croire à un monde qui lui apporterait ce que son désir exige, il ne régresse pas en se leurrant d’une réalité plus douce ; c’est bien plutôt la forme de l’expérience que le schizophrène veut changer, déréaliser, et subjectiver son expérience c’est la constituer en maitre, c’est devenir un Dieu à qui rien ne résiste, ni mystère, ni impossibilité. L’angoisse métaphysique persiste pourtant, car si le monde dépend de la conscience du schizophrène, il lui faut relever ce défi, ce qui explique bien des attitudes (prosternation pendant des heures, hurlements pour que cesse cette pression réflexive, etc.).
La réalité délirante du schizophrène n’est donc pas, pour Sass et selon ses descriptions phénoménologiques de l’expérience de Schreber et des autres patients, une expérience de réalité déficitaire, pas plus il n’y a là expérience en-deçà de la compréhension.
2. La logique paradoxale de la schizophrénie et du solipsisme: rendre compréhensible l’expérience de la folie
Le premier paradoxe qui apparait poursuit le premier : si le monde de Schreber est subjectivé et distinct de la réalité objective, pourquoi celui-ci réclame-t-il parfois d’avoir découvert la vérité ? En effet, le schizophrène oscille entre la reconnaissance d’une distinction de ses propos avec la réalité objective et la volonté de se voir reconnaitre comme porteur du vrai. Pour Sass, cela ne corrobore pas le modèle psychanalytique d’épreuve de réalité déficitaire, car c’est la structure même du solipsisme que de s’auto-réfuter, et par là de la position schizophrène. Sass passe ici à un argument logico-linguistique pour expliquer la contradiction après l’argument ontologique du premier chapitre.
Le paradoxe de la situation de Schreber c’est sa révélation : prêtant attention à son expérience, ses capacités représentationnelles le saisissent, d’où la déduction d’être le centre constituant de l’expérience. Pour autant, dire que le monde est ma représentation, c’est absurde, car si la représentation est représentation et non monde objectif, il est tautologique que cette représentation soit la mienne, il ne peut en être autrement ; le dire, c’est donc présupposer qu’il y a un monde objectif et une représentation de celui-ci et non que la représentation est la réalité. Etre un solipsiste conséquent, c’est renoncer au langage, car s’il n’y a pas de corrélat objectif de ma représentation et si ma représentation ne peut être que ma représentation, alors il est absurde de vouloir affirmer comme vrai que le monde est mon monde. Le solipsiste, parce qu’il a l’expérience de son expérience, parce qu’il a découvert le pouvoir de la réflexivité et en quelque sorte s’est défait de l’attitude naturelle, prend ce regard comme une capacité constituante. « Tu interprètes cette nouvelle façon de voir comme la vision d’un nouvel objet. Tu as fait un mouvement grammatical, et tu l’interprètes comme un phénomène quasi physique que tu observerais. (Pense par exemple à la question : « les sense data sont-ils les matériaux de construction de l’univers ? » » »11 Les représentations sont-elles ce qui constituent le monde objectif, voilà une question absurde, sans sens. Situation impossible, condition du schizophrène elle-même contradictoire : il y a une conscience constituante et il y a un monde objectif, soit il y a deux réalités, soit il y a une constitution d’un monde qui ne peut être objectif mais n’est que mon monde de solipsiste. On ne peut prétendre à l’objectivité en partant du solipsisme, on ne peut parler que de soi, que de la représentation, toute prétention à l’objectivité s’annule et se réfute. Il n’y a pas de langage pour le solipsisme, il ne se dit pas. « Le solipsiste ressemble à quelqu’un qui essaierait de mesurer sa hauteur, non pas en utilisant un système de référence indépendant, mais en mettant sa propre main sur le haut de sa tête – pour emprunter à Wittgenstein une de ses nombreuses métaphores pour dire la futilité de pareilles revendications métaphysiques » 12 Le schizophrène, de la même manière, fait un mouvement grammatical quand il découvre l’hyperconcentration réflexive, l’abandon de l’attitude naturelle, c’est-à-dire la découverte de la conscience apparait comme une révélation, mais ce qui n’est qu’un rapport au réel va devenir abusivement constitution de celui-ci. Il faudra au schizophrène quasi-solipsiste un monde objectif pour pouvoir affirmer son statut de conscience divine constituante, et pourtant pour affirmer cela, il est impossible qu’il y ait ce monde objectif. Le schizophrène est alors comme le solipsiste « pris au piège dans une tentative autocontradictoire d’outrepasser cette centralité. »13 On voit là la logique propre de la folie de se dire avoir un impact sur une objectivité, dont elle remet pourtant radicalement le statut en cause.
Le deuxième paradoxe de l’expérience schizophrénique est la coexistence, parfois simultanée, de la croyance du schizophrène en sa toute-puissance et de la croyance en sa petitesse misérable. Non seulement, comment comprendre cette expérience contradictoire, mais comment comprendre cette expérience grâce au solipsisme, alors même que l’interprétation solipsiste semble impliquer de se croire centre constituant de la réalité et non un être misérable? D’autre part, le schizophrène fait coexister à sa conscience absolue une autre conscience, celle d’un Dieu ou d’un « on », ce qui contredit manifestement l’hypothèse solipsiste. Mais si le solipsiste, versus le schizophrène, se prend pour le centre de l’univers à partir du simple constat de son expérience, aussi intensément est-elle vécue, il n’est donc pas un objet de cet univers, mais un sujet constituant. Où donc connaitre ce sujet, où est-il, existe-t-il seulement ; s’il peut être intuitionné, c’est alors comme objet de l’expérience et non comme sujet constituant. « Si quelqu’un me demande de décrire ce que je vois, je décris ce qui est vu. »14 La conscience constituante s’évanouit dans sa fonction et se perdrait dans son objectivation. Elle est tout, l’absolu et en même temps elle ne peut se trouver, elle ne peut faire l’expérience de soi si elle conditionne l’expérience. Le raisonnement de Wittgenstein va même plus loin : ce que l’on expérimente, c’est le monde, ce n’est pas le sujet constituant, « nous devrions plutôt dire « il pense », comme on dirait « il pleut », et non « je pense » . » 15 Le solipsiste est donc, comme le schizophrène, à la fois tout, centre absolu, et en même temps le schizophrène peut être soit un objet que l’on rencontre dans l’expérience constituée (ce qui est impossible pour le solipsisme), soit ce dont on ne peut savoir l’existence, ce sujet constituant. Il se sent donc à la fois tout-puissant et être misérable.
Ces contradictions, les schizophrènes les relèvent souvent dans leurs dits et écrits. Par exemple, Sass rapporte le paradoxe qui tourmente Schreber : « si la création dépend en un certain sens de son regard à lui [à Schreber] (…), comment se peut-il alors que lui-même et son regard avec lui aient pu être créés ? »16 Comment expliquer ces contradictions qui semblent être le critère de l’irrationalité propre à la pensée archaïque ? Mais pour Sass, c’est précisément le contraire qui fait naître ces contradictions : c’est la conscience hyperréflexive qui achoppe sur ces paradoxes. C’est parce que l’expérience n’est pas vécue naïvement, mais distanciée que s’insinue la perte solipsiste des repères du monde commun et c’est dans cette confrontation à la vie pratique et à ses exigences qu’il y a peut-être une solution thérapeutique, non dans « un autre acte cognitif de mise à distance »17 Sass s’embarque alors dans une discussion sur la réflexivité moderne et la réception wittgensteinienne de cet ethos dans sa dimension paradoxale, reprenant sa pensée sur les analogies entre modernité et folie18, mais la repoussant à plus tard : comment comprendre la parenté entre troubles schizophréniques et troubles modernes, n’est-ce qu’une coïncidence, est-ce que c’est l’époque moderne qui oriente notre compréhension de la schizophrénie, voire est-ce qu’elle crée des troubles mentaux ? L’enjeu est double : comment définir la schizophrénie, quels sont les critères symptomatologiques (faire de certains symptômes des critères clés et permettant le diagnostic pour définir la schizophrénie, c’est déjà interpréter la maladie), mais aussi la question de savoir ce qu’est la santé mentale, si celle-ci peut être mise en danger par certaines expériences, en l’occurrence quasi intellectuelles, ou s’il faut déjà une constitution biologique ou une histoire psychologique et traumatique telle que certaines expériences peuvent déclencher une maladie mentale. Sass repousse à plus tard ce type de questionnements. 19 Mais on voit que sa lecture du vécu expérientiel du schizophrène met en lumière des symptômes pour en rejeter d’autres, il se prévient de cela dans certaines notes repoussant cette tâche à un autre type de recherche ou expliquant ne retenir que la plupart des cas (l’exemple le plus flagrant est le fait que le schizophrène n’agit généralement pas en fonction de ses croyances). Cependant, cela n’invalide pas l’intuition de Sass, parce que d’une part cela n’empêche pas la complémentarité avec des approches neurobiologiques et psychologiques, d’autre part parce que le choix de la symptomatologie sassienne est prescrit par le récit même des schizophrènes.
Les paradoxes du délire schizophrène sont donc les paradoxes nécessaires de toute attitude solipsiste, c’est-à-dire les paradoxes d’une conscience qui conclut de sa capacité réflexive à sa constitution du monde. Démêlant l’aberration logique du solipsisme, Wittgenstein n’en convient pas moins qu’il s’agit là « d’une intuition métaphysique profonde, touchant le fait d’expérimenter la centralité du soi dans sa relation au monde.» 20 Si la conception solipsiste est absurde, être une conscience, c’est nécessairement faire l’épreuve concrète de la condition réflexive. Schreber et nombre de schizophrènes s’arrêtent sur cette épreuve et elle devient une manière de vivre, scruter la naissance de l’être dans l’hyperconcentration de la contemplation passive, ne rien faire, être attentif à l’être pour qu’il ne disparaisse pas. On aimerait que Sass se demande ce que dit cette manière de vivre : car si chacun peut faire l’épreuve de la condition humaine comme condition schizophrénique, tout le monde ne s’y arrête pas, la révélation du soi et du questionnement transcendantal n’implique pas la suspension de la vie ordinaire et de l’attitude naturelle comme garde-fou. C’est précisément à cet endroit que la constitution biologique et neurobiologique, ainsi que l’histoire traumatique du patient schizophrène peuvent compléter l’analyse.
3. Comprendre l’indicible expérience du schizophrène : au-delà du pronostic de Jaspers
Un des buts de Sass est de relever le défi lancé par Jaspers, à savoir rendre intelligible l’expérience schizophrénique, montrer le sens immanent de la schizophrénie, essayer contre Jaspers de montrer qu’il n’y a rien dans l’expérience humaine du schizophrène qui ne puisse être compris. Le défi est ici d’arriver à décrire et comprendre « l’atmosphère délirante » 21 dans laquelle vit le schizophrène. Cette atmosphère singulière difficile à retranscrire est l’effet de l’attitude passive, contemplative et hyperréflexive de l’individu schizophrène.
Le premier effet est ce que l’on appelle « la concrétude fantôme ». La concentration réflexive donne vie et substance à la conscience, c’est ce qui donne ce langage si imagé, concret et matériel des schizophrènes. Les fonctions mentales et les vécus internes sont réifiés. Sass rapproche cette réification schizophrénique de la critique wittgensteinienne de la tendance philosophique à la réification, à travers l’analyse de la doctrine des sense data. La question est celle du statut ontologique, la distinction entre ce qui est objet matériel et ce qui est objet de l’esprit, et l’impossible analogie entre deux types d’être aux propriétés radicalement différentes. Il y a, comme dans l’autoréfutation du solipsisme, la critique de l’oubli que certaines expériences et certains objets sont nécessairement reliés au sujet, qu’ils n’ont d’existence qu’en tant qu’ils lui sont relatif, ils ne peuvent donc, ici, être substantialisés. Fixer son attention sur cela, c’est déformer ce qui est un médium vers l’objectivité, c’est donc nier la vie pratique et couper les phénomènes mentaux de leur efficace pour un sujet pratique. Cette critique philosophique rejoint la tendance schizophrénique à réifier le soi. Le soi devient coloré, visible, matériel, Schreber, par exemple, compare l’esprit à des rayons et à des nerfs, la bouche d’une autre patiente lui apparait comme pleine d’oiseaux (réification des sensations). Sass cite Artaud (schizophrène de génie) « Oui, l’espace rendait son plein coton mental, où nulle pensée encore n’était nette et ne restituait sa décharge d’objets. (…) toute la pensée profonde à ce moment se stratifiait, se résolvait, devenait transparente et réduite. » 22 Si les images et la matérialisation de vécus psychiques nous apparaissent obscures, on comprend déjà mieux l’intention descriptive des « objets » sur lesquels la conscience focalise, « objets » qui lui semblent être le cœur constituant. Qui n’a déjà ressenti, à l’occasion d’une observation de soi, la fameuse lumière de l’esprit quand l’idée nait, la sensation de hauteur de la conscience, la sensation d’étroitesse et d’obscurité de la concentration, etc. S’il y a une erreur quant au statut ontologique de l’objectif et du subjectif, l’expérience schizophrénique sous ce jour étrange de la concrétude fantôme, peut trouver une intelligibilité dans le mouvement d’attention de la conscience à soi.
L’inquiétante particularité est la seconde caractéristique de l’expérience schizophrénique dans son étrangeté. Tout ce qui est perçu semble changé, on ne saurait dire en quoi, mais tout est teinté d’étrangeté, de ce que Jaspers appelle une « tension surnaturelle », où « objets et événements signifient quelque chose, mais rien de défini. » 23 Emerge de l’expérience une impression de sens à décrypter, parce que le réel n’apparait pas comme à son habitude, mais comme distant ou comme un décor de théâtre ou comme seulement d’une qualité différente de l’accoutumée. Cela s’explique aussi par l’attitude du schizophrène qui contemple avec fixité le réel et projette cette intentionnalité sur son expérience. Cette coloration de l’expérience soutient la vision quasi-solipsiste du schizophrène ou encore l’impression d’une intervention surnaturelle dans le cours naturel du monde. « Et ainsi, par un paradoxe étrange du réflexif, on ne prête aucune attention aux effets de sa propre hyper-attention – au fait que le processus même de l’observation concentrée, désengagée de la pratique, instille cette touche curieuse d’ineffable détermination, suscitant un sentiment de redoublement qui parait alors bien plus découvert qu’inventé. » 24 Cette impression de particularité muette semble indiquer une réalité spirituelle et transcendante la soutenant, et non une conscience essentialisant son expérience en la réfléchissant.
Conclusion
Sass revient sur ses choix, c’est-à-dire sur son interprétation singulière face aux modèles canoniques, comme celui de la psychanalyse qui est son modèle concurrent direct, car conceptuel, et il revient sur le caractère incomplet de son analyse. A l’horizon, se dessine une analyse transdisciplinaire de la schizophrénie, dont les choix conceptuels justifiés comme ici seraient complétés par « les questions relatives aux origines de la manière d’être de Schreber – aux difficultés que soulèvent les hypothèses biologiques, psychodynamiques, systémiques ou familiales, par exemple (…) »25 Où l’on voit que cette traduction du texte de Sass est la bienvenue, mais que manque le reste de l’œuvre de Sass, parce que les recherches en ces domaines vont très vite et qu’on aimerait voir Sass les investir, mais surtout parce qu’il faut un discours attentif à l’expérience et au sens même de la schizophrénie, discours qui mérite que tout modèle s’y confronte. Car ce qu’il y a de plus marquant dans cette œuvre, c’est la tentative, non pas de « sauver la folie » ou de critiquer les normes psychiques (il ne faut pas faire ce contre-sens), mais de prendre en charge l’expérience schizophrénique pour donner un sens et une explication immanents à la schizophrénie. Le schizophrène ne pâtit pas que d’un trouble qui l’investit malgré lui, il a une vision de l’être, c’est toute sa conscience qui est transformée, il n’a pas régressé, il ne voit plus la réalité de la même manière.
La ligne directrice du propos de Sass est donc le solipsisme, mais en fait ce que dit le solipsisme, c’est que la folie a souvent à voir avec la condition ontologique de l’être conscient. Mettre au cœur de la compréhension des pensées schizophrènes l’état d’âme de la conscience réflexive qui s’exagère son mouvement et s’y arrête obsessionnellement, insister sur l’ethos du schizophrène et le sens qu’il donne à l’objectivité et à la subjectivité, c’est s’inscrire contre une compréhension naturaliste réduisant ce sens à des états cérébraux et physiologiques et contre une interprétation dont « le facteur explicatif fondamental » est la sexualité, les désirs réalisés dans une autre réalité26. Sass insiste sur le désarroi ontologique du schizophrène, sur son désir le plus imminent que l’objectivité ne disparaisse pas et soit maintenue dans l’être par un sujet révélateur. Dans sa conclusion, il prend l’exemple du trouble de Schreber se croyant devenir femme. Là où on peut choisir d’interpréter l’événement comme un trouble sexuel, Sass oppose une interprétation en correspondance avec l’ontologie de Schreber. Reprenant ce que signifie pour Schreber le féminin et le masculin (le féminin comme passif et objet et le masculin comme actif et sujet), il le met en parallèle avec le conflit expérientiel de Schreber : suis-je un sujet constituant ou suis-je cet objet qui peut disparaitre comme tous les objets ? Schreber se voyant lui-même sous l’aspect d’une femme ne règle pas pour autant un conflit sexuel, il symbolise sa peur d’être un objet. Ce qui obsède Schreber, ce qui le fait souffrir, c’est une question ontologique, celle-ci le harcèle, « il va jusqu’à nous représenter ce penser compulsif comme une « torture mentale » ».27
- Louis A. Sass, Les paradoxes du délire. Schreber, Wittgenstein et l’esprit schizophrénique, Traduction Pierre-Henri Castel, Ithaque, Paris, 2010
- cf. manuscrit de Wittgenstein cité par Antonny Kenny, « Wittgenstein and the Nature of Philosophy », in Wittgenstein and his Times, Brian McGuinness, Blackwell, 1982, p. 13
- Louis A. Sass, Les paradoxes du délire, Wittgenstein, Schreber et l’esprit schizophrénique, Ithaque, 2010
- Recherches philosophiques, Paris, Gallimard, 2005, p. 274-289
- Mémoires d’un névropathe, Paris, Seuil, 1975
- Sass, Ibid, p.63
- Sass, Ibid, p.63
- Sass, Ibid, p.65
- Saas, Ibid, p.67
- Sass, Ibid, p.82
- Wittgenstein, Ibid, §§400-401
- Sass, Ibid, p.94
- Saas, Ibid, p.96
- Wittgenstein, Ibid, §398
- Sass, Ibid, p.109
- Sass, p.119
- Sass, Ibid, p.121
- Sass, Madness and Modernism : insanity in the light of modern art, littérature, and thought, Harvard University Press, 1992
- Sass, Ibid, p.129, note 110
- Sass, Ibid, p.117
- Jaspers, Psychopathologie générale, trad. Française : Paris, C. Tchou pour la Bibliothèque des introuvables, 2000
- Artaud, Œuvres, L’Ombilic des limbes, Paris, Gallimard, 2004, p.106
- Jaspers, Ibid, p.98
- Sass, Ibid, p.157
- Sass, Ibid, p.173
- Sass, Ibid, p.173
- Sass, Ibid, p.182







