Le 5 janvier 2009, Adolf Merkle, 74 ans, entrepreneur allemand, ancien multimilliardaire acculé à la faillite, met fin à ses jours. Il n’est pas le seul. Dans le contexte de la crise de 2008, l’événement pourrait presque passer pour un fait divers, n’émouvant que quelques aficionados de la finance mondiale. Après tout, l’accroissement des morts volontaires en temps de crise économique touche toutes les catégories de population, au premier rang desquelles les chômeurs. On aurait pourtant tort de les assimiler. Si la détresse de celui qui perd son unique source de revenus, celle qui lui permet de loger et de nourrir sa famille, peut à la limite rendre compréhensible un acte perçu par son auteur (à tort ou à raison) comme une anticipation, il est nettement plus difficile de concevoir le désespoir d’un homme dont le patrimoine comporte encore plusieurs maisons et domaines forestiers, un château sur le littoral de la Baltique et une somme à sept chiffres1. Si l’on estime que le sens de l’argent est celui d’un moyen de subsistance, dans un contexte de division du travail, en ce qu’il permet de rendre commensurables et donc échangeables les différents produits et services, comment comprendre qu’il devienne la fin même de la vie ? Comment comprendre qu’un homme subordonne son existence au principe d’infinie accumulation de la richesse, et ce à un point tel qu’il mettra fin à ses jours si le volume de sa propriété doit en venir à régresser ? Comment comprendre, surtout, que cette tendance, assimilée par les philosophes païens antiques (en particulier Aristote, dans sa condamnation de la chrématistique marchande2) comme par les Pères de l’Église à une perversion et à une faute (interdit général de l’usure, pour tous les chrétiens), soit devenue le moteur des sociétés industrielles, le modèle éthique d’une vie réussie ? En somme, comment l’esprit d’accumulation, c’est-à-dire l’esprit capitaliste, est-il possible et a-t-il pu devenir dominant ?
C’est ce problème que cherche à résoudre Max Scheler dans ses Trois Essais sur l’esprit du capitalisme, rédigés au printemps 1914 (à l’aube de la Première Guerre mondiale), dont Patrick Lang propose la première traduction en français. L’importante préface qui l’accompagne s’ouvre sur le « fait divers » du décès d’Adolf Merkle (que P. Lang reprend au politologue Fritz Reheis3), ce qui, à notre sens, présente deux intérêts principaux : (1) accomplir le propre du travail philosophique, en prenant à rebours le phénomène quotidien, l’apparemment « bien-connu », afin d’en débusquer le caractère foncièrement problématique ; (2) manifester d’emblée que les analyses de Scheler, bien loin de se trouver confinées dans une discussion d’époque (le début du XXe siècle, période de transition entre la première extension internationale du capitalisme4 et sa remise en cause, sous l’effet couplé des affrontements entre grandes puissances et de la montée au pouvoir de groupes qui contesteront ou relativiseront son hégémonie), ont un fort potentiel explicatif pour les événements qui nous sont les plus contemporains. L’ouvrage se veut, nous semble-t-il, moins une addition savante à l’histoire de la sociologie et de la philosophie politique moderne, qu’une contribution à la discussion critique actuelle tant sur les origines et la nature du système capitaliste que sur son devenir possible. C’est peut-être, d’ailleurs, tout particulièrement en ce début de XXIe siècle, alors que les événements du siècle précédent ont en partie manifesté la stérilité de « l’alternative piégée » entre marxisme soviétique et capitalisme, qu’il redevient urgent de lire celui qui la pronostiquait, tout en dessinant les linéaments d’une tierce voie.
Aux origines du capitalisme : l’esprit bourgeois contre le mode de production
D’où provient l’esprit du capitaliste, celui dont le principe directeur est l’accumulation infinie des biens et des services ? L’explication de Karl Marx est bien connue : cet esprit n’est qu’une conséquence (une « superstructure ») de l’évolution des moyens de production et de possession qui lui correspondent (l’« infrastructure »), ceux de la grande industrie, qui remplace progressivement l’artisanat et les manufactures. Dans une corrélation notable (qui aura son importance) avec le positivisme de cette première moitié du XIXe siècle, Marx impose dans l’étude du devenir historique, contre les hégéliens, la primauté explicative de la matière sur l’esprit (il remet la dialectique « sur ses pieds5 »), et substitue au « socialisme utopique » un « socialisme scientifique ». Or, de même que la mécanique newtonienne dans les sciences physiques se heurte à des phénomènes qui ne se ramènent pas à ses lois (l’électricité et le magnétisme), le « matérialisme historique » semble difficile à concilier avec les observations correspondant à l’émergence d’une morale d’acquisition : pour reprendre l’exemple de Max Weber, cité par Scheler, Benjamin Franklin, le fameux promoteur du « time is money6 », « était empli d’esprit capitaliste à une époque où son atelier de typographie, quant à sa forme, ne se distinguait en rien d’une quelconque entreprise artisanale7 ».
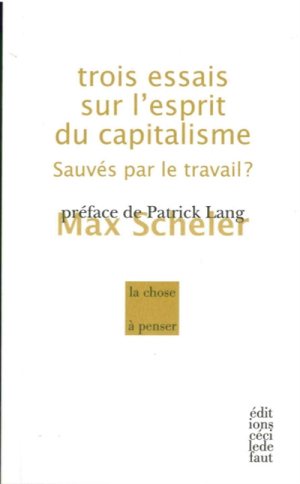
Ne faut-il pas, dès lors, s’affranchir des mécaniques marxiennes pour redonner la première place théorique à l’esprit capitaliste ? C’est ce à quoi s’ingénient, au tout début du XXe siècle, les trois auteurs avec lesquels Scheler entre en dialogue : Max Weber, Ernst Trœltsch et, au premier chef, Werner Sombart. Si les premiers font remonter l’esprit capitaliste à la Réforme protestante (XVIe s.)8, Sombart porte de plus sérieux coups de boutoir à la dialectique historique de Marx en faisant remonter les racines de la pulsion d’acquisition plus loin encore : dans la quête d’une vie luxueuse, réveillée chez les Occidentaux aux environs du XIIIe siècle, à la suite du contact, par les croisades, avec les mondes arabe et byzantin ; dans le développement, au XVe siècle, par les franciscains des techniques de compatibilité9 ; dans l’expansion, à la même époque, de la diaspora juive (qui pratique l’usure)10, puis calviniste ; dans le développement de l’organisation militaire, réclamé par les nécessités guerrières, depuis les croisades jusqu’aux campagnes napoléoniennes11 ; ou encore, dans la transformation, postérieure aux croisades, de la relation entre les sexes12.
Cet entremêlement de scénarios hétérogènes, s’il récuse efficacement la lecture marxienne, ne diminue-t-il pas cependant la valeur épistémique des analyses ? Les critiques de Sombart, au premier rang desquels l’on trouve Lujo Brentano, joueront allègrement de ce fouillis explicatif, en remontant plus loin encore que la période médiévale, pour identifier des formes de la pulsion d’acquisition dans l’antiquité phénicienne, grecque et romaine13 – après tout, comme nous l’avons vu, Aristote ne fustigeait-il pas déjà la tendance à chercher l’enrichissement pour lui-même ? Ne faut-il pas dès lors remettre en cause l’idée même d’une émergence historique de l’esprit capitaliste ? Celui-ci n’est-il pas présent de tout temps chez l’être humain, comme tendance à l’avidité qui pourra plus ou moins se déployer selon que les contingences historiques lui en donneront ou non l’occasion ? On retrouverait l’idée déjà énoncée par Glaucon dans le livre II de la République – celle qu’incarne le berger Gygès, en possession de l’anneau d’invisibilité : tout homme à qui l’on en donne la possibilité retourne à sa convoitise naturelle –, et qui sera maintes fois reprise par les défenseurs du libéralisme économique (en particulier par les économistes néoclassiques, pour contester l’existence d’une alternative politique14). C’est l’enjeu principal du premier des Trois Essais : Max Scheler veut s’introduire dans la brèche ouverte par Sombart dans la conception matérialiste de l’histoire, mais sans tomber dans le travers naturaliste de « bon nombre de nos historiens les plus compétents15 ». Contre ces derniers, il faut récuser avec fermeté l’idée d’une éternité de l’esprit capitaliste. Si celui-ci se définit par une tendance à l’acquisition sans fin, doit s’y opposer un esprit précapitaliste de « sustentation conforme au statut », selon l’expression scolastique16. Or, si l’on peut trouver à toute époque des marques d’avidité chez certains individus, l’essentiel pour rendre compréhensible l’émergence du capitalisme est de déterminer le point de bascule qui a rendu cette tendance majoritaire et légitime. En effet, explique Scheler :
Assurément il y a eu aussi à l’époque précapitaliste des individus et même des groupes entiers dont le désir d’acquisition dépassait l’idée de la sustentations conforme au statut. Mais l’essentiel, c’est qu’en général on ressentait cela non pas comme normal et « légitime », mais comme un phénomène anormal, et que les personnes concernées elles-mêmes ne considéraient pas l’acquisition illimitée comme un « devoir sacré », mais ne se livraient à cette pulsion qu’avec « mauvaise conscience ».17
Si la soif d’acquisition a pu exister dans l’antiquité et la période médiévale, son illégitimité morale comme politique la condamnait à ne pouvoir se pratiquer qu’à la marge de la vie économique normale, par des voies irrégulières (projets fantaisistes, recherche d’or, opérations alchimiques, razzias, exploitations des superstitions, etc.)18. On doit donc bien pouvoir trouver une origine identifiable de l’esprit capitaliste. Scheler, pour débrouiller l’effusion narrative de Sombart, propose de distinguer l’origine des vecteurs privilégiés de développement (qui la présupposent). Le point central de son analyse est le suivant : les diverses manifestations thématisées par Sombart, Weber et Trœltsch ne font sens qu’à l’intérieur d’un renversement général du rapport au monde, où les principes aristotéliciens de contemplation d’une nature organique se voient substitués ceux de technicisation d’un univers inerte, essentiellement régi par le mécanisme. Le luxe des pays d’Orient n’est une tentation que pour ceux qui aspirent déjà à l’accumulation ; les techniques de comptabilité ne servent qu’à ceux qui sont déjà dans un rapport comptable à leur monde ; l’usure n’étant permise chez les juifs que vis-à-vis des non-juifs (les non-élus), elle ne pouvait avoir pour conséquence sa valorisation (et donc sa généralisation) ; quant à l’idée protestante de vérification de l’élection par la grâce dans les affaires – qui permit l’essor décisif de l’héroïsme entrepreneurial –, elle suppose que ces dernières aient déjà perdu leur caractère suspect.
Où peut alors se situer le premier moteur ? Scheler s’appuie sur le dernier ouvrage de Sombart (qui cherchait déjà, dans son dialogue avec Weber, à coordonner ses flux explicatifs19) : il s’agit de l’éthos20 d’une classe encore subordonnée dans la période médiévale mais s’imposant progressivement dans les interstices urbains du pouvoir seigneurial – la bourgeoisie. Sa dominante psychologique – selon un concept que Scheler reprend à Nietzsche – est celle du ressentiment. Classe intermédiaire, elle est en effet à la fois obsédée par la peur d’être ravalée aux rangs inférieurs de la société féodale, dont elle ne se distingue que par de plus grandes possessions, et par la détestation de la domination nobiliaire qui limite son ascension. S’ensuit une détermination réactive au type aristocratique des valeurs de la bourgeoisie : contre le courage et l’amour du risque, l’esprit bourgeois cultive la crainte méfiante, la recherche de sécurité et de garanties, contre la prodigalité et la magnanimité, l’économie et le calcul des intérêts, contre la confiance dans un monde bien agencé, la défiance vis-à-vis d’une nature essentiellement hostile, qu’il faut déterminer par la science et maîtriser par la technique21. Si cette origine en est bien une, c’est qu’elle ne présuppose rien d’autre que l’existence du modèle qu’elle renverse.
Comment, toutefois, ce système axiologique fondamentalement subordonné et réactif a-t-il pu devenir dominant et donc absolu, dans le capitalisme ? C’est ce que Scheler reproche à Sombart d’avoir rendu incompréhensible22, en traçant une frontière étanche entre esprit bourgeois et esprit aristocratique. Il faut au contraire affirmer que, seul, l’éthos bourgeois est stérile. C’est grâce aux vecteurs précédemment mentionnés – et, tout particulièrement, la religiosité – que les « maximes d’épicier » pourront toucher les âmes les plus fortes, les détournant des tâches supra-individuelles (service de l’État, guerre, art, etc.) pour qu’elles consacrent leur énergie à la vie économique23. Alors seulement devient possible le capitalisme conquérant, porté par le héros-entrepreneur, et la transformation profonde qui s’ensuit des moyens de production et de possession.
La fin du capitalisme : deus ex machina ?
Pas d’analyse critique du système sans mise au jour d’une porte de sortie. Si la cause du capitalisme ne réside pas dans les moyens de production, il est vain d’attendre d’une transformation des conditions des travailleurs et du partage de la richesse, née du volontarisme politique ou du combat syndical, qu’elle y mette un terme. L’esprit d’infinie acquisition n’étant pas le produit (comme superstructure), mais la cause du mode de production, on ne saurait attendre que la réforme de celui-ci affecte mécaniquement celui-là. L’accroissement du prolétariat, né de la tendance (analysée par Marx) à la concentration progressive des capitaux entre les mains d’un plus petit nombre de propriétaires, ne conduira pas à la fin du capitalisme tant que la classe ouvrière ne sera liée que par un commun intérêt de possession24. Il faut au contraire s’attendre à ce que les renversements politiques correspondant aux soulèvements prolétaires, motivés par une simple itération du ressentiment bourgeois, conduisent à la formation progressive d’une nouvelle minorité privilégiée, c’est-à-dire d’une nouvelle bourgeoisie. C’est, nous semble-t-il, une des grandes forces des travaux de Scheler : une vision programmatique de l’impasse des révolutions d’inspiration marxiste, qui se résoudront dans la domination de l’intérêt d’un seul (dictateur) ou d’un groupe de possédants (nomenklatura). La mise au cœur du mouvement historique de l’esprit a par ailleurs le mérite d’éviter le paradoxe traditionnel de la dialectique marxiste orthodoxe : si l’histoire obéit à un mouvement nécessaire et matériel, dont les mentalités ne sont que l’épiphénomène, comment les travaux de l’esprit que sont les écrits communistes et leur travail de propagation peuvent-ils bien prétendre à une quelconque efficace ?
Quel esprit pourra se substituer à celui du bourgeois ? C’est ici, nous semble-t-il, que les difficultés s’accumulent, et que le propos de Scheler devient plus confus – voire tendancieux. Deux raisons possibles, explique-t-il, peuvent expliquer le déclin du capitalisme : (1) l’esprit bourgeois porterait en lui-même le germe de son extinction ; (2) la domination de l’éthos bourgeois serait bientôt relayée par celui d’un type d’homme différent25.
(1) Pour ce qui concerne le premier point, force est de constater que les deux arguments proposés par Scheler sont pour le moins étonnants. On peut, avance-t-il, augurer que le type calculateur du bourgeois l’amenant, logiquement, à moins se reproduire (la nombreuse progéniture divise le capital familial), la disposition à l’esprit capitaliste se transmettra de moins en moins dans la population, et donc disparaîtra progressivement dans les sociétés26. Difficile de savoir exactement de quel type de transmission parle Scheler : ou bien on suppose (en forçant quelque peu le texte) qu’il s’agit de l’éducation – auquel cas il fait une impasse étonnante sur le rôle de la scolarité, et néglige la tendance, pourtant analysée par lui, des classes subordonnées à intégrer bien vite les données du calcul dès lors qu’elles peuvent par là s’élever contre les autres –, ou bien c’est d’une sorte d’hérédité biologique (il n’a de cesse d’employer les termes de « caractères », de « propriétés » ou de « prédispositions héréditaires », de « type vital ») qu’il s’agit – et c’est alors que semble surgir un arrière-fond bien peu scientifique et plus que gênant pour le lecteur actuel. Scheler admettait déjà, dans le premier des Essais, que l’idée de Sombart d’une explication des types « biopsychiques » du bourgeois et de l’aristocrate par le « mélange des sangs » plutôt que par l’éducation, le milieu et l’adaptation, était tout à fait indémontrée – mais il lui donnait tout de même son « assentiment de principe27 ». Si l’on ajoute à cela que Scheler nourrit son espoir d’un « épuisement du géant28 » capitaliste dans le fait, dit-il, que les nouvelles générations délaissent progressivement l’opposition socio-économique riche-pauvre, pour se tourner « vers les questions qui concernent la vitalité, la santé du peuple et de la race, au point de vue physique et psychique », on obtient un ensemble douteux qui ne s’engage jamais résolument dans l’eugénisme et le racialisme, mais donne l’impression d’en suivre l’ornière. Patrick Lang consacre plusieurs paragraphes de sa préface à cette « dérive dans le biologisme racialiste29 », dont il montre que si elle procède d’une reprise inopportune du vocabulaire de Nietzsche et de Sombart, elle ne doit pas occulter le fait que l’essentiel de la doctrine de Scheler concerne la détermination culturelle des différents types d’hommes – et, en particulier, leur relation avec la religion.
Le second argument laisse entendre que, du fait de l’accroissement de ses richesses, en parfaite disproportion avec sa capacité de pouvoir en jouir ou en faire jouir sa famille (aussi large soit-elle), le bourgeois en viendra progressivement à une impression générale de satiété, de dégoût puis de honte devant ce « gâteau vraiment trop gros30 ». On peut à nouveau éprouver quelques doutes sur la solidité du pronostic – et ce d’autant plus que cet argument présente de fortes similitudes avec celui de Sombart, dans Le Bourgeois, que Scheler dans son commentaire jugeait « un peu trop disproportionné par rapport aux forces [du capitalisme] qui ont produit sa croissance et sa santé florissante : c’est comme si l’on attendait d’un moustique sur le nez d’un géant la mort de ce dernier!31 ».
(2) Quant au type d’homme différent qui doit s’imposer, la perspective est loin d’être nette. Tout se passe comme si la rigueur avec laquelle Scheler débusque l’esprit bourgeois partout où il se dissimule – dans les valeurs entrepreneuriales, évidemment, mais aussi dans la science moderne et sa mathématisation systématique, dans les morales déontologiste et conséquentialiste, dans la fondation contractualiste des sociétés et des États, etc. – laissait finalement peu de place à un en-dehors suffisamment conséquent pour pouvoir servir de contrepoids, et affermir l’espoir de jours nouveaux. Il semble que le « nouveau type humain32 » dont il est question trouve davantage son modèle dans la nostalgie du passé que dans l’avenir. Le deuxième des Trois Essais est entièrement consacré à sauver le catholicisme contre l’interprétation sombartienne, qui voit déjà dans les écrits thomistes l’exposition des valeurs de la bourgeoisie. S’appuyant sur Weber et Trœltsch, Scheler s’applique à disculper l’Église romaine : si elle n’en forme pas l’origine, la Réforme est, dans l’histoire religieuse, l’un des vecteurs les plus puissants d’expansion de la morale d’acquisition33. Quoi de plus adéquat que le protestantisme, animé vis-à-vis du catholicisme d’un double ressentiment (à l’égard de l’idéal catholique de « sainteté » comme à l’égard de la quiétude et béatitude obtenue au sein de l’Église dans la prière34), laisse entendre Scheler, pour servir de véhicule privilégié à l’éthos bourgeois ? Sans entrer dans cette discussion, bornons-nous à remarquer que, quand bien même l’interprétation schélérienne prévaudrait, fonder l’espoir d’une défection du capitalisme sur un regain de religiosité, quelle qu’elle soit, est assez hasardeux : si c’est tout particulièrement la croyance religieuse qui a rendu possible l’abandon d’Aristote au profit du capitalisme, on voit mal en quoi elle peut être une solution décisive. Pour que l’espoir soit raisonnable, il faut qu’il y ait du neuf dans ce type humain à venir, il faut qu’il se distingue qualitativement de celui qui s’est vu historiquement débordé par l’esprit comptable. Or cette « nouveauté » reste ici assez floue. Elle s’assimile pour l’essentiel à des lignes de fuite, tracées en suivant l’enthousiasme surprenant de Scheler vis-à-vis des nouvelles générations :
Dans la conception du monde en devenir qui est celle de la jeunesse, les phénomènes de fatigue spirituelle que sont le scepticisme, le relativisme, l’historisme, le fouissement dans le moi personnel, ont également cédé du terrain au profit d’un progrès puissant en direction d’un contact vécu immédiat aux choses elles-mêmes, d’une évidence absolue, qui affermit la force d’action et le caractère, d’un abandon expansif au monde. Ces métamorphoses inspirent l’espoir, précisément parce qu’elles ne sont pas bornées à des classes sociales ou à des partis politiques déterminés, mais imprègnent toutes les classes de leur nouvel esprit.35
Ici également, le lecteur d’aujourd’hui ne peut, au mieux (si, par lecture charitable, il sait faire abstraction du vocabulaire malheureux précédemment évoqué), que constater que la transformation annoncée est loin d’avoir résolument abouti. Et si l’on considère qu’en ce qui concerne le dépassement du capitalisme, Scheler explique qu’« il est clair qu’on ne peut attendre quelque chose d’essentiel que de ce genre de métamorphose – et non de la victoire de telle « classe » ou de tel « parti » déterminés36 » –, on en vient à penser que l’annonce prophétique de cette fin des temps capitalistes ne repose, en définitive, que sur un acte de foi.
Conclusion sur la publication
Il faut saluer le travail d’édition de Patrick Lang. La traduction proposée est d’une grande rigueur, sans qu’y soient sacrifiés la lisibilité et le style. La longue préface (presque cent vingt pages, quand les trois essais tiennent ensemble sur un peu plus de cent pages) présente l’intérêt d’éviter la surcharge de l’appareil de notes, en limitant celles-ci aux éclaircissements de contexte. Abordable pour le non-spécialiste, elle rend intelligibles les enjeux des discussions entre Scheler et ses principaux interlocuteurs, comme la construction générale de son argumentaire, au-delà des trois essais publiés. En ce qui concerne Max Scheler lui-même, les quelques réserves que nous avons évoquées ne doivent pas diminuer l’importance de sa contribution à l’explication des origines et de la mécanique du capitalisme, mais aussi des différentes formes d’organisation humaine, de la hiérarchie des valeurs, de la transformation du travail ou de la modernité scientifique37, qui renforcent l’urgence d’une édition scientifique en langue française des œuvres complètes de Scheler.
- Max SCHELER, Trois Essais sur l’esprit du capitalisme, Nantes, Éditions Nouvelles Cécile Defaut, 2016, Traduction et Préface de Patrick LANG : « Sauvés par le travail ? Max Scheler et la critique de la déraison économique », p. 9
- Aristote, La Politique, I, 3, 1256a-1258b
- Fritz Reheis, Wo Marx Recht hat (2011)
- Les économistes et historiens s’accordent pour parler d’une première mondialisation à partir de 1860 (liée, entre autres, à la libéralisation du Second Empire en France, entraînant la multiplication des accords de libre-échange avec le Royaume-Uni, la Belgique, l’Autriche ou l’Italie garibaldienne, à la Guerre de Sécession aux États-Unis qui amène le Nord à importer massivement pour soutenir l’effort de guerre puis reconstruire le pays et au début de l’ère Meiji au Japon, favorable à un industrialisation rapide du pays), qui se termine en 1914.
- Karl Marx, Le Capital, livre I, Postface de la seconde édition allemande : « […] Hegel défigure la dialectique par le mysticisme […]. Chez lui, elle marche sur la tête ; il suffit de la remettre sur les pieds pour lui trouver la physionomie tout à fait raisonnable. »
- Benjamin Franklin, Advice to a Young Tradesman, 1748
- Max Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1905), trad. Grossein, p. 45. Cité par Scheler dans « Le Bourgeois », p. 146 de la présente édition.
- Cf. Max Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1905) et Ernst Trœltsch, Protestantisme et modernité (1906)
- Werner Sombart, Le Capitalisme moderne (1902)
- Werner Sombart, Les Juifs et la vie économique (1911)
- Werner Sombart, Guerre et capitalisme (1913)
- Werner Sombart, Luxe et capitalisme (1913) : la redécouverte de la sensualité cadrant difficilement avec le caractère sacré du mariage, la généralisation de l’adultère aurait conduit à la multiplication des maîtresses et des courtisanes, dont l’entretien aurait conduit à l’explosion de la demande en biens de luxe.
- Lujo Brentano, Les Débuts du capitalisme moderne (1913).
- On pensera évidemment à Milton Friedman (1912-2006), dont l’assertion dans une interview donnée en 1979 est presque devenue un slogan : « Is there some society you know that doesn’t run on greed ? […] So that the record of history is absolutely crystal clear that there is no alternative way, so far discovered, of improving the lot of the ordinary people that can hold a candle to the productive activities that are unleashed by a free enterprise system ».
- Max Scheler, Trois Essais sur l’esprit du capitalisme, « Le Bourgeois », p. 144
- On lira là-dessus avec intérêt la note 17 (pp. 250-251 de la présente édition).
- Max Scheler, Trois Essais sur l’esprit du capitalisme, « Le Bourgeois », p. 150
- Ibid., p. 152
- Cf. Werner Sombart, Le Bourgeois. Contribution à l’histoire morale et intellectuelle de l’homme économique moderne (1913)
- C’est-à-dire, selon la définition qu’en propose Patrick Lang dans sa préface, p. 67 : « l’ensemble des règles de préférence au moyen desquelles [certaines] valeurs deviennent le fondement de l’expérience et de l’action humaine ».
- Cf. Ibid., p. 165-166. Scheler rapproche également l’opposition des deux types humains de celle entre « l’homme ouvert » et « l’homme clos », inspirée par Henri Bergson (mais pas rigoureusement présente) dans son Évolution créatrice (1907).
- C’est l’apport décisif de Scheler sur Sombart, qui permet une synthèse explicative laissée encore ouverte après Le Bourgeois.
- Max Scheler, Trois Essais sur l’esprit du capitalisme, « Le Bourgeois », pp. 169-170
- Op. cit., « L’avenir du capitalisme », pp. 218-219
- Ibid., p. 217
- Ibid., pp. 230-231
- Op. cit., « Le bourgeois », p. 164
- Op. cit.,« L’avenir du capitalisme », p. 234
- Op. cit., « Préface », pp. 76 sqq.
- Op. cit., « L’avenir du capitalisme », p. 235
- Op. cit., « Le bourgeois », p. 144
- Op. cit., « L’avenir du capitalisme », p. 235
- Op. cit., « Le bourgeois et les puissances religieuses », p. 210 : « Ce n’est pas le protestantisme – pas même le calvinisme – qui a « engendré » l’esprit bourgeois, mais c’est l’esprit bourgeois qui, dans le calvinisme, a brisé au sein même de la sphère religieuse ecclésiale, les bornes que lui avaient imposées l’Église catholique et aussi Thomas d’Aquin. »
- Ibid., p. 213
- Op. cit., « L’avenir du capitalisme », p. 237
- Ibid.
- Toutes ces thématiques des œuvres de Scheler sont présentées par Patrick Lang dans la préface. Nous avons choisi, dans le cadre de cette recension, de nous concentrer sur l’analyse des principaux arguments développés dans les trois essais.







