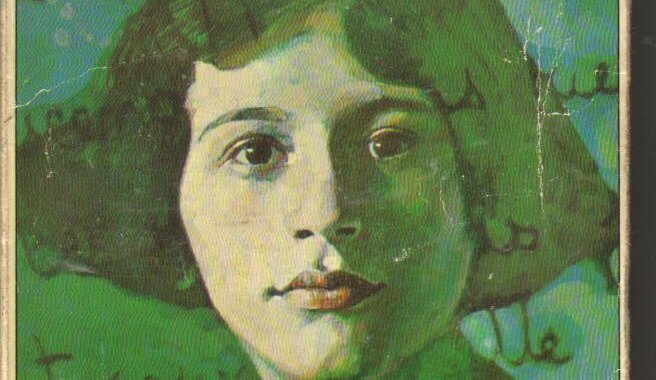Introduction et contexte
Le contexte dans lequel s’inscrit ce cinquième volume des œuvres complètes de Simone Weil[1] édité sous la direction de Robert Chenavier est celui de 1942, date où la France est alors occupée par l’Allemagne nazie et partagée par la « zone libre » administrée par Vichy. Simone Weil quitte Marseille en mai avant la prise de contrôle complète du territoire lors du mois de novembre 1942 décidée par Hitler à la suite de « l’opération Torch ». D’après les lettres indiquées par les différentes présentations des articles, on apprend que Weil n’avait dans un premier temps quitté Marseille pour le Maroc puis New York que pour rejoindre, dans un second temps, les filières de la « France libre » de la Résistance à Londres. Mais une fois aux États-Unis, Weil se trouve bloquée pour de longs mois et sombre dans une dépression qui l’empêche de travailler, « éprouvant le sentiment d’être un déserteur » (p. 21).
Depuis le début de la guerre, elle ne parvient pas à faire aboutir son « Projet d’une formation d’infirmières de première ligne », et sa rencontre à NYC avec Maritain, pour qui elle n’avait aucune estime, ne fait qu’accentuer sa léthargie. Ce n’est que vers la fin de l’été 1942 que Weil se remet passionnément au travail : le présent ouvrage s’ouvre ainsi sur un article en anglais expliquant la conjoncture en France et le faible écho du gaullisme. Parallèlement, elle poursuit une abondante correspondance sur le catholicisme et le judaïsme avec Thibon, le père Couturier et le père Perrin : c’est au deuxième que s’adresse la célèbre « Lettre à un religieux » présente dans ce volume qu’elle confiera à ses parents avant de quitter l’Amérique. En septembre 42, par l’entremise et l’assistance de Maurice Schumann, Simone Weil reprend espoir : ses contacts s’activent pour la faire venir à Londres ; elle embarquera en Novembre et restera en quarantaine à Liverpool. Une fois à Londres, elle se met à composer une série de textes qui formeront le fameux essai titré par Camus L’enracinement.
En janvier 1943, Weil loge à la caserne des volontaires français, et n’a de cesse d’implorer les autorités de l’envoyer en France pour effectuer diverses opérations de résistance ; elle rencontrera notamment Jean Cavaillès. Mais selon la présentation générale, on lui refusera toutes ses demandes en la renvoyant aux caractères d’une condition ou divers statuts qu’elle n’a pas choisis : ou bien celui de femme, ou bien de juive, ou bien d’intellectuelle, lui refusant ainsi, au sens de Simone Weil, « de prendre sa part de malheur » et de réaliser sa « vocation ». En mars-avril 1943, Simone Weil contracte la tuberculose, mais elle n’en dit rien, tout en complétant son « Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain » ; elle continue ses recherches sur la religion – elle se met en autre chose à travailler le sanskrit. Weil se brouille avec ses amis, ceux-ci ne pouvant accéder à ses demandes, rompt avec eux en juillet avant d’être transportée en août 1943 dans un sanatorium du Kent pour y mourir le 24 août ; elle sera enterrée à Ashford.
- Éléments de l’ouvrage et enjeux de ces articles
Ce premier volume du cinquième tome est consacré aux questions politiques et religieuses. Il est divisé en deux parties, toutes très largement et précisément présentées ; la première avec les écrits de New York, comportant deux articles en anglais, traduits, et traitant de la situation politique de Vichy et de l’empire colonial français, et deux textes sur le judaïsme avec la « lettre à un religieux ». Dans la deuxième partie, les écrits de Londres s’ouvrent sur « La personne et le sacré », puis « Réflexions sur la guerre », « Le problème des colonies », « Marx et le marxisme » et deux textes sur la religion. La dernière sous partie contient un certain nombre de textes consacrés à des questions techniques sur l’organisation politique du civile et du militaire, avec divers éléments pour une constitution ; un texte inédit, « Bases d’un statut des minorités françaises non chrétiennes et d’origine étrangère » est largement présenté, étant donné le caractère polémique qu’il contient aujourd’hui. Selon la présentation, la majeure partie de ces textes peuvent être lus dans la perspective d’un vaste travail de préparation de ce qui deviendra L’enracinement, mais cependant, ils valent pour eux-mêmes, comme cette hygiène, cette lutte constante de Weil contre « les fausses imitations » (p. 232) qui, à même ce qui est pur au point de n’avoir « pas de langage », tente de laisser jaillir au cœur de ce mutisme innocent, « la voix qui appelle » (ibid.) par la beauté, la justice et la vérité.
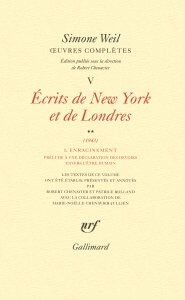
Ne pouvant se battre en France, Simone Weil en fut donc réduite à se débattre à New York et Londres, et les textes présents sont tous traversés par ce dilemme d’un engagement dont les modes d’actions lui sont refusés ou imposés : cette tension est aussi bien politique que religieuse, l’un et l’autre s’identifiant dans la quête du « bien supérieur » (p. 56), lequel « descend du ciel quand certaines conditions sont en fait réalisées sur terre » (ibid.). Le problème, c’est que la condition politique préparant l’articulation au bien surnaturel, n’est pas pour autant conditionnée en retour par celui-ci ; le politique ne peut également conditionner ce bien sans le corrompre, c’est-à-dire, pour Weil, le souiller de « puissance ». Ainsi, Weil oscille entre une solitude religieuse qui refuse toute institution sacramentelle, tout en l’interrogeant sans cesse en en scrutant les faits et gestes par ses lectures des textes sacrés, et de la même façon, elle hurle son engagement politique en attente du bien surnaturel, mais dont la préparation sociale conditionnée est par nature étrangère à ce bien qu’elle appelle.
Dans sa présentation, Robert Chevalier termine son texte par une citation de Weil qui révèle toute la tension de son œuvre :
« J’éprouve un déchirement qui s’aggrave sans cesse, à la fois dans l’intelligence et au centre du cœur, par l’incapacité où je suis de penser ensemble dans la vérité le malheur des hommes, la perfection de Dieu et le lien entre les deux. J’ai la certitude intérieure que cette vérité, si elle m’est jamais accordée, me le sera seulement au moment où je serai moi-même physiquement dans le malheur, et dans une des formes extrêmes du malheur présent » (E.L, p 213, p. 52).
Nous pouvons lire ici les différents prismes par lesquels les jugements de valeur de Weil passeront pour déterminer, ou plutôt trier, le bon grain de l’ivraie : ce qui donne un étrange mélange où le ton péremptoire cherche la nécessité pure en la distinguant du Juste, tout en plaignant sa condition imparfaite qui se révèle être, en même temps, la seule clé du miracle attendu.
- Le mal et le déracinement
Le premier texte proposé par l’ouvrage est donc transi par ces dilemmes et ces scrupules ; c’est un projet d’article sur la situation en France en 1942 peu avant l’invasion complète dont Weil résume ainsi l’état d’esprit : « Chaque Français, quel que soit son courage personnel, est déchiré entre le désir d’être libre et celui que le pays ne soit pas détruit par ce combat pour la liberté » (p. 91) et elle conclut ainsi le problème : « Quand une population s’effondre et se trouve absolument privée de chef, une aide morale extérieure peut parfois être utile : mais l’orgueil national français la rendrait difficile » (ibid.). Et nous avons là aussi l’exacte attitude en face des questions religieuses, l’exact style adopté par Weil lorsqu’il est question de la religion comme Église, ou comme voie vers la Grâce : là encore, Weil propose – s’impose – l’abandon moral et « l’anéantissement » – de fait, il fut réel si on lit les écrits de Weil concernant la condition ouvrière – tout en refusant (peut-être avec orgueil diront certains) une aide quelconque : seul l’appel, l’attention vide et sans objet compte, le pur « cri » (p. 232) qui doit résister à toute corruption illusoire relative (toute en maintenant qu’elle manifeste la vérité de la condition humaine), et doit pouvoir appeler la grâce sans puissance (c’est ce que Weil nomme le « miracle »).
Aussi voit-on dans la « Lettre à un religieux » ces contorsions permanentes, ce scrupule paradoxal d’une sorte de socratisme inversé, où le non-savoir est joué pour ignorer son savoir, tout en prétendant seulement l’appeler. Nous essayerons d’en dégager plus loin la cohérence, mais dans cette lettre, en résulte une vaste litanie de crispations sur un essaim de sujets posés pêle-mêle, égalisés, avec une absence d’humour qui en devient comique dans l’accumulation anarchique des points et des questions de nature différentes. Évidemment, de précieuses distinctions naissent dans ces interrogations, notamment sur « l’adhésion de l’intelligence » (p. 184 sq) aux mystères, qui n’a rien à voir avec « l’obéissance » qui, elle, au lieu de produire « l’attention », dérive et se dégrade en « suggestion » (p. 185). Le problème c’est que ces éléments dérivent de points de vue dont nous saisissons difficilement le sens philosophiquement parlant, même si, pour un Gnostique, ces mots résonnent avec force :
« L’idée d’une quête de l’homme par Dieu est d’une splendeur et d’une profondeur insondables. Il y a décadence quand elle est remplacée par l’idée d’une quête de Dieu par l’homme » (p. 190).
Mais c’est à partir de la révélation ou de la tension de ce point que Weil peut alors juger intellectuellement des doctrines. Ainsi, selon Weil, les hébreux n’ont pu thématiser (voir même produire) un seul acte de charité pure dans la mesure où, contrairement au bien – connu des grecs ou du christianisme originel – les hébreux ne pouvaient concevoir (hormis quelques exceptions comme Job ou Tobie dans l’Ancien Testament) « la possibilité du malheur des innocents » (p. 186). La conséquence est que, selon Weil, ils ont fondé une religion de puissance ordonnée par un Dieu des armés, répandant ainsi le « déracinement » parmi les peuplades, de la même manière que l’Empire romain.
Nous n’allons pas ici reprendre tout l’article d’Emmanuel Lévinas, « Simone Weil contre la bible », dans Difficile liberté, lequel est d’ailleurs critiquable lui aussi par bien des aspects, notamment lorsqu’il parle de « dialectique », mais il nous semble tout de même un peu difficile de suivre Weil qui, dans son autre article « Israël contre les Gentils », réduit « toutes les singularités de l’Ancien Testament » à un passage de 2 Chroniques XVIII, 19 [2]: « L’Eternel dit : Qui ira séduire Achab, roi d’Israël ? (…) L’Esprit s’avança (..) et dit : « J’irai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes » (p. 144). Les autres textes appréciés par Weil issus de ce même Ancien Testament pourraient donc également s’expliquer aussi par cette singularité, et si tel n’est pas le cas, Weil ne nous donne pas la clé de ce qui a pu, malgré tout, coappartenir à l’amour dans une religion de puissance. Weil renvoie à ce moment-là à des explications d’ordre historique : « on ne sent d’amour de Dieu que dans des textes ou certainement ou probablement postérieurs à l’exil » (ibid.). Mais elle reproduit ce même argument historique quand il s’agit du modèle grec, et que, par exemple, elle cite Thucydide au début de son article « Luttons-nous pour la justice ? » : « Là où il y a un fort et un faible, le possible est exécuté par le premier et accepté par le second (…) Chacun commande partout où il en a le pouvoir » (Guerre du Péloponnèse, V 105, 2) : Simone Weil commente alors : « Seuls les Grecs de cette époque ont su concevoir le mal avec cette lucidité merveilleuse. Ils n’aimaient plus le bien, mais leur pères, qui l’avaient aimé, leur en avaient transmis la lumière » (p. 240) : pourquoi ce raisonnement que l’on pourrait parfaitement appliquer aussi aux écrits de l’Ancien Testament appréciés ou dépréciés par Weil ? Pourquoi n’auraient-ils pas eux aussi été possibles par une même Tradition ? Mais à chaque fois que l’on touche au problème du mal chez Simone Weil, il semble que son argumentation se restreigne pour laisser place à une forme de spiritualisation, d’épreuve totale dont le seul choc ressenti devient un témoignage sans discussions possible. Nous ne le contestons pas, il y a une dimension mystique et gnostique avouée et revendiquée par Weil, mais pourquoi étayer ces expériences ou déclarations par des arguments (d’ailleurs, très peu érudits) d’ordres techniques, factuels et historiques ? Nous admettons ici notre incapacité à expliquer cela avec les articles du présent volume si nous tenons à voir en Simone Weil une quelconque intégrité intellectuelle.
Le fond de l’affaire, – et cela, Weil le reproche également avec véhémence au catholicisme dont l’institution religieuse aurait caché ou détruit l’essence même du christianisme en persécutant les Cathares ou rejetant le manichéisme avec Augustin et Thomas – c’est qu’il n’y a pas réellement de distinction entre « Dieu et le diable » (p. 144), la puissance divinisant indistinctement ce que le vrai bien sait voir, lequel bien avait été vu intellectuellement par les grecs. Weil va même plus loin en qualifiant de mystique cette intelligence qui appartient au bien : « La géométrie grecque est une prophétie » (p. 148). Face au mal, cette « intelligence » peut donc contenir ce mal et faire voir le bien absolu, mais Weil résiste en même temps à toute forme de sanctification.
Le mal est non seulement chez Weil tout ce qui a trait à la puissance, mais aussi ce qui atteint à l’intégrité d’un être, qui parcellarise sa complétude, qui cherche à abstraire son entièreté : d’où la condamnation du taylorisme et du personnalisme, mais aussi du système des « partis politiques » qu’un article de ce volume dénonce longuement le processus. Ce sont ces deux traits qui martyrisent la condition humaine qui résument le déracinement de l’âme selon Weil.
- La recherche mystique du bien impersonnel
Dans l’article « Collectivité – Personne – Impersonnel – Droit – Justice », Weil se situe contre le personnalisme qui distinguerait l’intégrité de la personne et son intégralité d’être, sa complétude et son entièreté. Weil refuse aussi une vue substantielle morale d’un être qui adorerait ensuite son eccéité pure et simple, sa forme. Toute atteinte directe ou indirecte est déjà mal et négation d’une totalité qu’est la personne, mais en tant que celle-ci est condition humaine selon Weil. On ne peut donc en rester à la personne individuelle si l’on veut entendre s’exprimer la dignité de cet être, et l’on ne peut pas non plus s’en tenir à une responsabilité simplement sociale vis-à-vis de cette condition humaine, car le collectif est aussi une forme de conditionnement qui anéantit l’être et asservi, c’est-à-dire enferme dans le mal l’être humain. Le terme de personne est donc pour Weil à la fois trop peu et pas assez, partiel et fabriqué sans laisser s’exprimer la tragédie de la condition humaine, l’absence d’enracinement de l’âme, qui est pourtant son besoin fondamental.
Comment distingue-t-elle des dispositions de l’âme alors que le mal vient produire ces différences de parties ? Weil refuse toute la métaphysique aristotélicienne, il ne peut y avoir d’ordre complémentaire ou constitutif de ce qu’elle appelle elle-même les « parties de l’âme » (p. 217). Il y a seulement une partie vouée à la pesanteur, asservissement dont la souffrance est « inexprimable » (p. 215), et une autre partie qui tend à l’accueil de la Grâce : ainsi, encore une fois, le collectif est-il condamné parce qu’il encombre cet accueil et le souille ; seule la solitude peut être « attentive » à la grâce surnaturelle.
La pensée de Simone Weil est en cela une spiritualisation mais qui s’en tient à l’expérimentation mystique secrète ; elle ne donne pas de méthode, d’initiation ou d’épreuve, de cycle, de stade, de cheminement, elle remarque avec attention des traces de grâce tout en essayant de traduire celles-ci dans des propos politiques. La seule expérience valable est l’abandon et l’anéantissement, le dé-saisissement complet qui n’est plus individuel ni collectif, mais l’inconcevable miracle :
« par l’effet d’une disposition providentielle, il est certains mots qui, s’il en est fait un bon usage, ont en eux-mêmes la vertu d’illuminer et de soulever vers le bien. Ce sont les mots auxquels correspond une perfection absolue et insaisissable pour nous. La vertu d’illumination et de traction vers le haut réside dans ces mots eux-mêmes, dans ces mots comme tels, non dans aucune conception. Car en faire bon usage, c’est avant tout ne leur faire correspondre aucune conception. Ce qu’ils expriment est inconcevable » (p. 235).
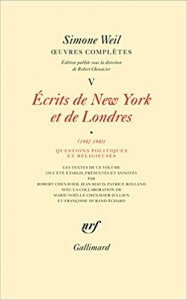
Quels sont donc ces mots illuminateurs ? « Justice, vérité, beauté » (p. 232) : dès qu’ils sont prononcés selon un usage vertueux, ils éclairent, selon Weil, toute la condition humaine et l’élève, la fait se délivrer dans sa finitude et son imperfection même. Cette illumination ne peut donc être factice, fabriquée, c’est-à-dire pour Weil, « conçue », mais il y a pourtant une certaine vertu dans l’usage de ces mots, donc probablement une forme de « maîtrise ». Weil cherche alors l’expression parfaite immédiate alors même que ce qui l’exprime est fini, imparfait : comme si la souffrance de la condition humaine comportait pourtant une force d’excellence, et les signes de la perfection à travers son absence de bien. Voilà à notre avis le paradoxe de Simone Weil dans laquelle ses propos lapidaires s’enroulent avec constance. Pourquoi est-il donc donné à l’homme de nommer la perfection au cœur et au moyen de son absence ? Il ne peut y avoir là de dialectique, la séparation est principielle ; ce n’est pas par la souffrance qui se renverse et se surmonte que le bien est exprimé, il ne peut être conçu, selon Weil, mais seulement exprimé dans ou à travers l’anéantissement même :
« Seule l’opération surnaturelle de la grâce fait passer une âme à travers son propre anéantissement jusqu’au lieu où se cueille l’espèce d’attention qui seule permet d’être attentif à la vérité et au malheur. C’est la même pour les deux objets. C’est une attention intense, pure, sans mobile, gratuite, généreuse. Et cette attention est amour » (p. 231).
L’expérimentation suprême est donc l’attention, qui n’est ni réflexion ou méditation, mais fixation transie par l’anéantissement d’un effort stérile, qui se concentre à vide, inapte à saisir quoique ce soit, et qui, cependant, atteint l’essentiel, c’est-à-dire exprime son âme, le besoin et la soif de son âme vers le surnaturel. A partir de cette disposition d’attention sans objet ni sujet, on atteint un « lieu » « d’enracinement » qu’est « l’impersonnel », lequel s’identifie avec la perfection – car selon Weil, « la perfection est impersonnelle » (p. 217). Alors seulement on peut « s’enraciner dans le bien impersonnel » (p. 218). Sur les modes même de cet « enracinement », Weil n’en dit rien dans ces articles-ci, sinon qu’il est de l’ordre du miracle ; pour le reste, la tâche immédiate n’est pas d’œuvrer au bien – ce serait le fabriquer illusoirement – mais de préserver du mal (p 233). C’est là la seule solution politique qui n’est alors ni collective, ni individuelle.
De fait, cette préservation du mal, toute l’œuvre de Simone Weil aux caractères explicitement politiques va s’ingénier à en définir les conditions de possibilités, lesquelles ne sont faites que pour l’attente patiente du miracle : ainsi dans son article « Luttons-nous pour la justice ? », on y trouve ceci : « Les hommes dans leur ensemble sont arrivés moralement à ce degré de maladie où il semble n’y avoir de guérison que miraculeuse. Miraculeuse, c’est-à-dire, non pas impossible, mais possible seulement à certaine condition » (p. 248). Weil prétend que cette ouverture à la Grâce n’est pas mécanique, mais procède d’un « consentement », d’un « esprit d’obéissance par amour » (p. 247), lequel échappe alors à la puissance – comme par exemple à « l’obligation de l’intelligence » (p. 185) – parce qu’il procède lui aussi de l’unité de la justice et de la charité (p. 244). Opposer la justice à la charité, c’est verser dans l’idolâtrie, c’est-à-dire, selon un autre article, « Cette guerre est une guerre de religion », organiser la société politique selon un partage fixe du bien et du mal (p. 252) ; et ne pas accepter ce partage serait également funeste selon Weil, dans la mesure où le désir a besoin d’un guide pour aimer.
La solution politique que propose Weil est donc la suivante : « La mystique est le passage au-delà de la sphère où le bien et le mal s’opposent, et cela par l’union de l’âme avec le bien absolu. Le bien absolu est autre chose que le bien qui est le contraire et le corrélatif du mal, quoiqu’il en soit le modèle et le principe. » (p. 254) Il faut donc que l’esprit d’un peuple soit organisé par une religion qui résiste à l’idolâtrie et mène à une dimension mystique.
Face au paradoxe d’un ordre institué comme une religion devant mener à son dépassement mystique, Weil garantit que cette infinité qui s’ouvre à l’Absolu n’est pas un hybris si celle-ci est faite de « vertu de pauvreté spirituelle » (p. 256) : alors elle incarne ce consentement à un enracinement impersonnel, cette attention au bien absolu, parce qu’elle obéit par charité et justice à Dieu selon les limites qu’Il assigne : le paradoxe qui est difficile à penser chez Weil, est que, d’un côté, elle veut reprendre une interprétation grecque de la divinité : « L’Antiquité savait que Dieu est ce qui assigne une limite » (p. 257), tout en interdisant la puissance à cette divinité, « la création est une abdication » (p. 242), – un peu comme Hans Jonas – et cela par l’unité même de la justice et de la charité puisque « La folie de Dieu consiste à avoir besoin du libre consentement des hommes » (p. 243).
- Le colonialisme et autres écrits politiques
A partir de là, dans le contexte de la seconde guerre mondiale en 1942, quelle forme d’action politique peut prendre selon Simone Weil une forme de résistance à l’occupation allemande ? dans « Réflexion sur la révolte », article ayant été lu par le Général de Gaulle, cela peut se faire par le « sabotage » mais certainement pas le « meurtre » (p. 263), précisément parce que cela pose des « problème moraux » dont Weil résume ainsi les enjeux :
« Il y a deux vérités qu’il faut toujours considérer ensemble. D’une part c’est principalement le moral qui décide de l’issue des guerres, et dans une guerre comme celle-ci plus que dans toute autre. D’autre part ce ne sont pas les paroles, mais les faits d’une certaine espèce combinés avec les paroles, qui élèvent ou abaissent le moral » (p. 265).
Relativement à ce que Weil écrivait et ce que nous avions cité plus haut, nous noterons donc ici une nuance substantielle du pouvoir mystique de certains mots. De même, quand Weil finit par écrire dans ce même article : « Une impossibilité militaire est un obstacle beaucoup plus sûr qu’une impossibilité morale. Il n’y a pas de plus sûr moyen de faire triompher en fait l’honneur et la vertu que d’en faire concrètement des facteurs stratégiques » (p. 267), nous reconnaissons volontiers ne pas comprendre, dans cette intrication, la manière dont évalue Simone Weil les éléments constitutifs de la révolte dont les « conflits sont avant tout spirituels » (p. 271).
Dans cet article, elle indique tout de même clairement et avec lucidité les formes politiques que devraient prendre la Résistance par rapport à l’opinion ; Simone Weil insiste pour ne pas en rester aux symboles mais réellement diriger, et d’emblée anticiper la fin de la guerre pour éviter la guerre civile et l’esprit de vengeance. Cela passe selon Weil par une unité de l’Angleterre et de la France Gaullienne.
Mais la résistance principale du pays a pour motif essentiel la lutte contre une Allemagne qui selon Weil tente « d’arracher à la France son passé ». Et cette question est directement liée à la « question coloniale » que Weil condamne également avec virulence et reproche au gouvernement français, car en effet, « la colonisation, c’est le déracinement. Elle aurait privé les pays conquis de leur passé. La perte du passé, c’est la chute dans la servitude coloniale » (p. 285). Dénoncer la colonisation, c’est donc prévenir le déracinement, résister à l’occupant, anticiper, selon Weil, le danger futur d’un plus grand déracinement encore qu’est « l’américanisation de l’Europe » (p. 288), et dépasser aussi la doctrine du progrès des Encyclopédistes, principal facteur de déracinement puisque, selon Weil, dans ces perspectives progressistes des Lumières, « l’humanité n’a aucun intérêt à conserver le passé » (p. 292). Si l’Europe trouve la force de dépasser ses pratiques coloniales, alors elle pourra retrouver son passé – lequel est lié selon Weil à l’Orient – et régénérer « la vocation spirituelle du genre humain » (p. 293). On pourra à partir de là trouver une perspective pour lire le texte qui apparaît comme actuellement le plus polémique de Simone Weil, « Bases d’un statut des minorités françaises non chrétiennes et d’origine étrangère » (p. 479). Ces éléments trouveront une forme d’accomplissement dans L’enracinement, lequel, contre les sociétés libérales et le nazisme, revalorisera la fameuse notion d’obligation. Tout le reste du présent volume est ainsi consacré à des études concernant le « Schéma de la constitution hitlérienne française » et à chercher par opposition « les bases de la réforme constitutionnelle » (p. 434) après la célèbre « Note sur la suppression générale des partis politique » (p. 396), laquelle forme est bien évidemment « idolâtre » (p. 404) aux yeux de Weil, dans le sens que nous avons décrit plus haut.
- Lectures de Marx
Mais avant ces derniers articles dont les adversaires sont à réformer ou combattre jusqu’à l’assimilation, Simone Weil en arrive au marxisme, lequel apparaît quand elle en parle – il faut bien le dire – comme une sorte de miroir déformant d’elle-même. En effet, dans l’article « Y a-t-il une doctrine marxiste ? » (p. 306) Marx y est décrit comme « un cœur généreux. Le spectacle de l’injustice le faisait réellement, on peut le dire charnellement souffrir » (p. 308), et là où nous pensions tenir enfin une véritable confrontation d’idées ou de concepts philosophiques, Simone Weil ne fait que convoquer nominalement quelques petites terminologies marxistes pour réitérer sa pose politico-mystique, pose qui est, dans ce texte, dévoilée avec une sincérité crue qui ne serait pas gênante si elle ne convoquait pas Platon et Marx à son spectacle :
« C’est surtout la contradiction essentielle, la contradiction entre le bien et la nécessité, ou celle équivalente entre la justice et la force, dont l’usage constitue un critérium. Le bien et la nécessité, comme la dit Platon, sont séparés par une distance infinie. Ils n’ont rien en commun. Ils sont totalement autres. Quoique nous soyons contraints de leur assigner une unité, cette unité est un mystère ; elle demeure pour nous un secret. La contemplation de cette unité inconnue est la vie religieuse authentique (…) la part du surnaturel ici-bas, c’est le secret, le silence, l’infiniment petit » (p. 310, sq).
Ici, ne serait-ce que sur l’unité contradictoire qui s’impose même à l’attention de Weil, l’interprétation aurait pu timidement en appeler à la « dialectique », mais celle-ci est, là encore, heureusement (miraculeusement) renvoyée au champs du silencieux mystère, même chez les Grecs qui, selon Weil, « employaient le mot dialectique quand ils pensaient à la vertu de la contradiction comme support de l’âme tirée en haut par la grâce » (p. 326), et Simone Weil conclut ici de façon désarmante : « Si Marx ne l’a pas senti, c’est qu’il n’a pas emprunté le mot aux Grecs, mais à Hegel, qui déjà l’employait sans signification précise » (ibid.). Que peut-on répondre ici à une interprétation aussi légère que péremptoire ? Comment ne pas nous même devenir ridicule en prenant au sérieux ces écrits de Weil pour qui, par ailleurs, « la négation de la négation est un ridicule bobard » (note 399 p. 715) ?
En faisant un petit bond dans la chronologie des textes hors du présent volume, ce genre de propos aurait pu être excusable étant donné l’état moral et physique de Weil alors au crépuscule de sa vie. Mais en lisant le chapitre « La vérité » dans L’enracinement – donc pratiquement au même moment que ces textes de 1942-43 – Simone Weil écrit : « le besoin de vérité est plus sacré qu’aucun autre » (Weil, Œuvres, Quarto, p. 1049), et elle va jusqu’à illustrer son propos en rêvant de faire juger par un tribunal Maritain pour ses propos sur la condamnation de l’esclavage dans l’antiquité en concluant : « Le tribunal blâmerait Maritain pour avoir imprimé, alors qu’il lui était si facile d’éviter l’erreur, une affirmation fausse et constituant, bien qu’involontairement, une calomnie atroce contre une civilisation toute entière » (p. 1050). Aussi est-il assez tentant de nous interroger sur le sort qu’aurait réservé un pareil tribunal de la Pensée à Simone Weil elle-même et cet article en particulier sur le marxisme, « alors qu’il lui était si facile d’éviter l’erreur ».
Ainsi, on apprend par Weil que Marx et ses écrits se trouvent dans « un désarroi ridicule devant la guerre et les problèmes relatifs à la guerre et la paix » (p. 323) : il est évident que si l’on relit les quelques lignes de Weil sur les conquêtes coloniales, on trouve des analyses beaucoup plus profondes que celles qui terminent le premier livre du Capital, puisque selon Weil, la Tunisie et le Maroc ont été pris selon « un réflexe de paysan qui agrandit son lopin de terre » ou encore que « les îles d’Océanie ont été prises au hasard de la navigation » (p. 283). Mais selon Weil, Marx « croyant que la production est l’unique facteur des rapports de force, en oublie purement et simplement la guerre » (p. 323). Faut-il croire que Weil n’ait rien lu sur l’aliénation du travail ? Ne voit-elle pas que « la production est la vie générique active de l’homme » (Marx, premier manuscrit de 1844, XXII, GF p.116) et que son aliénation est bien autre chose que la contradiction comme condition négative à obtenir le bien (p. 325) et s’y enraciner en tant qu’impersonnel ? Mais Weil poursuit ses affirmations « Marx était incapable d’un véritable effort de pensée scientifique » (p. 325), « Marx n’était pas heureux. La pensée de la misère le bouleversait » (p. 326), Marx « imaginait un mécanisme producteur de paradis », ou encore « Marx se regardait comme étant l’hirondelle dont la simple présence annonce par elle-même l’imminence du printemps, c’est-à-dire de la révolution. Il était pour lui-même un présage » (p. 319). L’absence de critique réelle nous empêche même dans cet article de répondre en évaluant leur teneur, tant le magma psychologisant est systématiquement mobilisé par Weil à chaque thématique plus ou moins proche du marxisme. Nous n’avons plus affaire à des concepts auxquels Weil répondrait par des analyses, mais au charme d’une présentation plus moins subtile d’attitudes qui se succèdent par sauts magiques, fleuries par d’effarants brocards incultes et paresseux, aussi dépourvus de goût que ceux des imitateurs de Schopenhauer.
Conclusion
Indéniablement, Simone Weil tente d’entrer dans un dialogue dont les occasions ne manquent pas de sincérité étant donné le contexte ; mais à vouloir éviter l’idéologie par mauvaise conscience, Weil substitue et imagine son interlocuteur avec des expériences hors-sujets, ou sans rapport avec les termes des débats employés, ou jugés à l’aune de ses propres enjeux. La totalité de l’analyse de Weil devient alors un monstrueux soliloque sourd à lui-même, un dialogue de spiritualisation aux références répétitives, où se succèdent des sketchs fantoches dont l’accumulation n’est que pure et simple « suggestion » – effet qu’elle n’a pourtant cessée de dénoncer dans le domaine politique et religieux. Weil dialogue sans risque avec Marx comme elle ferait parler les morts, en tournant les tables ; il n’y a pas à s’étonner du vertige de l’interrogation, ni de la bizarrerie des écrits souvent convoqués mais jamais réellement cités.
La recherche de la vérité est chez Weil une injonction qui s’accomplit dans une spiritualisation et non pas une libre enquête. Notre déception est grande étant donné qu’elle faisait de cette liberté un principe inconditionnel de l’intelligence dans sa « Lettre à un religieux ». Elle préfère à cela une sorte de mise à l’épreuve de toute expérience, y compris celle intellectuelle : le résultat n’est pas plus que de l’intimidation. Quel point spirituel, quelle vue spirituelle peuvent ensemble permettre une telle prétention ? Ce n’est pas une réflexion comme auto reflet, mais une sorte d’abandon implacable à la Vérité, lequel abandon est vécu comme un anéantissement, puis compris comme une pure injonction morale. En cela nous sommes dans un type de responsabilité morale immédiate face à l’Autre, et cela, même Levinas a bien obligeamment voulu le voir ; et Weil veut s’y maintenir en tant que souci de la souffrance, écoute non perverse du cœur souffrant qui plaint toute condition humaine : voilà semble-t-il l’épreuve de vérité ultime qui lui sert de principe de sélection dans sa démarche. Toute mise en perspective devient accommodement, et toute nuance dans ce que l’on rapporterait à cette petite voix du cœur souffrant, à cette « belle âme », serait suspect d’atténuation donc de complicité avec une relativisation d’oppresseur déracinant : l’unilatéralisme des expressions est alors inévitable. Alors, comment lire philosophiquement Weil ? Est-ce qu’il y a chez Weil, dans la mesure où elle fut l’élève d’Alain, encore des réflexes cartésiens qui rendraient lisibles ses évocations ? Il y a chez Weil ce même entrecroisement de trame démonstrative et de trame ascétique, mais elle en dénie le caractère fabriqué en prenant, pour le soutenir, un ton assuré sans partage. Il y a dans tous ses propos une sorte de méditation qui, d’une part, démontre pour finalement accéder à un type subjectif non logique, transformé, spiritualisé, mais qui, d’autre part, prétend être l’instigateur et sous-tendre la démonstration initiale. Weil maintient cette démarche comme une double voie et prend joie à s’y écarteler tout en réclamant le miracle d’une unité souvent annoncée, jamais accomplie et finalement renvoyée au « secret ».
[1] Simone Weil, Écrits de New York et de Londres (1942-1943), volume 1 – Questions politiques et religieuses.
[2] 2Ch 18:19 : «… – Yahvé demanda : « Qui trompera Achab, le roi d’Israël, pour qu’il marche contre Ramot de Galaad et qu’il y succombe ? » Ils répondirent, celui-ci d’une manière et celui-là d’une autre. Alors l’Esprit s’avança et se tint devant Yahvé : « C’est moi, dit-il, qui le tromperai. » Yahvé lui demanda : « Comment ? » – Il répondit : « J’irai et je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » Yahvé dit : « Tu le tromperas, tu réussiras. Va et fais ainsi. « … »