La première partie de l’entretien se trouve à cette adresse.
BR : Technique, Capital, Démocratie : c’est donc par ses catégories que vous appréhendez les temps contemporains en vous appuyant sur des « géants de la pensée ». Il est un fil que nous n’avons pas encore tiré pour lui-même, quoiqu’il apparaisse déjà ici ou là dans les échanges précédents. Vous évoquiez en effet la revanche de Platon sur Aristote, vous notiez avec Sohn-Rethel le rôle de la monnaie chez les Grecs, vous voyiez en Hegel l’annonciateur de la fin d’une ère ; mais on peut affirmer que, de façon générale, vos réflexions rétrocèdent de la modernité vers le surgissement de l’ontologie et de la métaphysique chez les Grecs : serait-ce donc en fin de compte dans la naissance même de la philosophie et de la raison que l’on doit déceler l’origine du déferlement de la technique planétaire ?
JV : Technique, Capital, Démocratie, et Science : notre époque est aussi celle de la domination de la science dans la compréhension du monde et l’explication des phénomènes. Tous les peuples de la planète se situent désormais dans le cadre de la rationalité scientifique, qui jusqu’au XVIIIe siècle était réservée à une petite minorité de savants européens. C’est dans la science que la provenance grecque est la plus évidente : c’est en Grèce ancienne, et nulle part ailleurs, que s’opère la rupture avec le mythe, c’est-à-dire l’explication des phénomènes par des entités surnaturelles, au profit de la raison, qui explique les phénomène naturels par d’autres phénomènes naturels. L’histoire des sciences depuis lors, c’est celle de la transmission de cet héritage grec, qui passe dans le monde hellénistique, puis l’Empire romain, puis le monde arabe, puis l’Europe occidentale, puis s’étend au monde entier par la colonisation ; les collégiens d’aujourd’hui apprennent encore Thalès, Pythagore et Euclide. Il ne faut donc pas faire le contresens positiviste qui voit dans les sciences contemporaines une sortie hors de la métaphysique : les sciences contemporaines accomplissent le projet métaphysique d’une réduction intégrale du réel à la raison pure et de sa détermination par l’idéalité mathématique. La science moderne commence avec Galilée, qui pose d’abord le plan mathématique : la science moderne se caractérise par le primat de l’idéalité, et l’expérience ne vient ensuite que comme médiation pour la vérification de la théorie. La technique contemporaine est elle-même en rapport avec la métaphysique, c’est-à-dire avec l’idéalité pure, et c’est ce qui fait son originalité par rapport à la technique ancienne. La technè grecque n’a aucun rapport avec la théorie, elle est toujours empirique. Quand les Grecs élaborent des traités de mécaniques, ils ne font qu’étudier et modéliser des instruments élaborés par des praticiens, et c’est la pratique qui est alors le principe de la technique. L’instrumentalisation de la science à des fins pratiques y est condamnée comme une déchéance : ainsi quand Plutarque évoque des inventions mécaniques d’Eudoxe de Cnide et Archytas de Tarente, il rapporte aussitôt que « Platon leur reprochait avec indignation d’avoir corrompu la géométrie, de lui avoir fait perdre toute dignité en la forçant comme un esclave de descendre des choses immatérielles et purement intelligibles aux objets corporels et sensibles, et d’employer une vile matière qui exige le travail des mains ». Archimède est resté comme le plus grand inventeur de la Grèce ancienne : mais sa plus grande vertu aux yeux des Grecs était d’être demeuré platonicien, de n’avoir pas avili la science et d’avoir même refusé de laisser trace des inventions militaire qu’il avait faite dans l’urgence du siège de Syracuse par l’armée romaine. Plutarque loue ainsi pour n’avoir pas « tourné son savoir des choses purement intelligibles vers les objets sensibles et rendu son raisonnement en quelque sorte accessible au sens et palpable au commun des hommes en les appliquant par expérience à des choses d’usage ». C’est la science moderne qui opère ce passage, lequel culmine aujourd’hui dans l’informatique. Notre époque est en cela caractérisée par la technoscience : les techniques sont désormais l’application directe de modèles scientifiques, en quoi elles permettent la soumission totale (cybernétique) du monde sensible au monde intelligible. Donc ce qui advient en Grèce ancienne, c’est la rationalité dans sa configuration abstraite et formelle, transcendante et objective (aliénation d’une rationalité originairement immanente à la communauté), le machinisme advient quand les techniques sont subordonnées et assujetties à cette raison universelle et abstraite, qui dispose alors des moyens de se produire elle-même. La révolution industrielle est ainsi le moment d’une inversion : alors qu’en Grèce l’idéalité géométrique se fonde sur les techniques (c’est la conclusion de Husserl dans L’Origine de la géométrie), à partir du XVIIIe siècle en Europe ce sont les techniques qui se fondent sur les idéalités géométriques (maintes analyses de Marx à ce sujet). Dans les deux cas, c’est l’argent qui est l’opérateur de conversion.
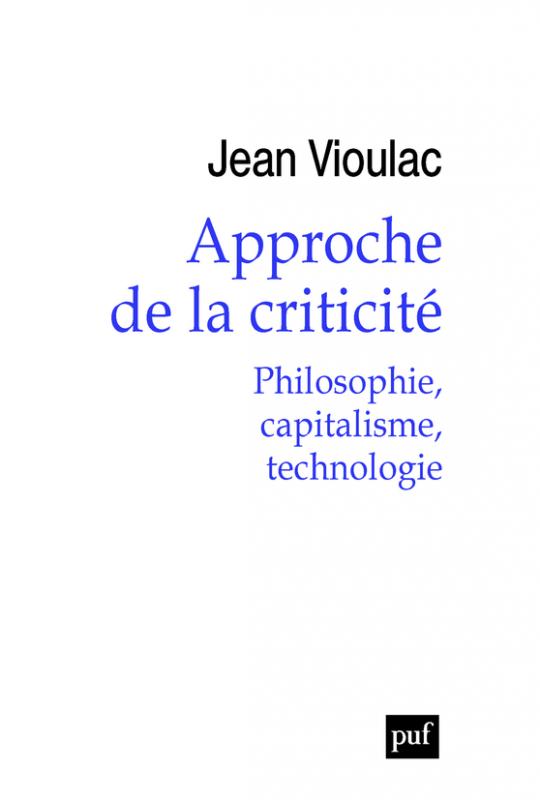
BR : Vous passez en revue, très rapidement, les étapes qui mènent des Grecs, et surtout de Platon, à la science moderne, et à Galilée, puis contemporaine. Mais n’a-t-il pas fallu que le monde, le cosmos, soit désacralisé pour que la technique puisse prendre une telle place ? Et, de ce point de vue, ne convient-il pas également d’accorder une place au christianisme dans cette genèse ? Par ailleurs, l’idéalité éthérée que vous décrivez fait tout de même penser au gnosticisme : diriez-vous qu’il existe une proximité entre la philosophie platonicienne et cet ensemble d’hérésies chrétiennes ?
JV : Vous soulignez à juste titre que ce passage en revue est très rapide : il ne s’agit que d’un schéma, qui n’a d’autre fonction que d’exposer en quoi la science contemporaine est de provenance spécifiquement grecque. Reprendre cette question de façon plus détaillée imposerait d’ailleurs d’étudier aussi les techniques et les institutions qui au cours de l’histoire garantissent la transmission d’une pensée : il n’y pas de pensée rationnelle sans la technique de l’écriture alphabétique, caractéristique de la Grèce ancienne et de la constitution de l’espace public de la Cité par la publication des lois, il n’y a pas de progrès des sciences sans l’accumulation et la transmission des doctrines et des concepts, et donc sans les techniques de fabrication des papyrus et parchemins puis de l’imprimerie, et surtout sans institutions, les Écoles, les Ordres monastiques, les Universités, qui prennent en charge la conservation et la transmission de tel ou tel corpus. Quant aux hérésies chrétiennes, je ne suis pas en mesure de vous répondre parce que je suis trop ignorant sur ces questions, quoique j’ai un intérêt ancien et une vieille tendresse pour l’hérésie cathare en Occitanie au XIIe siècle : c’est d’ailleurs pour parachever l’éradication du catharisme que l’Église catholique a fondé l’Université au XIIIe siècle (en même temps que l’Inquisition), ce qui montre que les institutions en charge de la pensée ont toujours aussi des missions idéologiques. Mais vous avez raison, le christianisme a sans nul doute une place dans ce processus, si l’on accepte d’envisager les phénomènes sur le long cours : c’est-à-dire en reconnaissant que la religion définit Homo sapiens, puisque celui-ci est caractérisé par l’apparition des premiers rites funéraires, donc du deuil et du maintien au sein de la communauté de l’espace de jeu du deuil. Le christianisme est à mon sens fondamentalement la religion du deuil : religion de l’amour et de la mort, mais le deuil est l’unité, ou plutôt l’intimité de l’amour et de la mort, le christianisme est la religion d’un deuil infini et d’un deuil impossible, celui de Jésus de Nazareth, et la sauvegarde fidèle de la crypte de son absence autour de laquelle se rassemble la communauté chrétienne. C’est pourquoi il est possible, comme le faisaient Hegel et Feuerbach (mais en un sens différent), de voir dans le christianisme la « religion absolue », la « religion parfaite » ou la « religion manifeste », celle qui manifeste l’essence pure de la religion : c’est-à-dire le deuil. C’est sans doute Hölderlin qui a saisi le plus purement et le plus clairement l’essence tragique et mélancolique du christianisme ; Hölderlin le premier y a reconnu la religion de l’Adieu, c’est-à-dire la religion du départ de Dieu. L’histoire du christianisme est en cela le long travail du deuil qui mène à saisir le cosmos comme absence de Dieu, Pascal déjà disait au XVIIe siècle que la religion chrétienne « ouvre les yeux à voir partout le caractère de cette vérité ; car la nature est telle, qu’elle marque partout un Dieu perdu, et dans l’homme, et hors de l’homme ». Parmi les caractéristiques de la crise contemporaine, il y a aussi la mort de Dieu, et c’est en quoi Nietzsche est l’un des Titans de notre temps ; parmi les processus révolutionnaires qui inaugurent notre époque, il y a aussi cette révolution religieuse qu’est la Réforme initiée par Luther, et qui révèle à la fin le christianisme comme religion de la sortie de la religion, et il faut souligner qu’il le fut d’emblée, et par essence : le christianisme est en effet un messianisme (« Christ » est la simple traduction grecque de l’hébreu « Mashia’h », « messie »), et un messie n’est pas fondateur d’une religion ; seul les prophètes fondent des religions. Le messie est celui qui vient réaliser ce que la religion attendait, il révèle par là même le caractère provisoire, formel, voire hypocrite (pharisaïque) de la religion : l’avènement du messie condamne brutalement la religion à l’obsolescence et condamne ses rites à l’insignifiance. Mais la question que vous posez, sur le rapport entre l’hégémonie de la technique et cette désacralisation du cosmos, et aussi sur le rapport au gnosticisme, impose de développer l’analyse de la question de la religion : il y a en effet un gnosticisme technologique aujourd’hui, qui affirme que la technique va en quelque sorte guérir l’homme de lui-même en libérant son esprit de son corps, en en faisant un pur esprit connecté à l’Esprit absolu matérialisé dans le cyberespace planétaire, il y a dans le rapport à la technique l’idée que l’on peut se fier corps et âme à son progrès, qui prend ainsi la place de la providence (et c’est sans doute pourquoi les critiques de la technique se heurtent à de telles oppositions, puisqu’il devient inacceptable de douter de cette perspective de salut). C’est flagrant quand on lit la littérature des prophètes du futur technologique, et aussi quand on constate le fétichisme dont font l’objet les smartphones, qui ont véritablement acquis le statut de talisman permettant à chacun d’être en contact avec le monde surnaturel des esprits (le cyberespace) par rapport auxquels on va constamment orienter sa vie terrestre. Il y a même un livre sorti l’année dernière sous le titre Informatique céleste (par Mark Alizart) qui nous apprend que « l’ordinateur est un Dieu », que l’avènement du Réseau informatique mondial n’est autre que celui de Dieu sur terre, et qui lui attribue le rôle « messianique » de « sauver le monde ». Le livre est paru aux Puf, qui est une maison sérieuse, et il faut donc prendre ce livre au sérieux : il n’est pas dénué de sens en effet, puisqu’en parlant d’informatique « céleste », il reconnaît que le réseau mondial n’est autre que le ciel des idées platonicien, il confirme à sa façon que le dispositif est effectivement l’accomplissement de la métaphysique, et que la technologie y occupe le rang de la théologie. Mais pour y voir le salut, il faut supposer que la chair et ses sensations relèvent du mal et qu’il faut les éradiquer, ou du moins les dresser et les discipliner par l’idéalité pure. J’ai tendance à penser que notre existence doit plutôt s’orienter par une érotique que par une logique, et que cette logicisation et cette abstraction totale de la vie humaine est son aliénation totale, et qu’elle est un danger. On peut là aussi situer notre époque dans l’histoire au long cours : l’émergence de l’humanité au sein de la nature est un processus d’humanisation, c’est-à-dire de désanimalisation, nous serions aujourd’hui au début d’un processus de mécanisation, machinisation et numérisation, c’est-à-dire de déshumanisation.
BR : Votre développement sur le christianisme, que vous définissez donc comme un messianisme, me permet de me tourner vers ce qui me semble le point de bascule de votre pensée : renversement annoncé à la fin de La logique totalitaire, avec une formule qui sonnait comme un programme (« penser l’apocalypse »), et pleinement accompli dans l’ouvrage suivant, Apocalypse de la vérité. Vous y écrivez en effet : « À l’hypothèse onto-logique qui délègue le sens et la vérité à un Universel à l’œuvre dans l’histoire, l’hypothèse christo-logique pose que la chair singulière et défaillante est principe unique et abyssal […] » (page 241), pour signifier un déplacement péremptoire de l’hellénisme vers le christianisme. De quelle apocalypse parlez-vous ? Dans quelle mesure la destruction se fait-elle simultanément révélation ? Et quel est ce logos que vous attribuez au Christ ?
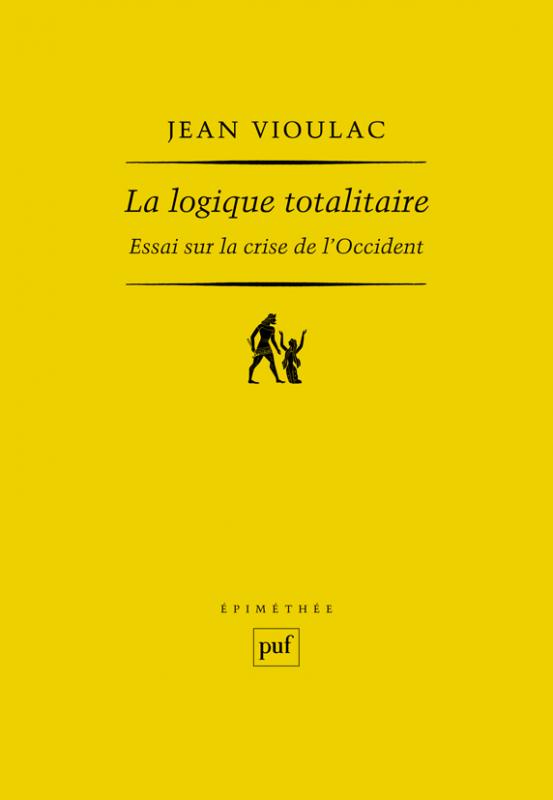
J.V. : Question abyssale, justement, qui suppose tout un nuancier de concepts et d’analyses : permettez-moi alors de prendre le temps de vous répondre. Comme disait Heidegger, parler de philosophie chrétienne, c’est comme parler de cercle carré (ou de fer en bois, selon l’expression allemande) : la pensée chrétienne est totalement autre que la pensée philosophique. Mais c’est précisément ce qui en fait le prix : Slavoj Žižek disait ainsi (dans Fragile absolu), que « l’héritage chrétien authentique est bien trop précieux pour être abandonné aux freaks intégristes », et il a raison. La pensée chrétienne propose en effet une autre conception de la vérité et une autre définition de la raison (du logos, c’est le prologue de l’Évangile de Jean), elle offre donc une alter-vérité et une alter-rationalité, elle ouvre et configure un espace de pensée paramétré autrement que l’espace de la rationalité grecque. Or c’est un des acquis de notre temps que d’avoir mis en évidence la finitude de la vérité, et son historicité fondamentale : il y a des régimes de vérité qui se succèdent dans l’histoire et coexistent dans des aires géographiques distinctes. La mathématique elle-même a une origine historique précise, elle a une histoire ; la géométrie peut être paramétrée de différentes façons (en opposant par exemple la géométrie hyperbolique de Lobatchevski ou la géométrie elliptique de Riemann à la géométrie plane d’Euclide) ; Claude Levi-Strauss a montré la vérité propre du mythe, Michel Foucault a étudié ce qu’il appelle des épistémés, mais c’est surtout Heidegger qui a montré l’époqualité de la vérité, c’est-à-dire la succession de différentes époques de la vérité. La pensée chrétienne est donc un régime de vérité parmi d’autres : il est plus important que d’autres, d’abord parce qu’il reprend la question grecque du logos pour le définir tout autrement, non plus par l’universalité du concept mais par la singularité de la chair, mais surtout, à mes yeux, parce que le christianisme est la religion du deuil. Or le deuil est la source la plus archaïque de l’idéalité : quand on fait la généalogie de l’idéalité, ou de l’esprit, on ne peut pas se contenter de la Grèce ancienne, on doit prendre en compte cette source la plus ancienne et commune à tous les peuples qu’est le deuil, l’institutionnalisation du deuil, les rites funéraires, l’espace du sacré, la ritualisation de la mémoire. La pensée qui s’origine dans l’idéalisation géométrique est la pensée scientifique, la pensée qui s’origine dans le deuil est la pensée religieuse, laquelle trouve sa forme achevée dans le christianisme. Il y a ainsi dans le christianisme une pensée tout autre, qui n’est plus ontologique mais « hantologique » pour reprendre un terme forgé par Derrida, c’est-à-dire une pensée hantée par les morts, une pensée non pas de la présence mais de l’absence, non pas du fondement mais de l’abîme, une vérité qui n’est plus définie par l’adéquation à ce qui est, mais par la fidélité à ce qui fut. L’absence, la hantise, la mort, la crypte du deuil et l’espace intérieur de la mémoire ouvrent une dimension qui n’est pas totalisable, qui excède la totalité de ce qui est ; rapport au néant qui transgresse les limites de l’être. C’est pourquoi cette pensée est si précieuse à l’ère de la totalisation capitaliste et de l’hégémonie cybernétique de la logique : elle permet de penser cette totalité à partir d’un point d’extériorité, elle permet de penser la dislocation de cette totalité. Ce rapport à ce qui excède la totalité, rapport au néant par-delà l’être, c’est ce qui définit l’eschatologie, et la pensée eschatologique est nécessaire pour aborder notre époque. Mais il faut réélaborer le concept d’eschatologie, comme l’a fait Derrida, pour lui donner un sens strictement philosophique et non plus théologique. Il ne s’agit certainement pas — en tout cas pas pour moi — d’élaborer une quelconque théologie ni de s’en remettre à une quelconque religion : penser la crise impose d’assumer jusqu’au bout la mort de Dieu, la fin des religions historiques et l’obsolescence de la théologie. Il s’agit de puiser dans le judéo-christianisme des concepts hétérogènes à la rationalité scientifique, dont on a besoin pour penser l’évènement contemporain. Parmi ces concepts, celui de messianisme est alors sans conteste le plus important. Si en effet la pensée de la crise impose une pensée critique, cette critique peut se déployer selon deux perspectives distinctes. D’abord la critique philosophique, inaugurée par Kant, qui consiste à ramener tout donné à ses conditions de possibilité, et à juger le fait au nom du droit. Mais il y a une autre critique possible, qui est éthique, et qui consiste à juger le présent au nom de ce à quoi on pouvait s’attendre, au nom d’une promesse ancienne que l’on espérait voir tenue. Nietzsche dans Par-delà bien et mal l’a dit dans des lignes inoubliables : « Il est peu de douleurs aussi poignantes que d’avoir vu, deviné, pressenti, comment un homme hors du commun a pu s’égarer et déchoir ; mais ceux qui ont le don peu répandu d’apercevoir le danger d’une déchéance générale de l’homme lui-même, ceux-là souffrent d’une angoisse à laquelle aucune autre ne peut se comparer. Ils savent que l’homme n’a pas encore épuisé ses possibilités les plus hautes et que le type “homme” s’est déjà plusieurs fois trouvé à la croisée des chemins, face à des décisions pleines d’incertitudes ; ils savent mieux encore, par leur plus douloureux souvenirs, que des contingences misérables ont habituellement brisé et anéanti jusqu’ici un être riche d’avenir ». Nietzsche juge ici celui qu’il appelle le « dernier homme », l’engeance la plus méprisable (disons le consommateur, le télespectateur, le geek, le touriste, le client de parcs d’attraction) au nom de ce que à quoi l’on pouvait s’attendre en se fiant à la grandeur atteinte dans l’histoire, dans la Grèce tragique, le christianisme primitif ou la Renaissance italienne. Le messianisme, c’est alors l’attente de l’accomplissement de la promesse. C’est donc ainsi qu’il faut comprendre le messianisme, en démythologisant et déthéologisant ce concept, pour y reconnaître l’exigence éthique d’accomplissement d’une promesse inhérente à l’être humain : ce que là aussi a fait Derrida quand il parlait de « messianicité » pour concevoir un « messianisme sans messie », distingué de toute religion déterminée. Et il y a en effet une messianicité inhérente à l’être humain en tant qu’il est historique. Si l’homme n’est pas une espèce comme les animaux et n’est donc pas un être particulier, s’il est défini par son exclusion du monde animal, sa libération de tout biotope particulier et son ouverture au monde, et par suite par son universalité, alors il est porteur d’une promesse : celle de l’accomplissement de cette universalité, de l’avènement de l’individu universel, de l’homme pleinement développé et effectivement libéré. Face au risque d’aliénation totale de l’homme que fait porter aujourd’hui l’hégémonie planétaire du dispositif techno-capitaliste, s’impose donc cette exigence éthique absolue d’accomplissement de la promesse dont l’homme est porteur — « liberté, égalité, fraternité », pour reprendre une devise magnifique qui, à l’heure où je vous parle, reste une promesse non tenue. Y renoncer, c’est renoncer à l’humanité, consentir à devenir une bête de troupeau, et c’est par là même annuler et réduire à l’insignifiance l’ensemble de l’histoire humaine jusqu’ici : paroxysme du nihilisme. La question, c’est donc celle de l’événement en lequel s’accomplira la promesse (événement messianique), et qui disloquera ainsi la totalité techno-capitaliste (événement eschatologique) : c’est pour définir cet événement que j’ai tenté d’élaborer le concept d’apocalypse, qui s’ajoute ainsi aux concepts de crise et de révolution pour penser notre époque. Mais il désigne le même événement : l’apocalypse, c’est le dévoilement (en grec apokalupsis) de quelque chose qui jusque là était resté caché, dévoilement qui advient dans une catastrophe totale et à la fin de l’histoire, et qui dans le même moment permet de nous sauver. C’est bien cela qu’a en vue Husserl : l’hégémonie de la logique objectivo-formelle est « le danger des dangers », celui-ci se produit lors de l’achèvement de la téléologie occidentale de la rationalité, qui révèle alors ce qu’elle avait voilé, à savoir le monde de la vie et la subjectivité transcendantale : ce dévoilement ouvre la possibilité d’une refondation terminale (l’Endstiftung) de la rationalité. Le concept d’apocalypse m’a semblé pertinent pour définir et articuler les divers moments structurels de l’événement critique, et ce d’autant plus qu’il l’aborde à partir de la question de la vérité et oppose ainsi un autre type de dévoilement (apokalupsis) au dévoilement (alèthéia) qui définit la vérité grecque : il permet ainsi de concevoir le conflit entre des régimes de vérité antagoniques, et le surmontement historique d’un régime de vérité par un autre. La question fondamentale reste celle de la crise, mais l’événement critique est apocalyptique. Marx lui-même le conçoit ainsi à la fois la crise capitaliste et la révolution communiste : la domination totale de la valeur universelle et abstraite est danger, mais aussi révélation de sa source oubliée, à savoir le travail communautaire concret ; dans son fonctionnement, le dispositif capitaliste crée le prolétariat dont l’action révolutionnaire sauvera l’humanité. Il y a clairement un messianisme chez Marx, d’abord au sens juif, puisque le prolétariat occupe le rang de peuple élu, mais surtout au sens chrétien, puisque le prolétaire est celui qui a été tellement déshumanisé par son exploitation qu’il n’a plus rien à revendiquer que l’humanité comme telle. De même que le Christ est celui qui s’est vidé de toute substance — ce que les théologiens nomment la kénose, du grec to kénon, le vide — pour aller ainsi jusqu’au bout de la souffrance, puis, par la résurrection, restaure l’humanité, de même le prolétaire est celui qui par la logique de l’exploitation a été dépossédé et vidé de toutes ses possibilités, pour ensuite, par la révolution, libérer l’humanité tout entière et la mener à la plénitude de son essence. L’événement révolutionnaire est messianique, et il est aussi eschatologique dans la mesure où il ne peut pas prendre place dans le temps du « progrès », lequel n’est autre que le développement de l’ordre techno-capitaliste : il doit au contraire interrompre ce processus, disloquer la totalité, il doit s’opposer radicalement à un régime de vérité défini par le calcul de toutes choses et l’automatisme d’une logique purement formelle, régime qui a conduit l’humanité à se « noyer dans les eaux glacées du calcul égoïste », selon les mots du Manifeste du parti communiste.
BR : Votre propos nous ramène à la croisée des chemins que vous annonciez dès votre première réponse, dans laquelle « la possibilité de s’accomplir » désignait, dans l’implicite, ce que ce l’on sait désormais devoir être nommé « messianisme ». D’où, étape suivante si je suis l’ordre chronologique de parution de vos ouvrages, la place centrale qu’occupent la communauté et le communisme dans Science et révolution : si le logos du christianisme est la vérité de la vie, cette dernière ne saurait se réduire à la seule dimension individuelle, mais au contraire s’étendre à l’intersubjectivité et même à la collectivité. Toutefois, le plus remarquable, c’est que vous parveniez à cette idée à partir de Husserl et de la phénoménologie…
JV : Si l’on décape ces questions essentielles de l’épaisse couche idéologique qui les recouvre, on découvre en effet une parenté entre le christianisme primitif et le communisme (il s’agit bien ici de la communauté chrétienne primitive, avant son aliénation dans l’appareil ecclésial et sa soumission à un nouveau légalisme sacerdotal et à sa hiérarchie). La structure messianique de la pensée de Marx a souvent été soulignée, ce qui a conduit à vouloir la disqualifier en affirmant que ce n’était « que » un christianisme sécularisé. On peut pourtant à l’inverse voir dans le christianisme primitif un communisme théologisé, et c’est ainsi que l’ont interprété Friedrich Engels et Karl Kautsky. Il est déjà étonnant que les pères fondateurs du marxisme s’intéressent autant aux débuts du christianisme, il l’est encore plus de voir comment ils le comprennent : comme première mise en œuvre historique de la communauté universelle du genre humain définie par un dépassement des différences de classes, de nations et même de genres (saint Paul dans l’épître aux Galates : 3, 28). L’étude fouillée que consacre Kautsky à L’Origine du christianisme en 1908 est à cet égard fascinante. Il explique d’abord le succès du christianisme par l’originalité de la prédication de Jésus : alors que les Juifs attendait un messie politique restaurant la royauté davidique, c’est un messie social qui est venu, qui ainsi n’a parlé à aucune nation particulière et a pu être entendu par l’universalité de la communauté humaine, et a surtout parlé à tous les exclus, les pauvres, les gens de peu, les classes inférieures de la société, c’est-à-dire, pour user d’un mot romain, les prolétaires (proletarius, celui qui ne possède rien, si ce n’est ses enfants). Kautsky voit alors dans le christianisme primitif la première forme d’une internationale prolétarienne, caractérisée par la communauté des biens (Actes des apôtres : 2, 42-44 et 4, 32) et l’exclusion des riches (parabole du chameau dans l’évangile de Marc : 10, 25), et vivant dans l’attente du Grand Soir (première épître aux Thessaloniciens : 5, 1-3). Il y a là, disent Engels et Kautsky, l’expression de l’exigence maximaliste de réalisation, ici et maintenant, du royaume de Justice : mais expression qui, dans le contexte de l’époque, ne pouvait se faire que dans le discours religieux. La nouveauté de la pensée de Marx consiste alors à exprimer cette exigence dans le discours scientifique. D’où l’importance de lire Marx ainsi, et d’aborder la technicité conceptuelle de ses analyses : ce que j’ai tenté de faire dans Science et révolution. Marx est en effet un philosophe, et un philosophe difficile, que l’on ne peut pas aborder à mains nues : il faut être sérieusement équipé avant de se confronter à la phénoménologie des formes-valeurs, à la déduction de l’équivalent général ou aux analyses de la temporalité du travail et de son aliénation dans le salariat et la monnaie de crédit. Le problème est évidemment aussi qu’il est le philosophe le plus dévoyé de l’histoire, et que le XXe siècle n’a fait que discréditer les concepts de révolution et de communisme : mais c’est la responsabilité et l’honneur de la philosophie que d’arracher les concepts à leur instrumentalisation idéologique et à leur prostitution médiatique. La phénoménologie de Husserl, dans son impeccable rigueur, permet alors de mettre en évidence le statut ontologique de ces concepts, ce qui est d’autant plus remarquable que ce n’était pas du tout son propos à l’origine : c’est la probité de son itinéraire qui, dans les dernières années de sa vie, l’a conduit à réélaborer entièrement sa philosophie. Le tournant transcendantal opéré dans les années 1910 conduit Husserl à une perspective kantienne, qui postule que l’objet est entièrement réductible à la subjectivité, laquelle occupe le rang de fondement, de sol : la philosophie première est alors une égologie transcendantale. Tout son itinéraire le conduit à admettre que cette position est intenable : parce que la subjectivité doit être incarnée dans son corps vivant, parce qu’elle est dépendante d’un héritage historique seul à même de lui procurer ses idéalités, et surtout parce que dans son rapport même à l’objet elle dépend d’autrui : seule la « validation réciproque des significations » garantit l’objectivité de l’objet et me confirme qu’il n’est pas une hallucination subjective. L’objectivité ne peut pas être le corrélat de la subjectivité transcendantale, mais seulement d’une intersubjectivité transcendantale, laquelle doit être incarnée dans des corps vivants, située, précise Husserl, « sur le terrain de la praxis », et dans une histoire dont elle hérite. La philosophie première, conclut expressément Husserl, ne peut plus être égologie transcendantale, elle doit être « sociologie transcendantale ». Dans la mesure où cette société doit être saisie dans son unité originaire, elle doit être analysée dans ce que Husserl nomme sa « communisation transcendantale », elle doit en dernière instance compris comme « communauté constituante ». Le trajet de Husserl le conduit ainsi à fonder le sol de la subjectivité sur le sous-sol de la communauté, et à dépasser le subjectivisme par ce qu’il faut bien nommer un communisme. Élaboré philosophiquement, dans une perspective ontologique — et non plus messianiquement, dans une perspective éthique —, le communisme reconnaît la communauté historique des hommes réels, en chair et en os, debout sur la terre solide et bien ronde, comme fondement en dernière instance de tout phénomène humain : c’est bien ainsi qu’il fonctionne dans Le Capital, puisque toute la phénoménologie des formes-valeurs consiste à mettre en évidence que la valeur d’échange est irréductible à la subjectivité, mais qu’elle est le phénomène spécifique de la communauté comme telle, elle est un produit social (d’où l’illégitimité de son appropriation privative). Quand Marx parle de communauté, il ne parle pas de Gemeinschaft, qui est le mot le plus courant en allemand, mais de Gemeinwesen, littéralement das gemeine Wesen, « l’essence commune », « l’être commun » : la communauté circonscrit ainsi le domaine d’essence, c’est-à-dire le champ transcendantal à partir duquel il est possible au sujet d’être celui qu’il est. On peut alors sur ce fondement de droit analyser, soit le système des sciences (ce que fait Husserl), soit le dispositif de production (ce que fait Marx). Or c’est le même concept qui revient dans les deux cas, celui d’autonomisation (Verselbständigung en allemand). Husserl et Marx les premiers ont vu l’avènement d’un système objectif qui fonctionne de lui-même en lui-même, de façon automatique, un système d’objets devenu autonome par rapport à la communauté des sujets. Ce qui est devenu flagrant avec l’internet des objets : il y a aujourd’hui plus de dix milliards d’objets connectés (soit plus que d’être humains), et plus de deux milliards de connexions sont d’ores et déjà effectuées par des machines entre elles (les connexions M2M, machine to machine), de même qu’est devenue flagrante l’aliénation de la communauté, puisque l’emprise planétaire du Réseau a opéré une dissolution des communautés réelles, atomisées et pulvérisées en tant que communauté : Chamath Palihapitiya, ancien vice-président de Facebook, a récemment reconnu « avoir créé des outils qui déchirent le tissu social ». Ce sur quoi insistent alors Husserl et Marx, c’est que ce n’est plus la communauté intersubjective qui est instance constituante, c’est l’universalité objective : c’est vrai dans les sciences, où c’est l’idéalité mathématique qui est principe de constitution, et c’est vrai aussi dans le capitalisme, où c’est la valeur d’échange qui est principe de la production. C’est donc ici qu’est mis en évidence l’inversion, le retournement du sujet et de l’objet qui définit autant la crise des sciences européennes que la crise économique. Les concepts d’« inversion » (Verkehrung) et de « retournement » (Umkehrung) se trouvent autant chez Marx que chez Husserl, et ils définissent alors une tâche urgente et impérative : remettre sur ses pieds ce système qui marche sur la tête, renversement qui définit la révolution. Husserl lui-même parle constamment de « révolution », et définit la refondation terminale de la rationalité comme « une révolution, la plus grande de toute » : mais la reconduction que lui-même opère de la science à la technique impose d’admettre que cette révolution ne peut pas être seulement théorique, elle doit être pratique, et c’est celle que Marx a conçue. La révolution communiste n’a aucun rapport, vraiment aucun, avec ce qui s’est prétendu tel au XXe siècle : elle est la réappropriation par la communauté humaine de son essence aliénée dans le système des objets.
BR : « Réappropriation de l’essence aliénée dans le système des objets », mais également de l’habitation du monde aliénée par le devenir-banlieue du lieu (que vous décrivez dans L’époque de la technique). Vous écrivez en effet : « La communauté définit tout à la fois les habitus, les habitudes et les habiletés de ses membres : et c’est en cela qu’elle est une modalité déterminée d’habitation du monde, qui devient par là le monde commun, l’habitat » (Science et révolution, page 188). Ainsi donc la communauté n’est-elle pas seulement communauté de travail…
JV : Bien sûr que non, elle ne peut pas être seulement communauté de travail. Mais elle l’est d’abord : il y a là ce que L’Idéologie allemande appelle les « présuppositions réelles, dont on ne peut faire abstraction qu’en imagination ». Avant toutes choses, il faut être bien nourri. Dans ses Carnets de captivité rédigés en Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale, Emmanuel Levinas l’a noté : « Au commencement il y avait la faim, comme un spasme énorme dans l’être ». La faim est en effet la faille primordiale qui tenaille et torture la chair vivante, qui interdit la quiétude et l’immobilité, qui fait de l’existence une constante inquiétude, la motive au travail et lui impose de s’ouvrir au monde. Sans la satiété, il n’y a pas de communauté, et il n’y a même rien d’humain : pendant la famine en Ukraine en 1933, les parents mangeaient leurs enfants, ou déterraient les cadavres tout juste inhumés pour s’en nourrir. Et pour nous les hommes, animaux sans organes, la satiété présuppose non seulement la production de biens de consommation, mais aussi la production de moyens de production : une communauté ne produit donc jamais avec des moyens naturels (des organes), mais avec des moyens produits (des outils, plus généralement des savoir-faire) par des générations précédentes, dont elle hérite. Même si on voulait la définir uniquement par le travail, il faudrait ajouter cette dimension d’héritage et de mémoire, de rapport à un passé, la communauté ne connaît donc aucun « état de nature », elle est fondamentalement historique. C’est pourquoi il est impossible de matérialiser cette communauté, puisqu’elle est faite de plus de passé que de présent, son héritage est la survivance en elle des générations mortes : quand Marx écrit dans Le 18 Brumaire de Louis-Bonaparte que « la tradition de toutes les générations mortes pèse comme un fantôme sur le cerveau des vivants », il circonscrit l’essence originaire de la communauté. La communauté (das Gemeinwesen) en tant qu’essence commune (das gemeine Wesen) circonscrit donc le legs d’un passé, le rassemblement de ce qui a été (das Gewesen). L’essence commune à la communauté, c’est un héritage commun ; cet héritage est le produit du travail des morts. Wesen ist was gewesen ist disait déjà Hegel, l’essence est le rassemblement de ce qui a été, recueil de la quintessence d’une production antérieure, qui fournit ainsi à la production actuelle sa réserve de possible et fonde l’existence présente, elle circonscrit ainsi le champ transcendantal. Ce qui rejoint donc la définition de la communauté par le deuil et son institutionnalisation, c’est-à-dire la reconnaissance de l’essence spectrale de l’esprit. Une communauté est faite de plus de morts que de vivants, de plus d’absence que de présence, de plus de mémoire que de matière. Mais cela ne suffit pas encore à définir une communauté. Que ce soit dans le travail en commun où dans la transmission de la mémoire, la communauté se définit par l’échange, non pas seulement de choses, mais de significations. La communauté est en cela dialogue, elle se définit tout aussi essentiellement par le langage. « La langue elle-même est tout autant le produit d’une communauté qu’elle est elle-même l’existence de la communauté (das Dasein des Gemeinwesens) et son existence parlante », disait Marx : la langue est ainsi à la fois un héritage (fantomal, spectral) des générations mortes, et le lieu même de la communauté (on pourrait traduire « das Dasein des Gemeinwesens » par « l’être-là de l’essence-commune », si l’on voulait heideggerianiser). Dire comme le fait Marx ici que « la langue elle-même est le produit d’une communauté », c’est la fonder sur une production, une poïèsis, c’est pourquoi le second Heidegger a pu reconnaître une telle importance à la poésie. Celle-ci ne renvoie pas à un simple sous-genre littéraire, elle désigne l’institution originaire de la langue, ce qui pendant des millénaires a ouvert et configuré l’espace-temps commun de chaque communauté : le peuple juif habite la parole de ses prophètes, le peuple grec la parole de Homère, chaque peuple s’est situé dans un mythe fondamental rapporté par les bardes, les druides, les aèdes, etc., les peuples modernes se sont aussi constitués en nations par l’élaboration d’un canon d’œuvres classiques. Contrairement à ce que croyait le second Heidegger (qui n’envisage jamais la dimension idéologique du langage), la poésie ne suffit certainement pas pour instituer une communauté et pour faire de la politique : mais elle a son importance. C’est à partir d’une parole primordiale et de sa transmission que se décide de l’habitation du monde, c’est-à-dire que se configure un régime de vérité, qui prédétermine chacun d’entre nous. Si le soleil m’apparaît comme un astre et non comme un dieu, ce n’est ni par un libre choix ni par ma perspicacité naturelle, mais parce que j’appartiens à une certaine communauté, à une certaine époque, dont la phénoménalité est structurée par la rationalité scientifique, par un certain discours et sa transmission. C’est-à-dire dans un espace commun qui a accompli le projet platonicien de La République d’éradiquer les poètes de la Cité pour imposer l’hégémonie du logos, qui accomplit donc la métaphysique. Et c’est bien ce qui caractérise l’espace-temps commun aujourd’hui : le spectacle, le cyberespace, c’est-à-dire un univers numérique où tout est déterminé par le nombre, par l’abstraction du plan mathématique, et qui surtout est un espace non-local (au sens où l’on parle d’espace non-local en physique quantique). C’est pourquoi il faut en effet constater un bannissement du lieu et une universalisation de la banlieue : c’est-à-dire une fin du monde. Mais il faut ici user avec précision de concepts rigoureux : parler de fin du monde ne signifie pas annoncer la destruction de la planète terre, il s’agit de constater un événement qui a déjà eu lieu, et ce à partir du concept de monde tel qu’il a été élaboré par la phénoménologie. L’espace originaire est monde, c’est-à-dire qu’il est le déploiement d’un horizon (la « mondanéité ») sur fond duquel les choses s’ordonnent en un tout cohérent, et se situent ainsi dans la différence entre le proche et le lointain, entre la terre et le ciel : l’ensemble de ce qui prend place dans cet horizon est ce qui définit un monde. Le lieu originaire à partir duquel se déploie cet horizon et à partir duquel les choses prennent sens, peut être religieux, politique ou artistique, et il y a ainsi de nombreux mondes différents qui se sont succédés dans l’histoire : le monde chinois, le monde grec, le monde chrétien ou le monde inuit sont très différents, et sont autant de façons d’habiter une même terre. Parler de fin du monde, c’est alors constater que la spatialisation, l’aménagement de l’espace d’habitation des communautés humaines, n’est plus mondanéisation, mais développement d’un plan universel abstrait, ce qui saute aux yeux dans l’urbanisation de l’espace, le bétonnage universel et la mise en place d’un gigantesque réseau de circulation : c’est pourquoi j’avais esquissé dans mon premier livre une analyse de l’histoire de l’urbanisme. Cette abstraction de la spatialité atteind alors son acmé dans le cyberespace, qui est cyberspatialisation. À partir du moment où le seul espace commun est celui du cyberespace, défini par la non-localité, qui se déploie à partir de la seule puissance du calcul, alors il n’y a plus de mondes : il y a un univers, déploiement spectaculaire de l’universalité numérique. C’est à tort que l’on parle de « mondialisation », il y a en réalité universalisation, et celle-ci est démondanéisation, elle pulvérise toutes les contrées et les dissout dans l’espace unique et homogène de l’univers numérique. Il reste sans aucun doute des mondes, puisque nous restons malgré tous des être en chair et en os debout sur la terre solide et bien ronde, mais le fait est que le monde environnant de nos pratiques quotidienne est lui-même situé par rapport à cet universel. D’abord parce que nous avons constamment conscience de l’univers tel qu’il nous est représenté (« en temps réel ») par le dispositif médiatique et que nous préoccupons sans doute plus de son spectacle que de ce qui nous entoure immédiatement. Et aussi parce que nos pratiques sont de plus en plus régulées et paramétrées (cybernétiquement) par cet espace numérique : des dispositifs comme le GPS ou GoogleMap sont ici particulièrement significatifs, puisque notre expérience corporelle du monde environnant s’y trouve médiatisée et déterminé par les coordonnées d’une cartographie planétaire numérisée. Mais il faut alors expliquer ce processus à partir de ses bases réelles, c’est-à-dire de l’avènement du marché mondial, en reconnaissant que celui-ci n’est pas un lieu d’échanges de marchandises (comme l’étaient les marchés avant l’avènement du capital), mais un lieu de circulation de valeurs, pures formes idéelles délestées de toute matérialité, où ce n’est plus l’argent qui sert à échanger des marchandises, ce sont les marchandises qui servent à faire circuler l’argent.
Suite et fin de l’entretien à cette adresse.







