Acheter le tome 1 des Oeuvres complètes
Acheter l’ouvrage de Ruedi Imbach
« Aguzza qui, lettor, ben li occhi al vero »
« Aiguise ici, lecteur, ton regard sur le vrai »
Purgatoire, VIII, 19.
Depuis le mausolée ravennate où repose le plus grand poète d’Occident après Virgile, l’autre pèlerin de l’Enfer, une voix s’élève : « Tu non pensavi ch’io loïco fossi » (Inferno, XXVII, 122). La formule, prononcée par le diable à l’adresse de Dante au chant XXVII de l’Enfer, mérite d’être attribuée au Florentin lui-même, avec plus de raison depuis une double parution dont il faut se réjouir. Première publication notable : le premier tome des Œuvres complètes[1] de Dante, traduit, annoté et richement préfacé par Bruno Pinchard. Le volume contient Il Convivio (Le Banquet), célèbre traité de Dante, « un des textes les plus difficiles de la tradition médiévale lisible en français », traduit et interprété « en faveur de la philosophie »[2]. Seconde publication sur Dante, d’un autre genre mais dans l’exacte continuité : un recueil d’études dantesques de Ruedi Imbach réunies sous le titre Portrait du poète en tant que philosophe. Sur la philosophie de Dante Alighieri[3]. L’ouvrage se confronte à l’exercice délicat du portrait philosophique : donner un « point de vue philosophique sur l’œuvre de Dante » et « représenter quelqu’un qui s’est vu et compris lui-même comme philosophe »[4], quoique petit parmi les philosophes authentiques : « inter vere philosophantes minimus » ou « phylosophorum minimum »[5].
Ces deux publications apportent-elles du nouveau ? Que Dante soit l’auteur d’une œuvre philosophique est un fait bien connu. Qu’il ait fait œuvre de philosophe l’est moins. Or il ne suffit pas de dire que le Banquet, avec la Monarchie, est un traité de philosophie : il faut encore le prouver. Ce à quoi Bruno Pinchard consacre sa longue introduction et les commentaires de sa traduction.
Le Banquet : œuvre de philosophie, œuvre de philosophe
 Rappelons les faits. Béatrice meurt – date traditionnellement fixée et communément admise – le 8 juin 1290, début d’une période de troubles extrêmes pour Dante, durant laquelle il fait deux lectures décisives : le De consolatione philosophiae de Boèce et le De amicitia de Cicéron. Doté d’une formation de poète et d’orateur, il se sent alors appelé à une vocation philosophique, tel saint Augustin lisant l’Hortensius. Il suit alors l’enseignement des religieux dominicains et franciscains de Florence et participe aux débats philosophiques qui se tiennent dans la cité. Vers 1293-1295, il rassemble ses poèmes de jeunesse et présente un livre intitulé Vita nuova où il rapporte l’histoire de son amour de jeunesse pour Béatrice, dans un style de poésie amoureuse nouveau : le « dolce stil novo ». À cette même époque (1293-1296), il s’essaie à de grandes chansons (canzoni) d’amour et de vertu, comme il les nommera lui-même, qui racontent comment il est passé de son premier amour, Béatrice, à l’amour de la philosophie. Prieur de Florence pendant trois mois en 1300, puis déchu et condamné à l’exil lors de la prise du pouvoir de la ville par les Guelfes noirs en 1302, Dante erre d’un château l’autre. Cette errance et méditation désenchantées, celle du pèlerin au commencement de la Divine comédie, donnent naissance à une idée : reprendre quatorze de ces « canzoni » largement allégoriques de ses trente ans et en faire une « sorte d’encyclopédie de tous les savoirs dans laquelle il tentera de se donner le profil d’un homme épris de perfection intellectuelle répondant à l’appel amoureux d’une « philo-sophie » qui, enfin, mériterait son nom dans l’intégralité de sa signification »[6]. Le Banquet est né en ces années 1304-1307/1308, selon Pinchard, alors que Dante approche des quarante ans. Le projet le poursuivra jusqu’à l’âge de 45 ans, âge de maturité tardive où il finira par s’atteler à la rédaction de la Comédie.
Rappelons les faits. Béatrice meurt – date traditionnellement fixée et communément admise – le 8 juin 1290, début d’une période de troubles extrêmes pour Dante, durant laquelle il fait deux lectures décisives : le De consolatione philosophiae de Boèce et le De amicitia de Cicéron. Doté d’une formation de poète et d’orateur, il se sent alors appelé à une vocation philosophique, tel saint Augustin lisant l’Hortensius. Il suit alors l’enseignement des religieux dominicains et franciscains de Florence et participe aux débats philosophiques qui se tiennent dans la cité. Vers 1293-1295, il rassemble ses poèmes de jeunesse et présente un livre intitulé Vita nuova où il rapporte l’histoire de son amour de jeunesse pour Béatrice, dans un style de poésie amoureuse nouveau : le « dolce stil novo ». À cette même époque (1293-1296), il s’essaie à de grandes chansons (canzoni) d’amour et de vertu, comme il les nommera lui-même, qui racontent comment il est passé de son premier amour, Béatrice, à l’amour de la philosophie. Prieur de Florence pendant trois mois en 1300, puis déchu et condamné à l’exil lors de la prise du pouvoir de la ville par les Guelfes noirs en 1302, Dante erre d’un château l’autre. Cette errance et méditation désenchantées, celle du pèlerin au commencement de la Divine comédie, donnent naissance à une idée : reprendre quatorze de ces « canzoni » largement allégoriques de ses trente ans et en faire une « sorte d’encyclopédie de tous les savoirs dans laquelle il tentera de se donner le profil d’un homme épris de perfection intellectuelle répondant à l’appel amoureux d’une « philo-sophie » qui, enfin, mériterait son nom dans l’intégralité de sa signification »[6]. Le Banquet est né en ces années 1304-1307/1308, selon Pinchard, alors que Dante approche des quarante ans. Le projet le poursuivra jusqu’à l’âge de 45 ans, âge de maturité tardive où il finira par s’atteler à la rédaction de la Comédie.
L’acte de naissance de la philosophie dantesque est, historiquement et à grands traits, posé. L’ouvrage que nous tenons entre les mains devait contenir quinze livres, un livre par canzone, les quatorze précédés d’un traité dédié à la justification d’un commentaire en vulgaire de poèmes écrits en vulgaire. Des quinze prévus, Dante n’en rédigera que quatre : le premier évoqué précédemment, suivi de trois livres exposant successivement « le passage de l’amour courtois à la philosophie, la forme de félicité réservée à l’amoureux de la sagesse, et, pour finir, une conception révolutionnaire de la noblesse remettant en cause le privilège des élites féodales au profit d’individualités vertueuses douées d’une nature favorable »[7]. Inattendu pour un lecteur fidèle de Dante, le Banquet est en outre une œuvre inachevée. « Simple détour dans une trajectoire principalement poétique »[8] ? La question mérite d’être posée – comme on s’interroge au sujet de l’Apologie pascalienne –, et l’œuvre, selon Pinchard, mérite plus qu’un détour, « quand [des] nœuds de civilisation sont remis entre les mains d’un homme et d’un créateur tels que Dante »[9]. Dernier des médiévaux et premier des humanistes, Dante demeure une énigme : on ne sait comment intégrer ses différentes œuvres au corpus dantesque. Malgré un foisonnement tout augustinien dans la diversité des genres et des combats, ainsi qu’une langue philosophique qui témoigne d’une bonne connaissance d’Aristote à travers saint Thomas et la scolastique, on voit se dessiner, chez le poète florentin, la figure de l’artiste total qui a connu tant de succès depuis le Trecento, des Renaissants aux écrivains du XXe, en passant par l’idéal encyclopédique des Lumières.
Dans cette œuvre totale, quelle place tient la philosophie ? Que fait le poète florentin en philosophie, voire de la philosophie ? L’alternative, selon Pinchard, est simple : « Ou bien Dante philosophe n’est qu’un petit scolastique pointilleux et labyrinthique », d’où le manque d’intérêt pour le Banquet et le retard du commentaire métaphysique du traité ; « ou bien il parle dans l’élément de l’esprit de l’Occident, au moins tel qu’il tente de se saisir depuis la fin des croisades. Si, poète, il fut comparé à Homère, il ne faut pas une moindre échelle de temps pour le reconnaître philosophe »[10]. Nous ne brisons aucun secret en révélant d’emblée la position de Pinchard : Dante, selon lui, n’est ni un théologien scolastique ni un maître de logique, deux figures réservées aux gens de savoir de son temps. « Il a été poète, et le sera bientôt à nouveau sous un mode définitif. Mais, en cet instant unique, il est philosophe, une figure d’humanité abolie en son temps depuis plus de mille ans peut-être. Dante n’a pas inventé seulement la terza rima, il a réinventé la philosophie, c’est-à-dire un goût de la perfection qui se fonde sur les raisons naturelles de l’humanité »[11].
Avant d’être un ouvrage de philosophie, le Banquet est le « livre des aveux » : ils constituent « son charme et son piège »[12]. Le Banquet est une œuvre de confession, confession d’un poète chrétien et – imaginairement – veuf qui sait avoir cédé au « développement intérieur [d’un] désir philosophique »[13] et avoir ainsi trahi sa vocation première – la poésie –, son amour de toujours – Béatrice – et, en un sens, son Dieu : la sophia des philosophes ne se confond pas exactement avec la sagesse chrétienne, nous le verrons. Œuvre de confession qui envisage, à l’issue, une reconstruction. Avant de nous édifier, Dante s’édifie lui-même, tente de rebâtir une existence malmenée par la mort de Béatrice et l’exil. En cela, selon Pinchard, le Banquet est le « point de départ d’autres proses de Dante qui en sont les prolongements évidents : le Traité de l’éloquence vulgaire, qui y est annoncé explicitement, La Monarchie qui n’en est qu’un développement particulier, la Question de l’eau et de la terre, qui précise les rapports entre la terre et la mer dans le cadre d’une réflexion physique sur la structure de l’univers. Quant à la Lettre XIII, qui propose une première interprétation du grand poème, sa structure, précisément, de commentaire d’une œuvre poétique ressemble trop au dessin du Banquet pour ne pas révéler une fidélité sans éclipse à la philosophie. Elle seule suffirait à faire de la Comédie non pas le dernier mot de la parole dantesque qu’on veut y voir, mais le schème effectif d’une vérité trouvée autrement et pensée ailleurs »[14].
Ces derniers mots sont décisifs. De quelle vérité s’agit-il ? Pourquoi Dante l’a-t-il esquissée dans le Banquet ? Et en quoi la pensée philosophique du Florentin est-elle si originale, au point de faire dire à Pinchard qu’il « est impossible de prendre assez au sérieux l’audace du Dante philosophe »[15] ? L’originalité linguistique de l’œuvre, on le sait, réside dans le recours à une langue vernaculaire, là où le De Monarchia sera rédigé en latin. À cette nouveauté sur le plan de la langue correspond une singularité philosophique : « Sous les auspices du dire poétique, la renaissance du vulgaire chez Dante, c’est d’abord le retour du Vates dans la civilisation de la Foi. Dante a eu la chance d’en être l’acteur à la fois souverain et conscient »[16]. Or cette résurrection poétique et prophétique va de pair avec un « besoin de rationalisation », l’autre « vocation de l’Occident » selon Malraux. « Loin de toute tentation apophatique, le cheminement avec Dante dans la puissance amoureuse du poème ouvre des voies nouvelles à la connaissance, une connaissance rationnelle de l’absolu », qui deviendra connaissance absolument rationnelle : « tout le Banquet enseigne que c’est par l’usage de la raison que l’amour atteint son accomplissement »[17]. Il y a donc continuité dans l’œuvre dantesque : celui qui chantait et chantera la gloire de l’amour dans ses canzone honore dans le Banquet son nouvel amour, celui de la raison.
Il y a donc bien, dans la vie de Dante, « une période d’enthousiasme et d’ardeur passionnée pour questa donna gentilissima Filosofia », ainsi que l’écrit Gilson dans son Dante et la philosophie. « Enthousiasme pour la beauté intellectuelle pure d’une science qui, par l’amour qu’elle inspire, affranchit l’âme de la douleur »[18]. La Philosophie est une donna, comme chez Boèce, au moins aussi séduisante que la Béatrice céleste. La grande défaite que narre le Banquet est celle, pour Dante, de n’avoir pu se tenir fidèlement à la mémoire de Béatrice défunte et de s’être épris d’une autre femme, une certaine Noble dame, déjà rencontrée dans la Vita nuova, mais repoussée alors comme une tentatrice. Aussi le Banquet fait-il figure à la fois de drame courtois, où est raconté « l’oubli de Béatrice pour le Noble dame », et de drame politique, portant sur « la déchéance de la noblesse dans l’histoire »[19]. Mort de l’être aimé et exil politique : les deux tragédies de la vie de Dante. Où se situe, dans ce cas, le drame philosophique ? Assurément dans la réflexion jamais achevée entre la nature et la grâce, où la première gagne une autonomie rarement envisagée chez les théologiens médiévaux jusque-là. En effet, la « sagesse de la Dame philosophie procède d’une Nature totale. Cette Nature est la première grande construction du pouvoir créateur de Dante »[20]. Loin de soumettre tout à un déterminisme inexorable, le savoir aristotélicien de la Physis, prolongé par Dante, engage le cosmos dans un « naturalisme de la restitution », selon l’expression de Pinchard : la nature ne subit pas, elle se rénove.
Résumons. Le Banquet s’ouvre sur l’idée d’une « Nature première » ou universelle et ne se départira pas de ce point de départ. Sous la « providence » d’une Nature première, toute chose va à sa perfection, selon Dante. Or notre âme ne connaît d’autre perfection que la science : elle ne trouvera son bonheur que dans celle-ci. Ce syllogisme dantesque témoigne d’une recherche de l’ultime, ultime perfection et ultime félicité. À l’évidence, cette Nature sera nommée Dieu, mais, comme le souligne Pinchard, c’est « Dieu rencontré comme Physis, avant qu’elle ne lui soit soumise au nom des lois de la surnature ». « L’enquête est naturaliste avant d’être soumise à une Sagesse révélée, qu’elle n’accueillera qu’à partir de ses propres principes et ses propres promesses de bonheur »[21]. Dante, en cela, est plus aristotélicien que saint Thomas d’Aquin et d’autres théologiens médiévaux, du moins sur le plan cosmologique. Il renverse les priorités. On comprend pourquoi Gilson plaidera, dans le cas du Banquet, pour un Dante sorti d’une « crise de philosophisme pur » dont il garde des traces[22]. Le philosophisme pur, chez Gilson, concerne des philosophes aussi différents qu’Aristote, Plotin et Spinoza ; des philosophes qui ont donné une « réponse métaphysiquement pure à cent pour cent, à la question de savoir comment réaliser le salut de l’homme au moyen de la seule philosophie »[23].
Est-ce vraiment le cas de Dante dans le Banquet ? Le Florentin ne tomberait-il pas plutôt sous l’autre jugement rédhibitoire qu’Étienne Gilson a adressé au saint Augustin philosophe comme au Malebranche philosophe, à savoir qu’ils n’ont, au fond, jamais eu la « philosophie de leur théologie » ? Descartes lui-même n’a-t-il pas reformulé « les principales conclusions de la théologie naturelle chrétienne, comme si la théologie surnaturelle chrétienne n’avait elle-même jamais existé »[24] ? Dante pourrait se prêter à une telle critique. Pinchard partage l’œuvre de Dante à partir d’une opposition simple : « avant la Faute, après la Faute »[25]. Le Banquet, et d’une façon générale, l’œuvre philosophique de Dante, présenterait une nature d’avant la Faute. « Bien sûr c’est une nature qui peut présenter des manques, des défauts, des empêchements, mais il y règne une terre et un ciel où le plus beau des anges n’est pas encore tombé ». Viendrait ensuite la Comédie, « grandiose vision du poids de la Faute sur les hommes et le cosmos tout entier, où la Faute est l’accident organisateur qui décide de la réécriture de l’histoire du monde ». Un signe permet à Pinchard et d’autres interprètes de justifier cette distinction : dans le troisième Traité du Banquet, l’axe organisateur du cosmos descend directement de l’étoile polaire et traverse la terre pour rejoindre le pôle Sud. Dans la Comédie, ce même axe est dévié : il conjoint Jérusalem, pôle du salut, et la Purgatoire sous la terre, île des futurs bienheureux, « seule partie des terres émergées qui porte encore à son sommet des traces de Paradis terrestre ». L’axe organisateur n’est plus cosmologique mais salvifique. L’œuvre de Dante, selon Pinchard, aura suivi successivement ces deux axes : « la philosophie décrit le monde réversible, sans frottement, innocent ; la poésie est le grand chant de la Faute et de la Rédemption »[26]. Notre époque universitaire ose si rarement de telles distinctions nettes – seul moyen de penser – et radicales, surtout lorsqu’il s’agit de distinguer pour, finalement, unir la philosophie et la littérature, que nous avouons être assez convaincu par ce dédoublement si propre à Dante. Le Florentin ne distinguait-il pas – et avec soin encore –, dans la Monarchie, les « phylosophica documenta » et les « documenta spiritualia », pour mieux montrer combien l’un dépend de l’autre ?
Pour autant, on peut légitimement s’inquiéter de ce mouvement de naturalisation vers lequel Dante pousse l’orthodoxie religieuse, et ce moins dans la perspective d’un « salut promis » que d’une « perfection retrouvée, selon une promesse plus virgilienne que paulinienne »[27], commente Pinchard avec raison. La question du désir naturel de Dieu, qui a fait gloser les théologiens jusqu’à ce jour, trouve chez Dante une expression parfois outrée. Puisque, selon Dante, la « volonté d’être » en Dieu est un fait de nature – « naturalissimo è in Dio volere essere » –, l’âme voudra être unie à Dieu pour fortifier son propre être. La personne du Fils, mise de côté par ce christianisme cosmologique, intervient plus tard comme agent d’une re-formation, d’une « rénovation de la forme dans son actualité »[28]. Cette restauration trouvera un nom inattendu dans le quatrième Traité : celui de noblesse. « Dante réveille la noblesse du monde et c’est là son secret le plus réservé », écrit justement Pinchard. Or cette noblesse procède de la nature quand elle règne dans sa plénitude et s’ouvre les voies de la joie. Nulle ivresse de l’infini, donc, mais une noblesse qui consiste, pour la nature, à accomplir sa fin déterminée, c’est-à-dire « l’actualisation maximale dans les limites qui sont les siennes ». Le Banquet cherche à « restituer son actualité au monde »[29] et à l’homme, tâche christique par excellence, mais que le Dante aristotélicien donne à la raison humaine d’accomplir seule, après avoir redéfini les termes du salut.
Redéfinition non négligeable, qui nous permet d’entrer dans l’autre grand enjeu du Banquet, et de la philosophie de Dante en général. Selon Pinchard, le Banquet est une Vita nuova, Béatrice en moins. Les conséquences sont foudroyantes. « D’abord il faut avoir le courage de congédier Béatrice, ensuite il faut expliquer qu’on ne la remplace pas par une femme bien vivante et munie d’attraits faciles, mais par un pouvoir transcendant à visage d’impassible impératrice, enfin il faut apprendre à aimer en dehors de la nostalgie du tombeau et d’une Florence sans retour. La vie veuve de Dante est devenue pouvoir assumé de création »[30]. Autrement dit, l’exil devient un terrain d’expérience : sur qui ou sur quoi le grand poète et savant va-t-il porter maintenant le désir infini qui, tels les païens dans le premier cercle de l’Enfer, brûle éternellement sans accomplissement ? « Dante est l’homme le plus passionnément présent au monde et le plus absent du monde », résume admirablement Pinchard. « Il faut cesser de n’aimer Dante que pour son authenticité et apprendre à l’aimer au point d’articulation entre le tremblement de son souffle et les lois éternelles de sa réflexion souveraine »[31]. Rien n’échappera à une telle puissance de la raison.
Dieu, le philosophe et l’empereur
Voilà le second grand enjeu du Banquet, disions-nous : la nature et la grâce déclinées dans l’histoire. Si le Banquet raconte bel et bien le « banquet de mariage de Dante avec la Noble dame »[32], il a un préalable épistémologique, lourd de conséquences dans le rapport que la philosophie entretient avec la théologie. Ce préalable se joue, chez Dante, dans une allégorie cosmologique connue. Dans le deuxième Traité, en effet, Dante classe les sciences en fonction de dix ciels, correspondant au Trivium et au Quadrivium de l’Université médiévale : Grammaire, Dialectique, Rhétorique, Arithmétique, Géométrie, Astrologie, Musique. À ces sept sciences s’ajoutent, selon un ordre propre à Dante, la Physique et la Métaphysique, qui répondent au Ciel des fixes, l’Éthique au Premier mobile ou Ciel cristallin et, pour finir, la Théologie à l’Empyrée. Telle est la grande originalité épistémologique de Dante : la Métaphysique apparaît, dans le Banquet, comme une science seconde par rapport à l’Éthique, plus haute science humaine face à l’éminence divine de la Théologie (Convivio, II, XIV, 14). Pire, Dante aligne la Physique et la Métaphysique sur un seul ciel (Convivio, II, XIV, 1). Pourquoi, venant d’un disciple d’Aristote, le Virgile du Banquet, un tel manquement à la doctrine péripatéticienne ?
Pinchard tempère l’innovation dantesque. Certes, les lignes de Dante sur le sujet ont suscité, notamment depuis les analyses de Gilson, « l’idée que Dante avait inauguré ici le tournant humaniste de la philosophie, qui soumet la Métaphysique à l’Éthique »[33]. Cependant, selon Pinchard, la suite du Banquet reviendra au primat de la contemplation sur l’action, en insistant sur la parfaite félicité conférée à l’acte intellectuel (Convivio, III, XV, 7). Le pouvoir de la philosophie morale serait d’abord, à cet égard, un « pouvoir d’influences et de fécondation ». « Le primat de l’Éthique, c’est d’abord le primat de la semence divine de la noblesse sur les actes qu’elle gouverne. Ce naturalisme astral se substitue ici à la philosophie morale purement rationnelle, comme à l’idée moderne d’un délaissement de l’ontologie en faveur du seul agir ». Ailleurs, Pinchard répète que les deux derniers Traités du Banquet tendront à « restituer à la Philosophie sa dimension spéculative et rappelleront le primat indiscuté de la Philosophie première ». En bref, Dante s’excuserait dès le Traité III de ses considérations du Traité II. L’hypothèse convainc peu. Néanmoins, on peut sans difficulté donner raison à Pinchard lorsqu’il estime que « l’interprétation essentiellement pratique de Dante repose ainsi sur la pérennisation d’un moment de son parcours »[34].
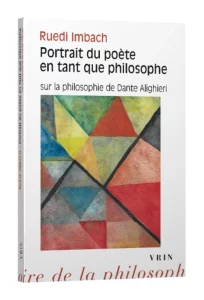 Sur cette même question, Ruedi Imbach mâche moins ses mots. Soulignant la profonde nouveauté au Moyen Âge d’une formule comme « la moralitade e belleza della Filosofia », la morale est la beauté de la philosophie » (Convivio, III, XV, 11), Imbach parle volontiers d’une « nette primauté de la raison pratique »[35], allant jusqu’à comparer cette intuition au primat moral chez Kant. En revanche, il tombe dans le travers justement désigné par Pinchard lorsqu’il écrit : « Cette primauté de la philosophie pratique vaut également pour la Commedia et son interprétation ». Imbach, en effet, considère comme l’une des « affirmations les plus importantes de toute la Comédie » celle de Béatrice à Virgile, au second chant de l’Enfer : « on doit craindre les seules choses / qui ont le pouvoir de faire le mal à autrui / les autres non ! Elles ne sont pas redoutables » (Inferno, II, 88-90). Pourquoi « pérenniser » un moment du parcours dantesque ? Imbach va encore plus loin dans son étude intitulée « Dante et la tradition philosophique », écrivant que « toute l’extraordinaire mise en scène de la Comédie doit être envisagée sous l’angle de l’éthique dont le principe fondamental est ici exprimé par Béatrice »[36]. Conscient de sa « provocation », Imbach a raison de dire que Dante « parle de l’au-delà pour inviter les hommes à mieux vivre ici-bas ». Pour autant, l’articulation entre philosophie et théologie, chez Dante, ne se confond jamais avec celle entre philosophie pratique et philosophie spéculative, encore moins avec celle entre éthique et métaphysique. Le primat de la morale sur la métaphysique n’abolit en aucune façon la transition bien signifiée par Dante entre les régions que Virgile, symbole de la raison naturelle, peut explorer, et celle où il doit faire appel à d’autres, Béatrice ou saint Bernard. D’où l’importance de lire attentivement le Banquet. « Nous gagnons notre Comédie en décidant de notre Banquet »[37], selon la formule de Pinchard.
Sur cette même question, Ruedi Imbach mâche moins ses mots. Soulignant la profonde nouveauté au Moyen Âge d’une formule comme « la moralitade e belleza della Filosofia », la morale est la beauté de la philosophie » (Convivio, III, XV, 11), Imbach parle volontiers d’une « nette primauté de la raison pratique »[35], allant jusqu’à comparer cette intuition au primat moral chez Kant. En revanche, il tombe dans le travers justement désigné par Pinchard lorsqu’il écrit : « Cette primauté de la philosophie pratique vaut également pour la Commedia et son interprétation ». Imbach, en effet, considère comme l’une des « affirmations les plus importantes de toute la Comédie » celle de Béatrice à Virgile, au second chant de l’Enfer : « on doit craindre les seules choses / qui ont le pouvoir de faire le mal à autrui / les autres non ! Elles ne sont pas redoutables » (Inferno, II, 88-90). Pourquoi « pérenniser » un moment du parcours dantesque ? Imbach va encore plus loin dans son étude intitulée « Dante et la tradition philosophique », écrivant que « toute l’extraordinaire mise en scène de la Comédie doit être envisagée sous l’angle de l’éthique dont le principe fondamental est ici exprimé par Béatrice »[36]. Conscient de sa « provocation », Imbach a raison de dire que Dante « parle de l’au-delà pour inviter les hommes à mieux vivre ici-bas ». Pour autant, l’articulation entre philosophie et théologie, chez Dante, ne se confond jamais avec celle entre philosophie pratique et philosophie spéculative, encore moins avec celle entre éthique et métaphysique. Le primat de la morale sur la métaphysique n’abolit en aucune façon la transition bien signifiée par Dante entre les régions que Virgile, symbole de la raison naturelle, peut explorer, et celle où il doit faire appel à d’autres, Béatrice ou saint Bernard. D’où l’importance de lire attentivement le Banquet. « Nous gagnons notre Comédie en décidant de notre Banquet »[37], selon la formule de Pinchard.
L’apologie dantesque de la philosophie pratique mérite donc d’être intégrée à l’hymne plus général à la philosophie. Gilson résume ainsi l’enjeu : « Le Banquet repose en effet tout entier sur ce principe ou, si l’on préfère, sur cet espoir, que l’homme peut, grâce à la philosophie, trouver une consolation à ses misères dans la béatitude du sage »[38]. Il ne s’agit donc pas tant de savoir si, chez Dante, la métaphysique est une science supérieure ou plus digne que la morale, mais de comprendre comment Dante donne une autonomie à l’ordre temporel et à l’activité de l’intellect humain, capable de trouver une certaine béatitude ici et maintenant par la philosophie. Telle est la véritable originalité dantesque, que Pinchard résume habilement ainsi : « Cet hymne à la Philosophie dépourvu de toute référence théologique pourrait être celle d’un Maître ès art de la Faculté de Paris luttant contre les Maître en théologie »[39]. Le procès fait à Dante d’être un disciple d’Averroès et de Siger de Brabant s’ouvre ici.
La thèse des deux béatitudes trouve son expression la plus claire et approfondie non dans le Banquet, mais dans la Monarchie. Elle a un fondement bien précis, issu de la définition que Dante donne de l’homme. Ce dernier étant à la frontière du monde corruptible et de la réalité incorruptible, il est orienté vers deux fins : la béatitude de cette vie, « qui consiste en l’épanouissement de ses vertus propres et qui est représentée par le paradis terrestre », et la béatitude de la vie éternelle, « qui consiste à jouir de la vision de Dieu, à laquelle ne peut atteindre notre vertu propre, si elle n’est aidée par la lumière divine » (Monarchia, III, XVI, 7-8). L’on parvient à la première grâce aux enseignements philosophiques, à la seconde grâce aux enseignements spirituels, qui dépassent la raison humaine. Le fond thomiste de cette distinction des deux béatitudes de l’homme ne fait aucun doute. Saint Thomas, en effet, a concilié la conception aristotélicienne du bonheur philosophique avec l’enseignement chrétien de la vie éternelle. Chez l’Aquinate, le bonheur conçu par Aristote, à savoir la connaissance parfaite de l’objet suprême de la connaissance, ne peut être atteint que dans la vision béatifique après la mort, avec le soutien de Dieu. Selon Imbach, « l’originalité de Dante réside dans le fait qu’il ne veut pas seulement distinguer le bonheur accessible au philosophe et la béatitude de l’au-delà, mais qu’il abandonne la subordination d’un bonheur à l’autre : le bonheur que l’on peut atteindre par la philosophie n’est pas subordonné au bonheur théologico-religieux »[40]. Dès lors, l’enseignement philosophique et les vertus enseignées par Aristote conduisent au bonheur en ce monde, et la foi et les vertus théologales, soutenues par la grâce de Dieu, appartiennent au bonheur dans l’au-delà. La Monarchie consistera à déduire – ce que le Banquet fait déjà, pour une part – de cette autonomie théorique dans le domaine du savoir et de la pensée les conséquences politiques, en concluant notamment que l’autorité des dirigeants temporels et politiques – l’Empire – ne dépend en aucun cas du pouvoir de l’Église et du pape. Il y a non plus un soleil et une lune, c’est-à-dire un pape qui donne à la lune sa lumière, mais deux soleils, selon l’image empruntée par Dante : toute subordination est exclue.
La séparation de l’Église et de l’Empire est consommée. Pourquoi et comment Dante est-il parvenu à une telle extrémité ? Les raisons sont nombreuses. Nous en retiendrons une assez rarement soutenue, qu’Imbach présente de manière très complète et convaincante dans sa dernière étude[41] et qui justifie assez l’effort philosophique de Dante dans le Banquet. Au-delà du besoin d’être consolé de la mort de Béatrice ou celui de trouver une nouvelle terre – la philosophie – en plein exil, il semble que Dante soit révolté d’abord par le sort réservé aux païens venus avant le Christ dans la doctrine catholique. Expliquons-nous.
Dante et les ouvriers de la première heure
On connaît l’interprétation des œuvres païennes qui précèdent la venue du Christ, voire la préparent, d’Homère à Virgile, en passant par les philosophes et les hommes d’action. Pascal a cette fulgurance quelque part : « Qu’il est beau de voir, par les yeux de la foi, Darius et Cyrus, Alexandre, les Romains, Pompée et Hérode agir, sans le savoir, pour la gloire de l’Évangile » (Laf. 317, Sel. 348). Beaucoup plus tard, un Péguy aura, dans la Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne, cette autre vision magnifique d’une praeparatio evangelica : « Ce n’est point diminuer la part de Jésus que de se demander si la cité antique n’a point été une autre préfiguration de la cité chrétienne et si le citoyen n’a pas été une sorte de préfiguration du fidèle : c’est simplement se demander si Dieu le Père n’avait point préparé pour son fils, outre les références officielles, les références officieuses, et si ce grand roi (c’est le fils que nous voulons dire) n’a point été en réalité précédé de deux cortèges ». Les deux cortèges seront esquissés dans Clio : « Israël apporta Dieu, le sang de David, la longue lignée des prophètes. Rome apporta Rome, la voûte romaine, la légion, l’empire, le glaive, la force temporelle […]. Rome apporta le lieu, Israël ayant apporté le temps. Rome apporta l’habitat, le climat, les préfets, Israël ayant apporté la race et l’horreur des préfets. Mais Homère et Platon avaient apporté précisément ce que vous essaierez de dire dans votre Essai sur la pureté antique. » À quoi les strophes d’Ève font écho :
« Les rêves de Platon avaient marché pour lui
Du cachot de Socrate aux prisons de Sicile.
Les soleils idéaux pour lui seul avaient lui.
Et pour lui seul chanté le gigantesque Eschyle.
Les règles d’Aristote avaient marché pour lui
Du cheval d’Alexandre aux règles scholastiques.
Et pour lui l’ascétisme et la règle avaient lui
Des règles d’Épicure aux règles monastiques. »[42]
Cette lecture que font les poètes et mystiques chrétiens – de Tertullien à Péguy – des temps païens d’avant le Christ se trouvent, in nuce, chez les théologiens que Dante a lus. Un saint Augustin autant qu’un saint Thomas ne cessent de s’émerveiller de la façon dont les philosophes et poètes païens ont cherché le vrai Dieu et, avant l’incarnation du Christ – la distinction de Pinchard entre avant la Faute et après la Faute fonctionne ici à plein –, ont rendu possible une certaine intelligence de ce mystère. Ce que Simone Weil, autre helléniste proche de nous, nomme les « intuitions pré-chrétiennes ». Cependant, Dante est plus thomiste qu’augustinien. Pinchard ne cesse de relever les passages du Banquet où le Florentin s’oppose au Docteur africain, notamment sur l’existence et le maintien providentiels – ou non – de Rome. En effet, là où saint Augustin imagine Platon lisant Isaïe, saint Thomas fait la part des choses. Il a la sagesse et le recul que donne l’histoire, recul dont saint Augustin n’a pas ou peu bénéficié. Selon l’Aquinate, l’œuvre du Philosophe, Aristote, nous aide à expliquer certaines vérités de foi accessibles à la raison. Il reconnaît la sagesse des Grecs et des Romains, mais il distingue rigoureusement l’humana doctrina de Deo, c’est-à-dire Dieu comme cause première connue par l’entendement, et la sacra doctrina à proprement parler, la participation de l’homme, par la foi, à la science que Dieu a de lui-même. La théologie philosophique des Grecs est certes le couronnement de la métaphysique mais elle reste essentiellement humaine, dans son objet comme dans son contenu. Autrement dit, avec des termes plus pascaliens ou péguystes, la marche de l’humanité païenne vers Dieu a beau être un cortège religieux avant l’heure, elle n’est pas une procession pour autant. Pour cela, il lui faudrait déjà connaître celui qu’elle suit et vers qui, eschatologiquement, elle se rend. Seule l’Église le peut. Avant de méditer, contrairement au philosophe, le théologien sait déjà ce qu’il va trouver : Dieu, celui d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Le philosophe ou le poète païen avance dans l’obscurité, pressentant l’existence d’une lumière. Alexandre ne connaît pas les limites du monde qu’il entreprend de conquérir, Platon et Aristote repoussent les catégories de la pensée. Et César, et Virgile, au sujet duquel Hugo écrit dans un poème des Voix intérieures :
« C’est que, rêvant déjà à ce qu’à présent on sait,
il chantait presque à l’heure où Jésus vagissait,
C’est qu’à son insu même, il est une des âmes
Que l’Orient lointain teignait de vagues flammes,
C’est qu’il est un des cœurs que déjà sous les cieux
Dorait le jour naissant du Christ mystérieux !
Dieu voulait qu’avant tout, rayon du fils de l’homme,
L’aube de Bethléem blanchit le front de Rome ».
Toute l’incompréhension dantesque tient dans ce presque du second vers. Ce n’est pas le chronos qui a manqué, semble-t-il, mais le kairos. On sait que, dans ce cortège de l’humanité vers Dieu qu’est la Divine comédie, Dante se choisit un compagnon parmi ceux qui agissaient, « sans le savoir », pour la gloire de l’évangile : Virgile, symbole de l’humanité païenne et de la raison humaine. Or, quand Dante et Virgile rencontrent, au IVe chant de l’Enfer, les poètes et philosophes de l’Antiquité, l’entretien qu’ils ont avec eux manifeste la compassion profonde des deux pèlerins.
« Mon bon maître me dit : « Tu ne demandes pas
quels sont les esprits que tu vois ?
Or je veux que tu saches, avant d’aller plus loin,
qu’ils furent sans péchés ; et s’ils ont des mérites,
ce n’est pas assez, car ils n’ont pas eu le baptême,
qui est la porte à la foi que tu as ;
et s’ils vécurent avant la loi chrétienne,
ils n’adorèrent pas Dieu comme il convient :
je suis moi-même un de ceux-là.
Pour un tel manque, et non pour d’autres crimes,
nous sommes perdus, et notre unique peine,
est que sans espoir nous vivons en désir. »[43]
« Gran duol mi prese al cor », poursuit Dante. Le Florentin s’interroge, en bon médiéval, sur le salut des âmes païennes, et notamment celle de la « gente di molto valore » : Homère, Horace, Ovide, Électre, Énée sont présents. Leur destinée est tragique : victimes d’un désir infini, ils auront éternellement soif d’un impossible salut. « Che sanza speme vivemo in disio ». Ils vivent « sans espoir dans le désir ». Virgile appartient aussi à cette communauté tragique du premier cercle de l’Enfer, communauté dominée par Aristote – « il mio maestro » –, avec Socrate, Platon, Démocrite, Sénèque, Ptolémée, et même Avicenne et Averroès. On est surpris de trouver les derniers. Imbach rappelle la nette différence établie par saint Thomas en matière d’infidélité entre le fait de résister à la foi sans l’avoir encore reçue (et talis est infidelitas paganorum sive gentilium) ou après l’avoir reçue : soit en figure (infidelitas Iudaeorum), soit dans sa pleine révélation de vérité (infidelitas haereticorum).
Dante s’embarrasse moins de ces distinctions. Premier humaniste, il déplore que les âmes de si grands personnages et grands esprits de l’humanité, des Grecs aux philosophes arabes, soient damnées. Et ce sans avoir commis d’autre faute, comme le dit Virgile au chant VII du Purgatoire, que celle de n’avoir pas eu la foi. « Io ciel perdei che nou ave fé ».
« J’ai perdu non pour faire, mais pour non faire,
La vue du haut Soleil que tu désires,
Et qui fut de moi connu trop tard. »[44]
« E che fu tardi per me conosciuto ». Question de kairos : on comprend les larmes de Dante et le silence de Virgile, accusé d’un Non fare. N’avoir pas suivi une lumière qui, s’il s’agit du Christ, ne lui avait pas encore été donnée. D’où l’exhortation de Virgile, au chant III du Purgatoire, qui invite les humains à être humbles. « State contenti, humane gente, al quia. »
« Contentez-vous, humains, du quia ;
s’il vous avait été possible de tout voir,
il n’était pas besoin que Marie engendrât ;
et vous avez vu désirer en vain des hommes
si grands que leur désir pouvait être apaisé ;
alors qu’il les tourmente, éternellement. »[45]
Dante, bon connaisseur des scolastiques, connaît la différence entre la demonstratio propter quid (preuve à partir de la cause) et la demonstratio quia (preuve à partir de la connaissance des effets). André Pézard, dans une note de la Pléiade[46], résume ainsi : Dieu seul sait le quare de toutes choses (pourquoi elle est), les philosophes tâchent d’atteindre au quale (quelle elle est, sa nature), et plus aisément au quid (savoir ce qu’elle est). Le vulgaire se contente du simple quia : « je sais que cette chose que je touche est là ». Tristesse de Dante et silence de Virgile : le premier comprend que la raison humaine est incapable de se sauver elle-même et demeure donc éternellement en elle un désir inassouvi et insatiable. Le second regrette de n’avoir eu droit au quia.
Est-ce exact ? On connaît les formules célèbres de saint Paul au premier chapitre de l’épître aux Romains : « Ce que l’on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le leur a montré clairement » (Rm 1,19). À qui s’adresse l’Apôtre ? À ceux qui, « depuis la création du monde », pouvaient voir « avec l’intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible ». Or, « malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l’action de grâce que l’on doit à Dieu ». À qui s’adresse l’apôtre, donc, sinon aux païens eux-mêmes qui disposaient bel et bien du quia ? Le recours par saint Paul aux arguments de l’apologétique juive contre le paganisme (Sg 13, 1-19) le porte à condamner sévèrement les païens qui, contemplant les merveilles de la création, ont dépensé des trésors de science en vain, puisqu’ils n’adorent pas le vrai Dieu et déifient, au contraire, la création. Dante, cependant, est loin de préfigurer la lecture luthérienne de l’épître aux Romains, actualisée et approfondie par Karl Barth qui se sert de ce passage pour justifier l’impossibilité d’une connaissance authentique du vrai Dieu en dehors de la révélation du Christ[47]. Si, en Jésus-Christ, la révélation du Dieu très-haut s’achève (1Co 1,30 ; 3, 16-4, 6), elle ne s’y réduit pas. La grâce et la vérité venues par Jésus-Christ (Jn 1, 17) concernent les hommes, vivants ou morts, qui ont mené une vie juste. On sait, par ailleurs, le retournement paulinien concernant le salut des païens : « l’endurcissement d’une partie d’Israël s’est produit pour laisser à l’ensemble des nations le temps d’entrer » (Rm 11, 25). Abandonner les païens qui ont cherché la vérité au dessein parfois incompréhensible de Dieu ne suffit pas à Dante. Les illustres philosophes et poètes qui désiraient voir Dieu ne l’ont pas vu, tandis que les humbles pêcheurs de Galilée ont pu connaître Dieu grâce à l’incarnation de son Fils. L’aporie demeure totale.
Le Banquet fournit une solution à cette aporie en même temps qu’une consolation à cette tragédie qui ne trouvait, dans la Comédie, qu’une bien maigre et artificielle résolution. En effet, ainsi qu’Imbach le rappelle, dans la Divine Comédie, Dante transforme la doctrine traditionnelle du limbus patrum et du limbus puerorum, lieu où prophètes et patriarches attendaient la descente aux enfers du Christ, et lieu pour les enfants morts sans baptême. Le Florentin invente un lieu de séjour propre pour les poètes et les philosophes de l’Antiquité, d’autres limbes pour ceux qui ont agi pour la gloire de l’Évangile. Trois exceptions notables cependant, relevées par Imbach : au chant XX du Paradis, parmi les bons princes, nous rencontrons deux païens : l’empereur Trajan et le troyen Riphée. Enfin, Caton d’Utique, l’homme qui a préféré se donner la mort plutôt que de perdre la liberté, est devenu chez Dante le gardien du Purgatoire. Dante a donc trouvé dans l’Au-delà, pour Virgile et les grands Grecs et Romains, un lieu propre : les limbes, avec les enfants morts sans baptême et les patriarches. Sans surprise, Dante se montre davantage scandalisé par le sort des païens que par celui des enfants morts sans baptême. Un familier de la doctrine thomiste comme lui résolvait aisément cette autre aporie. Minima poena, non tamen nulla, écrivait saint Augustin, avec plus de compassion que saint Thomas, à propos de ces mêmes enfants. Dante, en plaçant les Anciens dans un nobile castello, au premier cercle de l’Enfer, pensait résoudre de la même façon l’aporie.
Il est assez paradoxal qu’un philosophe accordant, comme le montre Pinchard, une importance si minime au Christ dans l’histoire du salut se montre à ce point christocentré au sujet de la destinée des païens. Une page du Banquet, richement commentée par Pinchard, l’explique. « Depuis le commencement du monde en effet, un peu plus de la sixième partie de ce mouvement s’est déjà déroulée ; nous sommes dans le dernier âge de ce siècle et nous attendons en toute vérité la consumation du mouvement céleste » (Convivio, II, XIV, 12). « Le Christ passait pour être apparu environ 5000 ans après la Création du monde. Une fois apparu, il met un terme à l’histoire du monde. La Métaphysique nous réoriente certes vers l’Orient, mais l’advenue du Christ marque les limites de cette conversion vers l’origine. La Métaphysique connaît donc deux impulsions, l’une, païenne, vers l’originaire, l’autre, chrétienne, vers le salut : le Christ en constitue à la fois la synthèse et la double borne en amont et en aval »[48]. D’où il suit que les vérités intelligibles sont à la fois incomplètes et solidaires du sort d’un monde condamné. Ailleurs, Dante imagine, progressant dans une « pensée de transgression délibérée », une « gestation d’un Christ naturaliste qui résulterait du miracle des conditions naturelles optimales conjointes sous la seule autorité de la « déité » »[49], ainsi que le reformule Pinchard.
L’interprétation que fait Dante des trois femmes au tombeau, le matin de Pâques, figures des « trois écoles de la vie active » (Convivio, IV, XXII, 15), les Épicuriens, les Stoïciens et les Péripatéticiens, prouve aussi la préoccupation christocentrée de Dante pour les païens. Ces trois écoles de philosophie pure se tournent vers le tombeau, qui figure le monde présent, réceptacle des choses corruptibles. Elles demandent le Sauveur, c’est-à-dire la béatitude, et ne le trouvent pas. « En soulignant l’imperfection de la connaissance intellectuelle en cette vie, Dante semble oublier les résultats du Traité précédent où il vantait la perfection ici et maintenant de la connaissance »[50], commente Pinchard. Au vrai, y a-t-il meilleure expression du bonheur et du malheur confondus des philosophies païennes, en particulier de la philosophie aristotélicienne ? Elles pressentent la venue du Christ comme les trois femmes ont pressenti sa résurrection, mais ne le rencontrent pas, parce que ce même Jésus-Christ les précède en Galilée (Mt 28, 7). En cela, Pinchard a raison de soutenir que le Banquet procède « d’un acte pur arraché à des questions radicales qui n’avaient pas résonné en Occident depuis la fin de l’Antiquité »[51].
Quelle solution les premiers traités du Banquet fournissent-ils donc ? En distinguant les deux béatitudes et les deux paradis, l’un terrestre, l’autre céleste, le Banquet rejoue le drame du cortège païen qui marche dans l’obscurité et lui confère une issue bienheureuse. Partant, la singulière justification du pouvoir impérial déployée par Dante ainsi que l’argumentation serrée et de part en part anti-augustinienne en faveur de l’élection divine de la civilisation romaine obéissent à la même volonté de soustraire le monde païen au soleil chrétien, ou plus exactement d’illuminer le monde païen d’une nouvelle lumière. Qu’on songe aux deux cortèges de Péguy, image qui fait admirablement écho aux deux soleils de Dante. David et Énée ne furent-il pas contemporains ? (Convivio, IV, V, 6). Énée n’a-t-il pas sa noblesse propre ? « Dans la suite des bontés de la nature et de la raison que Dante cherche à réveiller, on trouve ce principe à la base de tout le système féodal : la noblesse »[52]. La noblesse, sous la plume de Dante, s’apparente à une grâce sécularisée, une grâce que l’on pourrait acquérir par la pratique de la vertu. Façon de consacrer les premiers païens d’une sorte de baptême qu’ils n’ont pas eu la grâce de recevoir, étant venu trop tôt. Quiconque se lamenterait d’être venu trop tard dans un monde trop vieux sera ici convaincu qu’il n’en est rien. Au contraire, les « ouvriers de la onzième heure », selon la parabole évangélique (Mt 20, 1-16), ne connaissent pas leur chance. Dante, fidèle pèlerin aux côtés des ouvriers de la première heure, la leur rappelle.
***
[1] Dante Alighieri, Œuvres complètes, Tome I, Le Banquet, Traduction et édition critique par Bruno Pinchard, Établissement du texte italien par Franca Brambilla Ageno, Éditions Classiques Garnier, Paris, Bibliothèque italienne, 1, 2023. Nous nous référerons à cet ouvrage par les lettres « OC », suivies de la page citée.
[2] OC, p. 9. L’auteur souligne.
[3] Portrait du poète en tant que philosophe. Sur la philosophie de Dante Alighieri, Ruedi Imbach, Vrin, 2023. Nous citerons cet ouvrage en mentionnant « Portrait », suivi de la page citée.
[4] Portrait, p. 12.
[5] Deux formules de Dante dans ses Questio, citées par l’auteur, in Portrait, p. 12 et p. 107.
[6] OC, p. 10.
[7] OC, p. 11.
[8] OC, p. 11.
[9] OC, p. 12.
[10] OC, p. 67-68.
[11] OC, p. 68. L’auteur souligne.
[12] OC, p. 14.
[13] OC, p. 14.
[14] OC, p. 17. L’auteur souligne.
[15] OC, p. 19.
[16] OC, p. 21.
[17] OC, p. 22.
[18] Dante et la philosophie, Étienne Gilson, Paris, Vrin, 1986, p. 97.
[19] OC, p. 27.
[20] OC, p. 23.
[21] OC, p. 24.
[22] Dante et la philosophie, op. cit., p. 94 et passim.
[23] Ibid, p. 86.
[24] Ibid, p. 68.
[25] OC, p. 25.
[26] OC, p. 26.
[27] OC, p. 29.
[28] OC, p. 28.
[29] OC, p. 30.
[30] OC, p. 36.
[31] OC, p. 37.
[32] OC, p. 44.
[33] OC, p. 323, note 282.
[34] OC, p. 327, note 288.
[35] Portrait, p. 25.
[36] Portrait, p. 128.
[37] OC, p. 69.
[38] Dante et la philosophie, op. cit., p. 108.
[39] OC, p. 333, note 300.
[40] Portrait, p. 70. Nous soulignons.
[41] Portrait, pp. 139-166.
[42] Ève, Charles Péguy, Œuvres poétiques complètes, Gallimard, Collection de la Pléiade, 1948, p. 858.
[43] Inferno, IV, v. 31-42, trad. Jacqueline Risset, GF Flammarion, 1985.
[44] Purgatorio, op. cit., VII, v. 25-27.
[45] Ibid, III, v. 37-42.
[46] Dante, Œuvres complètes, Traduction et commentaire par André Pézard, Gallimard, Collection de la Pléiade, 1965, p. 1133.
[47] « Tel est l’aspect tragique de l’histoire infortunée de la vérité. Elle, la vérité qui éclate dans la résurrection, la vérité, selon laquelle l’homme est limité et aboli par le Dieu inconnu, est une vérité connue (…). Nous savons que Dieu est celui que nous ne connaissons pas, et que cette non-connaissance même constitue le problème et l’origine de notre connaissance. Nous savons que Dieu est la personne que nous ne sommes pas, et que ce non-être même, qui est le nôtre, abolit et fonde notre personne », in L’Epître aux Romains (1922), tr. P. Jundt, Genève, Labor et Fides, 2016, p. 51. L’auteur souligne.
[48] OC, p. 321, note 275.
[49] OC, p. 65.
[50] OC, p. 713, note 468.
[51] OC, p. 69.
[52] OC, p. 56.








