Voici la troisième et dernière partie d’un entretien dont la partie précédente est consultable à cette adresse.
BR : Un proverbe pythagoricien affirmait que « le commencement est la moitié du tout ». Et il est vrai que votre premier ouvrage, L’époque de la technique, comportait déjà en 2009, implicitement ou en creux, un nombre important de concepts et de vues appelés à être développés ultérieurement. Votre cinquième livre, Approche de la criticité, vient de paraître en janvier 2018 : comment décririez-vous schématiquement sa place dans l’économie de votre œuvre ?
JV : « L’économie de mon œuvre », c’est quand même beaucoup dire. Il faudrait qu’il y ait économie, et, quel que soit le sens que l’on attribue à ce mot, je vous garantis qu’il n’y a rien de tel, et il faudrait surtout qu’il y ait œuvre. Or en ce point je reste fidèle à Heidegger, qui avait noté en exergue de l’édition intégrale de ses textes : « Des chemins, non des œuvres ». Je tente simplement de me frayer un chemin avec les outils que j’ai sous la main. Il y a néanmoins sans doute une intention d’ensemble, qui serait de frayer une voie de sortie hors de la zone critique. Nietzsche écrivait dans une lettre : « Quand on se cache et s’enterre comme je le fais, en de profondes sapes, on devient souterrain. Mais quoique radicalement nihiliste, je ne désespère pas de trouver le trou et l’ouverture qui mènent à quelque chose », c’est exactement la position dans laquelle je me trouve. Donc je creuse, et quand on creuse, on ne fait pas des œuvres : on fait des trous, et on laisse des tas de gravats. Dans ce dernier livre, je creuse toujours dans le même filon charbonneux, celui de la crise, en reprenant la question de la crise des sciences européennes : la question est de se demander s’il y a véritablement crise. C’est en effet contestable : jamais les sciences n’ont connu de tels progrès qu’au XXe siècle, et, manifestement, la crise que Husserl a diagnostiquée dans les années 1930 n’a pas conduit à un effondrement de la production théorique, bien au contraire ; il est alors possible que ce diagnostic de crise ne provienne que de l’usage des principes d’une philosophie parmi d’autres (celle de Husserl, donc), et que celle-ci soit obsolète. Il faut donc, dans un premier temps, reprendre la question de la science contemporaine, de sa crise éventuelle, de son rapport à la métaphysique, à partir d’elle-même. Or le XXe siècle est en physique l’époque d’une véritable révolution théorique, à savoir l’avènement de la mécanique quantique, et cette révolution est une crise telle que la physique n’en avait jamais connu. Les géants de la physique du XXe siècle, Werner Heisenberg, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, ont pensé la physique quantique à la fois comme crise et comme révolution : ils sont aussi des penseurs de la crise, et il faut les lire comme tels. Le premier point fondamental, acté dès le cinquième congrès de Solvay en 1927, c’est la rupture irrémédiable avec les principes de l’épistémologie cartésienne : la science n’est plus connaissance certaine d’objets, par ordre et mesure, et dans le cadre de la causalité, et c’est donc le subjectivisme moderne qui s’effondre. Fondamental, puisqu’il introduit d’emblée à une thèse centrale de cet ouvrage qu’est l’obsolescence de la modernité, ce qui fournit la tâche de penser dans sa radicale nouveauté l’époque qu’est la nôtre, et en l’occurrence de la penser comme criticité. Mais l’analyse de la physique contemporaine s’impose aussi par rapport à la Critique de la raison pure : Kant y montrait en effet l’impossibilité de toute connaissance qui excèderait les limites assignées à la réceptivité par la finitude de la sensibilité, et en concluait, entre autre, à l’impossibilité de la cosmologie rationnelle : mais ces limites ont été dépassées depuis lors, et l’astrophysique propose aujourd’hui dès modèles parfaitement rationnels du cosmos, fondés sur l’analyse de radiosources distantes de plusieurs millions d’années-lumières, sur des observations de galaxies dans l’infrarouge et l’ultraviolet, sur des images de l’univers tel qu’il était il y a plus de 13 milliards d’années (par la mesure du rayonnement diffus cosmologique). Non seulement la science contemporaine ne semble pas avoir été affectée par la crise, mais elle a surmonté l’impossibilité que Kant avait cru déceler dans le projet même de la métaphysique. Il s’agit alors de se demander comment une telle chose est possible : et c’est possible par le progrès des techniques expérimentales, qui ont surmonté les limites de la sensibilité et les formes mêmes de l’espace et du temps. C’est pourquoi la science peut développer une métaphysique. Il y a en effet en physique contemporaine d’abord des modèles théoriques purement spéculatifs, non-intuitifs, qui postulent par exemple le concept de masse négative, puis des appareils qui vont procurer les data nécessaires à la vérification de ces modèles. La science contemporaine est une métaphysique expérimentale, qui réussit à vérifier les idées de la raison pure, elle n’est plus une phénoménologie, elle est une nouménologie, c’est-à-dire un idéalisme ; le platonisme, le pythagorisme de la physique quantique a été souligné, notamment en France par Bernard d’Espagnat. La physique quantique est un idéalisme métaphysique, et si elle peut l’être, c’est parce qu’elle n’a plus besoin de la médiation de la finitude, elle n’a plus besoin de données sensibles, mais de data numériques : cette nouménologie est phénoménotechnique, c’est-à-dire qu’elle constitue ses phénomènes (et en vérité elle les produit) à partir de moyens techniques. Il faut donc redéfinir le phénomène, comme l’a fait Niels Bohr, en y intégrant l’appareillage technique, en reconnaissant que le phénomène physique n’est plus fondé sur des conditions de possibilité immanentes à la subjectivité transcendantale, mais sur un dispositif technique qui occupe cette fonction transcendantale (et l’on retrouve ici la délégation et l’aliénation de la fonction transcendantale à la machine que l’on constatait dans l’analyse du dispositif médiatique et de ses écrans). Il y a ainsi dans la physique contemporaine le passage d’une phénoménologie à une phénoménotechnique, ce qui montre que la question de la technique ne concerne pas uniquement l’intendance, de simples moyens neutres dont on pourrait décider de l’usage : elle définit la position fondamentale de l’homme dans l’univers. La phénoménalité est aujourd’hui massivement technicisée, et ce dans un dispositif qui court-circuite la subjectivité. La physique contemporaine produit ainsi des modèles non-intuitifs, irreprésentables, inconceptualisables, irréductibles à la subjectivité : la physique, dont la mission première est de comprendre le réel, fournit des modèles incompréhensibles aux hommes, ce qui suggère que ce savoir n’est plus un savoir humain, il est un savoir purement objectif, logique et abstrait. Dans son livre La Nature et les Grecs, Schrödinger a alors reconnu qu’il y avait là un gros problème, il l’a défini comme crise, il a fait la généalogie de cette crise, dont il a trouvé l’origine en Grèce ancienne, dans l’oubli de la vie subjective par la rationalité scientifique : il a, sans le savoir, retrouvé trait pour trait le diagnostic de Husserl. De même, Heisenberg reconnaît que la configuration contemporaine des sciences ne provient pas d’un progrès théorique dans la recherche de la vérité, mais qu’il est l’effet de la puissance technique propre à l’Occident, laquelle produit ce qu’il appelle un « ordonnancement de la réalité » ou une « mise en ordre de la réalité » : il retrouve ce faisant le concept phénoménologique de monde, et définit la science contemporaine comme un certain régime de vérité parmi d’autres.
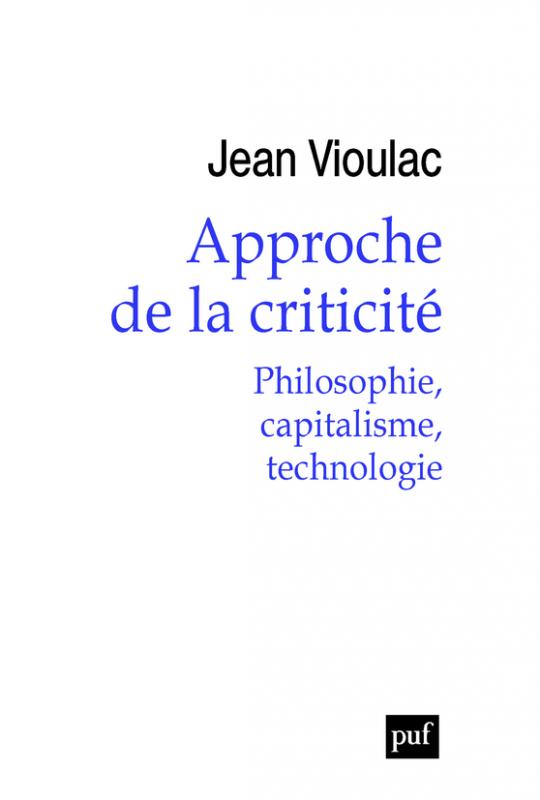
BR : Effectivement, ce qui frappe d’emblée le lecteur, c’est que le premier chapitre d’Approche de la criticité, est tout entier consacré à la physique quantique. Et vous vous référez alors à un philosophe dont nous avons jusqu’à présent tu le nom : je veux parler de Gaston Bachelard qui, précisément, a parfaitement saisi et mis en lumière le passage de la phénoménologie à la phénoménotechnique. Puis vous consacrez un second chapitre à la cybernétique : cette dernière était déjà bien présente dans vos ouvrages précédents – ainsi que dans les réponses du présent entretien –, mais là, vous la thématisez pour elle-même, et avec un titre de chapitre assez troublant, « La communauté cybernétique », qui sonnerait presque comme un oxymore : car la cybernétique n’est-elle pas précisément le point ultime de la dissolution (dans l’abstraction informationnelle) de la communauté au sens où vous l’avez définie plus haut ?
JV : C’est en effet Bachelard qui a thématisé la phénoménotechnique (mais la chose est aussi chez Niels Bohr, même si le mot n’y est pas), justement parce qu’il a développé sa phénoménologie à partir d’une épistémologie et non pas d’une égologie, et qu’il a ainsi d’emblée renoncé au postulat d’un ego censément indépendant des conditions socio-historiques de sa subjectivation. Mais pour comprendre le passage à la question de la communauté, il faut revenir à Heisenberg, et sur l’important manuscrit philosophique qu’il écrit en 1942, connu justement sous le titre Ordnung der Wirklichkeit. Il y consacre sa réflexion au séisme qu’a été en physique l’avènement de la physique quantique et de la relativité générale, constate que nous sommes les contemporains d’un nouvel « ordonnancement de la réalité », et en conclut que, dans l’histoire, divers « ordonnancements » se sont succédés. Quand il s’agit de comprendre sur quoi se fonde une telle mise en ordre, il parachève la rupture avec Descartes en reconnaissant qu’un tel système ne peut pas reposer sur une certitude indubitable (ni subjective, ni mathématique), elle repose sur une communauté historique. À chaque fois, c’est une communauté, dans sa façon de s’organiser, dans son type de rapport au monde, à partir de « l’humus du langage », ses « métaphores » et ses « allégories » (ce sont les termes de Heisenberg), qui met en ordre la réalité. Dès lors, la domination de la phénoménalité technique, la substitution de l’univers au monde que l’on a constatées doivent elles-mêmes s’expliquer sur ces bases communautaires, sur un processus de technicisation immanent à la communauté, et aussi de technicisation de son langage. C’est pour définir ce processus que Norbert Wiener a eu recours au terme de cybernétique. Ce que comprend d’emblée Wiener, c’est que l’informatique, par l’automatisation des procédures de calcul et de décision, l’enregistrement des données en mémoire, les processus de rétroaction, va attribuer un pouvoir exécutif aux machines logiques, et ce au détriment des hommes en chair et en os. Il y voit ainsi la deuxième phase de la révolution industrielle : la première avait transféré (aliéné) la puissance de travail des hommes aux machines, la seconde transfère (aliène) leur puissance intellectuelle, leur mémoire, leur capacité de décider. C’est pourquoi l’informatique est en réalité cybernétique, c’est-à-dire, littéralement, pilotage, commandement (en grec kubèrnesis) : parce qu’elle est issue d’un transfert de souveraineté de l’homme à la machine. Je ne veux pas répéter ce que nous avons déjà dit, mais il importe de situer la cybernétique dans un cadre plus vaste : en rappelant que le projet d’une détermination intégrale de la communauté politique par l’idéalité est le projet platonicien de La République, mais aussi en soulignant qu’il y a là le parachèvement de la gouvernementalité spécifique à la modernité occidentale, à savoir le gouvernement par les nombres. L’État moderne est indissociable de la statistique (mot dérivé de status, l’État), et en effet à partir du moment où s’institue au-dessus de la communauté civile un pouvoir de commandement (où il y a déjà transfert de souveraineté de la communauté à une structure abstraite), celui-ci va devoir connaître cette communauté pour la gérer, et la réguler à partir de déterminations quantitatives chiffrées (par exemple en France aujourd’hui avec l’INSEE, mais le premier bureau de la statistique été créé en 1801, et il était affilié au Ministère de l’Intérieur, ce qui montre d’emblée l’usage que l’on comptait faire de cette base de données). Le gouvernement moderne est indissociable de la statistique, du recensement, du calcul des taux de chômage ou de la croissance, de la quantification des masses et de la sérialisation des individus, de la volonté de prévoir et d’organiser à l’avance leurs comportements ; l’obsession des gouvernements modernes est de savoir qui fait quoi où quand et avec qui, et comment tout cela va évoluer. Avec la mise en place du réseau informatique, qui structure désormais l’ensemble du monde du travail, les administrations publiques et les rapports sociaux, qui collecte en continu des quantités gigantesques de données sur chacun et adapte de façon rétroactive les informations qu’il transmet, le gouvernement par les nombres a trouvé l’infrastructure technique qui lui est adéquate. En tant qu’elle est intégralement atomisée par sa numération numérique, la communauté est effet dissoute, et les communautés réelles sont ainsi dispersées, au sens où la police disperse une manifestation pour éviter que les choses sérieuses commencent. La domination du spectacle a ainsi des effets politiques : force est de constater que le peuple français ne descend pas en masse dans la rue pour défendre le droit du travail, il descend en masse dans la rue pour la mort à Johnny, c’est-à-dire que les classes populaires ne se vivent plus comme communauté de travailleurs, mais comme agrégat de spectateurs, comme public, et un public, c’est passif, donc soumis. Les communautés réelles sont dissoutes, et en cela vous avez raison de souligner que « communauté cybernétique » est, en toute rigueur des termes, un oxymore. Mais cette dissolution, on le constate aujourd’hui, s’accompagne de sa recomposition numérique, sous la forme de réseaux « sociaux », qui sont des pseudo-communautés déterritorialisées, communautés virtuelles ou communautés spectrales. La communauté cybernétique, c’est donc la cybercommunauté, c’est-à-dire la pseudo-communauté : la communauté aliénée. Que cette aliénation se fasse dans l’enthousiasme général n’est que la manifestation de son perfectionnement, et montre aussi que le commandement cybernétique est invisible, et que les hommes réels, en chair et en os, se font ainsi invisiblement manipuler : par une main invisible, qui est celle du marché. Il faut donc rappeler que Hayek définissait lui-même le marché autorégulé comme un dispositif cybernétique, où le prix « code l’information » (sur l’offre et la demande, sur l’état du marché, sur la baisse de la production de telle ou telle matière première) et la transmet à des individus qui ainsi pourront prendre leurs décisions (elles-mêmes fondées sur le calcul de l’intérêt). Ainsi le free market, c’est le commandement cybernétique des individus par le marché mondial par l’intermédiaire du code : si le bolchevisme a usurpé le concept de communisme, le néolibéralisme usurpe le concept de liberté, ce qui est d’ailleurs écrit en toutes lettres par Hayek, qui ne promeut rien d’autre que la « soumission aux forces impersonnelles du marché ». Comment pourrait-on tout à la fois être libre et soumis, ce n’est pas précisé.
BR : Alors justement, cela me permet de vous demander une précision. Car il est un terme, que je n’étais pas habitué à lire sous votre plume – à moins que je ne me trompe –, et qui apparaît à plusieurs reprises dans votre dernier ouvrage : celui d’ « institution ». Vous définissez cette dernière d’une part comme un « système d’homéostasie sociale » (page 200) en suivant Wiener dans le texte ; mais vous écrivez d’autre part que « le moment cybernétique est celui de l’immanentisation de la structure de commandement aux sociétés, lesquelles ne sont alors plus structurées par des institutions mais bien par des dispositifs » (page 234). D’où les questions suivantes : qu’appelez-vous au juste « institution » ? Quel lien cette dernière entretient-elle avec la communauté ? Et n’y aurait-il pas comme une contradiction à vouloir définir l’institution par le prisme de la cybernétique ? D’ailleurs, Wiener ne définit-il pas l’entropie comme le contraire de l’information et de la désorganisation, laissant ainsi supposer que l’homéostasie désignerait plus l’organisation que l’institution ?
JV : La question de l’institution s’impose déjà quand on dépasse l’égologie transcendantale pour une sociologie transcendantale : cette reconduction aux conditions de possibilité réelles conduit à dégager une communauté historique comme fondement de tout phénomène. Il ne suffit alors pas de fonder les idéalités sur les techniques, ni même de fonder l’idéalisation comme telle sur la monétarisation des échanges : il faut aussi prendre en compte les structures sociales propres à cette communauté. La généalogie de la rationalité contemporaine, qui reconduit en Grèce ancienne, impose ainsi de prendre en compte à la fois l’institution de l’esclavage et celle des régimes d’assemblée (formes subtiles d’aristocratie que les Grecs ont nommé « démocratie »), qui ont poussé à l’extrême la division entre le travail manuel et le travail intellectuel : il n’y a pas de production théorique sans l’institutionalisation de la division du travail, et aussi sans institution en charge de la préservation et de la transmission des produits de ce travail intellectuel. Mais l’importance de l’institution dépasse la question de la production théorique, elle concerne les structures sociales, les formes qui définissent une communauté, structures et formes qui préexistent à chaque génération et qui lui survivent : la question de l’institution s’impose donc aussi quand on a reconnu l’historicité fondamentale des communautés humaines, pour lesquelles n’existe aucune « loi naturelle », et qui doivent donc maintenir leurs structures constitutives contre le temps, avec lequel, comme savait Léo Ferré, tout s’en va. C’est ici que se trouve un point de contact avec la théorie de l’information telle que Norbert Wiener l’a conçue, c’est-à-dire à partir du second principe de la thermodynamique, principe d’entropie qui établit que tout système tend au désordre, que l’univers est un processus de désagrégation progressive. Dans ce processus de décomposition et de tendance au chaos, l’information est en effet ce qui maintient des enclaves d’ordre. L’information est ce qui s’oppose à l’entropie, thèse centrale de Wiener dans La Cybernétique (« Tout comme la quantité d’information dans un système est la mesure de son degré d’organisation, l’entropie d’un système est la mesure de son degré de désorganisation : l’un est simplement le négatif de l’autre »). L’entropie est principe de désorganisation, de désagrégation et de déformation ; l’information est principe d’organisation, d’élaboration et de formation. Dans le vocabulaire de Wiener, l’information est pattern, forme, modèle ou schème d’organisation, qui n’existe donc que provisoirement dans un flux informe, il écrit dans Cybernétique et société ces lignes qui pourraient presque être de Nietzsche : « Nous ne sommes que les tourbillons d’un fleuve intarissable, non substance qui demeure, mais formes qui se perpétuent ». Dans ce cadre, il est clair que l’homéostasie désigne l’organisme vivant, ce par quoi le vivant maintient (provisoirement) son organisation contre la mort, il maintient ainsi de façon parfaitement immanente et inconsciente des formes qui lui sont données. Il ne s’agit donc surtout pas de rabattre l’institution sur l’organisme, tout au contraire de définir des niveaux ou des paliers différents de maintien de la forme contre le flux : l’expression d’« homéostasie sociale » n’est ici qu’analogique, elle voulait simplement, peut-être maladroitement, souligner que l’institution a la même fonction, mais à un autre niveau. Ce niveau, c’est le niveau humain, où ces formes ne sont pas données par nature, elles sont produites. Wiener voit même dans cette production de structures d’ordre un devoir : dans un univers destiné au chaos et à la mort thermique, l’homme a pour « principale obligation de construire des enclaves arbitraires d’ordre ». L’être humain n’est pas un simple vivant en effet, qui n’aurait qu’à gérer de façon immanente (instinctive, inconsciente) une formation organique donnée par nature, il est un bâtisseur de formes, constructeur d’enclaves d’ordre arc-boutées contre le chaos, il est ainsi toujours au principe de ce que Heisenberg dans le manuscrit de 1942 nommait « ordonnancement de la réalité ». L’ordre ou la forme dont la désagrégation menacerait l’humanité de disparition est précisément celle qui configure les sociétés humaines : à l’organisation caractéristique de tout organisme vivant, l’homme ajoute donc des systèmes anti-entropiques locaux artificiels, des structures de mise en forme des sociétés humaines destinée à lutter contre leur désordre, ce sont les institutions. Or l’originalité de l’informatique, c’est de coder l’information, c’est-à-dire de réduire des formes à des quantités, à des entités numériques qui peuvent se transmettre indépendamment de toute matière, qui s’autonomisent ainsi par rapport à tout contenu, et où la matière ne sert que de support contingent. Quand l’informatique est cybernétique, c’est-à-dire quand elle commande la communauté, la forme n’a ainsi plus pour fonction de maintenir l’ordre de la communauté, elle se sert de la communauté pour se maintenir elle-même ; par le codage, l’information s’autonomise par rapport à tout substrat. L’essentiel dans le dispositif, c’est donc l’autonomisation de la structure d’ordre, qui n’a d’autre sens que de se maintenir elle-même, et qui commande à la communauté ce qui est nécessaire à sa perpétuation, c’est ainsi l’inversion du rapport entre forme et matière, inversion qui définit également l’autovalorisation du capital. Ce qui explique ce paradoxe : l’empire contemporain de l’informatique et de l’information se traduit par la dérégulation totale des sociétés, leur atomisation et leur désagrégation. L’individu y est en effet directement commandé et régulé par l’idéalité (le code, l’information, le spectacle, le prix), le gouvernement de l’individu est en cela immédiat et porte directement dans son intériorité monadique, il ne passe plus par les médiations sociales, par les institutions, par les rapports à autrui : la cybernétique rejoint ici la question du management, mais vous connaissez ce problème bien mieux que moi.
BR : Alors je pose une dernière question qui rejoint, par une autre voie, les propos théologiques précédents. Si la cybernétique introduit en effet un mode de gouvernement immédiat (le « temps réel », l’actualisation permanente), qui se passe des médiations et des institutions, ne relève-t-elle pas fondamentalement plus du millénarisme que de l’idéalité grecque ? Je m’explique : dans ce désir d’un salut qui ne relève plus d’un procès de négativité mais d’une positivité à l’état pur, ne retrouve-t-on pas ce schème hérité de l’abbé calabrais Joachim de Flore qui rompt avec l’Incarnation, qu’il rétrograde à la seconde étape de sa vision historique ternaire (Age du Père, Age du Fils, Age du Saint-Esprit) au profit d’un règne entièrement spirituel, et par conséquent d’une communion immédiate entre frères, qui se passent tous deux des médiations de la Chair (le Christ) et de la liturgie institutionnalisée (le Magistère de l’Église) ? Tout comme, aujourd’hui, la cybernétique se passe des institutions politiques et culturelles. Formulé en d’autres termes : n’y aurait-il pas une archéologie de l’époque planétaire qui passe aussi par la prise en compte d’un mouvement de sécularisation ?
JV : Mais le millénarisme dont vous parlez, c’est précisément celui des prophètes contemporains de la Singularité technologique et de l’Esprit global, c’est l’idéologie new age de la Silicon Valley, de ceux qui promettent l’immortalité de l’esprit par son téléchargement dans des machines, ceux qui préparent la connexion immédiate entre le cerveau et les ordinateurs (et donc l’Internet) par les interface neuronales (tel Elon Musk, qui a créé l’année dernière Neuralink, société entièrement destinée à la création de ces interfaces : nous ne parlons pas ici de simples hypothèses spéculatives, mais bien d’un processus en cours). Le rapport entre cette noosphère et le millénarisme chrétien a été fait, tout particulièrement par Teilhard de Chardin, et il y a là cette identification du progrès technique à la providence dont nous parlions déjà à propos du gnosticisme technologique. La sécularisation, c’est donc ici celle de la providence, un concept élaboré par Platon (tou théou pronoïa, « la providence divine », dans le Timée) et systématisée par le stoïcisme : en grec, la providence, c’est la pronoïa, c’est-à-dire la capacité d’anticipation propre à l’intelligence ordonnatrice (le noûs). La théologie médiévale a entièrement repris cette structure métaphysique, ce qui l’a conduit à la définition d’un deus ordinator, un « Dieu ordinateur », un Dieu qui ordonne toute chose, que Leibniz élabore avec sa rigueur logique et mathématique dans son idée d’un « Dieu calculateur », où la création du monde est un calcul (« dum deus calculat mundus fit »), c’est-à-dire une programmation. Avec l’avènement de cet empire cybernétique, on a bien l’hégémonie totale du nombre, de l’idée, de l’esprit, du calcul qui définit la métaphysique : c’est-à-dire l’ontothéologie, c’est-à-dire tout autant l’ontologie que la théologie, cette théologie du deus ordinator. Donc la question que vous posez (celle du statut que l’on peut donner à la perspective d’un règne entièrement spirituel) est celle que nous avons déjà abordée dans le rapport à Hegel : à partir du moment où l’on définit l’homme, non plus par un esprit céleste, mais par son corps terrestre, à partir du moment où l’on reconnaît que le nombre et l’idée sont des produits de communautés historiques réelles, occupées à travailler en commun afin de subvenir à leur besoin, définies par un certain type de rapport sociaux (par la division du travail), de rapport au monde (par les techniques) et de rapport à leur propre passé (par les institutions de la mémoire), à partir du moment où l’on reconnaît que l’esprit est spectral, alors tout se renverse : la réalisation de ce pur esprit est menace de déshumanisation, ce règne purement spirituel (purement numérique) est le danger qu’il faut conjurer. Mais dans le même moment, il faut reconnaître que l’avènement de cet esprit global n’est pas l’effet d’une puissance céleste, mais qu’il a ses bases terrestres dans un certain dispositif de production et de circulation : le capitalisme. C’est là toute la niaiserie des cyberprophètes, qui n’interrogent jamais l’infrastructure économique de leur mégamachine, dont l’abstraction dissimule l’énorme quantité d’énergie et de matière dont elle a besoin pour se produire et se reproduire. De ce point de vue, Matrix, le film des Wachowski, est plus lucide que tout ce qu’a pu écrire Teilhard de Chardin, puisqu’il reconnait que la Singularité technologique a besoin d’énergie, et que sous l’empire de l’esprit global, les hommes ne deviennent pas des anges, ils deviennent des piles. Là encore, on ne peut pas aborder la question de la technique en la déconnectant de celle du capital. Norbert Wiener a constaté dans l’avènement de l’informatique la seconde phase de l’aliénation, celle où ce sont les capacités intellectuelles de l’homme qui sont transférées au système des objets, mais Marx l’avait anticipé de façon tout à fait remarquable quand il parlait dès 1857 de « cerveau social » et d’« entendement social », et notait qu’avec la systématisation du machinisme, « le savoir social universel, la connaissance, est devenue force productive immédiate et par suite les conditions du processus vital de la société sont elles-mêmes passées sous le contrôle du general intellect (« l’intellect général », en anglais dans le texte) et sont réorganisées conformément à lui » : ce qui définit rigoureusement la cybernétique, et ce qui confirme que l’Intelligence Artificielle est dans une connexion essentielle avec le Capital. Face à la menace (et non le salut) qu’est l’avènement de cette entité numérique totale, exsangue et désincarnée, il s’agit de comprendre comment la communauté réelle des hommes de chair et de sang peut reprendre la main, se réapproprier tout ce qui s’est autonomisé dans des processus machiniques, comment la communauté des sujets peut reprendre en main le système des objets : la question est celle de la révolution communiste, qui d’un certain point de vue relève en effet d’un millénarisme, mais où l’horizon est celui de la communauté fraternelle d’hommes libres et égaux. Mais là aussi, il faut dégager le concept de révolution de son usage politico-historique des siècles passées : il ne s’agit pas de conquérir un appareil d’État quel qu’il soit, de guillotiner, fusiller ou déporter qui que ce soit, d’appliquer ensuite tel ou tel programme, ni même de changer le régime de propriété. Ce qui définit la révolution, c’est le « retournement » de ce que Marx appelle un « monde à l’envers », et cette question n’est pas propre à Marx : elle est un des motifs de fond des penseurs de la crise, les géants qui vu le processus en cours avec assez de hauteur pour pressentir qu’il conduisait l’humanité droit à l’abîme. Hölderlin déjà (le retour au pays natal), mais surtout Marx (le retournement du capitalisme), Nietzsche (le retournement de toutes les valeurs), Husserl (le retournement des significations) et Heidegger (le tournant dans l’être), tous ont tenté de concevoir (avec plus ou moins de pertinence) l’événement susceptible de conjurer la menace. Un tel événement ne relève pas de la mythologie du Grand soir, peut-être peut-il se faire lentement et en douceur, peut-être ici faut-il se fier à Nietzsche qui disait que « les grands événements arrivent sur des pattes de colombes ». Mais si c’est le cas, cette colombe a vraiment de toutes petites pattes, parce qu’on n’entend rien venir.
BR : Cher Jean Vioulac, je vous remercie pour cet entretien tout à fait captivant, et vous laisse le mot de la fin.
JV : Je conclurai alors par les vers de Bob Dylan que je cite en exergue de ce dernier livre : « I don’t care about economy / I don’t care about astronomy / But it sure do bother me / To see my loved ones turning into puppets ». Le problème, ce n’est pas celui de la science pour elle-même, de l’économie comme telle, ni même de la technique. Le problème, c’est leur pouvoir d’assujettissement, de manipulation et d’aliénation sur les hommes réels, en chair et en os, leur pouvoir de faire de nous leurs fonctionnaires, leurs pantins et leurs fantoches. Le problème, c’est ce qui est en train de nous arriver à nous, les hommes.








