« Renouveler de fond en comble les thèmes de base de la pensée, être l’auteur d’une révolution intellectuelle, être celui par qui les écailles tombent, ce sont là des nécessités philosophiques fondamentales, tout au moins dans la présentation. Aucun philosophe ne peut poser sa candidature à l’existence historique simplement en tant que continuateur. Il ne peut être qu’un fondateur, celui qui apporte la lumière et démasque les erreurs séculaires, d’où l’obligation parfois de les amplifier, ces erreurs, de les caricaturer, de les styliser quand ce n’est pas de les inventer, pour se procurer l’objet de la réfutation instauratrice. » Jean-François Revel 1.
La mort de la philosophie
Cette recension porte sur le livre de Markus Gabriel, Pourquoi le monde n’existe pas [Markus Gabriel, Pourquoi le monde n’existe pas, JC Lattès, 2014. Sauf mentions contraires, toutes les références en note de bas renverront à ce livre.[/efn_note], qui a eu un certain retentissement médiatique ces derniers mois, et qui a soulevé un grand nombre d’objections. Mais avant d’en venir au livre lui-même, il me paraît important, pour bien comprendre le sens de ce livre, de rappeler le contexte dans lequel il s’inscrit. Il est en effet nécessaire de savoir que la philosophie a fait ces dernières années l’objet de vives critiques de la part de plusieurs scientifiques américains de renom, à commencer par Stephen Hawking, qui déclare dans son livre, [ The Grand Design (2010) : « philosophy is dead ».
« How does the universe behave? écrit Stephen Hawking. What is the nature of reality? Where did all this come from? Did the universe need a creator? Most of us do not spend most of our time worrying about these questions, but almost all of us worry about them some of the time. Traditionally these are questions for philosophy, but philosophy is dead. Philosophy has not kept up with modern developments in science, particularly physics » [Propos répétés presque à l’identique [lors d’une conférence en mai 2011.[/efn_note].
Je crois que c’est en bonne partie pour répondre à cette déclaration de décès que Markus Gabriel a écrit son livre, en s’attaquant à ce qu’il considère comme une prétention scientiste de Hawking à vouloir se passer complètement de philosophie. Et c’est du même coup en s’opposant à cette misosophie de Hawking qu’il va chercher à fonder sa propre philosophie, qui se veut totalement originale et novatrice.
En soi, l’idée de répondre aux attaques des scientifiques en défendant les prérogatives de la philosophie, n’est pas originale, et elle est tout à fait légitime. En effet, d’autres personnalités influentes et reconnues dans le domaine de l’astrophysique ont déjà porté le même genre de critiques qui peu ou prou reviennent à dire que la philosophie est soit morte, soit inutile : elle a fait son temps et, désormais, ne peut plus rien nous apprendre sur l’univers et sur nos origines. Le fondateur de la physique quantique, Richard Feynman, aurait ainsi déclaré : « Philosophy of science is as useful to scientists as ornithology is to birds ». L’épistémologie n’a aucune utilité pour les scientifiques car elle les observe de l’extérieur et ne peut pas les aider à mieux pratiquer leur métier. Lisant Spinoza pour aider son fils à faire son travail, Feynman s’aperçoit que tout ce que dit l’auteur de l’Ethique sur l’Essence est tout simplement invérifiable. On pourrait dire comme lui, qu’il n’y a qu’une seule substance infinie, ou bien le contraire ! Alors, au lieu de disserter en l’air, dit en somme Feynman, allons vérifier ! Un usage simplement spéculatif de la raison ne peut pas accroître nos connaissances. Un tel usage vire à l’abstraction gratuite et n’est d’aucun bénéfice pour les sciences.
Face à ce genre d’attaques, la défense des philosophes peut consister à rappeler le rôle de la réflexion éthique et métaphysique sur les fondements des sciences, face à l’approche uniquement empirique et objective à laquelle un scientifique doit se tenir. Il s’agit alors de dire que la question du sens de la connaissance mérite toujours d’être posée, parce que le scientifique ne peut pas y répondre ; qu’en somme philosophie et sciences sont complémentaires plutôt qu’ennemies, thèse que défend par exemple Christopher Norris, professeur de philosophie à l’université de Cardiff. Aucun questionnement sérieux sur le monde ne peut faire l’économie d’une approche normative et/ou herméneutique, tâche qui reviendrait en propre à la philosophie. Les scientifiques ont donc tout à perdre à mépriser la philosophie : « those scientists who claim to have no use for philosophy are most likely in the grip of a bad old philosophy or an insufficiently thought-out new one that they don’t fully acknowledge ». Les scientifiques ne peuvent faire l’économie d’une réflexion sur le sens de leurs pratiques. Or, le but de l’épistémologie est de comprendre le fonctionnement de la science, pas de faire des découvertes. On ne peut donc lui reprocher de n’avoir pas fait de progrès dans la compréhension de l’univers, puisque tel n’est pas son but ! [Cet argument est mis en avant par Massimo Pigliucci [dans sa réponse aux attaques de l’astrophysicien Lawrence Krauss et à celles de Neil Degrasse Tyson, lui aussi astrophysicien, très réputé auprès du grand public : « The main objective of philosophy of science, écrit M. Pigliucci, is to understand how science works and, when it fails to work (which it does, occasionally), why this was the case. It is epistemology applied to the scientific enterprise. And philosophy is not the only discipline that engages in studying the workings of science: so do history and sociology of science, and yet I never heard you dismiss those fields on the grounds that they haven’t discovered the Higgs boson».[/efn_note]. Le caractère indéniable, et même spectaculaire, des découvertes scientifiques, prouverait qu’on peut désormais se passer de philosophie. Les sciences sont sorties de la philosophie, mais elles n’y reviendront pas.
La question est de savoir si les scientifiques ont vraiment besoin des épistémologues pour comprendre leur discipline, s’ils ne peuvent pas eux-mêmes réfléchir à leurs méthodes de recherches, et s’ils ne sont pas capables, notamment, de tirer d’eux-mêmes les leçons de leurs échecs. C’était la thèse de Deleuze dans Qu’est-ce que la philosophie ? : la philosophie n’est pas une réflexion sur d’autres domaines. Le scientifique n’a pas besoin du philosophe pour réfléchir à ce qu’il fait, il en est tout à fait capable par lui-même. Les scientifiques progressent en se critiquant entre eux : voir par exemple les critiques actuelles, menées par des scientifiques, contre la « théorie des cordes », qui en vingt-cinq ans, n’a encore pas pu être vérifiée expérimentalement, de sorte qu’elle n’est pas encore à proprement parler une théorie. Or, que peut apporter le philosophe sur cette question ? Manifestement, rien. Sa seule manière de procéder est de distinguer la recherche et la réflexion sur les fondements. Mais pour tout dire, il paraît bien commode de renvoyer les chercheurs à un empirisme myope, au positivisme borné, comme s’ils étaient de simples ouvriers de la connaissance : à eux la tâche d’étudier les faits, tout en laissant, bien évidemment, l’apanage de spéculation sur les « fondements » aux philosophes. Comme si au fond, tout à leurs observations affairées, les scientifiques devenaient aveugles à leur propre pratique, et avaient donc besoin de faire de temps en temps un petit saut transcendantal vers l’Ego pur, afin de sortir de leur « naïveté pré-critique».
Cette première ligne de défense est celle de la philosophie institutionnelle des sciences : à la science l’étude du divers sensible, à la philosophie la spéculation « transcendantale » sur l’Inconditionné [Kantisme qu’on n’hésitera pas à assouplir quelque peu, pour ne pas être trop rigide face aux assauts spéculatifs les plus avant-gardistes. Voir à ce sujet le livre de Catherine Malabou, Avant demain. Epigénèse et rationalité, Paris, PUF, 2014. Face au « réalisme spéculatif », sorte d’avatar philosophique de la physique quantique, l’auteur maintient la nécessité d’une corrélation sujet-objet, et donc d’une interrogation sur les formes a priori de la sensibilité, en insistant sur leur origine biologique. Voir [la recension du livre sur ce site. La question est de savoir si le transcendantal est dérivé de l’expérience ou bien si c’est lui qui la constitue. Comme la question n’est pas tranchée, on doit, selon C. Malabou, maintenir l’étude de la corrélation entre le sujet et l’objet. Mais en tout état de cause, la « corrélation sujet-objet » n’est pas la réponse au problème, elle n’est que l’indication de la difficulté. Le corrélationnisme est simplement un intitulé. Si on prend le corrélationnisme pour une solution, ce sera une solution uniquement verbale, comme les vertus dormitives de l’opium. Or, on peut se demander dans quelle mesure la philosophie des sciences n’est pas devenue qu’un fantôme de science. Le sujet transcendantal est-il autre chose qu’un décalque du sujet empirique, servant à conserver une apparente scientificité à la philosophie, à une époque où elle celle-ci a cessé d’apporter une quelconque connaissance ?[/efn_note].
A l’évidence, la philosophie subit une crise, dont témoigne les attaques des scientifiques de renom. Elle n’a plus d’utilité pour la recherche expérimentale. Elle ne fait que singer leurs résultats, au mieux, ou bien elle les ignore et s’enferme dans le cercle d’une dialectique verbale et stérile, parce qu’elle n’a pas su entrer dans « la voie sûre de la science » (Kant).
A l’opposée de cette ligne de défense « fondationnaliste », on trouverait la ligne de contre-attaque « continentale gauchiste » , qui concède que Stephen Hawking a en partie raison d’affirmer que « philosophy is dead », parce que s’il y a une philosophie qui est morte, c’est uniquement la philosophie analytique anglo-saxonne, toujours soupçonnée d’être rétrograde et transformer les philosophes en « conservative police officers defending science and other potentially non-democratic agendas (sic) at the cost of marginalising creativity, political action, and social critique ». La philosophie badiousienne et zizekienne, on l’aura reconnue, a pour mission de nous mettre en garde contre cette dangereuse entreprise qui nous voue au « goulag du néo-libéralisme » et qui, avec sa manie de pinailler sur le sens des mots et sa volonté de normaliser le langage et les comportements, prouve bien qu’elle est restée coincée au « stade anal » (sic) ! 2 Car il est bien évident que la Science (avec un grand S), et tous les philosophes qu’elle stipendie, est avant tout un pouvoir « disciplinaire » (cf. Foucault), qui ne cherche qu’à brimer les penseurs des marges et de la transgression (des transgressions marginales, en fait).
On pourrait évidemment rétorquer que la démocratie a bien besoin de rationalité, scientifique en particulier (mais pas seulement) et qu’on ne risque pas de trouver beaucoup de rationalité dans ces divers épigones de la post-modernité qui n’ont à proposer qu’un baratin de campus regorgeant de concepts fumeux, bien propre à épater les crédules et qui, à force de promettre des lendemains créatifs parfaitement illusoires, incitent plutôt à la résignation face à un monde décidément trop « hétérogène » et « complexe » pour qu’on puisse y voir clair. Mais ce serait sans doute faire le jeu de l’ordre établi…
Il est certain que c’est ce genre de propos qui ont toutes les chances de dégoûter les scientifiques de la philosophie, et réciproquement. Du reste, les philosophes ont sans doute plus à y perdre, car, du fait de l’absolue liberté spéculative qui leur est octroyée, ils n’ont aucune barrière les empêchant de plonger la tête la première dans l’irrationnalisme et le verbiage, alors qu’un scientifique est normalement tenu de vérifier expérimentalement ce qu’il avance et de se confronter aux critiques de ses collègues. Il est remarquable que plus une philosophie se déclare expérimentale ou novatrice, et moins elle s’intéresse à quelque expérience que ce soit. Et plus elle défend l’« hétérogénéité », plus elle devient rigide et intolérante.
J’en viens maintenant à la ligne de défense originale de Markus Gabriel, sorte de « troisième voie » ni institutionnelle ni « gauchiste », et que je ne sais comment qualifier pour le moment, sinon de très étonnante. Markus Gabriel défend les droits de la spéculation philosophique, en soutenant deux thèses pour le moins audacieuses : 1) que tout ce qui existe a un sens, et que la science n’est qu’une façon parmi d’autres d’aborder le sens de ce qui existe, et surtout 2) en défendant l’idée que le scientifique ne peut pas connaître le monde dans son entier, pour la bonne et simple raison que le monde n’existe pas !
Tout existe, les planètes, l’Allemagne, les séries télés, mais pas le monde comme un tout.
La thèse de Markus Gabriel n’est donc pas que les sciences ne s’occupent que d’un ensemble particuliers de phénomènes, alors que la philosophie s’intéresse à tout (au Tout en tant que tel), et qu’elle seule pourrait donc maintenir une vision unifiée du réel face à sa dispersion dans des champs de recherche spécialisés. Non, Gabriel affirme au contraire que ce sont les sciences qui croient pouvoir connaître la totalité du réel, là où la philosophie doit dissiper cette illusion qu’il existe un Tout, par-delà l’intrication des domaines infiniment divers qui constituent notre réalité ! Cette thèse est selon Markus Gabriel le fondement d’une philosophie qu’il qualifie avec Maurizio Ferraris de « nouveau réalisme » : tout existe, sauf le monde ! Lassé de voir la philosophie confinée à un rôle de second plan, lassé d’être obligé de s’en tenir à de simples phénomènes, le nouveau réalisme entend s’installer de plein pied dans la réalité et ne plus se laisser intimider par la science, c’est à dire transgresser l’interdit kantien et retrouver véritablement la chose en soi. Nous pouvons connaître la chose en soi : telle est l’affirmation principelle du nouveau réalisme.
Le moins que l’on puisse dire est que Markus Gabriel combat des adversaires nombreux et variés. Il ferraille à lui tout seul contre une véritable armée de métaphysiciens qui, selon lui, s’ignorent ; dans le désordre : matérialistes, post-modernes, réductionnistes, physicalistes, kantiens, scientistes… Et encore n’est-ce que pour ce qui concerne les sciences, dont je vais m’occuper presque exclusivement dans cette recension, laissant à part les chapitres consacrés à l’art et à la religion. On essaiera de voir à quoi mène cette tentative de redonner son rôle fondamental à la philosophie, dans une perspective paradoxalement opposée à toute position fondationnaliste, c’est à dire posant un socle à l’expérience et à la pensée.
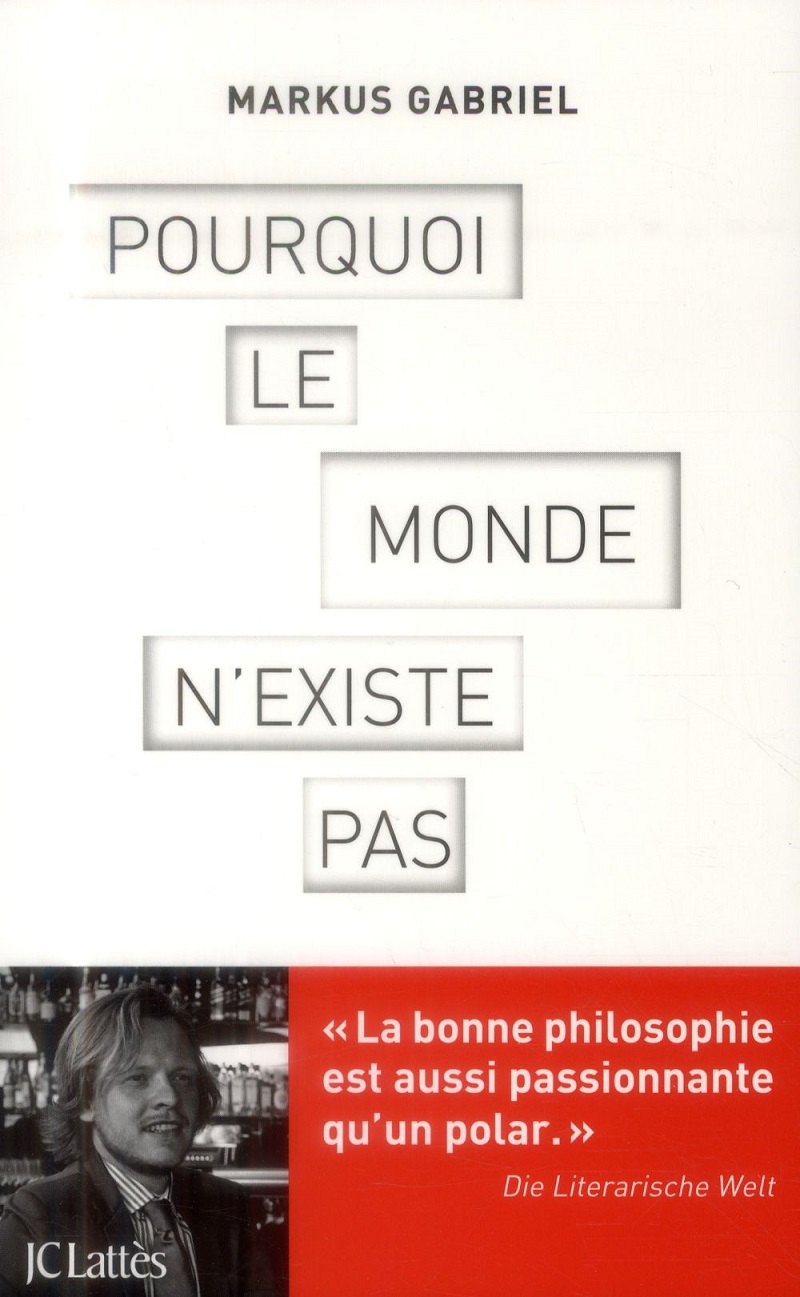
La post-modernité en question
« La postmodernité, écrit Markus Gabriel, a voulu consommer la rupture avec la tradition et nous libérer de l’illusion qu’il y aurait un sens à la vie auquel nous devrions tous aspirer. Mais pour nous libérer de cette illusion, elle n’a fait qu’en créer de nouvelles – et plus particulièrement celle qui prétend que nous sommes en quelque sorte pris au piège de nos illusions. La postmodernité a voulu nous faire croire que depuis la préhistoire l’humanité souffrait d’une gigantesque hallucination collective, la métaphysique » 3.
C’est cette période de la « fin des grands récits » que Gabriel veut dépasser, pour sortir du relativisme généralisé qui a fait de la réalité une simple construction, pire une fiction, finalement une illusion. La métaphysique a prétendu comprendre l’essence de tout ce qui est, mais elle a été un échec grandiose. Or, quand la métaphysique s’effondre, on ne reprend pas contact avec la réalité débarrassée des illusions spéculatives. Non, on constate que c’est l’idée même de réalité qui s’effondre à son tour. Ne reste alors plus que l’infini des perspectives changeantes, un monde de simulacres éphémères.
« La postmodernité a pris l’existence humaine pour un long film d’art et d’essai français, dans lequel chaque protagoniste s’efforce de séduire tous les autres, essaie de prendre le pouvoir sur eux et de les manipuler » 4.
On pense évidemment aux analyses foucaldiennes, développées à satiété dans ses livres et ses articles, sur le pouvoir, la bataille, le conflit, les procédures par lesquelles une société se « stratégise », ou encore aux propos de Lyotard sur le post-moderne, époque où il n’y a plus de norme de juste, de sorte que chacun en est réduit à jouer des coups dans une partie ouverte et sans règles fixes. Il n’y a plus de justice, il n’y a que des coups efficaces, qui fonctionnent bien sur le moment. S’il n’y a plus de réalité, tout est permis ! C’est le pragmatisme le plus cynique qui prévaut alors. Il faut que « ça » marche, et si « ça » marche, c’est bon ! Le sophiste défend son client, une armoire à glace accusé d’avoir tué son voisin. Et il dit : non, mon client n’a pas tué, car il savait bien que du fait de son physique, il serait aussitôt désigné comme l’assassin !… S’il n’y a plus de norme du juste, il n’y a plus qu’à jouer avec l’opinion des gens et se jouer d’eux en manipulant les simulacres. N’est juste et vrai que ce qui, à un moment donné, s’impose comme juste et vrai 5.
Pour sortir de la post-modernité, Markus Gabriel ne prétend toutefois pas revenir à l’ancienne métaphysique, c’est à dire la vision médiévale des essences : « L’ancien réalisme, c’est-à-dire la métaphysique, ne s’intéressait qu’au monde privé de spectateurs, tandis que de manière très narcissique le constructivisme fondait le monde et tout ce qui y apparaît sur notre imagination » 6.
Ignorant le cadre imposé a priori par le sujet à l’expérience, la métaphysique dogmatique erre en prétendant connaître la chose en soi, tandis que le relativisme moderne, tombant dans l’excès inverse, ne voit plus rien au-delà du monde chatoyant des interprétations. Ni post-kantien, ni pré-kantien, Markus Gabriel pourrait être qualifié, provisoirement, de non-kantien : il refuse totalement la notion de corrélation entre sujet et objet, faisant éclater, comme on va le voir, ces deux termes. Il n’y a plus un seul objet, ni un sujet unifié, mais toujours une diversité d’approches. Gabriel identifie donc la métaphysique comme cette discipline qui a commis l’erreur de vouloir spéculer sur le tout. Voilà selon lui l’illusion de départ : la croyance à une totalité des êtres.
Le nouveau réalisme aurait donc pour fonction de déciller notre regard. Enfin les illusions vont tomber, les idoles vont choir et nous allons reprendre contact avec la réalité telle qu’elle est, cette réalité que les philosophes modernes ont manquée, qu’ils soient « réalistes » au sens médiéval ou bien post-modernes : les premiers pour avoir tenté de spéculer sur l’essence des choses, les seconds pour avoir totalement désespéré de connaître une quelconque réalité indépendante de l’esprit. Le nouveau réalisme prétend pour sa part sortir enfin de ces différentes métaphysiques grâce à une ontologie renouvelée.
Ontologie négative et théorie du tout
Derrière cette rangée d’adversaires métaphysiciens, ceux que Gabriel veut atteindre en premier sont, à mon avis, les adversaires scientifiques de la philosophie comme Stephen Hawking. C’est contre eux qu’il dirige sa thèse renversante : le monde n’existe pas. Il défend cette « ontologie négative » contre ce qu’il estime être la métaphysique implicite de la science. En astrophysique, la possibilité de comprendre l’ensemble des phénomènes physiques reste pour le moment hypothétique. Il s’agirait de comprendre l’ensemble des quatre interactions physiques fondamentales sous une même théorie, dite « du tout » : Theory of Everything (ToE). Celle-ci parviendrait à accorder les résultats de la physique quantique (valable aux échelles microscopiques) et de la relativité générale (valable aux échelles macroscopiques). Comme on le sait, plusieurs solutions hypothétiques sont avancées actuellement, telle qu’une théorie de la gravité quantique, ou le recours à des « cordes » comme composants ultimes de la matière, qui existeraient dans un univers en 11 dimensions ! Mais Markus Gabriel refuse tout de go cette prétention scientifique à faire une théorie sur tout. Et c’est certainement contre les partisans de la ToE qu’il écrit : « Le monde n’est pas identique au domaine d’objets des sciences de la nature » 7.
Pour contrer ce réductionnisme de physiciens, il se propose de démontrer qu’il est impossible de tout réduire à un seul domaine, car le tout n’a pas d’existence. Le monde est le domaine de tous les domaines (Heidegger), pas seulement celui de la nature. Comme il existe d’autres domaines et que tous les domaines ne sont pas liées entre eux, la réduction à un seul d’entre eux n’est pas possible. Il n’y pas de rapport de tous les rapports, donc pas de totalité cohérente qu’une théorie pourrait décrire. La ToE est donc impossible. Il n’y a que des choses diverses et variées, qui ne forment pas un ensemble cohérent. Tout n’est pas dans tout. On comprend dès lors que pour Markus Gabriel, même s’il n’emploie pas ces termes, il n’y aura qu’hétérogénéité et multiplicités. (Ce qui, au passage, sonne étrangement postmoderne…) Il est impossible de se faire une représentation du monde, puisqu’il n’y a pas de monde du tout.
On peut immédiatement se demander si l’auteur ne sollicite pas le texte de Hawking en lui prêtant l’ambition de bâtir une théorie de la totalité de ce qui est. Quand Gabriel entend Theory of Everything (sans vraiment la nommer) comme théorie de la totalité de ce qui existe, il prend l’expression au pied de la lettre, et certes on peut entendre cela si on n’en sait pas plus, mais il oublie que pour les scientifiques, la ToE porte sur l’ensemble des phénomènes physiques, pas l’ensemble de tous les phénomènes. Ils cherchent simplement à accorder en une totalité cohérente un domaine qui est pour le moment expliqué par deux théories, physique quantique et relativité générale. Or, cela est insupportable pour l’esprit scientifique : comment des phénomènes de même nature pourraient-ils obéir à des lois totalement différentes selon leur échelle ? Il faut bien parvenir à une théorie réconciliant deux théories incompatibles ! Voilà tout ce que Hawking et ses collègues veulent dire, me semble-t-il. Mais pour le philosophe, tout cela prend des proportions… métaphysiques ! C’est le philosophe qui prête au scientifique des préjugés de métaphysicien, pour mieux ensuite réfuter les excès métaphysiques des sciences. Et Gabriel passera une bonne partie de son livre à combattre l’hydre (ou la chimère) du scientisme, à grands renforts d’arguments pour nous démontrer que non, il existe des phénomènes bel et bien des phénomènes non-naturels, tels que les Etats, les sentiments, la pensée etc. Certes, mais qui en doute sincèrement parmi les scientifiques ?… Vouloir comprendre l’ensemble des phénomènes de l’univers n’est pas tout réduire à l’univers physique. Ce qui est le plus intrigant chez Gabriel est cet effort aussi considérable qu’artificiel pour réfuter une thèse adverse manifestement intenable. Il est vrai que depuis Platon, mettant en scène des sophistes manifestement idiots, le procédé n’est pas nouveau : on s’invente un ennemi débile intellectuellement pour se donner le prestige de le vaincre par KO. Et il faudrait être un scientifique singulièrement borné, ridiculement borné même, pour prétendre embrasser l’ensemble des phénomènes (naturels, sociaux, esthétiques…) à l’aide d’une seule grande théorie. Même quelqu’un comme Jean-Pierre Changeux, qui prétend que grâce à la « neuroesthétique » nous pourrions comprendre le plaisir esthétique comme satisfaction devant une parcimonie comparable à celle de la sélection naturelle, bref même quelqu’un qui visiblement ne comprend rien à l’art comme Jean-Pierre Changeux, reconnaît que l’étude du cerveau ne permet pas de comprendre pourquoi nous faisons des oeuvres d’art et pas les singes, alors que nous sommes si proches d’eux !
Mais pour Markus Gabriel, les scientifiques seraient pris aujourd’hui d’une hybris de connaissance que le philosophe devrait dénoncer séance tenante ! Or, le scientifique ne peut pas rationnellement renoncer à expliquer l’ensemble des phénomènes qu’il étudie, et ce n’est pas une prétention démesurée de sa part, c’est simplement son métier ! Ce n’est pas pour autant qu’il réduit tout à son domaine, quoi qu’il essaye, il est vrai, d’expliquer le plus grand nombre de phénomènes à partir de sa discipline. Il est alors, à la marge, amené à tenter la réduction d’autres phénomènes au sien (le vivant à du chimique, le mental à du cérébral), afin de pousser le plus loin possible sa recherche. Il est en effet impossible de connaître par avance jusqu’où une science peut obtenir des résultats. C’est pourquoi un scientifique est nécessairement réductionnisme dans sa pratique.
Mais la figure du réductionniste radical et borné est un épouvantail bien commode pour le philosophe. Ce dernier se donne le beau rôle quand il vient rappeler le scientifique à la raison après l’avoir fait passer pour fou. « Les prétendus théoriciens des cordes pensent qu’en dernière instance la réalité physique n’existe même plus d’une manière compréhensible sur le plan spatio-temporel. Il pourrait s’agir, du moins dans l’espace-temps à quatre dimensions, d’une sorte d’hologramme, projeté depuis de lointaines étendues avec des processus déterminés formulables en équations physiques » 8.
En présentant cette image d’un monde totalement exotique, absolument différent de celui qu’appréhende le commun des mortels, Markus Gabriel cherche à nous faire peur. Le philosophe va alors faire appel au bon sens en rabrouant ces scientifiques égarés par leurs théories extravagantes. Mais qui s’égare vraiment ? Conjecturer l’existence d’une ToE, ce n’est pas déterminer à l’avance son contenu. A vrai dire, les scientifiques ont plus de recul sur cette question que le philosophe. Selon Edward Witten, physicien spécialiste de la théorie des supercordes, on pourra un jour parvenir à une théorie-M pour unifier l’ensemble des modèles actuels, en sachant que « the M in M-theory can stand for « magic », « mystery », or « matrix » according to taste, and the true meaning of the title should be decided when a more fundamental formulation of the theory is known ». Quant au philosophe nouveau réaliste, plus pressé, il veut tout de suite nous émerveiller avec sa matrice de concepts d’où vont surgir, comme on va le voir, bien des effets magiques et des déclarations mystérieuses !

Espace multidimensionnel de Calabi-Yau
« Tout existe sauf le monde ! »
Ces réserves, considérables, étant faites, voyons comment Markus Gabriel défend sa propre thèse. Qu’a-t-il à opposer à tous ces gens qu’il a magistralement renvoyés à leurs errances spéculatives ? Comment va-t-il nous ramener à la réalité ?…
Dès le début de sa démonstration, les difficultés s’accumulent. Pour défendre son ontologie négative, l’auteur doit en effet tordre le vocabulaire et la logique à l’extrême, tant sa thèse est paradoxale. Par exemple, lorsqu’il affirme : « … Il existe bien plus de choses qu’on pensait, à savoir tout ce qui n’est pas le monde. Je soutiens qu’il y a des licornes en uniforme de police sur la face cachée de la lune, car cette pensée existe dans le monde et avec elle les licornes en uniforme » 9, il est évident qu’il cherche à nous sidérer. Pourquoi pas, bien évidemment, c’est le péché de mignon des philosophes… Mais le plus étonnant dans cette phrase n’est pas l’existence des licornes sélénites en uniforme. Le problème se pose davantage au niveau logique. Je vois deux difficultés quasiment insurmontables dans l’affirmation que je viens de citer :
1) Comment ranger dans une même catégorie « tout ce qui n’est pas le monde », si le monde n’existe pas ? Je peux faire une catégorie de tous les objets non-verts, par exemple, mais à condition que le vert existe ! Car si le vert n’existe pas, tous les objets sont non-verts, donc être non-vert n’est pas une propriété, même pas négative ! Tout comme si, en suivant Berkeley, j’affirmais que la matière n’existe pas et qu’ensuite je faisais une catégorie des objets non-matériels. Cette catégorie regrouperait de fait tous les objets qui existent. Cet ensemble aurait donc une extension infinie et une compréhension nulle. Aussi, même à l’intérieur de la logique de l’auteur, l’expression « tout ce qui n’est pas le monde » est pour le moins problématique. Le problème métaphysique se redouble d’un simple problème de vocabulaire.
2) Et surtout : comment affirmer dès la phrase suivante que cette pensée (qu’il existe des licornes) existe « dans » le monde ? Mais on vient de dire que le monde n’existe pas ! Et que veut dire l’énoncé : cette pensée existe et avec elle les licornes ? Il y aurait d’un côté les licornes imaginaires, de l’autre la représentation intellectuelle de ces licornes ? Mais où est la pensée et où sont les licornes : dans deux lieux séparés, dans un seul lieu (l’imaginaire) ?…
On voit sur ces deux phrases le genre de contradictions sémantiques et logiques dans lesquelles l’auteur s’empêtre. Il est difficile de se passer complètement du terme de « monde » et plus encore, de distinguer ce qui existe de ce qui n’existe pas. Car en poussant le raisonnement de l’auteur, si tous les objets imaginaires (les licornes) et idéels (les nombres) existent, au même titre que les objets matériels (les chevaux), pourquoi dans ce cas le monde n’existerait-il pas ?… Les licornes n’existent qu’en imagination, donc pour Gabriel, elles existent tout de même bien. Or, en suivant la logique pour le moins paradoxale de l’auteur, on aurait envie de dire que c’est bien parce que le monde n’existe pas… qu’il existe !
A mon avis Frédéric Nef se trompe dans sa recension en affirmant que « Gabriel néglige l’immense jungle des choses non existantes », car Gabriel dirait bien que les licornes existent dans l’imaginaire, quoique par ailleurs Frédéric Nef ait raison de pointer une contradiction en ajoutant aussitôt que « si le monde n’existe pas, on aimerait bien savoir de quelle sorte d’objet non existant il s’agit, et si cet objet non existant est composé ou pas d’entités plus petites ». La remarque est très juste car, si on se place dans la logique de Markus Gabriel, on est bien forcé de d’admettre la règle suivante : ce n’est pas parce qu’une chose n’existe pas matériellement qu’elle n’existe pas du tout ! En effet, si on peut tenir un discours sur les licornes, pourquoi ne le pourrait-on pas aussi du monde inexistant ? Y aurait-il une distinction subtile à faire entre différents modes de non-existence ?… La licorne existe seulement dans notre imaginaire mais on dirait que le monde n’existe pas du tout… même pas en rêve ! Sauf que cette affirmation est contestable, comme l’a vu Frédéric Nef, car si des gens cherchent une totalité au monde, ou s’ils rêvent d’un monde commun, le monde existe au moins en imagination, ou comme un idéal, donc il n’est pas rien du tout !
On touche ici à une limite de l’argumentaire soutenu par Gabriel. Il ne suffit pas de penser que le monde existe pour qu’il existe réellement comme un tout, mais – toujours en suivant l’ontologie négative de Gabriel – on doit dire que, du moment qu’on le pense, le monde n’est plus un pur néant. Le nouveau réalisme ne produit-il pas que des chimères ? Nouveau réalisme, nouvel illusionnisme ?
Il est vrai que l’auteur répond à l’objection peu après, en distinguant le domaine dans lequel les choses existent :
« La question n’est donc jamais simplement de savoir si quelque chose existe, mais de savoir où quelque chose existe. Car tout ce qui existe, existe quelque part – ne serait-ce que dans notre imagination. La seule exception est, une fois encore, le monde. » 10
Mais pourquoi ? Si j’imagine les licornes, le monde, et un monde avec des licornes, ce monde existe ! Si j’imagine le tout, il existe, cela découle de ce que vient de dire l’auteur. Il est pourtant prêt à admettre ce paradoxe massif que les licornes existent « dans » l’imagination mais pas « dans » le monde ! Sauf les fois où, par commodité d’expression, il est obligé d’évoquer ce qui existe « dans » le monde (et pas seulement « dans » notre esprit).
Même en prenant bien soin d’entendre le monde au sens de totalité, on n’échappe pas aux formules renversantes, à la limite de l’illogisme, de l’inintelligible : « Tout se passe dans un grand nulle part » 11. Encore ce « tout », dont on a décidément bien du mal à se passer, non seulement comme mot mais surtout comme idée. Comment prétendre parler de tout en disant que le tout n’existe pas ? Et comment éviter de s’interroger sur la totalité de la réalité pour parler du monde ? Nous voici vraiment perdus au milieu de nulle part…
Mais l’auteur, certain de ses principes, va de l’avant. Plus d’une fois, des indications donnent l’illusion d’un cours magistral : « retenons donc ceci » (page 40) etc. mais rien ne dit qu’on progresse véritablement, sinon en allant d’affirmations renversantes en paradoxes ahurissants.
Les faits et les choses
Le monde est fait d’objets qui apparaissent « dans » des domaines d’objets et il existe beaucoup de domaines d’objets, qui ne se recouvrent pas complètement, voilà où veut en venir Gabriel. N’oublions pas que ce propos a pour but de justifier que ne se réduit pas à des particules élémentaires, que nous sommes donc dans le cadre d’un anti-réductionnisme primaire, qui est lui-même assez simpliste, hélas. Le scientifique doit sagement se cantonner à son domaine particulier, c’est le philosophe qui le dit :
« Mais le philosophe peut décider que l’univers n’est pas le tout pour la bonne raison qu’il n’est que le domaine d’objets, ou le domaine de recherche, de la physique. Parce que, comme toute science, la physique est aveugle à tout ce qu’elle n’étudie pas, l’univers est plus petit que le tout » 12.
A ce moment de la lecture, on serait tenté de dire que l’auteur combat un réductionnisme caricatural à grand renforts de distinctions conceptuelles évidentes, sur fond d’une métaphysique complètement contradictoire (l’univers est plus petit que le tout… qui n’existe pas, rappelons-le). Reste que c’est le philosophe qui a « décidé » que… Il n’est donc que de s’incliner devant ses décrets.
Peu après, on aura droit à une réfutation convenue du matérialisme : « le matérialisme doit reconnaître l’existence des représentations idéelles pour être à même de les dénier par la suite » 13. Gabriel parle ici comme ces théologiens qui affirment que l’athée doit reconnaître que Dieu existe pour essayer ensuite de réfuter son existence. Le matérialisme radical se réfute certes de lui-même, car pour affirmer qu’il n’y a que de la matière, il faut le penser, donc il faut qu’il n’y ait pas que de la matière, mais aussi de la pensée. Mais là encore, on invoque le démon du scientisme borné pour l’exorciser victorieusement.
L’auteur cherche ensuite à affiner sa définition de la notion de monde, pour mieux la réfuter ensuite. De Heidegger, nous passons alors à Wittgenstein, pour qui le monde est l’ensemble des faits. De Heidegger à Wittgenstein, autant dire un véritable saut du coq à l’âne !
Un fait, selon Gabriel « est quelque chose qui est vrai à propos de quelque chose » 14. La définition est pour le moins vague. En outre, elle repose sur une amphibologie de la notion de « quelque chose », prise en deux sens différents : dans la première occurrence, elle désigne un énoncé ou une affirmation, dans la seconde un objet, réel ou non. Mais la définition serait plus claire si on la formulait par exemple de cette façon : un fait est un état du monde que l’on constate et dont on doit nécessairement tenir compte (c’est un fait qu’aucune vitesse ne peut dépasser celle de la lumière ; c’est un fait que faire un choix comporte toujours un risque d’erreur etc.) Mais on ne peut mettre l’énoncé (verbal ou écrit) sur le même plan que le phénomène observé, sauf à être victime d’une hallucination mentale ! Or, l’auteur semble bien donner en plein dedans, comme le montre la supposition suivante :
« Admettons qu’il n’y ait que des choses, et pas des faits. Il serait donc vrai de ces choses que rien n’est vrai à leur propos » 15. Cela signifie que les faits existent au même titre que les choses. Imaginons donc un univers dans lequel il n’y aurait qu’un seul objet matériel. Pour Gabriel, il y aurait paradoxalement deux choses dans ce monde : l’objet lui-même et le fait que cet objet existe.
Imaginons même, toujours avec l’auteur, un monde sans rien, une désolation infinie. Dans cet univers, il y aurait au moins un fait : le fait qu’il n’y a rien. Donc même s’il n’y avait rien (au sens usuel du terme), il y aurait quelque chose (au sens de l’ontologie de Gabriel) ! Il ne peut pas y avoir rien, rien de rien, car le fait du rien serait bien là. Comme si le fait était « dans » ce monde vide comme les atomes « dans » l’univers. Au moment où il réfute la notion de monde comme globalité dans laquelle tout est contenu, Gabriel ne cesse d’avoir recours à cette image du contenant, comme si les faits étaient « dans » le monde, ce dernier fût-il vide. On s’arrache les cheveux pour suivre la logique du propos.
Ne peut-on objecter que les choses existaient avant qu’un esprit ne puisse faire des constats à leur sujet ? Que donc il n’y a de faits qu’à condition qu’il y ait quelqu’un pour pouvoir constater quelque chose ? Or, dans un univers vide, il n’y a rien à constater, et personne non plus pour faire des constats ! Alors, à quoi bon soutenir malgré tout qu’il y a toujours au moins un fait, même en l’absence de toute chose ? La confusion consiste à mettre dans les choses mêmes ce que l’on dit sur elle, comme si les propositions faites sur les choses étaient des propriétés contenues dans ces choses !
Mais l’auteur poursuit, sûr de lui : « à présent, nous savons que » (Page 54)… Les attaques contre Hawking deviennent explicites : « Une réduction ontologique du tout en un est au mieux l’expression d’une fainéantise qui n’a rien de scientifique » 16. Le scientifique dogmatise quand il prend son domaine pour le tout. Raison pour laquelle Hawking est « bien trop surfait comme intellectuel » 17… Mais le philosophe n’est-il pas fainéant de prêter des illusions philosophiques à ses adversaires pour le réfuter plus facilement ?
Les champs des sens
Nous en arrivons ensuite au concept-clef de l’auteur, celui de champ de sens (Sinnfeld), qui doit permettre de fonder son ontologie et donc de définir la nature ultime et non-métaphysique de la réalité. Les champs de sens sont les « unités ontologiques fondamentales » 18. L’argumentation, brièvement résumée, est la suivante : la question est de savoir pourquoi le monde n’existe pas, ou plus littéralement en allemand, « pourquoi le monde n’est pas donné », « Warum es die Welt nicht gibt ». Réponse : parce que le « monde » ne se donne qu’à travers des champs de sens. Or, il n’y a pas de champ de sens qui englobe l’ensemble de tous les champs de sens : il n’y a pas de super-champ qui contiendrait tous les champs et se contiendrait lui-même. Il y a donc toujours une pluralité de champs de sens, non totalisables. L’idée du tout est fausse, donc le monde n’existe pas.
Or, la position de l’auteur ne s’arrête pas à la contestation du positivisme « scientiste », sur la base d’une mise en avant de l’activité interprétative du sujet. Gabriel entend aller plus loin et soustraire totalement l’interprétation à la subjectivité. Ce n’est pas l’esprit humain qui dessine préalablement un champ de sens (science, religion, art etc.) au sein duquel des phénomènes vont apparaître et avoir du sens pour l’esprit. Néanmoins, l’auteur ne dit pas non plus que le sens appartient aux faits eux-mêmes, ce qui serait une façon de revenir au « positivisme ». Un fait donné peut avoir plusieurs sens, car il peut apparaître au sein de plusieurs champs de sens. Le cheval apparaîtra différemment à l’éthologue, au boucher chevalin, à l’éleveur, au peintre, à l’historien des mythes… Il apparaîtra toujours dans un champ de sens qui est toujours déjà-là au moment où je m’intéresse au cheval. Et si plusieurs champs de sens peuvent s’entrecroiser (l’éthologie peut intéresser l’éleveur etc.), il n’existe pas un sens supérieur aux autres et qui les comprendrait tous : le cheval existe bien mais il n’apparaît jamais de façon « neutre ». Il n’y a pas de « cheval en soi ».
Les champs de sens ne sont ni subjectifs, ni objectifs. Cela exclut l’hypothèse kantienne d’une corrélation chose-esprit. Le sens existe indépendamment de l’esprit qui le perçoit, mais aussi, semble-t-il des choses elles-mêmes. Le champ de sens est plutôt la façon dont les choses nous apparaissent et simultanément, la façon que nous avons de nous rapporter à elles. En un geste qui n’est pas sans rappeler celui de Heidegger, Markus Gabriel cherche à revenir en-deça du corrélat sujet-objet, pour retrouver l’espace à l’intérieur duquel ce corrélat peut apparaître. Le sens est la manière dont un objet apparaît et le sens est rapporté à l’apparaître lui-même. L’objet se donne à nous d’une certaine façon. Le sens est consubstantiel à l’apparaître et il n’y a pas d’apparaître « neutre ». Il y a toujours un style, une façon, une tournure.
Au passage, je me demande dans quelle mesure la notion de champ de sens n’est pas un décalque de la notion de champs de particule de la Quantum Field Theory. Tout existe au sein d’un champ de particules élémentaires. La querelle engagée par Gabriel porterait sur le primat ontologique d’un des deux types de champs. Qu’est-ce qui vient en premier, le champ de particules ou le champ de sens ?… Or, comme on l’a vu, pour Gabriel, le champ de sens est premier : il est la façon dont un phénomène nous apparaît. Le champ gravitationnel apparaît toujours au sein d’un champ de sens ; la science n’est qu’un champ de sens parmi d’autres. Seul le philosophe peut voir qu’il n’y a que des champs de sens divers. Je me demande si Gabriel n’a aussi pas décalqué son concept de la notion de courbure de l’espace/temps dans la relativité générale : ce n’est pas l’objet qui courbe l’espace/temps, l’objet est lui-même cette courbure. J’admets cependant que ce n’est qu’une conjecture de ma part, mais si elle est juste, on peut dire que, tout comme une masse est une déformation de l’espace/temps, chaque champ de sens est comme une « courbe » dans la réalité. L’auteur, comme d’autres philosophes avant lui, aurait décalqué des notions scientifiques pour forger un concept philosophique, par transport de sens, c’est à dire par métaphore. En soi, l’opération n’a rien d’impossible ni de scandaleux, si toutefois elle apporte quelque profit théorique et ne nous enferme pas dans des paradoxes intenables.
Avec les champs de sens, le transcendantal kantien est en quelque sorte éclaté en une myriade de conditions de perspectives. Il n’y a jamais une façon unique de considérer les choses, la science n’est donc pas une connaissance ultime qui pourrait prendre la place de toutes les autres. Il serait scientiste de dire que le seul champ de sens valable est celui de l’astrophysique. Le monde n’est pas fait que de quarks, de gluons et de positons. Tout ne se réduit pas à la matière. C’est le perspectivisme.
Mais hélas, le propos de l’auteur se réduit à ne démontrer que cela… A côté des sciences, il y a de nombreux domaines qui ont leur validité : « Même si fondamentalement, il est louable de parier sur la science, la raison et les lumières, il ne faudrait pas pour autant rabaisser sans raison la philosophie, parce qu’elle progresse et régresse comme les autres sciences » 19. Il se pourrait malheureusement que Hawking ait de bonnes raisons pour lui, à savoir que la science a progressé et pas la philosophie. Et il est notable que lorsqu’on affirme que la philosophie progresse, ou régresse, on se donne rarement le mal de dire en quoi. Ce flou est bien sûr très utile pour maintenir l’aura scientifique de la discipline.
Le chaos du sens
Quand l’auteur veut illustrer son concept à l’aide d’oeuvres d’art, le propos n’est pas plus convaincant. Je passe sur une tentative d’explication du fameux Carré noir sur fond blanc de Malévitch, bien trop confuse et sur une longue dissertation, typiquement post-moderne, consacrée à la série américaine Seinfeld, dont le nom va être acrobatiquement raccroché à la notion de champ de sens (Sinnfeld) : Seinfeld, c’est littéralement le champ d’être. Or, Seinfeld est une série où les personnages parlent de tout et de rien, donc c’est une série sur le tout et le rien, donc le champ de sens, c’est le champ d’être etc.
Autre exemple, le film Cube (1997, de Vincenzo Natali) : un groupe d’individus qui ne se connaissent pas se réveillent enfermés dans une vaste salle cubique. Ils vont découvrir des dizaines d’autres salles comme celle-ci, à l’intérieur d’un gigantesque cube rempli de pièges. « Cependant, écrit Gabriel, à l’extérieur du cube, il n’y a que le vide, le néant qui apparaît aussi à la fin sous forme d’une lumière éclatante » 20. Chaque cube est donc un champ de sens et il n’y a rien au-delà. Ce film est donc sans le savoir une illustration du nouveau réalisme ! Interprétation contestable. L’existence de ce Cube est peut-être tout sauf absurde. En effet, au cours du film, les personnages vont être mis face aux fautes qu’ils ont commises avant leur emprisonnement et punis selon la gravité de leurs crimes. On peut donc penser qu’ils ne sont pas dans ce cube par hasard et que ce dernier est en réalité une gigantesque salle du Jugement Dernier. De cette épreuve ne ressortiront que ceux qui n’ont pas commis de péchés mortels. Et la lumière aperçue à la fin pourrait donc être celle du paradis. Rien ne dit que ce film soit une illustration de la pensée de Markus Gabriel. Mais les philosophes ont bien du mal à voir dans les oeuvres d’art autre chose qu’une illustration de leurs thèses métaphysiques…
Markus Gabriel propose en fait une monadologie sans harmonie préétablie (on a pu dire la même chose de Nietzsche) : il n’y a que des champs de sens divers, sans unité, sans ordre. Il n’y a pas de champ de sens englobant tous les autres, de sens dernier qui serait le fond de tous les autres. Il n’y a pas, dit l’auteur, de « superobjet », à savoir, dans le langage sophistiqué auquel il nous a habitué : « quelque chose que rien ne distingue de tout le reste et qui n’est identique qu’à soi-même, ne peut bien entendu pas exister : cela ne sort pas du lot » 21. Le superobjet serait tous les objets et aucun objet. Objet contradictoire, certes, mais dont on peut dire contre l’auteur qu’il sortirait du lot ! Il ne serait pas hors du lot, puisqu’il serait le lot lui-même !
En somme, le monisme de Spinoza est faux et on ne peut pas parler du tout. Il reste alors un pluralisme perspectiviste, à l’infini, sans origine ni point de fuite. Mais comment l’auteur peut-il savoir qu’il n’y a que des champs de sens ?… Qu’ont-ils comme propriété commune pour qu’on sache qu’il n’y a qu’eux ? Lorsque Nietzsche présente son interprétation du monde en terme de volonté de puissance, il insiste sur son caractère hypothétique 22, alors que pour Markus Gabriel, l’existence des champs de sens est une certitude. Mais si l’existence des champs de sens est attestée, ne faudrait-il pas en appeler à un super champ de sens qui nous offrirait la vision de la nature commune de tous les champs particuliers ?
Bref, comment l’auteur sait-il qu’il n’y a que des champs de sens ? Quelle intuition géniale lui permet de l’affirmer ? Comment a-t-il eu cette vision directe d’un tout, dont il s’acharne à montrer qu’il n’existe pas ?
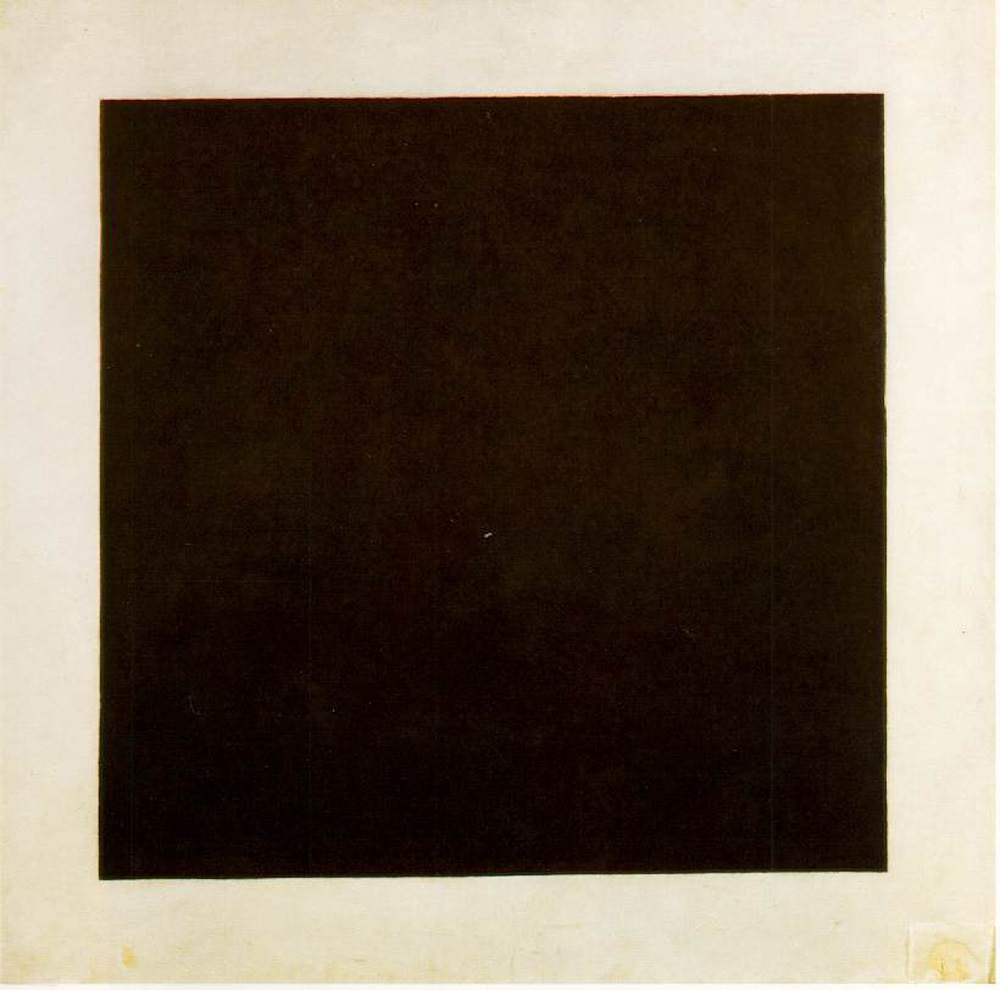
Kasimir Malevitch, Carré noir sur fond blanc, 1915
Les espaces infinis
Quelle est la place de l’homme dans ce vaste chaos de sens ? A ce sujet, les affirmations aussi déroutantes que définitives se multiplient dans la suite du livre. C’est toujours la science qui est en point de mire :
« En pensant que sans nous le monde n’existerait pas, nous croyons que l’univers veillera bien à la pérennité de l’humanité, car l’univers devrait tout de même être intéressé à persister dans son être » 23. Mais qui croit cela ? Sûrement pas les astrophysiciens, qui savent à quel point l’univers est hors de proportion par rapport à notre planète et à ce que le sens commun peut appréhender. L’astrophysicien dirait plutôt, à mon avis : l’univers a existé sans nous pendant des milliards d’années et il continuera d’exister bien après nous.. Nous sommes donc un grain de sable dans un univers qui n’a pas besoin de nous pour exister. L’astrophysicien sait donc bien que le « conatus » de l’univers n’implique en rien la pérennité de l’humanité ! On découvre tous les jours que l’univers est encore bien plus grand que tout ce qu’on imaginait la veille. J’ai lu récemment que le plus grand trou noir connu a une masse égale à treize milliards de fois celle de notre soleil !
Et pour continuer sur cette phrase, que veut-elle dire ? Comment peut-on poser une relation entre « le monde sans nous n’existerait pas » et « l’univers veillera bien à la pérennité de l’humanité » ? Il y a là une contradiction flagrante, comme si deux thèses opposées venaient de se heurter et de s’agglomérer en une seule proposition. En tout état de cause, soit 1) l’univers nous est indifférent et il peut se passer de nous, soit 2) le monde est intéressé à notre existence et il ne peut pas exister sans nous.
Je tâche autant que possible de me montrer charitable avec l’auteur mais j’avoue que certaines de ses phrases sont vraiment trop confuses pour qu’on puisse espérer démêler leur sens.
Je retiens que Markus Gabriel oscille aussi dans son livre entre la reconnaissance de notre insignifiance face à l’univers, et l’affirmation que tout a un sens dans le monde, en particulier l’existence humaine. Je n’ai pas l’impression que cette hésitation soit vraiment dépassée. Le monde humain n’est rien face à la totalité du monde physique mais pour nous, à notre échelle minuscule, il est essentiel. D’un point de vue physique, nous ne sommes rien, mais la réalité ne se réduit pas aux phénomènes physiques, donc l’humain a de l’importance dans le monde (avec toutes les précautions quant aux termes de « monde » de « dans »)…
Gabriel parvient difficilement à tenir les deux positions à la fois. Il constate que le monde est infiniment plus riche, plus vaste, plus complexe que ce que l’esprit humain est capable d’appréhender ordinairement et il voudrait situer notre place à l’intérieur de ce monde infiniment complexe. « Un nombre infini de choses ont lieu en même temps. Simplement, nous ne mesurons pas l’ampleur du phénomène, ne serait-ce que parce que nous ne sommes pas capables de nous occuper d’une infinité de choses en même temps » 24.
Gabriel reproche aux scientifiques de se perdre dans la contemplation de ces « espaces infinis » (Pascal) et d’oublier notre monde humain en ne le voyant que comme une poussière dans l’univers. Le scientifique serait victime de l’illusion d’objectivation : il s’oublierait dans la contemplation de phénomènes qu’il a lui-même découverts. Le sujet de la connaissance s’oublie dans l’objet connu, il se dépossède lui-même de sa place dans un monde que pourtant il a objectivé à partir de cette place. Il est en quelque sorte aliéné par ses propres découvertes, parce qu’il oublie qu’il parle toujours depuis un certain point de vue qui offre un regard sur les choses. Pour le dire autrement, l’astrophysicien oublie que c’est l’homme qui fait de l’astrophysique etc. Contre cette vision désespérante, Gabriel veut maintenir la valeur de la présence de l’homme dans l’univers.
Il faudrait resituer la connaissance scientifique à sa juste place… ce qui est de toute façon impossible dans cette ontologie des champs de sens. C’est là toute l’ambiguïté du rapport de Gabriel aux sciences : il refuse qu’elles soient auto-fondées et ne les accepte à la limite que si elles se conforment aux injonctions de la philosophie.
« Intention éminemment philosophique, comme le dit Jean-François Revel, puisque la philosophie moderne pallie la difficulté qu’elle éprouve à définir son propre objet en définissant celui des autres disciplines, ou plutôt pallie la difficulté qu’elle éprouve à conserver un objet quelconque en contestant tous les autres. En même temps qu’elle récuse volontiers les sciences, elle s’offre bizarrement à les rendre légitimes à condition qu’on fasse appel à ses services, elle seule ayant à ses propres yeux qualité pour les fonder. Dans cette conduite ambiguë se lisent à la fois le désir d’annuler magiquement les types de savoirs extérieurs à la philosophie et celui d’y participer, le projet de reconstruire le savoir en marge du savoir » 25.
Le sens de la vie
En fin de parcours, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés à la fin sur le sens ultime tant recherché : « Le sens de l’être, la signification de l’expression « être », ou plutôt « existence », c’est le sens même » 26. Cette réponse n’est guère plus substantielle que les petits jeux heideggeriens sur les génitifs réversibles : la vérité de l’être, c’est l’être de la vérité ; l’être du sens, c’est le sens de l’être etc.
« Le sens de la vie, c’est la vie, la confrontation avec le sens infini à laquelle par bonheur nous avons le droit de participer » 27. Ce sont autant de questions en suspens contenues dans une réponse faussement simple : un sens infini est-il encore un sens ? Pourquoi est-ce d’un bonheur d’y participer et pas un malheur pour la une conscience perdue face à l’infini ?…
Il est évident qu’à force de vouloir tout dire, Markus Gabriel ne dit plus rien. Il veut prononcer le mot définitif sur le sens dans la vie, en ayant auparavant supprimé toutes les conditions qui rendraient une réponse possible ! Le sens infini, c’est l’infini du sens, mais c’est surtout la perte dans la confusion mentale la plus complète ! Qu’on en juge : l’auteur prétend définir LE sens de la religion, puis LE sens de l’art, ainsi que celui de la science, de l’univers, de la philosophie, de la vie… Tout cela en moins de 300 pages ! Avec deux chapitres de plus, nous aurions eu le sens de la morale et de la politique -curieusement absentes de ce grand traité du tout et du rien… Markus Gabriel nous propose en fait une super-salade composée, je veux dire composée de tous les ingrédients imaginables, un mélange tellement riche qu’il en devient indigeste !
Plus on lit l’auteur, plus on s’aperçoit que sa philosophie est vraiment proche du post-modernisme qu’il prétendait dépasser : s’il n’y a que des champs de sens, il n’y a pas de vérité définitive, il n’y a pas de réalité à laquelle se raccrocher avec certitude, il n’y a que des interprétations à l’infini, ce qui est la formule même de la post-modernité. François Loth a bien raison de parler d’un « post-post-modernisme » de Gabriel. Il ne propose en fait qu’une version nouvelle du relativisme et sa philosophie n’offre rien de plus que n’importe quelle autre forme de relativisme, à savoir un mélange de paradoxes vains et d’évidences.
Or, l’auteur aurait pu se sortir de ce relativisme généralisé en suivant Heidegger un peu plus loin qu’il ne le fait, en se rappelant que pour Heidegger, le monde n’est ni l’ensemble de ce qui est, ni la nature de tout ce qui est, mais ce que nous habitons : nous avons à le bâtir d’abord, afin de l’habiter 28 . Il est une construction humaine, historique, contingente et fragile sans doute, mais indispensable à notre existence. Et cela n’en fait pas une illusion, s’il est le produit de notre action.C’est pourquoi il est très difficile de se passer de toute idée d’une « structure fondamentale englobante » 29, comme ont prétendu le faire les post-modernes, et Markus Gabriel à leur suite. Ce n’est pas céder à une superstition métaphysique ou scientifique que de vouloir penser ce qu’est notre notre monde et ce qu’il devrait être demain. Markus Gabriel serait peut-être d’accord, du reste, mais la tâche d’une ontologie positive est rendue explicitement impossible par son propos. Pour lui, soit le monde existe, comme une construction métaphysique grandiose, soit il n’existe pas du tout. Mais revenons sur terre, et prenons les mots dans un sens plus commun. On peut penser ce qu’est le monde sans être pris de fièvres métaphysiques.
Matérialisme et athéisme
Il est vrai toutefois, à la décharge de Markus Gabriel, que, dans certains bien précis, la philosophie peut avoir encore son mot à dire sur les avancées scientifiques, non pas tant pour borner par avance l’horizon de découverte, que pour signaler au scientifique les présupposés métaphysiques qu’il entretient. Par exemple, pour l’astrophysicien américain Lawrence Krauss, auteur en 2012 d’un livre de vulgarisation scientifique, A Univers From Nothing : Why Is There Something Rather Than Nothing ?, la théorie des champs quantiques (quantum field theory) permet enfin d’expliquer comment l’univers peut surgir à partir de rien : des particules de matière peuvent surgir par fluctuations dans le vide quantique. La vieille question ontologique serait enfin résolue ! Quelque chose peut surgir de rien.
Néanmoins, ce vide quantique (vacuum state), qui est défini comme un espace sans matière et dont la température est le zéro absolu, présente la particularité bien étrange d’être… instable ! Il le faut bien, puisque c’est d’une fluctuation aléatoire de ce vide que des particules peuvent surgir ou non -qu’il y ait une, deux, mille ou une infinité. Mais c’est tout de même un bien étrange vide que celui d’où peuvent surgir des univers entiers !
Qu’il soit donc actuellement vide ne signifie pas qu’il n’ait pas certaines virtualités (certains physiciens parlent en effet de particules virtuelles). D’après ce que nous disent les scientifiques, il est même possible qu’un tel champ contienne virtuellement tout un univers ! Or, pour que quelque chose (something) surgisse de ce rien (nothing), il faut bien que ce quelque chose soit virtuellement contenu dans le rien, donc que ce rien ne soit pas rien du tout !… Le vide quantique a beau être aussi vide que peut l’être un espace physique, il n’y a pas tout à fait rien en lui.
Il y a donc ici un malentendu, entre le rien au sens métaphysique et le vide de l’astrophysicien. Alors, de deux choses l’une : soit le vide quantique n’est pas encore le rien métaphysique tant recherché, et peut-être la science finira-t-elle par mettre au jour ce dernier ; soit c’est la notion métaphysique de rien qui n’était qu’une approximation conceptuelle par rapport au seul vide qui existe physiquement, le vide quantique. Le néant ne serait qu’une notion pré-scientifique ou anti-scientifique, comme l’âme du théologien par rapport aux états cérébraux du neurologue. A tout prendre, l’ancêtre de ce vide quantique serait moins le néant du métaphysicien que l’apeiron des « physiciens » présocratiques : l’apeiron comme cet illimité indéfini d’où tout peut surgir.
Dernière option, plus radicale : c’est la question « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » qui est totalement dénuée de sens. Il n’y a ni raison ni origine à l’existence du monde, parce que le néant n’existe pas. Il serait donc vain pour le scientifique de chercher une réponse à une fausse question. Un peu de réflexion philosophique ne semble pas inutile pour clarifier quelque peu cette confusion sur les mots. En voulant se placer sur le terrain de la question de l’être, cette question si prestigieuse qu’elle passe pour le mystère ultime de l’univers, l’astrophysicien rend indirectement hommage à la philosophie et à la théologie, comme pour parer sa recherche du prestige de celles-ci, alors même qu’il veut les réfuter. Il s’ensuit chez quelqu’un comme Lawrence Krauss un contresens sur l’athéisme, qu’il revendique de façon franchement prosélyte. Or, dans cette version, l’athéisme devient une a-théologie, qui affirme dogmatiquement, et même agressivement, la non-existence de Dieu. Ce qui est parfaitement absurde. L’athéisme n’est pas le fait de croire que Dieu n’existe pas, c’est le fait de ne pas croire qu’il existe. En faisant de l’athéisme un anti-théisme, et pas une absence de position théiste, un Lawrence Krauss ou un Richard Dawkins se battent contre leurs adversaires en partageant la même conviction d’avoir raison sur Dieu. Il se mettent logiquement à leur ressembler, en organisant conférences et forums pour réfuter la religion, comme ces « télévangélistes » qu’ils détestent. Dogmatisme contre dogmatisme. Or, la raison voudrait plutôt que le scientifique ce contente d’expliquer ce que la science sait aujourd’hui et qu’il laisse à chacun le soin d’en tirer les conséquences, à savoir que si le recours à Dieu pour expliquer la nature est inutile, c’est sans doute parce que Dieu n’est réellement pour rien dans cela… Il est d’ailleurs remarquable de voir que quelqu’un comme Lawrence Krauss est convaincu que grâce à ses découvertes, les religions pourraient disparaître d’ici quelques années. Ce qui est tout de même faire preuve d’une confiance bien excessive dans les pouvoirs de la science ! Or, on ne peut pas se dire mécréant et se comporter en théologien, ou le contraire. Alors, scientifiques athées, encore un effort pour être matérialistes !

Conclusion
Peut-être un jour pourra-t-on écrire un théorème de psychologie de la découverte qui énoncera à peu près cette constante : arrivé à un certain degré de progression dans son domaine, surtout si ledit progrès est spectaculaire, tout scientifique, si modeste soit-il par ailleurs, finit par se prendre pour un métaphysicien.
Ce phénomène se vérifierait par exemple dans le cas d’un Axel Kahn nous parlant du bien et du vrai, ou de Jean-Pierre Changeux sur le beau, le bien et la neuroesthétique.
Réciproque : Il se trouvera toujours un philosophe pour rabrouer plus ou moins poliment le scientifique qui, en proie à l’hybris, a outrepassé les bornes de ses compétences, et pour lui démontrer que seule la philosophie peut fonder sa discipline.
Et nous en revenons à Markus Gabriel et aux champs de sens : il n’a pas découvert, il n’a démontré que le monde n’est fait que de champs de sens, il l’a décidé. Au bout du compte, sa philosophie n’est pas un perspectivisme, ni un relativisme, ni un réalisme nouveau. C’est tout simplement un idéalisme dogmatique. Il a trouvé une idée, puis il a voulu en faire la clef de compréhension ultime de la réalité et il a prétendu grâce à elle réfuter tout ce qui s’est fait avant lui. Or, non seulement ce genre d’envolées métaphysiques n’apporte rien à la connaissance du réel, mais constitue encore un obstacle contre elle. Comme le dit l’historien marxiste Edward P. Thompson, « cette quête de la sécurité d’une théorie totalisée et parfaite est la première des hérésies contre la connaissance. Ces créations idéalistes parfaites, dont chaque couture tient superbement grâce à un invisible point conceptuel, finissent toujours dans un vide-grenier » 30.
Au fond, ce qui frappe dans ce livre est son enthousiasme juvénile. Gabriel veut tout refonder, tout redémontrer, tout dire. L’auteur ne veut pas nier que le monde existe, il veut refaire le monde, comme tout le monde à un certain âge de la vie, voilà tout. Et son livre concentre un grand nombre des qualités et des défauts les plus typiques de la philosophie de jeunesse : l’originalité des idées et l’entêtement dans les paradoxes intenables, le goût de la démonstration et la volonté de tout prouver, le goût des questions essentielles et la perte dans les divagations métaphysiques ; la passion de comprendre et l’égarement dans des interprétations incertaines, les effets d’annonce grandioses et les résultats extrêmement modestes en bout de course, enfin le désir de tout embrasser d’un coup et la confusion qui en résulte inévitablement.
- Jean-François Revel, « Pourquoi des philosophes ? », préface à l’édition de 1971, in Jean-François Revel, Bouquins, Robert Laffont, 1997 (1999), page 34.
- Dans philosophie analytique, il y a en effet anal, ce n’est pas Lacan qui dirait le contraire, mais au petit jeu de l’apocope (élision de la fin des mots), il n’est pas sûr que la philosophie continentale s’en sorte mieux…
- Pages 10-11.
- Pages 13-14.
- Voir Au juste, de Jean-François Lyotard, Bourgois, 1979.
- Page 16.
- Page 19.
- Page 35.
- Page 25.
- Page 25.
- Page 33.
- Page 41.
- Page 50.
- Page 52.
- Page 52.
- Page 59.
- Page 68.
- Page 75.
- Page 72.
- Page 111.
- Page 82.
- Voir Par-delà bien et mal, §36.
- Page 102.
- Page 103.
- Jean-François Revel, op.cit., page 22.
- Pages 277-278.
- Page 278.
- Être et Temps, §14-18 et la conférence de 1951 « Bâtir, habiter, penser » in Essais et conférences, Gallimard, 1980.
- Page 279.
- Edward P. Thompson, Misère de la Théorie. Contre Althusser et le marxisme anti-humaniste, l’Echappée, collection Versus, 2015, page 307.








