Introduction
Le recueil Nietzsche et le relativisme1 est le vingtième de la collection éditée par « Ousia » ; il comprend une série d’articles offerts à l’occasion d’un colloque organisé en mai 2016 à l’université Montpellier 3 sous la direction de Paolo Stellino et Olivier Tinland. Après une l’introduction problématique de ce dernier, l’ouvrage se présente en trois parties : une consacrée aux qualifications de la vérité au sens sceptique et relativiste vis-à-vis de Nietzsche avec Helmut Heit, Joao Constancio et Yannick Souladié ; les deux premiers articles insisteront surtout sur les sources d’inspirations kantienne et langienne, ce qui introduit à la deuxième partie qui s’ouvre sur les sources schopenhaueriennes de Nietzsche avec Luca Lupo. Cette mise en contexte de la réflexion nietzschéenne en regard du relativisme se poursuit avec des articles qui tenteront des analogies avec le pragmatisme de James (Pietro Gori), Whitehead (Dorian Astor), et Foucault (Scarlett Marton). La troisième partie qui termine ce livre rassemble des articles sur le problème de l’éthique nietzschéenne face à la relativité des normes. Isabelle Wiemand et Janske Hermens proposent de mettre ces questions en perspective avec la notion de « santé » chez Nietzsche, puis Paolo Stellino propose un article mettant en relation Nietzsche avec le « projectionnisme » et enfin, le dernier article du recueil expose la dimension esthétique de la pensée nietzschéenne à travers le prisme du « jeu ».
Le problème du relativisme avec l’œuvre de Nietzsche se présente donc ainsi : quel service Nietzsche pensait-il rendre à la vérité, dans la mesure où celui-ci considère que « le service de la vérité est le plus rude des services » (Antéchrist § 50), tout en dénonçant celle-ci, en la privant de sa stabilité, de sa valeur, de tous critères de validité et de sa forme en l’interprétant même comme une « sorte d’erreur » dans ses sources, son émergence et son expression? Deuxièmement, Olivier Tinland détermine ce second problème (p. 25) : comment expliquer chez Nietzsche la promotion de la force par la sélection et la hiérarchie alors qu’il conteste toute norme de valeur préétablie ? En effet, dans la préface de Humain trop humain § 6 on trouve la réflexion suivante : « Tu devrais voir avec tes yeux le problème de la hiérarchie, voir la puissance, le trait et l’étendue de la perspective s’accroître ensemble vers les hauteurs ». Mais comment est-ce possible si les critères de validités propres aux évaluations sont contestés ?
Même si le terme de « relativisme » n’apparaît qu’une fois dans l’œuvre de Nietzsche (Cf. Considérations inactuelles) et n’est pas thématisé ou utilisé conceptuellement par Nietzsche, nous pouvons observer à travers les deux problèmes qu’ils portent en eux le risque ou le style du relativisme, c’est-à-dire de l’autoréfutation (p. 33). Comment l’œuvre de Nietzsche parvient-elle à dépasser le problème de la vérité vers d’autres enjeux, perspectives et critères normatifs ? Selon quels types d’interprétation, d’approche du langage Nietzsche parvient-il à dépasser les écueils du relativisme ?
Olivier Tinland mentionne quatre éléments significatifs du relativisme (p. 11, sq) : 1. L’opposition à l’universalisme : il ne peut pas y avoir d’accord sur une définition stable 2. L’opposition à l’objectivisme : il n’y a pas d’appréhension extérieure à un spectateur neutre sans un contexte prédominant sur la considération. 3. Opposition à l’absolutisme : on ne trouve pas de norme ou de valeur absolue 4. Opposition au monisme, l’idée qu’une question donnée ne peut avoir qu’une seule bonne réponse. Dans la plupart des cas, ceci entraîne la promotion d’un sens historique ou bien généalogique (p. 12).

Selon Richard Porty (p. 13), il y a également des types différents de relativismes : le pratique et nihiliste selon lequel tout se vaut car rien ne vaut, ou que deux opinions incompatibles sont également valables. Le problème c’est que le relativiste risque bien cette même autoréfutation puisque se dire relativiste c’est relativiser la portée de sa propre affirmation relativiste, voire de l’ensemble des thèses secondaires qui découlent d’une telle affirmation première. Et c’est pourtant à cela que Nietzsche prétend échapper, tout comme à celui d’un relativisme descriptif qui constate l’inexistence d’un critère absolu d’évaluation et de hiérarchisation entre diverses conceptions ; de même, Nietzsche n’est pas du tout réductible à un relativisme prescriptif : il n’est pas « anti-anti-relativisme » au nom de la tolérance à l’égard de la pluralité des cultures (Cf. Clifford Geertz). Par ailleurs, alors que cela pouvait être le fondement même de l’attitude relativiste, Nietzsche entreprend aussi de dépasser le subjectivisme (qui fait jouer aux états physio-psychiques du sujet individuel le rôle de contexte ultime de relativisation) en ancrant la conduite individuelle dans un vaste processus de culture dans la mesure où « l’individu lui-même est la plus récente des créations ».
Si Nietzsche dénonce bien les principes de la vérité, il les interprète cependant par le style d’un nouveau langage ; il n’en reste pas au même plans que les principes qu’il dénonce sans pour autant les critiquer de l’extérieur, car il en retraduit la sémantique et en produit la généalogie : ainsi, la vérité devient sous sa plume une perspective ou ensemble de perspectives dotée d’une valeur pour la vie, produite par des pulsions du corps, renforcée à la faveur d’un long travail civilisationnel d’élevage et de dressage (Cf. Patrick Wotling), conformément à des impératifs vitaux eux-mêmes liés aux exigences de la Volonté de puissance. La vérité apparaît donc comme une forme de nature pulsionnelle, donc interprétative (cf. Par delà bien et mal, §. 32). Le propos général des articles qui suivront sera donc de montrer comment Nietzsche pouvait utiliser comme des perspectives et des interprétations certaines de ces différentes formes, applications ou critiques de types relativistes sans pour autant s’y enfermer, et la manière dont Nietzsche échappe structurellement à leurs écueils à travers la réinterprétation de la vérité qu’opère sa pensée.
I. Relativisme, scepticisme et vérité
1. « Nietzsche et le « relativisme épistémique », Helmut Heit
Le problème que souhaite discuter cet article est le suivant : Nietzsche peut-il être considéré comme un partisan ou un défenseur du relativisme, eu égard aux questions épistémologiques (p. 40) ? L’ambivalence de Nietzsche, c’est qu’il salue la crise et la fin du dogmatisme tout en prenant au sérieux la « tension de l’esprit » qu’a créée « l’erreur dogmatique » pour prétendre à « des buts plus lointains » (p. 43). Mais ce qui semble intéresser Nietzsche c’est que des auteurs tels que Comte, Schopenhauer, Mill, Lange, Guyau ou encore Spir se sont opposés aux aspirations absolutistes et ont tous insisté sur le caractère conditionnel de la connaissance humaine. Nietzsche possédait d’ailleurs une traduction en allemand des parties introductives du Cours de philosophie positive de Comte. Et l’on sait que Comte associe l’impression de « connaissance inconditionnée » à l’âge théologique et métaphysique de l’humanité, différent de l’esprit de notre stade scientifique, lequel a fini par renoncer à ce genre d’ambitions et « prend conscience de l’impossibilité de parvenir au savoir absolu ». Selon l’explication favorable que Mill donne de la doctrine comtienne du positivisme, « nous n’avons d’autre connaissance que celle des phénomènes, et celle-ci est relative et non absolue ». Nous ne connaissons que la relation entre des faits, leur succession et leur ressemblance, l’essence des choses nous est inconnue et les causes sont inconnaissables.
Ainsi donc, le relativisme n’est pas seulement pour Comte la disposition d’esprit informée, réflexive et modeste de la science moderne, mais aussi la seule attitude intellectuelle qui puisse garantir la sympathie et le progrès de la culture (p. 47). Comte voit donc dans le relativisme la position épistémologique valable des penseurs qui ne sont pas arriérés. Et comme l’esprit relativiste est mieux préparé à accepter des alternatives et à admettre l’imperfection, il l’est naturellement aussi à l’ouverture d’esprit et au progrès. C’est là exactement ce que pensait Jean Marie Guyau, un autre auteur français que Nietzsche avait lu avec enthousiasme entre 1885 et 1887 selon Helmut Heit.
Si l’on continue cette généalogie néopositiviste, on note qu’en 1865, Nietzsche découvre Schopenhauer : ce dernier nie « les affirmations des dogmatiques, que le monde externe est vrai indépendamment du sujet » et affirme que sans notre entendement le monde n’est rien : « le monde entier des objets est et demeure représentation ; et précisément pour cette raison, il est et sera toujours conditionné par le sujet. Ainsi, le monde n’est qu’une série de représentations reliées par le principe de raison suffisante (p. 49). Le relativisme de Schopenhauer est toutefois limité par les conditions catégorielles nécessaires de la pensée et de la représentation. Schopenhauer ne cède par conséquent pas au subjectivisme arbitraire, pas plus qu’il n’admet une pluralité de monde phénoménaux également valables. L’idéalité transcendantale du monde doit être la même pour tout sujet rationnel (p. 50), ce qui ne manquera pas d’annoncer les profondes divergences d’avec la pensée nietzschéenne.
Après avoir abordé d’autres sources ayant pu inspirer Nietzsche – comme notamment les néokantiens (p. 61) et Friedrich Albert Lange (p. 55) qui emploie explicitement le terme dans son Histoire du matérialisme de 1866 avec cette définition : « l’exactitude de toute doctrine est justifiée sous réserve du progrès de la connaissance » -, Helmut Heit donne trois caractéristiques du relativisme que Nietzsche aurait pu accepter compte tenu de sa préface à Par-delà Bien et Mal :
1) Le relativisme s’accorde avec la science et sa pratique tandis que la philosophie dogmatique et les spéculations absolutistes n’aboutissent qu’à la superstition et à l’erreur. L’histoire des découvertes scientifiques a causé l’effondrement de l’absolutisme et renforce une interprétation relativiste. Le relativisme offre une meilleure explication de la pratique effective de la science.
2) Le relativisme inclut le faillibilisme et invite au progrès, tandis que le dogmatisme et l’insistance sur la vérité absolue entravent la recherche scientifique et l’évolution de la culture. Nier la relativité conduit à la stagnation, et même selon Guyau à la barbarie.
3) Le relativisme est une attitude épistémique et culturelle de force et de souveraineté, capable de modestie et de tolérance, tandis que ceux qui ont besoin de la vérité absolue, de la certitude et de la sécurité ne peuvent supporter ni l’existence ni même l’idée d’alternatives. Toutefois, sans alternatives, la vie humaine est affaiblie et l’avenir vide. Ce qui intéresse Nietzsche, ce sont les conséquences culturelles du relativisme épistémique puisque le relativisme est une crise nécessaire à la transformation de notre culture pour découvrir que la découverte du monde n’est pas passive mais que nous le « co-construisons » (p. 62).
Helmut Heit conclue ainsi son article : le relativisme épistémique est souvent défini comme une combinaison de deux thèses, d’une part, une thèse de dépendance ou de relativité, et d’autre part, une thèse de symétrie ou de pluralité. Si Nietzsche souscrit clairement à la première, il souscrit beaucoup moins à la seconde (p. 67).
2. « La « vérité relative ». Remarques sur la négation langéenne et postkantienne de la vérité chez Nietzsche », Joao Constancio
L’objectif avoué de cet article est de montrer que, dès le début, Nietzsche souscrit à une conception de la vérité que Friedrich Albert Lange a tirée de sa lecture de la Critique de la raison pure de Kant, à savoir : la conception de la « vérité relative » (p. 69). A partir de là, Joao Constancio propose de développer cinq thèses (p. 70 sq) dont la dominante sera en définitive, il faut le reconnaître, très (trop?) néokantienne[sur le sujet, on peut consulter les leçons d’Eric Dufour consacrées aux rapports subtils de Nietzsche à Kant (Leçons sur Nietzsche. Nietzsche héritier de Kant), leçons recensées [ici et là.[/efn_note] :
1) Les catégories fondamentales du monde tel qu’il nous apparaît (c’est-à-dire les phénomènes) appartiennent à notre appareil de connaissance, et non aux choses-en-soi. La connaissance du monde est conditionnée par la constitution de notre appareil cognitif. Dans « Humain trop humain » §19, Nietzsche recopie un passage des Prolégomènes de Kant (§. 36) : « l’entendement ne puise pas ses lois dans la nature, mais les prescrit à celle-ci ».
2) Nos catégorisations structurent le monde et sa forme, le monde dans lequel nous croyons vivre. C’est une prescription indispensable mais fausse, dont le statut a priori est à discuter.
3) Il n’y a pas de connaissance des choses en soi, pas d’objectivité absolument valable.
4) Les sujets humains non pas accès à la vérité métaphysique.
5) Kant a montré que la métaphysique est impossible ; il ne reste donc que l’Art. Dans un Fragment posthume de 1872-73, Nietzsche note ainsi : « Position différente de la philosophie depuis Kant. Métaphysique impossible. Autocastration. La résignation tragique, la fin de la philosophie. Seul l’art peut nous sauver » (FP 19 319, KSA 7, p. 517). La philosophie devient alors une évaluation, une édification du devoir-être non fondée sur l’être, donc purement artistique.
Joao Constancio développe donc ces points en insistant sur l’inspiration qu’a pu être la lecture de Lange notamment dans Humain trop humain qui reprend la question de la vérité relative selon trois arguments (p. 77) :
1) les lois de la nature n’étant pas absolues, la philosophie ne peut être qu’une discipline historique. Là-dessus, Kuno Fischer pensait lui aussi que « la philosophie transcendantale n’était pas une investigation de la logique de la connaissance mais de ses origines »
2) Les lois de la connaissance ne sont que des phénomènes linguistiques.
3) Le monde n’est qu’une représentation ou une interprétation. Mais Nietzsche se distingue de Schopenhauer sur ce point en ce que ce dernier considère comme objectives les catégories de la représentation (si illusoire soit-elle) : selon Nietzsche cette représentation constitue une erreur : « ce que nous appelons notre monde est le résultat d’une foule d’erreurs et de fantasmes qui ont pris progressivement naissance au cours de l’évolution globale des êtres organisés… De ce monde de la représentation, la science exacte ne peut effectivement nous délivrer que dans une mesure restreinte. » (Humain trop humain §. 16).
Joao Constancio conclut ensuite sa démonstration en expliquant les réticences nietzschéennes et son refus de la vérité absolue ; celles-ci reposent sur trois idées principales (p. 88sq) : 1) La prise de conscience du fait que le kantisme implique un refus de la vérité métaphysique, donc qu’il n’y a pas de vérité de la « chose en soi » 2) La thèse de la chose en soi est contradictoire 3) La vérité absolue n’est qu’une simplification liée aux conditions de préservation de l’espèce.
3. « Un scepticisme de la force contre le relativisme », Yannick Souladié
Le propos commence par examiner des citations de dictionnaires et d’encyclopédies sur l’article et la définition du relativisme (p. 94) pour s’arrêter à celle-ci : a) la connaissance et les valeurs humaines sont relatives à des facteurs, des normes, des limitations. b) le relativisme récuse toute possibilité d’une connaissance authentique. Et selon Yannick Souladié, Nietzsche adopte le « a » mais pas le « b » car il ne remet pas en cause la « valeur » de la connaissance mais sa « validité ». A l’appui de cela, Yannick Souladié indique des passages de Ecce Homo et de l’ Antéchrist indiquant un changement de « méthode » qui a pour conséquence de penser toute vérité comme relative, mais relative à l’état du corps qui pense, le spirituel étant dérivé d’état corporel plus moins fort ou faible (p. 102). Et pour ce dernier état, le symptôme est justement la « volonté de vérité » qui signifie que « je ne veux pas tromper, pas même moi-même : et nous voilà par-là sur le terrain de la morale. » (cf. Gai Savoir). Donc si la vie, la réalité sont foncièrement tromperies et apparences, alors la volonté morale d’éviter toute « erreur » s’oppose à la vie. Si l’on revient à la définition indiquée au début, le relativisme paresseux de type « b » qui constate les limites de la connaissance et son impossibilité, ne fait donc que témoigner de l’inégalité des corps et de leurs faiblesse dans leur paralysant toute forme de connaissance par impuissance. Le relativiste « b » n’est en réalité qu’un faible, un peureux face à tout affrontement, fuyant la dispute par maladie en cherchant l’apaisement (p. 106).
Afin d’exposer l’autre versant, Yannick Souladié reprend les analyses de Didier Franck dans son Nietzsche et l’Ombre de Dieu2. Il constate que la vérité nietzschéenne « crée l’adéquation elle-même en créant les termes entre lesquels elle est susceptible d’avoir lieu » (p. 112). Ainsi donc, si Nietzsche peut avoir des pages admiratives pour le scepticisme, ce n’est cependant pas pour verser dans un scepticisme du renoncement, d’une volonté qui ne sait plus commander, mais un perspectivisme entier et créateur, un enthousiasme dans la création de nouvelles relations pour l’activité vitale de la Volonté de puissance. Et le propos se termine par cette magnifique illustration de Montaigne « Nul esprit généreux ne s’arreste à soy » (Les Essais, III, 13).
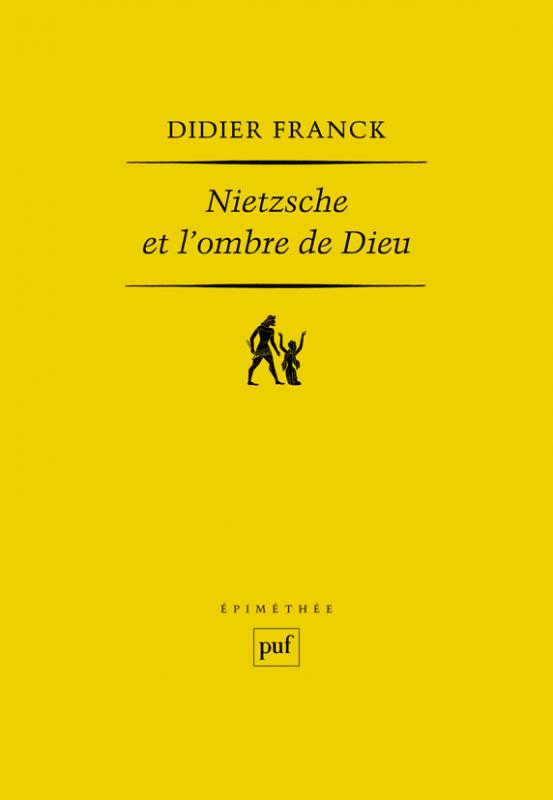
II. Le relativisme en contextes
1. « Pour une généalogie du relativisme nietzschéen : Schopenhauer » Luca Lupo
Luca Lupo entreprend ici un article centré sur l’initiateur de Nietzsche, Schopenhauer, tout en constatant une triangulation avec Kant et Kleist selon qui « la vérité n’est plus rien et tout effort est vain mon but suprême a sombré et je n’en ai plus aucun » (p. 131). Sous ce rapport et cette crise de la « vérité », l’orientation du propos sera donc dirigée vers le domaine éthique. Pour Schopenhauer, il faut décrire l’agir sans lui prescrire quoique ce soit, et selon Luca Lupo, « c’est son objectif laïque que de comprendre l’agir » et non de concevoir ses normes (p. 132). Mais comment donc donner une description de l’agir sans pour autant faire émerger certaines normes? La difficulté se renforce puisque Nietzsche indique que « Schopenhauer s’est moqué avec raison de Kant avec sa « fin en soi », son « devoir absolu », sa « valeur absolue » comme autant de contradiction » (Fragments posthumes 1884, 26 86).
Schopenhauer surmonte ainsi la difficulté – et cette façon indique là, selon Luca Lupo, l’une des sources d’inspiration décisive de Nietzsche (p. 134) – : « toute valeur est une grandeur comparative, et se trouve même impliquée dans une double relation : elle est relative car elle existe pour quelqu’un ; et en deuxième lieu elle est comparative, car elle existe par comparaison avec quelque chose d’autre qui permet de l’évaluer. Détaché de ces deux relations, le concept de valeur perd tout sens et toute signification » (Fondement de la Morale § 8).
De même, pour Schopenhauer, « la dignité humaine » kantienne n’est pas plus qu’un argument d’autorité vide, et le « spéciste » fondant une pseudo primauté de l’homme sur l’animal n’a donc aucune justification. Ainsi, la rationalité ne suffit donc pas selon Schopenhauer à garantir une supériorité morale de l’homme sur le vivant. Schopenhauer relativise et reconduit les notions de bien et mal à notre « expérience quotidienne » et par-là ouvre au discours généalogique nietzschéen (p. 141) d’après Luca Lupo.
2. « Le pragmatisme et la pensée perspectiviste : des programmes comportementaux pour faire face au relativisme », Pietro Gori
Pietro Gori entreprend un parallèle audacieux entre Nietzsche et William James, soit entre le perspectivisme et le pragmatisme (p. 144). Ceux sont, selon l’auteur, des positions constructives face aux renoncements relativistes à la vérité. Il s’agit donc de discuter du perspectivisme de Nietzsche selon le pragmatisme et de le comparer, voir même de le rapprocher sur certains point qui concernent les principes de connaissance du monde en identifiant les critères d’évaluation au sein d’un contexte relativiste.
Pietro Gori présente le pragmatisme via un article assez navrant de Dewey publié en 1908, « Qu’est-ce que le pragmatique entend par pratique ? » dans lequel il propose le constat suivant : le processus d’élaboration de la connaissance ne s’achève jamais. Les idées sont des objectifs de recherche, des « intentions » et ce qu’elles ont en vue est « prospectif » (p. 148). Dewey reprend ainsi les mêmes définitions à la sauce Bernard, ce qui donne après l’alambic James : « Nous considérons les lois scientifiques actuelles comme des « raccourcis conceptuels » vrais dans la mesure où elles sont utiles, mais pas au-delà » (p. 150). D’après James « la vérité d’une idée n’est pas une propriété stagnante qui lui serait inhérente. La vérité survient à une idée. Elle devient vraie, est rendue vraie par des événements. Sa vérité est en réalité un événement, un processus, à savoir le processus de se vérifier elle-même, de sa vérification » (p. 151). La stabilité de « véricité » est une stabilisation historique fruit de l’expérience des ancêtres qui ont su se conserver (p. 152).
A partir de ces petites définitions, Pietro Gori va donc opérer quelques rapprochements selon le prisme du « processus de véricité » entre Nietzsche et le pragmatisme. Pour nuancer ce parallèle, Pietro Gori cite tout de même le paragraphe 354 du Gai Savoir :
« …Nous n’avons justement aucun organe pour le connaître, pour la « vérité » : et même ce que nous qualifions ici d’«utilité » n’est finalement aussi qu’une croyance, qu’un produit de l’imagination et peut-être précisément la plus funeste des bêtises dont nous périrons un jour ».
Malgré tout, l’article se poursuit et enchaîne sur les influences de Nietzsche avec la pensée scientifique de son temps, notamment Spencer et Darwin, avec lesquels il soutient une conception évolutive de la connaissance bien avant 1887 (p. 154). Là-dessus, on ne peut là encore qu’être circonspect étant donné les insultes dont Nietzsche gratifie ceux-ci dans le Crépuscule des idoles, « Flâneries inactuelles » 14 ou encore Par-delà bien et mal, §. 253. Mais il est vrai qu’une parenté peut être nominalement notée notamment en Gai savoir, § 110 : « La force des connaissances, ne tient pas à leur degré de vérité mais à leur ancienneté, au fait qu’elles sont incorporées, à leur caractère de condition de vie ». C’est donc un jeu d’équilibre délicat que joue Pietro Gori dans son intervention, dans la mesure où les influences nietzschéennes sont immédiatement suivies de différences ou de démentis, ceux-ci étant cités avec intégrité (p. 157) : « les idées logiques sont une falsification utilitaire biologique » (Fragments Posthumes 14, printemps 1888) ou encore (p. 159) « contre le positivisme qui en reste au phénomène, il n’y a pas de faits, seulement des interprétations » (Fragment Posthumes 7, 60 1886-7). Tout cela pour dire que Nietzsche peut se rapprocher de certains thèmes relativistes de type pragmatiques ou néo positivistes, mais qu’en tant que perspectiviste, sa pensée canalise le torrent relativiste (p. 168).
3. « Relativisme ou relationnisme ? le concept de réalité chez Nietzsche et Whitehead », Dorian Astor
Un peu dans la même veine que Pietro Gori avec James, Dorian Astor propose cette fois-ci un rapprochement de la pensée de Nietzsche avec les écrits de Whitehead. Là encore, les thèmes communs ne manquent pas, même s’il y a une différence – à notre avis – structurelle entre un vocabulaire et des significations nominalement proches avec une similitude d’approche ou d’intention. Mais Dorian Astor cite avec confiance en en-tête de son texte : « Notre expérience débute par un sentiment de puissance, et progresse jusqu’à la discrimination des individualités et de leurs qualités. Dans son essence, « l’actualité » est « composition ». La puissance conduit par essence à la création d’une valeur esthétique pour elle-même. Toute puissance dérive de ce fait d’une composition atteignant une valeur pour elle-même. Il n’y a pas d’autre fait. » (Whitehead, Modes de pensée).
Il est vrai par ailleurs que Whitehead annote en 1930 le second volume des écrits posthumes de Nietzsche (p. 172), et que, d’une façon générale, c’est par une pensée de la relation comme perspective que Nietzsche comme Whitehead insistent pour critiquer une connaissance qui sépare l’apparence de la vérité. Ces deux auteurs « fondent » tous deux le modèle perspectif sur un processus en devenir.
Cela dit, Dorian Astor veut proposer ici non pas un inventaire de l’héritage de Nietzsche chez Whitehead, mais plutôt une analogie, expérimenter certains points pour voir comment ils « s’entr’expriment » et de les « prendre en conjonction » (p. 199). Le problème c’est que Dorian Astor ne s’en tient pas toujours à cette distinction dans son article et va même jusqu’à rapprocher des auteurs par nature hors sujet comme Bruno Latour (« le relativisme est une qualité, pas un défaut. C’est la capacité à changer de point de vue, à établir des relations entre mondes incommensurables. Cette vertu n’a qu’un contraire : l’absolutisme » Le Monde, 18 janvier 1997 « Y a-t-il une science après la Guerre froide » (p. 173)).
Mais passons. Dorian Astor indique que l’on peut rapprocher Nietzsche et Whitehead sur leur dénonciation de l’abstraction de l’absolutisme, renvoyant ainsi dos à dos le matérialisme comme l’idéalisme dans la mesure où « nous avons en réalité affaire à un continuum qui n’a pas de rupture ou de points isolé autrement que par abstraction. » (Gai savoir, § 112). Et Whitehead analyse aussi en vis-à-vis de cela :
« Dire qu’un élément matériel a une localisation simple signifie que – en exprimant ses relations spatio-temporelles – il est approprié d’affirmer qu’il est là où il se trouve, en une région définie de l’espace, et pendant une durée finie définie, en dehors de toute référence essentielle aux relations de cet élément matériel à d’autres régions de l’espace et à d’autres durées » (La science et le monde moderne, 1925, p. 75).
Whitehead poursuit et souligne « en des termes que Nietzsche ne renierait pas » selon Dorian Astor, le rôle sélectif de l’évolution dans l’activité d’abstraction : « la perception sensible est le triomphe de l’abstraction dans l’expérience animale. Une telle abstraction naît de la croissance de la force d’accent sélective. Elle dote la vie humaine de trois dons, à savoir : une approche de l’exactitude, un sens de la différenciation qualitative des activités extérieure, et une négligence des liaisons essentielles qui constituent conjointement le foyer de la conscience, comme dans l’expérience humaine » (p. 181, sq).
Il y a donc chez Whitehead un type de connaissance perspectiviste se distribuant en deux modes, l’un abstrait, l’autre spéculatif (p. 183) « qui atteint une forme universelle et nécessaire de la relation perspective, « l’efficacité causale. » » : c’est là que l’on peut noter les limites du rapprochement étant donné les multiples moqueries de Nietzsche concernant les explications de type causales d’où quelles soient.
La suite de l’article continue avec des considérations sur le pluralisme entre les deux auteurs puisque tous les deux sont, selon Dorian Astor, « mus par un but qui sera celui de Deleuze : « Arriver à la formule magique que nous cherchons tous : PLURALISME = MONISME, en passant par tous les dualismes qui sont l’ennemi, mais l’ennemi nécessaire » (p. 199).
A cela, Dorian Astor conclue prudemment comme Pietro Gori par deux démentis nietzschéens importants : Whitehead pense et promeut l’idée d’un Dieu comme cause finale ; et autre différence, la question qui ne cesse de hanter la pensée de Whitehead est celle de la nouveauté (p. 200), alors que Nietzsche indique en Gai savoir, §. 109 : « gardons-nous de penser que le monde crée éternellement du nouveau ».
4. « De Foucault à Nietzsche : pluralité d’interprétations et importance des critères », Scarlett Marton
Nous avons ici un autre rapprochement mais sous le rapport de l’utilisation foucaldienne de Nietzsche en ce qui concerne la méthode d’interprétation. Si ce thème ne manque pas d’intérêt, nous avons malheureusement droit, d’une manière générale, à un article très répétitif et prévisible dans les citations de Nietzsche. Scarlett Marton indique tout d’abord l’interprétation de Nietzsche par Foucault ainsi : l’interprétation n’a pas de terme comme les signes, mais son temps est circulaire ; elle ne traite pas ce qu’il y a dans le signifié mais s’interroge sur qui interprète : ainsi le concept de bien et mal a une « double préhistoire, soit dans l’âme des castes dominantes, soit dans l’âme des opprimés, des impuissants ». La question n’est donc pas uniquement « qui interprète ? », car pour chercher, non la continuité, mais les marques différentielles, il faut chercher les points de surgissement et non ce qui le rend possible de façon causale. Ce que Nietzsche inaugure selon Foucault, c’est l’histoire des émergences selon des états de forces (p. 206. sq). Scarlett Marton nuance cependant en citant une annotation posthume de Nietzsche qui indique : « il ne faut pas demander : « qui donc interprète ? » (Fragment Posthume 2, 151 automne 1885 (p. 210)). Mais à l’appui, Foucault cite la préface de la Généalogie de la Morale :
« nous avons besoin d’une critique des valeurs morales, il faut remettre une bonne fois en question la valeur de ces valeurs elle-même – et pour ce, il faut avoir connaissance des conditions et des circonstances dans lesquelles elles ont poussé, à la faveur desquelles elles se sont développées et déplacées ».
Foucault ne répond cependant pas à la question, il signale seulement un fonctionnement de force. Il y a donc chez Foucault comme chez Nietzsche une connaissance perspectiviste, c’est-à-dire expérimentale, qui ne verse pas dans le relativisme vulgaire parce qu’elle cherche la hiérarchie des interprétations selon les systèmes de forces à l’œuvre dans ses modes différentiels, sans pour autant en chercher l’explication selon les causes puisque, selon Nietzsche : « connaître signifie : entrer en relation conditionnelle avec quelque chose : se sentir conditionné par quelque chose et entre nous – cela consiste donc en tout état de cause à déterminer, définir, rendre consciente des conditions (non à sonder les essences, des choses, des « en-soi ») » (Fragment Posthume 2, 154, automne 1885)). Le processus organique présuppose donc un perpétuel interpréter (p. 217) qui se crée son propre critère en tant qu’il est vie, donc processus qu’interprète la Volonté de puissance.
III. Relativité des normes : santé, éthique, esthétique
1. « Nietzsche et le relativisme : la conception nietzschéenne de la santé », Isabelle Wienand et Janske Hermens
Dans une note en bas de page, Isabelle Wienaud et Janske sont les seuls auteurs du collectif à remercier Olivier Tinland et Paolo Stellino de les avoir invités à ce colloque. Ces auteurs proposent d’éviter d’utiliser le terme « relativisme » et de lui préférer le « scepticisme » pour analyser l’œuvre de Nietzsche et ses intentions puisque, si l’on prend la conception au cœur de cet article, il n’y a pas d’équivalent normatif moral dans l’évaluation de la santé (p. 230). Bien sûr, l’OMS définit ce concept : « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (p. 234), mais c’est précisément une telle définition, en tant qu’elle porte un jugement de valeur, que Nietzsche va dénoncer sur un mode sceptique dans la mesure où la notion même de santé est variable avec des caractères relatifs, irréductible à l’expérience individuelle (p. 236).On trouve par exemple en Gai Savoir III, §. 120 : « ta vertu est la santé de ton âme ».
Au sens de Nietzsche, il n’y a donc pas de santé en soi, la santé est corporelle, et la maladie n’est pas indépendante de la santé. La santé est donc évaluative, elle est un critère d’évaluation des valeurs (p. 239) et ce que Nietzsche appelle « la Grande Santé » consiste à embrasser une multiplicité d’expériences sans succomber à leurs conflits. De fait, quand Nietzsche parle des personnes en bonne santé, il décrit des capacités à sélectionner et trouver la mesure juste, ainsi qu’à imposer un sens de la distance noble : c’est là ce que les auteurs de cet article appellent « une fortitude » pour décrire la personne saine (p. 240). Il y a donc une certaine hiérarchie de la santé, alors même qu’elle n’a pas de définition ni standard englobant possible.
Nietzsche, malgré le relativisme ontologique, n’abandonne donc pas l’idée d’une dimension morale normative de la santé (Cf. Gai savoir V, §382), mais il la thématise précisément en tant qu’occasion d’exercer sa force comme croissance vitale ; sous ces rapports, toutes les dimensions représentatives de la santé ne se valent donc pas (p. 245).
2. Projectivisme et relativisme moral chez Nietzsche », Paolo Stellino
Paolo Stellino propose une analyse en deux temps, l’une qui interprète les procédés d’évaluations nietzschéens selon le « projectionnisme » – lequel est le fait que la valeur morale que nous retrouvons dans le monde est une projection toujours relative à une perspective évaluatrice spécifique, mais n’est pas pour autant un relativisme moral (p. 249). Puis, dans un second temps, Paolo Stellino évalue le statut de ce même « relativisme moral » via un examen des définitions données par Maria Baghramian (p. 262. sq). Le problème liant ces deux pôles étant celui qu’indique Nietzsche au paragraphe 250 de « Par-delà bien et mal » : « Il n’y a pas de phénomènes moraux du tout, mais seulement une interprétation morale des phénomènes ». Autrement dit, « Pourquoi la réalité nous apparaît comme chargée moralement alors qu’elle ne l’est pas (p. 250) ? »
Tout d’abord, Paolo Stellino explique donc ce problème à travers le « projectionnisme » : la réalité est en soi dénuée de valeur et la valeur morale apparaît parce que nous la projetons. Bien que très éloigné de Nietzsche, il y a là encore matière à analogie puisque la source principale de cette explication vient de David Hume dans son Traité de la Nature Humaine (III, I, 1ère section) : « le vice vous échappe complètement tant que vous considérez l’objet ». Ainsi, les attributs moraux ou esthétiques, sont des sentiments qui appartiennent au sujet et ne sont pas des propriétés intrinsèques de l’objet.
Paolo Stellino montre toute la ressemblance en citant des passages de Vérité et mensonge au sens extramoral (1872) , Humain trop humain §. 16, Aurore §. 210, Ainsi parlait Zarathoustra I ,« Des Mille et une fins », avec enfin, les Fragments posthumes de novembre 1887. La réalité est dénuée de valeur morale et pourtant elle nous apparaît comme chargée moralement car l’homme projette une valeur selon sa perspective évaluatrice avec ses affects. Nous oublions cet acte de projection et considérons l’objet comme ayant intrinsèquement en lui-même la propriété projetée. Et enfin, cette croyance est une illusion qui est dénoncée par la généalogie nietzschéenne des précédentes étapes (p. 257. sq). L’ambiguïté ou l’ambivalence de cette analyse nietzschéenne propre à créer un caractère apparemment relativiste, c’est que la projection n’est pas seulement une condition d’existence et de conservation, mais aussi de croissance : la Volonté de puissance de l’être humain trouve son expression dans cet acte (p. 259).
Aussi Paolo Stellino conclut en notant que lorsque l’on pose la question de l’intersection entre la pensée nietzschéenne et du relativisme moral, il est essentiel de clarifier préalablement ce qu’on entend exactement par « relativisme moral » et quel type de notion on emploie ; ainsi il n’y a pas de relativisme radical chez Nietzsche, sinon il serait un nihilisme axiologique égalisant et valorisant toutes perspectives alors même que Nietzsche cherche constamment la hiérarchie dans l’évaluation des valeurs (p. 275).
3. « La tâche du joueur. Jeu et crise des valeurs chez Nietzsche », Maria Joao Mayer Branco
La conception du jeu que souhaite interpréter Maria Joao Mayer Branco dans cet ultime article du recueil a pour prétention de se distinguer d’une esthétisation vitale de l’art tout comme d’une perspective phénoménologique mais également morale de cette notion, ceci afin de montrer que, le jeu n’étant pas une valeur, il s’associe à une disposition qui suspend les effets de la relativisation générale des critères de validité qui réglèrent l’ensemble de la vie humaine et artistique jusqu’à la modernité (p. 277). Pour ce faire, Maria Joao Mayer Branco commence par mettre en perspective le propos de Nietzsche avec l’histoire de l’art et le statut même de l’objet d’art et de sa perception au XIXème siècle, lequel devient de plus en plus autoréférent, tiraillé entre le divertissement commercial de masse ou la critique universitaire desséchée, et ce sans plus aucune tension substantielle vers le beau, le bien, le vrai (p. 279). L’art ne dit plus la vérité, l’art est tout simplement un jeu d’apparences (p. 280) mais c’est ce jeu même qui produit de la force noble, et en cela, l’art peut encore trouver une certaine forme de destination élevée ou ascendante. En effet, les premiers écrits de Nietzsche – « La naissance de la tragédie » entre autre – sont placés sous le signe du jeu artistique qui s’identifie à la force : l’art est « la force qui donne forme au monde » ( cette formule est reprise de Héraclite), car cette force est celle de la création, qui est au fond un mode de recréation (dans tous les sens du terme) de l’instable et de l’éphémère, tout comme le jeu de l’enfant. De même que chez Baudelaire l’art était « l’enfance retrouvée à volonté », de même, Nietzsche suggère une sorte « d’éternelle enfance » donc un commencement persistant sans achèvements (Humain trop humain II, §270)
Certes, le jeu artistique suspend les normes dans son caractère d’exception d’œuvre d’art ; mais il produit cependant ses critères normatifs et évaluatifs en terme de force vitale : aussi, la hiérarchie artistique est possible en tant qu’elle dépasse la narcose nihiliste et ses anesthésies vides et vampiriques : de fait, l’événement historique dont Nietzsche sonde le fond n’est pas un art autoréférent ; car celui-ci n’est là que comme un autre symptôme d’un plus grand événement qui s’impose au jeu artistique : la Mort de Dieu et son ouverture vers le « nouvel infini » (Gai savoir, §. 343) qui implique la « grande tâche » (Ecce Homo §. 10) ; et c’est là le jeu qui engage ainsi « la Grande Santé » (Gai savoir §. 382)
Conclusion
Il est difficile d’évaluer globalement la teneur d’un recueil d’articles aussi divers à beaucoup d’égards et de facture ou de style plus moins inégaux dans l’ensemble. On y trouve tous les aspects intéressants d’un recueil de colloque avec des remarques extrêmement stimulantes (notamment sur les différences de traductions p. 99 note 19 sur « Antéchrist » §. 14 ) mais également toutes les vanités de l’autoréférence (notamment p. 92, p. 184, p. 218 et p. 282) qui font parfois croire à l’insuffisance du fond et au caractère très relatif du propos offert.
Malgré tout, Olivier Tinland donne une excellente introduction, précise et bien cadrée par rapport à un sujet assez vague, puisque l’on ne peut pas identifier Nietzsche au relativisme mais seulement identifier des tendances ou des risques dans l’expression de sa pensée quand il est question de la vérité.
Les auteurs se marchent tous un peu sur les pieds avec la seule occurrence du terme dans les Considérations inactuelles mais, bizarrement, ils manquent justement tous le simple fait que le propos de Nietzsche s’oppose, dans cet ouvrage, à l’historicisme vulgaire et son hégélianisme dégradé. On pourra évidemment se rattraper en lisant Léo Strauss, La renaissance du rationalisme politique classique, chapitre « Relativisme » (p. 89. sq)3, mais il aurait sans doute été fécond d’évaluer cette critique nietzschéenne alors que le relativisme et ses valorisations en contextes valorisent l’approche historiciste contre les modes de considérations inactuelles.

Certes, ce sont là les risques inhérents au travail de recherche, entre la précision de détails trop abstraite de la totalité d’une œuvre et en même temps un examen trop général quand une notion trop informe comme le relativisme est utilisée – Helmut Heit note p. 67 que « Martin Kusch a récemment montré que le relativisme est un ensemble de thèses incluant jusqu’à neuf dimensions » -, une notion qui est donc trop inconsistante pour révéler quoique ce soit et mettre en lumière une pensée aussi protéiforme que celle de Nietzsche.
Les analyses proposées par ce recueil couvrent cependant un vastes corpus mais il est surprenant qu’aucun n’ait pu analyser le problème du relativisme face à l’Éternel retour du Même, donc une certaine évaluation normative de l’action. Et là-dessus, au lieu de se lancer dans l’évocation des concepts de Darwin ou Emerson, on aurait pu s’interroger sur les « preuves scientifiques » de l’Eternel retour que Nietzsche avait eu l’intention de donner selon Henri Lichtenberger (Cf. La Philosophie de Nietzsche4 et Lou Andreas-Salomé5.
Nous restons donc sur notre faim concernant ces derniers aspects absents du recueil, franchement circonspects sur les « analogies » avec James et Whitehead, mais positivement intéressé par les références mobilisées pour approfondir indirectement cette question de la Vérité chez Nietzsche.
- Paolo Stellino et Olivier Tinland (dir.), Nietzsche et le relativisme, Ousia, 2019
- Didier Franck, Nietzsche et l’ombre de Dieu, Paris, PUF, coll. Epiméthée, 2015
- Leo Strauss, La renaissance du rationalisme politique classique, Trad. de l’anglais (États-Unis) et postfacé par Pierre Guglielmina. Édition de Thomas L. Pangle, Paris, Gallimard, coll. Tel, 2009
- Henri Lichtenberger, La philosophie de Nietzsche, Paris, Alcan, 1898, p. 163
- cf. F.Nietzsche in seinen Werken, Severus, 2015, p. 224








