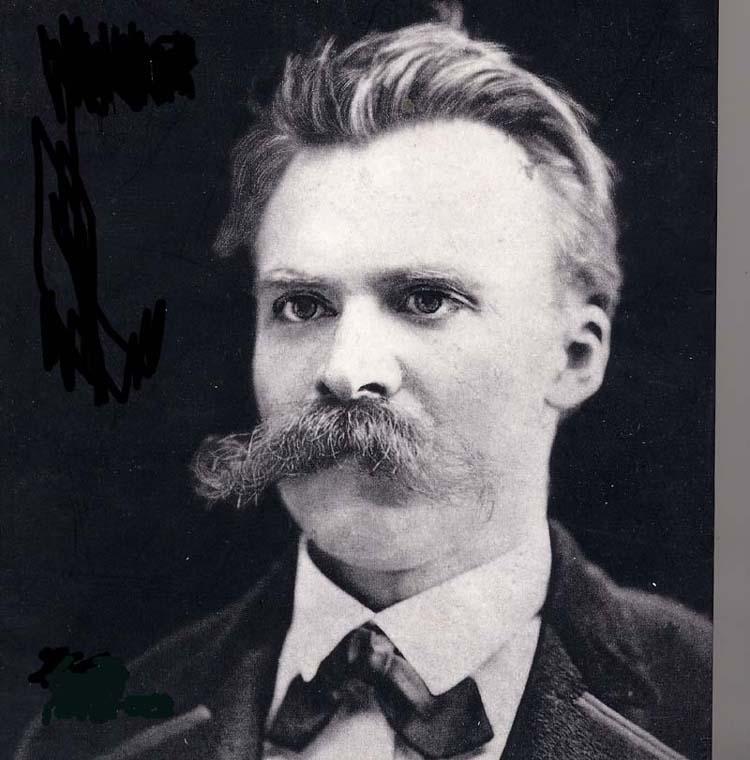Patrick Wotling vient de confirmer avec son dernier ouvrage consacré à Nietzsche1 qu’il était aujourd’hui le plus grand commentateur français de Nietzsche et qu’il prenait avec bonheur la suite des Jean Granier et Eric Blondel qui avaient tant fait pour rappeler l’impératif d’en revenir aux textes nietzschéens, et de se débarrasser des a priori de lecture tout aussi pénibles qu’automatiques, faisant de Nietzsche un simple Platon inversé (version Heidegger), ou un anti-Hegel invétéré (version Deleuze). L’ouvrage de Wotling, qui est composé d’articles déjà parus, prend le contrepied de ces lectures faciles, et invite à entrer dans la nuance même du texte nietzschéen, c’est-à-dire invite à ne pas tronquer les citations lorsque le texte nietzschéen ne convient explicitement pas à l’idéologie qui veut l’embrigader – l’exemple le plus fameux étant la suppression de la partie essentielle du § 4 de l’avant-propos d’Aurore par Deleuze lorsqu’il en rend compte et où la phrase suivante : « En nous s’accomplit – au cas où vous souhaiteriez une formule – l’auto-dépassement de la morale. – »2 disparaît totalement des citations deleuziennes pour des raisons évidentes – tout en proposant ainsi de lire Nietzsche avec honnêteté, et l’esprit libéré de toute idée préconçue.
L’esprit de l’entreprise de Wotling se trouve fort bien résumé dès l’avant-propos où ce dernier se propose comme dessein de rompre avec les lectures irrationalistes de Nietzsche, faisant de ce dernier un fossoyeur de la rationalité dont les écrits auraient porté trace de cet abandon de la rationalité étouffante, et ce en vertu d’une forme aphoristique dont le souci premier serait celui du style et non de la cohérence. Contre cette lecture facile et habituelle, Wotling propose l’interprétation suivante : « L’ambition de ce volume est de dissiper le sentiment sourd d’arbitraire qui peut accompagner, sans doute assez communément, la rencontre de Nietzsche, plus communément sans doute que ce n’est le cas des philosophes qui le précèdent. »3 Loin d’être une succession d’aphorismes arbitraires, la pensée de Nietzsche se présente au contraire comme une mise en forme ordonnée et cohérente d’une philosophie dont Wotling se propose d’explorer la rationalité certes déplacée mais toutefois bien présente. D’où ce constat qui guidera tout l’ouvrage : « Nietzsche n’a de fait rien d’un mystique, d’un romantique, ou d’un irrationaliste, si l’on entend par là un esprit qui se dispensait de toute cohérence pour adorer la seule affirmation – il a, en revanche, bel et bien tout fait pour compliquer la tâche de son lecteur. Et ce, avant tout en masquant la cohérence à laquelle il se soumet. »4 Ironiquement, donc, Wotling va agir en médecin face à la philosophie nietzschéenne, afin de diagnostiquer la rationalité inaperçue qui parcourt secrètement l’œuvre nietzschéenne, tout en montrant les déplacements, les limites, mais aussi la cohérence que sa présence rend possible.
A : Le problème de la vérité
Les treize chapitres de l’ouvrage se proposent d’aborder un certain nombre de problèmes spécifiques à l’œuvre de Nietzsche, mais il me semble que certaines questions s’affirment comme transversales au découpage des chapitres ; ainsi, et de manière dominante, me semble surgir la question de la vérité qui apparaît comme la véritable épine dorsale du livre. Je pourrais même dire que cette introduction à la pensée de Nietzsche ressemble à une gigantesque relecture de son œuvre à l’aune du problème de la vérité, dont Wotling propose une saisissante reconstruction, nuancée, subtile et extrêmement convaincante.
Le premier chapitre se propose ainsi de poser la vérité comme « régime d’interprétation », ce qui sera au fond le fil conducteur des occurrences de la vérité tout au long de l’ouvrage. Là où Wotling témoigne d’une originalité certaine, c’est par l’angle d’attaque retenu pour traiter de ce problème : il part d’une lettre de Descartes envoyée à Chanut le 31 mars 1640, dans laquelle celui-là explique à celui-ci que quiconque possède la vérité ne se soucie plus de la chercher ; de cette lettre, deux remarques méritent d’être tirées : d’une part, et c’est une évidence, rechercher la vérité signale qu’on ne la possède pas encore ; mais d’autre part, et c’est fort intéressant, une fois que l’on possède la vérité, on n’y pense plus, de sorte que la possession de la vérité s’accompagne aussitôt de l’oubli de sa quête, c’est-à-dire que la vérité ne peut plus faire l’objet d’une quête consciente ; aux yeux de Wotling, cette remarque cartésienne est déjà nietzschéenne : l’oubli chez Nietzsche, n’est pas la disparition de la chose pensée, car « ne plus penser à quelque chose que l’on possède constitue aussi bien la marque spécifique de l’intériorisation. En d’autres termes, l’inconscience et l’oubli, en leur dimension fondamentale, se présentent bien plutôt comme les résultats de la présence effective de la chose, en acte, et surtout de la maîtrise parfaite de la chose. »5
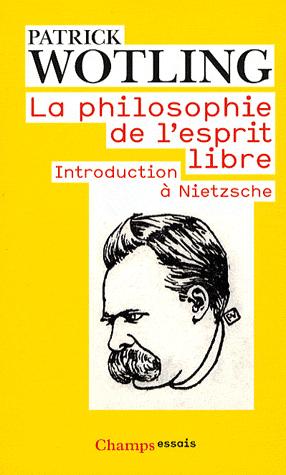
Que pouvons-nous déduire de cela ? Que si les philosophes affirment avec tellement d’entrain qu’ils recherchent la vérité, c’est bien là la marque qu’ils ne la possèdent pas, et que seul celui qui parvient à intérioriser cette vérité, parvient du même geste à se détacher de cette quête obsédante ; mais l’essentiel n’est pas là, ou plutôt il est dans le questionnement de cette quête : pourquoi être en quête de la vérité ? Pourquoi affirmer qu’il y a une vérité, si personne n’y parvient ? Pourquoi continuer à croire qu’il y a une vérité si la quête, comme signe de son absence, est sans cesse revendiquée ? Parce que le vrai est fondamentalement une passion, un amour : l’homme aime la vérité, et cette quête de la vérité ne procède pas d’une quelconque rationalité mais bien plutôt d’un état passionnel dans lequel l’homme éprouve un désir orienté vers une vérité qu’il cherche sans cesse à atteindre, sans jamais réellement parvenir à la saisir. Et cette vérité fuyante après laquelle court l’homme révèle la situation réelle de ce dernier : ne parvenant pas à saisir la vérité, l’homme est condamné à l’erreur, de sorte que l’erreur désigne la vérité de l’homme. La vérité de l’homme est erreur, dan l’exacte mesure où la quête même de la vérité révèle qu’il se tient dans l’erreur, tout en croyant chercher le vrai. « Le vrai est erreur, le vrai est cette espèce de faux que parvient à dissimuler sa nature et se faire recevoir pour la négation de ce qu’il est (…). »6
Pour autant, et là Wotling signale sa subtilité, il serait absurde d’en déduire que Nietzsche sombre dans un relativisme intégral, où l’idée même de vrai se trouverait désintégrée. Cette critique de Nietzsche selon laquelle il romprait avec la vérité, quoique répandue, est tout simplement fausse mais ravageuse7, et demeure aujourd’hui encore assez dominante. Contre cette déplorable doxa, Wotling prend le temps d’expliquer avec intelligence quelle est la véritable question nietzschéenne : non pas « y a-t-il du vrai ? » mais bien plutôt « pourquoi préférons-nous le vrai à l’erreur ? » Autrement dit, Wotling montre admirablement que le problème de Nietzsche est celui de comprendre pourquoi les hommes préfèrent une interprétation du monde (le vrai) à une autre (le faux) : mais se demander pourquoi les hommes préfèrent le vrai au faux, ce n’est pas nier l’existence du vrai – et du faux – c’est tout au contraire avaliser leur réalité, tout en se demandant pourquoi l’un serait préférable à l’autre. Le vrai et le faux sont deux lectures possibles du monde, et Nietzsche essaie de montrer que nous n’avons pas de raisons rationnelles incitant à préférer une lecture vraie du monde à une lecture fausse ; là réside la véritable subversion nietzschéenne qui se situe aux antipodes du relativisme.
Wotling exprime très bien ce questionnement nietzschéen, qu’il résume ainsi : « Pourquoi, à un certain stade de son histoire et de son conditionnement culturel, un type de vivant éprouve-t-il le besoin impérieux d’interpréter la réalité en fonction de la vérité ? La généalogie de la vérité ainsi mise en œuvre conduit à l’identification de besoins qui cherchent à se satisfaire dans cette mise en forme originale de la vérité. »8 Dans ces conditions, le philosophe libre, ce n’est pas celui qui affirme : « la vérité n’existe pas », mais c’est bien celui qui s’écrie : « je n’ai aucune raison de m’aliéner à la vérité », reconnaissant implicitement par cet affranchissement que ce à l’égard de quoi il s’affranchit existe bel et bien.
Ce après quoi Nietzsche en a, c’est donc à la philosophie qui est volonté de vérité, qui est volonté d’une connaissance vraie ; derrière cette volonté se dissimule quelque chose qui ne relève ni de la vérité ni de la connaissance. « La volonté de connaître contient autre chose, cache autre chose que de la connaissance. Il faut se résoudre à la penser comme dérivée et non originaire. »9 Mais de quoi est-elle dérivée, de quoi procède cette volonté de vérité ou de connaissance vraie ? Elle procède, comme toujours lorsque la généalogie est déployée, de la morale : la morale interdit de mentir aux autres, comme à soi-même. Et c’est cette interdiction de mentir qui structure de manière essentielle la volonté de vérité ; nous préférons le vrai au faux parce que la morale nous interdit de choisir le faux en interdisant le mensonge. Ce que Nietzsche demande donc à l’esprit libre, ce n’est pas de nier l’existence de la vérité, c’est de comprendre quelles sont les valeurs qui structurent notre volonté de vérité, si bien que le problème de la vérité met en crise la tâche même de la philosophie : la philosophie ne doit pas à tout prix vouloir la vérité, mais elle doit substituer à cette quête le questionnement des valeurs : quelles valeurs voulons-nous ?
B : L’étude des valeurs
La partie précédente nous a menés au problème des valeurs ; la question des valeurs se substitue à celle de la vérité, de telle sorte que la question ne soit plus : « comment puis-je parvenir à la vérité ? » mais bien : « quelles valeurs ai-je envie de créer et / ou d’adopter ? » Cette question des valeurs est ainsi centrale, et c’est elle qui vient perturber en son sein l’adhésion à la vérité qui, en fin de compte, repose sur une valeur très forte, en ce sens que le platonisme et la morale ont fait du rejet de l’erreur et du mensonge une valeur cardinale qui s’avère être le fondement même de la croyance en la nécessité de la vérité ; mais ai-je envie d’adopter les valeurs morales ? Ce n’est pas pour rien non plus que Patrick Wotling l’installe durablement au centre de la problématique de l’éternel retour : aux yeux de Wotling, en effet, l’éternel retour c’est très précisément cette voie indiquant la possibilité de valeurs nouvelles, et appelant à les réaliser effectivement.
Wotling nous invite également à penser l’ensemble des problèmes philosophiques comme un conflit de valeurs, et c’est à travers ce conflit que se trouve éclairé le sens réel de la métaphysique : la métaphysique, ce n’est rien d’autre que la préférence pour une valeur au détriment d’une autre, c’est-à-dire la survalorisation du suprasensible au détriment de la valeur sensible ou, pour le dire avec Wotling, « la postulation d’une valeur supérieure du monde de l’être par rapport au monde sensible. »10 Toute l’entreprise de la liberté consiste alors à montrer la nécessité d’abandonner la recherche de la vérité au profit d’une pensée de la logique inhérente aux valeurs, que Wotling définit ainsi : une « croyance divinisée »11
Mais ne risque-t-on pas alors de tomber dans un piège dissimulé, qui pourrait être la ruse de la métaphysique ? Ne risque-t-on pas en effet de chercher à connaître les valeurs en reconduisant une croyance certaine en la vérité des valeurs, faisant de celles-ci des fondements, presque métaphysiques, d’un certain nombre de phénomènes dont la philosophie disserte habituellement ? Autrement demandé, pouvons-nous nous contenter d’affirmer ceci : chaque problème philosophique repose sur une valeur cachée, une évaluation secrète, que le philosophe libre se doit de révéler ? Cette démarche serait insuffisante, assure Wotling, car elle reviendrait à faire des valeurs un fondement, et donc à reconduire toute une forme moderne de la métaphysique. « On ne saurait trop le souligner : le tournant capital de la compréhension de la philosophie ne tient pas simplement au fait de détecter la présence de valeurs à la source de toute pensée, dissipant ainsi le mythe de son autonomie, mais bien plutôt au fait de ne pas traiter ce fond nouveau de manière théorique : de reconnaître qu’il ne relève pas de la logique du connaître – sans quoi la valeur ne serait rien de plus qu’un nouveau fondement. Au contraire, la position de Nietzsche est neuve en ce qu’elle permet d’interroger l’idée qui veut que la logique de la philosophie soit une logique de principe ou de fondation. Dès lors, la logique à laquelle obéit la réflexion nietzschéenne s’éclaire : le rejet des doctrines des philosophes indique que ceux-ci n’ont pas su réaliser l’idéal de la philosophie ; la dévalorisation simultanée de la critique indique qu’ils ont survalorisé à tort le théorique (…). »12 On ne peut ici que rendre hommage à la subtilité de la lecture que propose Wotling, et à la nuance qui parcourt ses propos : certes il convient de révéler les valeurs qui courent secrètement sous les problèmes habituels, mais il serait néfaste de s’arrêter là et de se contenter de ce simple soupçon : c’est l’idée même de fondement qui doit entrer en crise, et une nouvelle cohérence doit ainsi jaillir de la critique nietzschéenne ; la cohérence ne doit plus être assurée par les fondements théoriques, mais bien plutôt prendre acte de l’émergence d’une valeur nouvelle : le corps.
C : La subtilité nietzschéenne
Une lecture hâtive de Nietzsche pourrait faire croire qu’il suffirait de créer de nouvelles valeurs s’opposant aux anciennes pour assurer sa liberté ; ainsi, remplacer l’esprit par le corps assurerait par exemple un affranchissement considérable, et tout un ensemble de phénomène réputés irrationnels par la métaphysique rationnelle recevraient de la sorte une sorte de légitimation immédiate de ce renversement nietzschéen des valeurs. Pourtant, ainsi que le montre Wotling avec brio, tout cela est bien plus compliqué qu’un simple renversement, et il appert rapidement que Nietzsche ne se contente pas de ce renversement facile ; la notion de pulsion, par exemple, que l’on pourrait imaginer réévaluée positivement comme marque du corps renversant la raison, reçoit chez Nietzsche une lecture extraordinairement nuancée, dont Wotling restitue avec bonheur les méandres. Ce que Nietzsche veut éviter, selon Wotling, c’est de retomber dans l’erreur qu’il dénonce : fonder une nouvelle ontologie stabilisatrice, fût-elle fondée sur autre chose que la raison. Hypostasier l’instinct ou la pulsion en ontologie, voilà qui marquerait somme toute l’échec de l’entreprise nietzschéenne qui reconduirait ainsi le geste traditionnel de la métaphysique.
En excellent connaisseur des textes nietzschéens, Wotling peut ainsi montrer comment Nietzsche échappe à tous ces pièges que lui tend la métaphysique et que beaucoup de ses commentateurs, se réclament parfois de lui, n’ont pas su éviter. « C’est pourquoi la pensée nietzschéenne n’est pas assimilable à une monadologie pulsionnelle, ou à une monadologie de la volonté de puissance : les pulsions ne deviennent pas des atomes spirituels, encore moins des êtres ou de manière générale des référents objectifs. »13 Mais dire cela, c’est aussi rompre avec une certaine lecture faisant des pulsions et de leur intensité un point cardinal de l’interprétation : si, en effet, la pulsion ou l’instinct ne sauraient être hypostasiés en ontologie, alors cela signifie que la pulsion, loin de désigner la structure du réel, se contente de l’organiser : on peut analyser le réel en termes de pulsion, car le réel n’est pas d’ordre chosique, mais pour autant cela ne signifie pas que la pulsion dessine une ontologie : là pourrait être l’extrême subtilité de la pensée nietzschéenne. Mais cela nous permet d’aller encore plus loin : si le réel se laisse lire en termes de pulsions, alors cela vient contredire l’interprétation dominante de Deleuze consacrée à la décadence ; ainsi que Wotling l’explique fort bien « pour Nietzsche, ce n’est pas nécessairement la question de la qualité intrinsèque des forces (actives / réactives selon la terminologie privilégiée par Deleuze) qui explique la décadence (il est au demeurant délicat de leur attribuer une qualité intrinsèque), mais d’abord la présence ou l’absence d’une organisation hiérarchique nette des instincts. »14
Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce livre, riche, intelligent et, vertu rare chez les commentateurs de Nietzsche, honnête. Wotling a abondamment lu Nietzsche, il l’a traduit, et cela se sent à chaque page : le commentateur se met au service d’une œuvre qu’il admire, et loin de chercher à la faire rentrer dans un moule préconçu, il en restitue la foisonnante richesse, sans se laisser intimider par la doxa habituelle, réduisant Nietzsche à un irrationaliste relativiste, qui se serait contenté de renverser la métaphysique, tout en la reconduisant. Il s’agit donc à la fois d’une introduction à une œuvre fascinante, celle de Nietzsche, mais en même temps d’une confirmation, à savoir que Wotling est sans aucun doute avec Eric Blondel le plus grand commentateur de Nietzsche français, ce qui force l’admiration.
- Patrick Wotling, La philosophie de l’esprit libre, Introduction à Nietzsche, Champs Flammarion, 2008
- cf. Nietzsche, Aurore, Traduction Julien Hervier, folio essais, 1989, p. 18
- Wotling, op. cit., p. 9
- Ibid.
- Ibid. p. 26
- Ibid. p. 34
- il n’est qu’à penser à ce collectif saturé de raccourcis, où certains auteurs reprochent à Nietzsche de congédier la vérité, ce qui le placerait dans une contradiction performative ; cf. Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens, LGF, 2002
- Ibid. p. 46
- Ibid. p. 93
- Ibid. p. 74
- Ibid. p. 298
- Ibid. p. 187
- Ibid. p. 228
- Ibid. note 1, p. 396