Gwenaëlle Aubry est philosophe et écrivaine. Directrice de recherche au Centre Jean Pépin (CNRS-ENS), ses recherches, d’abord ancrées dans la philosophie antique, principalement orientées par les concepts de sujet et de puissance, se sont poursuivies par l’étude de la philosophie médiévale et contemporaine, sous l’angle des théologies de la toute-puissance. Guidés par Pierre Hadot, ses premiers travaux, ont été consacrés à Plotin. Ainsi, après avoir traduit et commenté le Traité 53 (I, 1) des Ennéades de Plotin[1] (2004), elle a publié plusieurs études sur la postérité au long cours du hēmeis (« nous ») plotinien. Elle a mené ensuite une enquête archéologique sur la constitution de l’ontologie de la puissance. Dans ce cadre, en 2007, paraît Dieu sans la puissance. Dunamis et Energeia chez Aristote et chez Plotin. Archéologie de la puissance I[2]. Ce livre, qui a été revu et augmenté pour sa nouvelle édition en 2020 constitue le premier volet d’une archéologie dont le deuxième a été publié en 2018 sous le titre Genèse du Dieu souverain. Archéologie de la puissance II[3].
A : Les motivations de l’archéologie
Actu-Philosophia : Pourquoi une nouvelle édition revue et augmentée de Dieu sans la puissance, initialement paru en 2007, plutôt qu’un nouvel ouvrage ? L’édition de 2020 présente, en effet, un chapitre entièrement refondu sur Aristote et vous avez publié, par ailleurs, de nouveaux articles sur Plotin qui n’ont pas été intégrés à cette édition. Les découvertes et les résultats exposés dans ces nouvelles recherches sembleraient pouvoir s’intégrer à ce nouveau livre. Quelle continuité souhaitiez-vous garder ?
Gwenaëlle Aubry : La nouvelle édition de Dieu sans la puissance n’infléchit pas la thèse proposée dans la première – ce qui aurait pu en effet justifier l’écriture d’un nouveau livre, en forme de repentir – mais vient la consolider. L’un des enjeux de ce premier volume de l’archéologie consistait à proposer une lecture unitaire et ontologique de la Métaphysique d’Aristote fondée sur le couple conceptuel de l’en-puissance et de l’en-acte (irréductible à celui de la puissance et de l’action) et, à partir de là, à mettre en évidence une ontologie qui dissocie l’être de la puissance mais aussi, intégrée à celle-ci, une théologie du dieu sans puissance. Les résultats inédits apportés par la nouvelle édition ont trait au livre Lambda de la Métaphysique. Ils viennent renforcer cette thèse de trois façons :
- D’abord, en allant contre la lecture traditionnelle de Lambda, à savoir la lecture bipartite qui distingue en son sein entre un traité d’ousiologie et un traité de théologie, ou encore entre un traité des substances sensibles et un traité de la substance séparée. Cette lecture bipartite de Lambda engage une lecture scissioniste de la métaphysique (comme science et comme œuvre), dès lors partagée, pour reprendre la description heideggérienne de l’onto-théologie, entre une science de l’être commun et une science de l’être premier – scission qui ne peut éventuellement être résorbée que par le haut, c’est-à-dire par la théologie. Or il s’agit ici, à l’inverse, de proposer une lecture continuiste de Lambda, qui passe notamment par une réévaluation de Λ 5, envisagé non plus comme seuil entre un traité des principes de la substance sensible et un traité de la substance séparée mais comme clef de leur unité. Λ 5 énonce en effet à la fois que dunamis et energeia sont les principes communs à toutes les substances par analogie (1071a 4-5) et que la substance séparée doit être conçue comme energeia et non comme forme (1071a 8-9). Sont ainsi posées tant la possibilité d’une unification de l’ousiologie fondée sur la dunamis et l’energeia, que celle de l’intégration de la théologie à l’ousiologie ainsi définie : en tant qu’energeia, la substance séparée a un principe commun avec les substances sensibles et est à leur principe. Aristote parvient ainsi à assurer l’univocité du discours ontologique tout en posant, en son sein, le primat du principe théologique.
- Mais ce n’est pas tout. Désigner la substance séparée comme acte, energeia, et non comme forme, à la façon des Platoniciens, c’est élucider la nature de sa relation aux substances sensibles. Dire que la substance séparée, c’est-à-dire le premier moteur immobile, est ousia energeia, c’est dire qu’elle est exempte tant de puissance que d’en-puissance : il n’y a en elle ni puissance active ni potentialité. Le dieu d’Aristote est entièrement actuel et n’agit pas. Or, c’est précisément en tant que tel qu’il est au principe du mouvement : acte pur, il est la fin qui conditionne le mouvement des autres substances vers leur acte et leur fin immanents. (Pour déplier un peu les choses, même si je ne peux ici le faire en détail, l’analogie dont il est question en Λ 5 doit être entendue au sens d’une identité de rapports : le rapport de l’ousia energeia aux substances composées est le même que celui, au sein de celles-ci, de l’en-acte et de l’en-puissance ; de même que, pour chaque substance composée, son mouvement, qui a pour principe l’en-puissance, tend à l’acte qui est sa fin et son bien, de même le mouvement en son ensemble a pour condition l’existence d’un acte pur qui, lui, est le bien toujours-déjà réalisé). Ce que cela signifie, c’est que l’absence de puissance du premier moteur est la condition même de son efficacité.
- Enfin, désigner le dieu comme acte pur (et non comme « forme pure », syntagme fréquent chez les commentateurs mais que l’on ne trouve nulle part chez Aristote), c’est l’identifier, non seulement à la fin, mais aussi au bien. Aristote réussit ainsi là où les Platoniciens ont échoué : en démontrant que l’energeia, et non la forme, est le mode d’être de la substance séparée, il pose le bien au principe, il établit non seulement son primat sur les substances sensibles mais sa relation à celles-ci, enfin, il identifie sa causalité singulière comme étant celle de la fin et allant sans puissance.
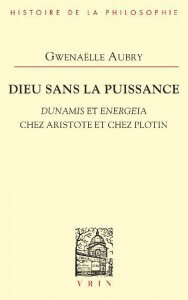
Cette thèse aristotélicienne ici consolidée est déterminante pour la suite du projet archéologique : l’enquête au long cours qui se déploie au fil de Dieu sans la puissance puis de Genèse du Dieu souverain est en effet régie par une double question. Il s’agit de comprendre comment on est passé de l’ontologie aristotélicienne de l’en-puissance et de l’en-acte à l’ontologie moderne de la puissance et de l’action ; et, corrélativement, comment on est passé d’une théologie du dieu sans puissance et identique au bien à une théologie du Dieu tout-puissant – et dont la puissance peut être posée comme excédentaire au bien.
C’est pourquoi, si je n’ai pas jugé nécessaire d’intégrer à l’édition augmentée de Dieu sans la puissance mes travaux sur Plotin postérieurs à 2007 et, au demeurant, déjà publiés, j’y ai en revanche apporté une série de renvois systématiques à Genèse du Dieu souverain. À ce titre, cette nouvelle édition vient clore le projet archéologique, en nouant plus fermement les deux volets du diptyque et en marquant plus nettement la grande opposition qui l’organise : entre dieu acte pur et Dieu tout-puissant, entre dieu-bien et Dieu-souverain.
AP : L’usage du terme « archéologie » pour désigner une méthode ou une approche philosophique remonte à Kant, qui opposait l’archéologie philosophique à l’approche empirique du récit historique[4]. L’archéologie philosophique est la méthode qui permettrait aux philosophes de réfléchir sur l’origine, le but et la fin des choses. En effet, il s’agit de poser la question, à rebours, sur l’arché, qui implique, chez Kant, une téléologie revisitée de la rationalité. On doit à la psychanalyse de Freud[5] l’introduction de la méthode archéologique dans l’étude des couches non conscientes de la constitution du sujet, impliquant une remise en question du projet de la rationalité et de toute prétention téléologique. Cette méthode sera déployée, chez Foucault[6] et chez Agamben[7], comme une méthode critique du présent. Chez ces derniers philosophes, l’archéologie serait parente mutatis mutandis de la généalogie nietzschéenne, tant pour les fins critiques que pour le rejet d’une reconstruction empirique de l’histoire. Alain de Libera[8], s’inspirant de Foucault et de Heidegger, emprunte aussi la méthode archéologique pour retracer la naissance de la notion du sujet. Pour Agamben et pour de Libera, les études de la pensée en amont de la Modernité occupent une place importante dans leurs archéologies. Dieu sans la puissance (2020) et Genèse du Dieu souverain (2018) sont deux volets d’une même enquête archéologique allant de l’antiquité à l’époque médiévale. L’influence d’Agamben est claire dans le deuxième volet de votre archéologie, si bien que nous pourrions comprendre les deux volets comme s’inscrivant dans le même versant méthodologique. Je me permets toutefois de poser une première question sur la nature et les motivations du choix de cette approche. Faut-il comprendre la démarche archéologique dans un horizon kantien, généalogique, herméneutique, ou encore biopolitique ? Faut-il la distinguer de la généalogie et l’opposer à la téléologie ? Son point de départ est-il le présent ou la Modernité ?
GA : Vous avez raison, et je vous en remercie, de déplier toutes les strates du terme « archéologie » que sa vogue actuelle tend, par-delà les différents usages fondés et précis que vous évoquez, à vider de sens. De son usage foucaldien, complété à partir de 1971 par celui de « généalogie », je retiens avant tout la nécessité de ne pas aborder le concept de puissance à partir d’« un équipement de problèmes constants » (Les Mots et les choses, Tel-Gallimard, 1966, p. 171). Il s’agit ici de compliquer, de tourmenter, et finalement de défaire un récit linéaire, en étant avant tout attentive aux ruptures, aux conflits, au discontinu. Quant à Agamben, il est pour moi une référence centrale. Dans L’Usage des corps, il articule fortement l’archéologie foucaldienne à l’enquête ontologique en tant que « l’ontologie a constitué durant des siècles l’a priori historique fondamental de la pensée occidentale » (Seuil, 2015, p. 169). Genèse du Dieu souverain s‘ouvre d’ailleurs sur une citation extraite cette fois d’Opus Dei. Archéologie de l’office : « Une transformation terminologique, si elle exprime une mutation dans l’ontologie, peut être aussi efficace et révolutionnaire qu’une transformation matérielle ». Mais dans le même temps, pour l’une des questions directrices qui m’occupent, à savoir l’écart entre l’ontologie de la puissance et de l’action et celle de l’en-puissance et de l’en-acte, Agamben tend à minorer, à linéariser la mutation : dans la distinction aristotélicienne entre dunamis et energeia, il voit en effet « le noyau originaire de l’ontologie de l’effectualité », de sorte que pour lui « la tendance à résoudre ou, à tout le moins, à confondre l’être dans l’agir » est présente « fût-ce de manière latente, depuis le début de l’ontologie occidentale » (Opus Dei, Seuil, 2012, p. 81).
Ici, je reviens à l’arkhè, à la Métaphysique d’Aristote, mais pour en libérer d’autres effets que ceux qui lui sont d’ordinaire attribués : pour établir que loin de trouver en elle sa source, l’ontologie de la puissance et de l’action se construit contre elle. Du même coup, et pour continuer à vous répondre, l’archéologie de la puissance que je propose est, sinon anti-téléologique, du moins non-destinale : il s’agit de montrer que la puissance (et avec elle, j’y reviendrai, la possibilité de la violence) n’est pas inscrite dans le destin de la métaphysique, puisque celle-ci, en son origine, pense dieu et l’être sans la puissance. On ne peut dès lors dire, comme Levinas, que « l’ontologie comme philosophie première est une ontologie de la puissance » (Totalité et infini, Le Livre de poche, 1971, p. 37), ni, pour citer cette fois Derrida lecteur de Levinas, que « le tout de la tradition issue d’Aristote » porte cette inscription de la puissance (« Violence et métaphysique », L’Écriture et la différence, Seuil, 1967, p. 123). Il s’agit bien plutôt d’identifier le lieu d’élaboration de l’ontologie de la puissance, et la rupture qu’il engage avec la métaphysique et l’ontologie aristotéliciennes.
Mais cela implique d’aller creuser sous la surface apparemment homogène du vocabulaire philosophique (et c’est également en ce sens, aller sous la surface des mots, que j’entends le travail archéologique). Un exemple : Thomas d’Aquin désigne Dieu comme actus purus essendi. Mais cette apparente reprise du lexique aristotélicien masque une profonde rupture conceptuelle : loin d’exclure la puissance, l’acte pur d’être est tout-puissant. Plus encore, l’acte pur vient nommer chez Thomas la plénitude de la puissance d’être (potestas ou virtus essendi). De la même façon, Thomas désigne comme en-puissance (in potentia) ce qui reçoit l’acte (c’est-à-dire en fait le don divin de l’être). Mais ce concept d’en-puissance comme pure réceptivité (qui joue un rôle fondamental dans la doctrine thomasienne de l’analogie) n’est pas aristotélicien : il est hérité, via le néoplatonisme, du concept peu connu d’epitēdeiotēs, lequel désigne une puissance intégralement passive. À la corrélation aristotélicienne de l’en-acte et de l’en-puissance, Thomas substitue ainsi, tout en en reprenant les termes, celle de la toute-puissance et de la réceptivité (aptitudo ou capacitas). La réactivation du lexique aristotélicien masque bien une profonde mutation : au dieu sans puissance se substitue un Dieu tout-puissant en qui l’acte nomme comme bonne l’identité de l’être et de la puissance ; et l’ontologie aristotélicienne de l’accomplissement, de la perfection possible ici et maintenant, laisse place à une ontologie de la création et de la dépendance. Mettre au jour, sous la trompeuse continuité terminologique, des glissements et des réinventions, permet donc d’identifier des coupes conceptuelles, des gestes philosophiques irréconciliables, qui à leur tour déterminent, non pas les épisodes d’une histoire linéaire, mais des moments métaphysiques radicalement distincts.
Cette enquête archéologique, puisque vous m’interrogez sur sa genèse, est d’ailleurs née à la conjonction d’une question philologique suscitée par mes toutes premières recherches sur Plotin, quand j’étais étudiante sous la direction de Pierre Hadot, et d’une inquiétude philosophique dont le point de départ est, lui, contemporain. Traduisant Plotin, j’ai été confrontée au problème que pose l’usage chez lui du terme de dunamis appliqué au premier principe, l’Un-Bien. Comment comprendre la désignation de l’Un-Bien comme dunamis pantōn ? Comment la dunamis, associée par Aristote au devenir comme moindre-être, passe-t-elle chez Plotin à l’au-delà de l’être ? L’Un-Bien est-il en-puissance de tout ou puissance de tout ? Totalité potentielle ou puissance productrice de tout ce qui est ? J’ai été très marquée, à la même époque, par la lecture d’un petit livre de Hans Jonas, Le Concept de Dieu après Auschwitz. Jonas y interroge la possibilité de maintenir ce qu’il appelle « le concept traditionnel de Dieu », soit l’idée d’un Dieu à la fois tout-puissant, compréhensible et bon, face à l’événement qui porte le nom d’Auschwitz. Plutôt que la bonté, ou la compréhensibilité, Jonas choisit de sacrifier la toute-puissance en forgeant le mythe, inspiré par la cabale lourianique, d’un Dieu qui, à travers la création, aurait, non pas manifesté, mais abandonné sa puissance. Les différents fils de l’enquête se sont tendus à partir de là : la question plotinienne invitait à une enquête à rebours sur la dunamis aristotélicienne, laquelle m’a conduite à mettre en évidence cette figure singulière du divin distincte tant du Dieu tout-puissant de la métaphysique chrétienne que du Dieu impuissant invoqué par Jonas, mais aussi par d’autres contemporains, comme par exemple Gianni Vattimo et le pensiero debole. Mais une nouvelle question se posait dès lors : comment, après Aristote, s’opère le double nouage de l’être et du dieu avec la puissance ? Et le travail que j’ai mené sur la genèse de l’attribut divin de toute-puissance m’a aussi conduite à déplacer la question de Jonas : car le problème que pose la toute-puissance n’est pas seulement celui, classique, de la théodicée, à savoir la compatibilité entre un Dieu posé comme à la fois tout-puissant, compréhensible et bon et l’existence effective du mal. L’attribut de toute-puissance peut conduire à poser, en Dieu lui-même, la possibilité du mal. La question qui régit l’enquête admet dès lors encore une autre formulation (peut-être la plus inquiète) : comment en vient-on à penser en Dieu non plus la réalité du bien mais la possibilité du mal ?
AP : L’un des résultats de cette archéologie est la mise en évidence d’une ontologie unitaire et axiologique qui, naissant au sein de la pensée d’Aristote (premier volet de l’archéologie), serait remplacée par l’idée d’un Dieu tout-puissant excédant le bien, racine médiévale (deuxième volet de l’archéologie) de la pensée moderne. Ce Dieu s’opposerait au Dieu impuissant, souffrant et faible qui relève du débat philosophique contemporain (Jonas, Vattimo, Agamben) face aux catastrophes humaines. Dans de tout autres termes, vous avez réfléchi à titre personnel[1], dans un court texte publié dans la collection de circonstance « Tracts de crise » des éditions Gallimard, sur la pandémie que nous connaissons aujourd’hui. Croyez-vous que l’ontologie que nous présente Dieu sans la puissance serait plus susceptible de répondre aux requêtes du monde contemporain que les ontologies liées au dieu souverain ou au dieu faible ?
GA : Comme je viens de le préciser, la grande opposition qui organise les deux volets du diptyque est celle, non du Dieu faible et du Dieu tout-puissant, mais du Tout-puissant et d’un dieu qui, quoique sans puissance, n’est pas impuissant (ou : qui, quoique non-efficient, est efficace). Le dieu d’Aristote est en fait une figure tierce, qui déverrouille l’alternative entre toute-puissance et faiblesse. La figure du divin que dessine le livre Lambda de la Métaphysique invite du même coup à remettre aussi en question l’identité, posée par Vattimo et plus généralement par la tradition nietzschéo-heideggérienne, entre Dieu de la métaphysique et Dieu tout-puissant.
Par ailleurs, et si vous me permettez encore une autre précision, il ne s’agit pas tant de décrire la substitution d’une théologie à une ontologie, que d’identifier deux mutations, l’une ontologique et l’autre théologique: substitution du dispositif puissance/action au dispositif en-puissance/en-acte, d’une part; du Dieu tout-puissant au Dieu acte pur, d’autre part. Reste que ces deux mutations sont étroitement corrélées: dans Genèse du Dieu souverain, il s’agit de montrer que le nouage de l’être et de la puissance s’opère d’abord en Dieu, en l’être premier – le moment thomasien, que j’évoquais plus haut, étant à cet égard déterminant. Et que le concept de puissance comme efficience immédiate et non-normée trouve sa source, non chez Aristote, mais dans la théologie de la toute-puissance. Ultimement, le livre en dérive les effets politiques – ainsi, la mobilisation par Carl Schmitt du concept médiéval de puissance absolue (potentia absoluta) pour définir la souveraineté par la décision de l’état d’exception. Si l’enquête peut avoir une pertinence pour l’ultra-contemporain, sur lequel vous m’interrogez, c’est peut-être là qu’elle réside : c’est dans la mesure où, à travers la pandémie, nous faisons l’expérience, paradoxalement collective, de la séparation, mais aussi celle, radicale et concrète, du pouvoir et de l’impuissance. Les analyses d’Agamben ont ici une pleine portée: nous expérimentons une vie sinon « nue », en tout cas pour beaucoup dangereusement précarisée, et de plus en plus réduite à sa dimension biologique, à l’obsession de la mort et de la maladie, coupée de toute communauté, restreinte dans ses possibilités d’action politique, intellectuelle et artistique (je pense ici à la pérennisation, en France, de la fermeture des lieux d’art et de savoir) – et ce faisant, nous éprouvons aussi notre sujétion à un pouvoir souverain qui, à travers la succession et la reconduction, depuis 2015, d’états d’urgence tend à écrire la loi à partir de l’exception.
Entretien avec Gwenaëlle Aubry : Autour de Dieu sans la puissance. Dynamis et Energeia chez Aristote et Plotin (partie 2)
[1] Aubry, Gwenaëlle, Se souvenirs des confins, Paris, Gallimard, coll. « Tracts de crise », 2020.
[1] Aubry, Gwenaëlle, Plotin. Traité 53 (I, 1), Introduction, traduction, commentaire et notes, Paris, Cerf, 2004.
[2] Aubry, Gwenaëlle, Dieu sans la puissance. Dunamis et Energeia chez Aristote et chez Plotin, Paris, Vrin, 2007, édition revue et augmentée en 2020.
[3] Aubry, Gwenaëlle, Genèse du Dieu souverain. Archéologie de la puissance II, Paris, Vrin, 2018.
[4] Kant, Emmanuel, Les progrès de la métaphysique en Allemagne depuis le temps de Leibniz et de Wolff, trad. fr. Louis Guillermit, Paris, Vrin, 1973, p. 9. Voir aussi, Paltrinieri, Luca, « Archéologie », Dans Le Télémaque, 2015/2 (48), p. 15-30.
[5] Freud, Sigmund, Malaise dans la civilisation, trad. fr. Pierre Cotet, René Lainé et Johanna Stute-Cadiot, Paris, PUF, 1995. Voir aussi, Strauser, Joëlle, « Note sur l’archéologie », dans Le Portique [En ligne], 2004/13-14 : http://journals.openedition.org/leportique/638 ; et Ricœur, Paul, De l’interprétation. Essai sur Freud, Paris, Seuil, 1965.
[6] Foucault, Michel, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.
[7] Agamben, Giorgio, Signatura rerum : sur la méthode, trad. fr. Joël Gayraud, Paris, Vrin, 2008 ; Homo Sacer. II, 5, Opus Dei : archéologie de l’office, trad. fr. Martin Rueff, Paris, Seuil, 2012.
[8] De Libera, Alain, Archéologie du sujet. I. Naissance du sujet, Paris, Vrin, 2007 ; Archéologie du sujet. II. La Quête de l’identité, Paris, Vrin, 2008 ; Archéologie du sujet III. La double révolution. L’acte de penser, 1, Paris, Vrin, 2014 ; L’archéologie philosophique, Paris, Vrin, 2016.







