La tendresse d’un humour acide…
Les premières pages du roman de Michel Desgranges placent immédiatement le lecteur dans un monde de l’altérité, si bien que, nous présentant son personnage Anicet Broutard, l’auteur nous invite au même type d’initiation lexicale et romanesque que n’importe quel roman de science-fiction. Jargon spécifique et ironique, jeux de piste et devinettes plutôt transparentes, la situation absolument ordinaire de l’incipit (Anicet doit ramener un bidon de lessive à sa femme) semble à la fois critique (tendre) et défense (molle) de la condition du philosophe. Il n’est pas interdit d’imaginer que le théoricien russe de littérature Victor Chklovski eut trouvé dans cet incipit la parfaite illustration de sa théorie de la défamiliarisation : en transposant les gestes et pensées ordinaires dans un champ particulièrement abstrait (avec un excès qui ne dissimule pas sa propre autodérision), ou du moins, en présentant ce monde qui, pour tout ordinaire qu’il puisse être au lecteur dont l’esprit restitue les formes que modifie la transposition, l’auteur présente notre monde avec un humour grinçant. Cet autre monde littéraire qui est pourtant le nôtre à qui partage les codes esthétiques et — il faut le dire — professionnels de son auteur.
Les nombreuses saillies humoristiques, les « traits d’esprit », qui émaillent le texte dès les premières pages ne laissent pas de doute sur l’ambition de Michel Desgranges : ce n’est pas tant une vocation polémique qu’un tour d’horizon du milieu de l’activité philosophique, certes envisagé avec une malice certaine. La finesse de ces railleries ne se départit pas d’une honnête affection et l’on peut très vite trouver Anicet aussi fatiguant qu’attachant — l’un n’allant peut-être pas sans l’autre. Naturellement, le lecteur ne perd pas de vue comme Anicet est peut-être une paisible incarnation d’un ensemble, l’ensemble des philosophes universitaires (surtout ceux de « cinquième cycle »[1]). Une philosophie-fiction, donc, qui nous emmène dans un monde dont on ne sait encore s’il est idéal ou cauchemardesque, et dont on peut penser pour le moment qu’il ressemble férocement au nôtre.
Mentionnons ça et là certains ancrages particulièrement agressifs qui ne manqueront pas de faire sourire (au moins) le lecteur lui-même universitaire, comme l’évocation d’un
« Bernard-Henri Lentourloupe réclamant le retour à la démocratie des Seychelles où un aide-cuisinier venait de s’emparer du pouvoir avec la complicité d’une troupe de marmitons. Anicet fut irrité. En public, il ne manquait jamais de faire l’éloge du double prix Nobel, gloire nationale, gloire de la philosophie et de la chimie, dans son for intérieur, il considérait Lentourloupe comme un dilettante imposteur, un kantien de maternelle, dont l’omniprésence médiatique était un outrage à l’ontologie authentique qui ne pouvait, elle et Anicet, s’exprimer, en dehors des enceintes du savoir universitaire, que sur Radio-Être, qui émettait une fois par mois sur petites sondes entre trois et quatre heures du matin. »[2]
Le roman est tout à coup propulsé dans le registre du pamphlet qui ne dit (pas beaucoup) son nom, et invite peut-être à une certaine actualisation du regard porté sur les « nouveaux philosophes », cette génération qui n’en finit plus de ne pas mourir et qui riva la parole médiatique (et donc polémique) dans la moelle osseuse de la pratique philosophique. Que l’on songe seulement au livre directement contemporain des deux contributeurs à Actu Philosophia que sont Nicolas Rousseau et Henri de Monvallier : Les imposteurs de la philo dont la banderole publicitaire enfonce le clou par une désignation ad hominem : « Raphaël Enthoven, Charles Pépin, Raphaël Glucksmann et quelques autres »[3]. N’allons pas jusqu’à parler d’un nouveau front polémique mais observons toutefois que le paysage politique interne au monde de la philosophie forme les conditions propices au conflit. Il n’est pas difficile pour qui le souhaite de restituer les silhouettes dans le théâtre d’ombres, dont les noms sont à peine dissimulés comme ici, du roman de Michel Desgranges. Car s’il s’agit probablement d’une réflexion critique sur le milieu universitaire de notre époque, le roman ne laisse pas non plus de repos aux institutions politiques qui font le quotidien des « citoyens » ordinaires, et notamment des très grandes villes françaises.
…mais aussi un regard de naturaliste
Il n’est pas non plus question d’envisager un roman qui soit seulement à charge et dont les victimes seraient strictement telle ou telle catégorie des professionnels rémunérés de la philosophie : le personnage central est loin d’être épargné. Non content d’écrire des livres à la spécification absconse et dérisoire au regard de l’avancée de la recherche pratique en philosophie, réduit à n’être qu’un énième exégète dans la longue liste des commentateurs du poème de Parménide, notre pauvre Anicet tire en plus son peu d’orgueil du calcul scolaire de ses étudiants :
« La vente de ses trois ouvrages fondamentaux, L’Être vu de face, L’Être vu de dos, et L’Être vu de profil, achetés par des étudiants soucieux de sa bienveillance, lui rapportait bon an mal an entre deux mille et deux mille cinq cents zlotys… »[4]
On passera en outre sur l’usage de la monnaie polonaise dont la présence, de la bouche même de l’épouse Broutard, est incompréhensible. L’euro et la livre tournois sont mentionnés, donnant un caractère franchement absurde à un univers narratif jusque là difficilement sérieux. La remarque de Mélanie Bouchard (née Mapuce) montre que les personnages eux-mêmes s’interrogent sur leurs conditions d’insertion dans un univers clos aux jeux référentiels dont la démarche satirique produit une hétérogénéité difficilement assimilable. Mais dès lors que madame Bouchard s’en étonne à son tour, le melting-pot est justifié par la conscience narrative d’un absurde qui se joue à des fins critiques. Et en effet tout y passe. À la présentation du personnage suivant l’auteur trouve une nouvelle occasion pour la peinture féroce de ce que pourrait être l’hyper-spécialisation philosophique en vase clos, et poussée jusqu’à l’absurde :
« Rassemblant dans ce qui avait été un vaste champ de luzerne trois blocs de béton avec fenêtres plexiglas dus à un architecte moldave aux honoraires timides, l’Université était un rare témoin des succès de la première et dernière tranche d’un plan-programme décrété par le feu Président — une Université dans chaque chef-lieu de canton — afin d’unir savoir et ruralité ; on y trouvait une Faculté de sciences humaines — ontologie globale, dont dépendait Népomucène, histoire non factuelle et grammaire vagabonde — et une Faculté de sciences exactes — mathématiques oniriques, physique ludique et téléphonie citoyenne. »[5]
Nous écrivions tout à l’heure que le lecteur pouvait encore hésiter entre un monde idéal ou cauchemardesque : il semble assez clair désormais que les passerelles entre la fiction et le système référentiel avec lequel elle joue nous invite plutôt à concevoir notre monde comme étant tout près du cauchemar — ce que l’on appelle poliment une dystopie. Le roman se fait alors, sous couvert de ne parler que des philosophes, l’espace d’un véritable brûlot contre notre époque où le tout administratif a ramifié la substance des disciplines au point de les décliner jusqu’à, là encore, un absurde qui déroute jusqu’aux personnages. La proximité avec la réalité des mondes universitaires contemporains est telle que, parfois, la morsure ironique pourrait laisser pensif, tant et si bien que l’auteur a réussi le pari délicat d’un roman allégorique qui s’attaque de manière directe à une réalité tout en dépeignant, presque comme un naturaliste, la réalité d’un milieu invisibilisé par le phénomène dit « de la tour d’ivoire ». Il ne serait probablement pas difficile de trouver des témoignages de chercheurs et chercheuses en philosophie qui iraient dans le sens de ce roman — et de fiction loufoque et bouffonne, celui-ci deviendrait possiblement une entreprise salutaire.
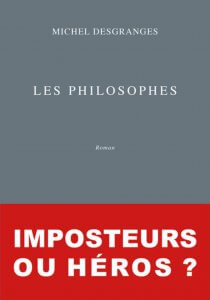
Contre l’excès technocratique, contre l’absurdité poussive de la bureaucratie, mais aussi contre l’organisation salariale qui met les femmes sous les hommes, au rang d’objet dont il faut calculer le coût de revient — et ce alors même que le roman commence par les introspections métaphysico-ménagères d’un homme qui souhaite rapporter à sa femme la bonne marque de lessive :
« Passer Professeur… Avec mille (ou douze cents) zlotys en plus chaque mois, il pourrait même, en faisant attention à la nourriture, s’offrir tout Chick Corea en vrai vinyle authentique, qu’il pourrait écouter s’il trouvait un tourne-disques d’occasion, un Thorens serait superbe…, et il pourrait changer son vieux cheap-phone Samsung, donné en prime avec trois boîtes de cornflakes aux soldes d’une supérette, pour un philosophone avec un giga écran de 4 pouces, il s’abonnerait à Flop, la chaîne pour mobiles qui diffusait les dernières créations off-off Broadway, quarante zlotys par mois, mais il fallait payer deux ans d’avance pour voir les pièces avec les commentaires du scénographe, des machinistes, de l’éclairagiste et de l’hôtesse d’accueil, si indispensables pour pénétrer toutes les nuances d’un sous-texte signifiant, il pourrait aussi faire une folie, un blouson imperméable pratique les jours de pluie, et peut-être même prendre une épouse, mais là, bien faire les comptes, lui professeur, il serait d’abord échelon B4, la femme, un niveau en dessous, la règle dans les ménages d’enseignants, donc elle serait échelon C3, C2 avec de la chance, cela la met… professeur des lycées, quelque chose comme ça, donc un salaire en plus pour le foyer, mais des frais aussi, un lit à deux places, une autre chaise, un peu de linge… tout bien calculer… Ses pensées vagabondaient… une femme… avec même de l’amour… l’amour, évidemment il connaissait, il avait planché sur Le banquet et, grâce à une recherche sur Glouglou, il avait même lu quelques pages de Stendhal et Destutt de Tracy sur le sujet, mais qui manquaient de dimension ontologique, et il était retourné à Levinas, s’était demandé quel poids d’altérité il y avait en kilogrammes dans l’autre d’un couple, à déterminer avant de s’engager… Dans le mariage on trouvait aussi, selon des rumeurs persistantes, du sexe, et ça, il avait étudié dans des livres, Freud, Sade, Bataille, cela lui paraissait bien compliqué et même dangereux, surtout quand on était plusieurs, pourtant il avait pratiqué une fois, après avoir obtenu sa licence et bu beaucoup de rosé de Provence, il ne se rappelait pas trop bien tout, sauf que tous les deux ils avaient beaucoup vomi, parfois quand même il avait des envies, il se satisfaisait tout seul en regardant des photos d’Hannah Arendt, avec une épouse, il ajouterait aussi des photos de Martin H. parce qu’il n’était pas égoïste et il avait lu dans des livres qu’il existait également un plaisir féminin qui se manifestait par des sortes de gloussements casse-oreilles, dont il avait entendu un échantillon sur Tontube, et ce n’était pas pareil que les sons rauques et gutturaux émis par la doctorante restituant au carrelage ses moule-frites… »[6]
Notons que Mélanie Mapuce ne devint Mélanie Broutard qu’en vertu d’une consommation excessive de rosée de Province, ce qui semble un élixir fluidifiant les relations sexuelles et leurs conséquences dans l’univers romanesque de Michel Desgranges. Cet univers romanesque vire donc à l’horriblement acide, impitoyable et désespéré et ne donne aucun argument héroïque dans lequel le lecteur pourrait laisser ses propres fantasmes et rêveries se réfugier. C’est, nous a-t-il semblé, la définition d’un roman au vitriol, l’adresse stylistique et la mesure rythmique le permettant. Nous ne sommes pas loin de songer à la première partie du roman Belle du Seigneur[7], qui brosse un portrait de la Société des Nations au moins aussi dur — un certain désir romantique en plus — que l’auteur, ici, peint le monde des universitaires.
Mais plus encore que cela, nous flirtons désormais franchement avec l’ambiance d’un 1984 de Georges Orwell[8] où l’administration répartit le droit au mariage selon les grades et la dystopie déclarée n’est, une fois encore, pas sans surligner en passant certaines réalités On y trouve donc aussi une critique d’un monde intellectualisant à outrance la moindre prestation artistique, ainsi qu’un commentaire renversé de l’éternelle question opposant intellectualisme et matérialisme, dans la vie mondaine comme dans la vie érudite. La détermination qu’emploie l’auteur pour ridiculiser ses personnages confine à la radicalité d’une démystification qui n’épargne aucun domaine : ni le champ intellectualiste, nous l’avons bien vu, ni celui de la connaissance, ni même la perspective amoureuse, bastion d’une certaine sacralité dans les registres romanesques. Les grandes figures de la philosophie paraissent donc parmi les cibles privilégiées de ce déboulonnage en règle (après Husserl et « Martin H. », l’auteur parle d’un colloque intitulé « Traduire Heidegger en allemand », page 17), mais pas seulement et toute l’activité moderne est ainsi sous-jacente dans la stricte critique de la vacuité existentielle de ce Népomucène, archétype bien excessif et pourtant juste du rat de bibliothèque universitaire, qui pratique le clientélisme comme d’autres milieux professionnels pratiquent franchement la courtisanerie :
« […] Népomucène […] avait avancé ses pions, publiant des recensions flatteuses d’ouvrages de spécialistes influents dans Être-à-La Fierté-Guidon, le bulletin de son unité de recherche, il passait des heures à surveiller […] les pages Brainbook ou Philotube des sommités de tous continents, dès qu’il voyait apparaître un projet, une annonce de publication, il envoyait des éloges ou des félicitations, qu’il n’oubliait presque jamais de signer, avec tous ses titres, il n’omettait pas de souhaiter leur anniversaire à d’importants responsables administratifs avec des courriels ornés de smileys colorés et soigneusement choisis, il ne négligeait pas ses confrères assistants, leur adressant un mot aimable à toute manifestation d’activité — organisation d’un apéro-onto dans une brasserie ou d’un autodafé de livres offensants dans une bibliothèque —, parfois, il se privait de dîner pour offrir un café à un chercheur invité, ainsi se créait-il un réseau de relations, qui se transformeraient en soutiens au moment de son élection, surtout si se manifestait ouvertement en sa faveur le grand Anicet Broutard. »[9]
Les calculs alambiqués d’une stratégie universitaire (et l’on retrouve les rentrées d’argent du foyer Broutard grâce à ce que nous avons appelé le « calcul scolaire » des étudiants qui achètent le livre d’Anicet) côtoient la routine sordide d’un Népomucène qui cherche à flatter l’ordre féodal au-dessus de lui afin d’être autorisé, peut-être, à entrer dans la catégorie supérieure. Le rythme pratiquement morbide de l’existence universitaire du post-étudiant Népomucène rejoint la placidité de celle du professeur Anicet. Les deux personnages ainsi connectés par la narration, peuvent se trouver et faire naître le prétexte romanesque du texte. Et l’interaction génératrice de récit ne cesse pas de s’ancrer dans un discours général tourné tantôt contre l’Éducation Nationale, tantôt contre le monde de l’édition mais toujours contre la forme verticale des rapports sociaux, à la faveur, bien sûr, d’une posture cynique :
« Il est sain, lorsque l’on est ambitieux, de regarder au-dessus de soi, mais lorsque l’on se sent l’âme grise, comme il est revigorant de regarder en dessous, de contempler cette misérable masse humaine inférieure hiérarchiquement et financièrement, même intellectuellement, et tandis que sa pensée jouait avec le spectacle de cette pauvre tourbe, Népomucène sentit lui revenir son énergie, qu’il employa à rêvasser. »[10]
La trame du romanesque qu’il convient d’éprouver
Bientôt arrive un autre personnage, pré-existant au seul roman Les Philosophes, puisque son aventure commence dans Une femme d’État[11], et il s’agit de Laurent Petifretin. Les constructions nominales, comme les sauts de destins croisés d’un texte à l’autre, proposant des focalisations spécifiques un temps durant ici et là, n’est pas sans nous évoquer la pratique fort courue dans l’œuvre littéraire gigantesque de l’anglais Terry Pratchett et ses Annales du Disque-Monde (1983-2013, avec quarante-et-un volumes). L’environnement absurde et les noms bariolés, l’univers pensé à partir des écarts sur le même, cette fameuse défamiliarisation propre aux récits de science-fiction, l’acerbe critique sociale peinte avec tendresse mais non sans vigueur rappellent la fresque des Malaussène[12], l’œuvre de Daniel Pennac. Le roman de Michel Desgranges, éditeur, romancier, ce monsieur qui « vit désormais retiré du monde pour mieux l’observer » (4e de couverture) est probablement un livre à lire et d’une compagnie de bon goût, quelles que soient nos propres affections ou désaffections, et dont tout un chacun tirera profit par l’analogie ou la comparaison aux affres de sa propre existence.
Un roman qui fait penser, en somme, et qui ne se contente pas de penser à l’héroïsme ou l’imposture des philosophes, ces gens dont les profils varient autant, d’Anicet le pauvre professeur cocu, à Laurent le haut-fonctionnaire misérablement déchu, en passant bien entendu par Népomucène, archétype du gratte-papier très loin d’un Lentourloupe. Il nous faudrait sans doute présenter les autres personnages (Zébulon, Églantine, Armand, le riche Hippolyte Trouchou, etc.) mais il n’est pas question de proposer une lecture rapide de ce roman dont l’expérience ne peut se faire que, fort précisément, dans l’expérience de sa lecture. N’est-ce finalement pas de toute la bonne société intellectuelle dont il faut se demander si l’on n’y trouve quelques héros ou bien seulement des imposteurs ?
[1] — M. Desgranges, Les philosophes, Paris, Les Belles Lettres, 2019, page 10.
[2] — Ibid., page 12.
[3] — Paru en octobre 2019, préfacé par Michel Onfray, aux éditions Le Passeur.
[4] — Ibid., pages 12 et 13.
[5] — Ibid., page 14.
[6] — Ibid., pages 15 et 16.
[7] — A. Cohen, Belle du Seigneur, éd. Gallimard, 1968.
[8] — Ou plus spécifiquement sa première adaptation cinématographique, celle du réalisateur M. Radford, avec J. Hurt et S. Hamilton dans les rôles de Winston et Julia.
[9] — Ibid., pages 17 et 18.
[10] — Ibid., pages 20 et 21.
[11] — M. Desgranges, Les Belles Lettres, 2011, Paris.
[12] — Saga de D. Pennac constituée de six tomes diffusée par Gallimard de 1985 à 1999.







