Il y a quarante ans, le 15 avril 1980, Sartre disparaissait. En 2020, comme depuis quelques décennies, des chercheurs s’activent autour de son œuvre et les différents groupes d’études sartriennes ne sont jamais avares en publications et colloques. Il serait difficile de le nier : Sartre est bien connu, « on entre dans sa vie comme dans un moulin » rappelait très justement, en 2011, Michel Contat. Or, force est de constater que l’université boude l’auteur de La Nausée et que ses œuvres majeures sont beaucoup moins lues qu’auparavant. On lui préfère Camus, plus consensuel, et dont les œuvres se répètent, avec une bienveillante régularité, dans les rayons des librairies, dans les manuels scolaires et jusqu’aux descriptifs des épreuves anticipées de français. Cela est bien dommage car pour le grand public ronronnant, il n’est pas certain que le corpus sartrien, lui, soit aussi accessible et connu que la vie de son auteur.
Tout se passe comme si la prophétie de Montherlant dans Le Solstice de juin se réalisait pour Sartre : les écrivains qui veulent « être de leur époque » seraient voués à l’oubli. Il faut dire que l’auteur des Chemins de la liberté paie le prix du paradoxe vivant qu’il fut : sans doute le meilleur défenseur de la philosophie face à la montée des sciences humaines et en même temps son fossoyeur, chantre de la transparence, souvent exposé en pleine lumière médiatique. Le « jeune serin à bésicles » de Montherlant serait-il désormais au purgatoire ? Il serait exagéré de l’affirmer. Cependant, on peut s’inquiéter du silence qui se fait aujourd’hui, hors des cercles de spécialistes, autour de l’œuvre sartrienne.
On en conviendra : Sartre n’a pas inventé la liberté, ni l’angoisse, ni même Roquentin que la littérature connaissait déjà chez Duhamel sous les traits de Salavin. Pourtant, son œuvre est d’un intérêt exceptionnel : chez Sartre, jamais la pensée ne se fatigue, toujours elle se renouvelle et revêt de nouveaux aspects : tout est style, tout est pensée pure ou les deux.
Aujourd’hui donc, cette petite Philosophie de Sartre publié chez Vrin dans la collection « Repères philosophiques » est un grand soulagement. Son auteur, Philippe Cabestan, est l’un des meilleurs spécialistes du philosophe. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, un ouvrage synthétique comme celui-ci, clair et pertinent, n’est pas un volume supplémentaire sur Sartre : l’ensemble introduit clairement à la lecture de l’œuvre en se maintenant sans cesse au plan de la pensée, évitant ainsi au lecteur des digressions biographiques. P. Cabestan rend ainsi grâce à Sartre qui se voulait d’abord un authentique philosophe, et dont l’œuvre comporte une indéniable unité.
Contingence, conscience et liberté
Cabestan le souligne : le corpus sartrien est constitué d’œuvres qui s’articulent et s’approfondissent. Il n’y a qu’un seul Sartre. Ce dernier avait déclaré dans Les Mots que la mort de son père le rendit à la liberté. Cette idée est le fondement même de toute son œuvre : si la liberté est la condition même de l’existence, il ne suffit pas de la détenir ou simplement d’y croire, mais il s’agit de l’exercer, d’en faire la preuve concrète : c’est le sens du projet de chaque homme, condamné à être libre pour ne pas se réifier, se manquer. Entrer dans la vie et l’œuvre de Sartre, c’est y découvrir un humanisme : un appel à l’homme pensé comme un centre d’initiatives. En cela, quelque soit la profondeur de la situation dont il doit s’arracher, chaque homme est l’auteur de sa vie et, avec tous les autres hommes, de l’histoire humaine. Se dessine d’emblée la trajectoire qui orientera Sartre de l’Être et le Néant à la Critique et de la Critique au Flaubert.
L’auteur commence par rappeler, citant La Force de l’âge, ce qu’Aron, revenant de Berlin, aurait dit à Sartre lors d’un cocktail : « Tu vois, mon petit camarade, si tu es phénoménologue, tu peux parler de ce cocktail et c’est de la philosophie. »[1] Dès lors, Sartre part pour Berlin et découvre Husserl avec grand intérêt. Mais avant cette découverte, il y a un Sartre formé à la mode française. Malheureusement, certainement à cause du format de l’ouvrage, P. Cabestan en parle peu.
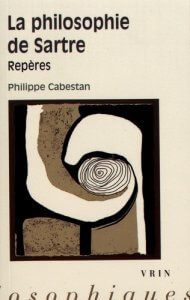
Dans un petit paragraphe intitulé « Avant la phénoménologie »[2], l’auteur fait état de deux écrits bien connus des sartriens : d’abord Le Second voyage d’Er l’arménien (1930) puis le Carnet Dupuis. Le premier porte une première attaque contre l’idéalisme quand le second renferme des notes fondatrices sur la contingence. Et l’auteur de mentionner Brunschvicg sans pour autant – et cela nous est toujours regrettable dans les ouvrages sur Sartre – évoquer le rapport, sans doute fondateur, qui existe entre les deux philosophes. Malheureusement, trop peu de spécialistes évoquent les relations pourtant capitales entre Sartre et ses maîtres. De prodigieux historiens de la philosophie comme Alphonse de Waelhens (1911-1981) et surtout Henri Mougin (1912-1946) tissèrent de précieux liens entre Sartre et ses devanciers. Le second, avec une grande précision et implacable puissance de réflexion, montre comment Sartre offre à l’idéalisme français, la possibilité d’en finir avec ses grossesses nerveuses successives ! Les idéalistes voudraient bien accoucher… de l’existence. La plus notoire fut celle d’Hamelin, que Sartre connaissait indubitablement, et le second fut Le Senne, développant une pensée originale de l’existence. Au sujet de cette dernière, P. Cabestan rappelle qu’une idée fondamentale comme la contingence doit être soulignée. Elle donne à l’existence, chez Sartre un caractère singulier. En effet, rappelant l’épisode de l’absence de Simmonot dans Les Mots, il montre que ce sentiment doit trouver un fondement philosophique :
« Cette notion de contingence est, avec la liberté, au cœur de la conception sartrienne du sujet […]».[3] Or, une seconde idée fondamentale est exposée immédiatement après : l’intentionalité.
Il faut en effet indiquer que c’est d’abord dans l’atmosphère idéaliste et spiritualiste que le jeune Sartre est formé. La notion d’esprit est au centre d’une réflexion qui, auparavant, l’avait évacué. Quand Sartre intègre l’ENS, Léon Brunschvicg (1869-1944) lui fait face et incarne – bien que considéré comme un professeur « malin » – l’idéalisme français. Pour Sartre dans La Transcendance de l’Ego (1937), Brunschvicg est la voix d’un rationalisme intellectualiste « où l’effort d’assimilation spirituelle ne rencontre jamais de résistances extérieures. En effet, l’auteur des Âges de l’intelligence est considéré par Sartre et Nizan comme le chantre d’une philosophie d’ombres, sans aspérités, incapable de percevoir le réel, sans Histoire : en un mot, l’idéalisme brunschvicguien ne peut penser l’Homme et célèbre un esprit de classe que les bourgeois peuvent tranquillement penser mais qui ne dit rien du monde. Mais ce que Sartre combat précisément, c’est la conscience telle que l’entend son professeur. Comme le rappelle P. Cabestan[4], un article célèbre de Sartre, « Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl : l’intentionnalité » (1939), porte le fer dans le sein de l’idéalisme français :
« Nous avons tous lu Brunschvicg, Lalande et Meyerson, nous avons tous cru que l’Esprit-Araignée attirait les choses dans sa toile, les couvrait d’une bave blanche et lentement les déglutissait, les réduisait à sa propre substance. Qu’est-ce qu’une table, un rocher, une maison ? Un certain assemblage de “contenus de conscience“, un ordre de ces contenus. O philosophie alimentaire ! Rien ne semblait pourtant plus évident : la table n’est-elle pas le contenu actuel de ma perception, ma perception n’est-elle pas l’état présent de ma conscience ? Nutrition, assimilation. »[5]
Le premier reproche de Sartre qui consiste à déplorer un Esprit assimilant les choses aux idées se double, dans le même article, d’un second reproche : « la conscience que nous prenons des choses ne se limite point à leur connaissance. La connaissance ou pure “représentation“ n’est qu’une des formes possibles de ma conscience […]. »[6] Sartre fait ici référence à la « vie consciente » telle que la nomme Brunschvicg dans le premier chapitre de son Introduction à la vie de l’esprit (1905).
Dans cet ouvrage, Brunschvicg définit l’activité spirituelle. Celle-ci comporte deux moments successifs : « l’action de ce qui paraît en dehors de l’esprit lui-même et qui se traduit en moi par la représentation du dehors, – et l’action de l’esprit sur ce dehors, qui est mon action proprement dite. »[7] Ainsi, la représentation d’une chose dans le monde est conçue comme une série de tableaux, un contenu que je peux saisir en rentrant en moi-même. Par conséquent, je ne saisis pas directement le monde parce que je ne puis, précise Brunschvicg, sortir de moi-même sans cesser d’être moi : « Le monde qui est connu est en moi ; s’il était absolument extérieur à moi et en tant qu’absolument extérieur, il ne pourrait être connu. »[8] La conclusion que tire Brunschvicg de cette affirmation est relativement grave car le philosophe va jusqu’à donner le même statut à la représentation imaginaire – l’hallucination – et à la représentation effective d’un objet.

La conscience se sert de ses états intérieurs pour connaître ce que nous appelons des objets. Si toute représentation du monde extérieur se constitue de faisceaux d’états de conscience, il faut que ces faisceaux s’organisent entre eux, que les différentes images qui se succèdent dans la conscience fusionnent ou se juxtaposent afin de former la représentation d’une donnée ou, pour ainsi dire, la donnée elle-même. Fort de cette double opération de fusion et de juxtaposition, Brunschvicg peut ainsi passer de la représentation à l’idée par l’entremise de l’opération intellectuelle. Avec l’intervention de la réflexion s’opère une relation entre « les fragments d’images isolées, produit de l’abstraction, et les collections d’images, produit de la généralisation. »[9] Chez Brunschvicg, l’idée ou le concept c’est la relation. Une fois l’idée constituée, elle devient le centre fixe autour duquel évoluent les images qui s’y rapportent. Il y a plus : ce rapport, cette relation, est objet d’affirmation ; énoncer un concept, c’est juger, c’est-à-dire affirmer le rapport impliqué dans le concept. L’esprit ainsi conçu est un centre opératoire et ses opérations sont principalement synthétiques.
Derechef, on comprendra la déploration de Sartre :
« En vain, les plus simples et les plus rudes parmi nous cherchaient-ils quelque chose de solide, quelque chose, enfin, qui ne fût pas l’esprit ; ils ne rencontraient partout qu’un brouillard mou et si distingué : eux-mêmes. »[10]
Toute l’entreprise sartrienne sera de montrer que les choses ne peuvent se dissoudre dans la conscience car celle-ci n’est pas de même nature, elle n’est pas une chose qui contient des choses : il faut plutôt concevoir la conscience comme « un grand vent », transparente à elle-même et faisant face à la chose c’est-à-dire la passivité, l’opacité.
Dans cette perspective réformatrice, Sartre publie La Transcendance de l’Ego en 1937. Dans cet essai, il se consacre directement au fondement de sa psychologie phénoménologique : il se propose de « vider » le champ transcendantal de l’Ego. Cela signifie que si l’on s’accorde à dire que nos contenus de conscience, nos souvenirs, peuvent être – réflexivement – des objets pour la conscience, il n’existe pas pour autant de « Je » unificateur, l’Ego transcendantal, qui précéderait ou maintiendrait toutes les activités de la conscience. Sartre fait observer que nous pourrions en effet saisir ce « je » en proclamant « c’est moi qui » mais cela ne veut pas dire nécessairement que cette unité appréhendée par la conscience précède et rende possible cette dernière. Fort de sa lecture de Husserl, Sartre montre que la conscience intentionnelle joue un rôle capital dans l’unification du moi : « l’objet est transcendant aux consciences qui le saisissent et c’est en lui que se trouve leur unité […]. Il faut que les consciences soient des synthèses perpétuelles des consciences passées et de la conscience présente. »[11] C’est donc par un jeu d’intentionnalités « transversales » entendues comme rétentions, que la conscience s’unifie elle-même. Par conséquent, la nature du « Je pense » kantien devant accompagner toutes nos représentations est une illusion. Si le « moi » doit être quelque chose, il n’est le sens que je donne à la multiplicité des actes intentionnels. Par nature, la conscience sartrienne n’est rien, son caractère est d’être impersonnelle, le « moi » n’étant qu’une sorte de symbole ou d’objet construit réflexivement. C’est que Sartre veut montrer le piège dans lequel tombe la conscience, piège que toute La Transcendance de l’Ego se propose de décrire et d’illustrer. Comme le souligne P. Cabestan, nous comprenons aisément le titre de l’ouvrage : « dès lors Sartre peut soutenir la thèse […] selon laquelle l’ego n’est ”ni formellement ni matériellement dans la conscience.” mais il est hors de la conscience à l’instar de n’importe quel objet transcendant comme cet arbre ou ce stylo.»[12] Ainsi débarrassé de l’Ego, réduit au statut d’objet psychique a posteriori, Sartre peut conclure que « la conscience transcendantale est une spontanéité impersonnelle. Elle se détermine à l’existence à chaque instant, sans qu’on puisse rien concevoir avant elle. »[13] La distinction entre conscience irréfléchie – qu’il appelle aussi conscience absolue – et conscience réflexive ainsi faite, Sartre indique l’un des fondements capitaux de sa pensée qu’il approfondira dès l’introduction de L’Être et le Néant.
C’est précisément dans L’Être et le néant – sur lequel P. Cabestan revient avec précision, insistant notamment sur le rôle de l’introduction trop souvent négligée[14] – que, chez Sartre, la liberté trouve sa plus forte assise philosophique. Si le mouvement de la conscience est pure extériorité, il en est de même pour la liberté, exercice d’objectivation du sujet dans le monde. Nous sommes heureux que P. Cabestan rappelle comment Sartre se distingue de Bergson sur ce point en dénonçant, chez ce dernier, « cette conception rassurante d’une liberté qui engendre ses actes comme un père ses enfants et qui manque alors la véritable ”donnée immédiate” de notre liberté »[15]. Il est utile de préciser comment, sur ce point, P. Cabestan prend la peine de mieux circonscrire la notion de liberté chez Sartre dont l’angoisse est le principe[16], en questionnant ses prétendues démesures et limites. Après avoir rappelé que la liberté se confondait avec le choix, il se pose un problème de taille, une objection majeure : « le choix peut-il être inconditionné s’il répond à une motivation involontaire ? Peut-on soutenir qu’on choisit de haïr, […] d’avoir peur […] ? »[17] Comme l’indique ensuite l’auteur, « le caractère involontaire de ce qu’on dénomme les passions de l’âme peut-être de même dissipé »[18] et P. Cabestan de se référer à l’excellent petit ouvrage de Sartre : Esquisse d’une théorie des émotions (1939).
En usant de l’outil phénoménologique, Sartre va montrer que l’émotion est une forme organisée de l’existence humaine et qu’elle est le tout de la réalité humaine en tant que la conscience « se ”dirige-émue” vers le monde ».[19] Si l’émotion comme fait apparaît inhumaine, il s’agit pour le phénoménologue, conscient que l’émotion est avant tout signifiante, de dévoiler le signifié. Il s’agira d’interroger le sens de l’émotion. Sartre s’emploie d’abord, avec une rapidité se doublant d’une extraordinaire efficacité, de souligner l’insuffisance des théories psychologiques classiques de son époque ainsi que celle de la théorie psychanalytique. C’est qu’il faut en finir avec l’omniprésence de la conscience réflexive et les mauvaises habitudes de l’idéalisme ! Chez James ou Janet, l’émotion est toujours conçue réflexivement comme un état de conscience. Mais la peur, nous dit Sartre, n’est pas « originellement conscience d’avoir peur »[20] : la conscience émotionnelle est irréfléchie, elle est d’abord conscience du monde, elle revient sur l’objet qu’elle vise pour s’en alimenter. Bref, le sujet ému est indissociable du sujet émouvant. Sartre explique que l’émotion, comme l’acte d’écrire – qu’il prend pour exemple – n’est ni réflexif ni une habitude : l’acte d’écrire est un acte semblable à d’autres actes eux-mêmes semblables à d’autres besoins ou d’autres désirs qui constituent notre monde. Et ce monde est difficile car il est parsemé d’obstacles. L’originalité de Sartre est de montrer que la difficulté du monde n’est pas une notion obtenue réflexivement mais elle est le sens vécu de ce monde, le corrélatif noématique de tout acte. Dès lors, on comprendra ce qu’est une émotion : lorsque les chemins que le monde propose sont trop difficiles ou impossibles à emprunter, nous essayons, pour agir, de changer le monde « c’est-à-dire de le vivre comme si les rapports des choses à leurs potentialités n’étaient pas réglés par des processus déterministes mais par magie ».[21] À partir de La Transcendance de l’Ego et plus encore grâce à l’Esquisse d’une théorie des émotions, nous comprenons que la conscience existe toujours selon un mode intentionnel particulier ; elle est toujours motivée, se laisse embarquer par le monde qu’elle habite de manière originale. La conscience, toujours située, s’embarque dans le monde mais s’en empare pour le réaliser singulièrement selon une conduite qu’elle choisit.
Ce mode immédiat d’appréhension du réel et qui situe la conscience en la déterminant est ce que Sartre appelle justement « situation ». Pourtant, l’une des premières définitions de ce concept important est présente dans L’imaginaire, ouvrage dont P. Cabestan souligne, à juste titre, l’importance et la qualité[22], et qui se propose de dévoiler la structure de la conscience en tant qu’elle se rapporte à l’irréel. Sartre décèle, dans les théories de l’imagination qu’il critique dans L’imagination, une erreur permanente qui consiste à considérer les images – envisagées telles des contenus de conscience – comme des choses qui se donneraient à la conscience. Sartre, dans L’imaginaire, montre que l’image n’est pas un objet : il y a une différence d’épaisseur, une différence qualitative entre l’objet et l’image ; la richesse de l’objet est sans fond alors que l’image est mince, donnée toute entière lors de son avènement. Percevoir signifie rencontrer une donnée présente et qui me résiste ; imaginer, fonction symbolique, consiste, en une observation qui ne m’apprend rien que je ne connaisse déjà, à rendre présent un irréel. La fonction imageante nous fait découvrir pour la première fois un concept important chez Sartre : la néantisation. Pour imaginer, il faut rejeter ce qui est présent devant soi pour y substituer une conduite imaginaire : en d’autres termes, il s’agit d’isoler l’objet imaginaire du monde présent et, du même coup, supprimer un instant sa propre présence au monde. Former des images suppose deux mouvements qui consistent à néantiser le monde et se néantiser. Dès lors, la fonction imageante conçue comme processus de néantisation dépasse de loin la seule question de l’imagination : si cette dernière suppose la néantisation, alors il faut que la conscience puisse être capable d’une telle opération et cette capacité vient de sa nature même qui est d’être liberté. Pour Sartre, on imagine toujours situé ; la conscience est tournée vers le monde, rencontre une situation qu’elle dépasse et en fonction de laquelle elle imagine.
La néantisation, notion capitale de l’imaginaire est au cœur de L’Être et le néant, que P. Cabestan présente avec beaucoup de netteté pour qui voudrait se lancer dans l’aventure passionnante que constitue la lecture de cet ouvrage imposant. Cette présence du néant et son rôle déterminant, qui aura fait dire au grand Lavelle que la liberté sartrienne était une « expression cruelle de l’époque »[23], P. Cabestan lui consacre un paragraphe : il explique en quelques lignes selon quelle modalité il y a du néant dans l’être. Pour cela, l’auteur reprendra l’exemple d’absence de Pierre. Du cogito préreflexif au libre projet, P. Cabestan retrace avec une incroyable puissance synthétique la première partie de la pensée de Sartre que cet ouvrage constitue. En effet, L’Être et le néant est bien une épopée du sujet. Ce que la conscience irréfléchie saisit dans son surgissement c’est un en-soi, une présence qu’elle distingue devant elle et qui n’est pas elle. Par conséquent, pour qu’une distinction s’opère entre ces deux modes d’être, il faut qu’une distance s’établisse entre le pour-soi et l’en-soi et c’est précisément le néant qui est cet intervalle. En saisissant son objet, la conscience, portée vers lui, le néantise en tant qu’elle le surmonte pour s’en distinguer. Le néant, l’opération de néantisation que le pour-soi introduit dans son rapport à l’en-soi, c’est précisément un décalage immédiat, un refus spontané de se confondre avec l’être massif, l’en-soi. Pour être plus précis, on doit considérer le néant non pas comme un non-être absolu – dans ce cas, l’être et le néant disparaîtraient – mais comme le contradictoire de l’être. Le pour-soi est donc un néant d’être : on comprendra que, au plan existentiel, l’autre nom du pour-soi est la liberté. C’est ici le cœur de la pensée du premier Sartre : la liberté est le tout de la Réalité humaine. L’essence de la liberté est de se dégager de l’en-soi comme proclamation de son indépendance. L’en-soi ne détermine ou ne surdétermine pas le pour-soi, mais c’est le pour-soi qui se détermine librement par rapport à l’en-soi en le néantisant. Ainsi, la manière d’être du pour-soi, c’est l’existence : en se déterminant toujours, le pour-soi fait valoir la suprématie de l’existence sur l’essence, c’est-à-dire que le projet du pour-soi est de se faire, de se constituer librement : l’être humain n’est pas quelque chose mais il existe, il est un être à réaliser. Puisque le pour-soi surgit, il est libre et responsable[24]. Une telle liberté qui ne peut jamais s’annuler, condamnée à se faire, ne peut que faire surgir en son sein l’angoisse. En nous ressaisissant comme seul acteur de notre liberté, nous éprouvons, selon Sartre, un vertige qui en est constitutif : la liberté s’angoisse d’elle-même, de son indétermination, du futur qu’elle engage en se déterminant. Seul responsable de son avenir, l’être du pour-soi est l’angoisse de ce qu’il a à être. Évidemment, face à cette liberté constitutive de soi, je peux chercher à fuir ma responsabilité, à me définir à partir de l’objet.
C’est dans le rapport à autrui que Sartre illustre le mieux cette tentative de fuite du pour-soi vers l’en-soi, et que P. Cabestan rappelle[25], sans oublier de faire référence à la fameuse sentence de Huis Clos (145). En effet, Sartre nous demande de considérer la situation suivante : « Imaginons que j’en sois venu, par jalousie, par intérêt, par vice, à coller mon oreille contre une porte, à regarder par le trou d’une serrure. »[26] Cette situation décrit le pour-soi, seul, absorbé dans son observation ; la conscience se confond avec ce qu’elle a à faire : hors de question pour l’individu de penser réflexivement les motifs qui le poussent à observer ce qui se passe à travers le trou de la serrure. Or, voici que quelqu’un surgit dans le couloir : j’ai honte et cette honte joue un rôle presque identique à celui de l’angoisse : j’ai eu conscience de moi à travers le regard d’autrui qui vient de me surprendre. Tout se passe comme si autrui m’avait volé mon « objet-moi », il m’empêche de faire retour sur moi, il vole à ma conscience réflexive mon « moi » en tant qu’objet psychique. Ainsi « autrui est d’abord pour moi l’être pour qui je suis objet, c’est-à-dire l’être par qui je gagne mon objectivité ».[27] Face à cela, j’ai à adopter une conduite : ou bien la honte119 m’amènera à assumer ce que je suis pour autrui ou bien je chercherai à fuir ma honte – comme je fuirais mon angoisse – en faisant preuve de mauvaise foi. Par exemple, je m’efforcerai de trouver à mon acte des justifications en dehors de ma propre liberté. À ce sujet, Lavelle commentant Sartre, écrit très justement que : « […] la mauvaise foi ou ce qu’on appelle de ce nom naît quand on transporte sur le plan théorique, où le réel est considéré comme déjà donné, cet être qui n’a de subsistance que sur le plan pratique, c’est-à-dire dont l’être est de se faire, et qui tente vainement de transformer en donné l’acte même par lequel il se fait ».[28] Ainsi, j’étoufferais ma honte au regard d’autrui comme j’étoufferais mon angoisse pour fuir la responsabilité inhérente à ma liberté car « je puis en effet vouloir ”ne pas voir“ un certain aspect de mon être que si je suis précisément au fait de l’aspect que je ne veux pas voir ».[29] Dans l’exemple de celui qui épie par le trou de la serrure, cet aspect, c’est précisément le voyeur que je suis pour l’autre.
Dès lors, on voit comment la relation de l’Homme au monde est, au fond, le rapport complexe entre le pour-soi et l’en-soi, entre la liberté et ce qu’elle dépasse ou ce vers quoi elle veut fuir en souhaitant se chosifier par mauvaise foi. Libre en situation, chacun d’entre nous n’a pas le choix : il doit se faire, quelque soit la conduite adoptée ; le rapport au monde, à autrui, donne à cette liberté une dimension concrète et vécue.
La philosophie, toujours : Histoire et liberté.
Em 1960, lorsque Sartre publie la Critique de la raison dialectique, il affirme de nouveau la singularité du mouvement philosophique qui est indubitablement dialectique. Plus important encore, P. Cabestan rappelle les mots de Sartre dans Situations X : « le champ philosophique, c’est l’homme »[30] ; proclamer cela en 1966 revenait tout simplement à déclarer la guerre au structuralisme, à Foucault, à l’éclectisme qui faisaient de l’homme au mieux un résultat, au pire un récent souvenir. C’est justement contre les prétentions éclectiques de Foucault que Sartre s’élève : « Si l’on admet comme moi, que le mouvement historique est une totalisation perpétuelle, que chaque homme est à tout moment totalisateur et totalisé, la philosophie représente l’effort de l’homme totalisé pour ressaisir le sens de cette totalisation. Aucune science ne peut le remplacer, car toute science s’applique à un domaine de l’homme déjà découpé. La méthode des sciences est analytique, celle de la philosophie ne peut être que dialectique. »237[31] C’est au nom même de cette distinction que Sartre ira même plus loin. Lorsqu’on l’interroge sur Les Mots et les choses, il répond en contestant la démarche archéologique de l’ouvrage pourtant voulue par Foucault. Pour Sartre, Foucault ne révèle pas l’essentiel, ne fait pas œuvre de philosophe : pour philosopher, distinguer ne suffit pas ; plus encore, l’éclectisme n’est pas philosophie : difficile pour les sciences humaines de penser l’impossibilité de l’Histoire dans la mesure où elles n’ont pas les outils pour penser sa possibilité. De ce point de vue, la Critique était attendue : elle contribue à maintenir la singularité de la démarche philosophique dans le champ intellectuel.
La Critique, ce grand essai d’anthropologie philosophique, rappelle que l’homme n’est pas mauvais par nature mais qu’il peut le devenir, confronté comme ses semblables à la rareté. C’est ici que P. Cabestan rappelle judicieusement le caractère contestable de cette notion : Aron en déplore le caractère factuel quand Sahlins montre qu’elle n’existait pas dans les sociétés paléolithiques[32]. Quoi qu’il en soit, dans la pensée de Sartre, la lutte des classes et les mécanismes d’oppression sont, comme le souligne l’auteur, incompréhensibles sans la rareté. C’est par elle que l’Histoire trouve son origine dans la matière que l’homme travaille et transforme, dans la matière ouvrée qu’il produit. Plus encore, il faudrait parler de la rareté comme le fondement même de la société humaine où il n’y en a pas assez pour tous. Cette rareté qui est contingente – elle varie selon les régions du monde – rend ainsi compte de l’existence du besoin car peu importe le degré de richesse d’une société, l’ensemble des richesses reste en deçà du besoin de chacun de ses membres : « Tout se découvre dans le besoin : c’est le premier rapport totalisant de cet être matériel, un homme, avec l’ensemble matériel dont il fait partie. »[33] Le besoin, qui cherche à combler, est la forme du pour-soi c’est-à-dire de la liberté qui nie le manque. Mais cette liberté est d’emblée aliénée lorsque s’engage l’action – la praxis – pour combler le manque. Il faut comprendre que l’action humaine est l’unification d’une matière inerte, c’est-à-dire d’un objet portant la marque de l’homme. Le résultat de la praxis, Sartre le nomme pratico-inerte ou « forme passivisée de l’activité » : plus précisément, il s’agit des différentes formes que la matière ouvrée par l’homme peut prendre. Un passage du premier livre de la Critique, ressaisit avec un génie synthétique qui force l’admiration, le processus d’aliénation de la liberté dans la matière organique et l’émergence du pratico-inerte. P. Cabestan souligne ce passage, celui des paysans chinois qui, en quête de terres arables, déboisent la forêt. C’est là sans doute le point le plus important de l’œuvre, quand s’opère la « métamorphose de la liberté en nécessité »[34] En effet, les hommes engagent des moyens pour réaliser leur projet d’obtenir de nouveaux espaces de culture et ne saisissent que la pleine positivité de la fin poursuivie : conquérir le sol et cela, depuis des siècles. Mais toute l’entreprise de Sartre est de montrer comment la praxis des chinois « s’inscrit dans la Nature, positivement et négativement ».[35] Elle est positive en ce qu’elle vise à rendre les terres arables mais elle est négative en ce qu’elle abat les arbres. Mais cette absence d’arbre n’est nullement perçue par les Chinois car, écrit Sartre, « ils n’avaient pas d’yeux pour ce manque qui n’était pour eux, au plus, qu’une libération, que l’élimination d’un obstacle ».211 C’est ainsi qu’une conséquence de la praxis échappe aux paysans pour se retourner contre eux ; les arbres n’étant plus un rempart contre le limon, ce dernier s’accumule dans le fleuve pour le faire déborder. Les inondations, retournement non prévu de la praxis contre elle-même, que Sartre appelle contre-finalité, forcera les Chinois à réengager des moyens pour en finir avec les caprices du fleuve. Mais les paysans, a posteriori, ne saisissent pas qu’ils sont responsables des inondations. En effet, la Nature ayant matérialisé leur praxis – en son versant négatif – depuis des siècles, les inondations leur apparaissent comme appartenant au radicalement autre. Bref, le travail ou même l’artefact, échappe à son auteur dans la mesure où il aboutit toujours à sa matérialisation c’est-à-dire « une caricature matérielle de l’humain ».214 Chargée de significations nouvelles, cette caricature s’impose aux hommes comme une fausse nature dont ils sont à la fois la libre cause et les prisonniers.
Cabestan, dans la partie de son ouvrage consacrée à la Critique, rappelle avec limpidité le passage à la série puis à cet impensable libre praxis du groupe que Sartre nommera « groupe en fusion »[36]. Dans ce monde du pratico-inerte, les choses exigent de nous ; ce que nous fabriquons devient autre, gagne en indépendance pour se faire excédentaire en significations. Ainsi, ces objets ou totalités ont une influence indéniable sur l’organisation de la vie des hommes, les orientent, les structurent en collectifs. Sartre nomme ce rapport structurel homme-objet, externe-interne, la sérialité: elle désigne les collectifs, les rassemblements passifs d’individus appelés séries : le collectif reçoit son unité de l’objet qui les rassemble et nie la véritable réciprocité des hommes alors rassemblés. Par conséquent, il faut bien distinguer la série du groupe: le second, actif, sous-entend une certaine communion des libertés, ce qui n’est pas le cas de la première qui rassemble les hommes du dehors.

Pour clairement définir la série, Sartre convoque un exemple concret, celui d’un rassemblement à l’arrêt d’autobus. La sérialité fabrique des masses, des rassemblements anonymes appelés par l’objet, conditionnés par lui. Sous le règne de la sérialité, chacun est le même que l’autre, les hommes sont interchangeables, identiques : des usagers trouvent une raison extérieure – l’autobus – à leur rassemblement ; l’objet « autobus » maintient les usagers dans leur isolement en tant que seul motif de rassemblement. La sérialité est le lit de tous les conformismes, de toutes les manipulations, de toutes les oppressions. Au moment où les hommes se retrouvent inéluctablement devant l’impossibilité de continuer de vivre dans des conditions données, ils ressentent cette impossibilité comme impossible à pérenniser, à accepter. Le règne de la sérialité se voit ainsi menacé : l’homme se retourne contre le champ pratico-inerte, devenu une sorte de nécessité ou de destin dont il s’aperçoit qu’il l’a réduit à l’impuissance. C’est le moment où la dialectique de l’aliénation, la dialectique de la rareté s’inverse pour se faire antidialectique : le moment du rassemblement des libertés surgit. P. Cabestan revient alors sur le célèbre passage de la prise de la Bastille, moment que Sartre dénomme « l’apocalypse »[37]. Pour illustrer ce moment dans lequel la liberté se reprend, Sartre examine « les caractères immédiats d’un groupe en fusion, c’est-à-dire, par exemple, de Paris en 89 de la population du quartier Saint-Antoine les 13 et 14 juillet […]. »[38] Le groupe a un but : se battre et sauver Paris. Chacun, malgré la panique et le désordre, aspire à former une unité. Il y a plus : celui-là même qui se sent séparé du groupe est appelé par ce groupe en ce qu’il lui manque. Dans ce moment de fusion, le regroupement en marche est pour chacun un motif d’accroissement : « il est pour chacun un ensemble à totaliser et un groupe à accroître par sa propre présence ; et, par lui justement, chacun saisit le mouvement du tiers qui lui fait face comme son propre mouvement et comme l’accroissement spontané du groupe dont il va faire partie ».227 Qu’est-ce à dire, si ce n’est que « l’action du groupe est nécessairement neuve, en tant que le groupe est une réalité neuve et son résultat est une nouveauté absolue. Le peuple a pris la Bastille ».228 On comprendra que le groupe en fusion n’est pas un ensemble dirigé par une seule liberté, il n’est pas lui-même une supra-liberté ; je ne suis pas non plus dans le groupe un objet manipulé par d’autres mais bien plutôt celui qui se fait la liberté de tous en même temps que la liberté de tous est ma liberté. Le groupe, c’est « la praxis commune devenant en un tiers régulatrice d’elle-même chez moi et chez tous les autres tiers dans le mouvement d’une totalisation qui me totalise avec tous. Cette régulation totalisante, je ne peux la reconnaître pour telle que dans la mesure où mon action est la même chez le tiers totalisateur […]. »[39] Ce sommet dans la libre communion qu’est le groupe, exigera de ses membres ce que Sartre appellera le serment afin de sceller le groupe et de retarder au maximum le retour de la nécessité du pratico-inerte. De ce serment découle la fraternité-terreur, mode d’être du groupe dans lequel chacun donne le droit à l’autre de le punir ; cette idée prend tout son sens lorsque Sartre évoque le régime politique issu de la Révolution : une démocratie. C’est-à-dire qu’elle se donne le droit d’anéantir quiconque menace de retomber dans la sérialité. Mais l’énergie du groupe retombera – une fois les objectifs atteints – dans le règne de la sérialité.
En décrivant ce moment de l’Histoire qui est l’Histoire elle-même, Sartre fait de l’aventure de l’homme historique une suite de contractions dialectiques dans lesquelles, parfois, les libertés se réalisent et parviennent à s’arracher à l’inerte. Avec la Critique, Sartre ne propose pas un système mais bien une anthropologie philosophique en acte. Il s’agit pour lui de déployer une pensée vivante, c’est-à-dire non pas décrire mais penser dialectiquement. Avec cette œuvre proprement magistrale, arme redoutable contre tous les antihumanismes et les déterminismes faciles, Sartre ne se fait pas le penseur de la violence ou de la révolution : on ferait erreur en orientant politiquement la Critique. Il s’agit de voir dans cette somme étourdissante, géniale, une philosophie de l’Histoire c’est-à-dire une conquête répétée de la libération.
Une psychanalyse existentielle
L’épopée sartrienne s’achève en psychanalyse existentielle. Peu d’ouvrages traitent de cette partie de l’œuvre de Sartre, la contribution la plus notoire étant celle de M. Moati avec son récent Sartre et le mystère en pleine lumière. La psychanalyse de Sartre se fonde en partie sur la critique émise dans l’Esquisse d’une théorie des émotions : Les psychanalystes entendent bien l’émotion comme une organisation synthétique de conduite mais celle-ci n’a pas son origine dans la conscience : les émotions sont guidées, utilisées par des tendances inconscientes ; les psychanalystes interprètent l’émotion consciente comme la réalisation symbolique d’une désir refoulé par la censure. Sartre fait remarquer que nous n’avons pas conscience de ce désir car sinon, nous serions de mauvaise foi. Par conséquent, le signifié se voit littéralement coupé du signifiant : ce dernier, le fait de conscience censuré, apparaît comme une chose par rapport à sa signification. Pour Sartre, cette conclusion est problématique : on ne peut admettre que la conscience se constitue en signification sans être consciente de la signification qu’elle constitue. Si elle possède une signification, elle doit la contenir en elle comme structure de conscience. Tout ce qui se passe dans la conscience doit recevoir son explication de la conscience elle-même. Si la conscience organise l’émotion comme une réponse à une situation, comment se fait-il qu’elle n’ait pas conscience de cette adaptation ? Pourquoi cherche-t-on à contrôler nos émotions ? On voit bien que Sartre, dans cette critique souvent raillée, se montrait plus que réservé à l’égard de la psychanalyse. Au sujet de celle de Sartre, très originale, P. Cabestan donne avec une grande clarté, les quelques principes qui la fondent. Il rappelle tout ce que cette idée doit à Pascal, se référant ainsi à la fin de L’Être et le néant : si, contrairement à Pascal, les formes du divertissement ne tentent pas de masquer la misère de l’homme sans Dieu, elles tentent d’étouffer le « désir d’être Dieu, désir de l’en-soi-pour-soi »[40]. Mais le principe d’unité reste, pour Sartre, insuffisamment dégagé et défini. Quel est donc ce moi dont on serait tenté de se détourner et de le définir naïvement à partir de multiples attributs ? Pour Sartre, il est un choix originel que traduisent toutes les conduites particulières : « La personne est en ce sens comparable à la substance spinoziste ‘qui s’exprime toute entière dans chacun de ses attributs’».[41]
Appliquée aux écrivains, la psychanalyse existentielle doit « dégager le projet originel du sujet par rapport auxquels ses autres projets sont secondaires et dérivés ».[42] Au passage, on lira avec une certaine délectation quelques interprétations téméraires et sans doute hâtives de Sartre sur Baudelaire ou Mallarmé. C’est justement sur ce dernier que P. Cabestan se penche, croisant dans sa courte étude, les spectres de Baudelaire et de Flaubert. On regrettera peut-être la trop petite place faite à l’Idiot de la famille, œuvre à laquelle est réservée la fin de l’ouvrage et dont l’essence est restituée avec brio. Dans cet ouvrage monumental, le « couronnement de l’œuvre sartrienne »[43], la démarche de Sartre emprunte aussi bien à L’Être et le néant qu’à la méthode déployée dans la critique de la raison dialectique. Dans Question de méthode, Sartre avait défini cette méthode : elle doit être d’abord progressive en exigeant que l’histoire nous expose les faits dont elle est constituée, et en même temps régressive, c’est-à-dire déterminant les conditions de ces faits. Pour comprendre l’application de cette méthode, Sartre prend l’exemple de Robespierre :
« Nous connaissons déjà la biographie de Robespierre en tant qu’elle est une détermination de la temporalité, c’est-à-dire une succession de faits bien établis. Ces faits paraissent concrets parce qu’ils sont connus avec détails mais il leur manque la réalité puisque nous ne pouvons encore les rattacher à un mouvement totalisateur. »[44]
Il s’agit donc, à l’aide d’une « herméneutique existentielle » de saisir le projet existentiel de Flaubert à l’origine de l’histoire-Flaubert. A la fin de son paragraphe sur la psychanalyse, P. Cabestan ne manque pas de se demander malicieusement si, l’existence ainsi soumise à des conditionnements diverses, ne voit pas sa liberté significativement réduite.
Conclusion
Avec cette Philosophie de Sartre, Philippe Cabestan signe un ouvrage indispensable. En plus des œuvres les plus travaillées du corpus sartrien, il présente aussi des œuvres aussi célèbres que Réflexions sur la question juive ou le Saint Genet, il jette la lumière sur le rapport intéressant que Sartre entretenait avec les arts plastiques (on pourra penser à la grande culture musicale du philosophe, lui même pianiste, et dont il avait fait état dans l’ancienne revue Obliques), il n’hésite pas non plus à éveiller la curiosité du lecteur en évoquant des pages plus connues des spécialistes comme pour le cas de Guillaume II qui, dans Carnets de la drôle de guerre, pose les premiers jalons de la psychanalyse existentielle.
Bref, dans les deux grandes parties de son livre, P. Cabestan offre à un large public, avec un grand talent, les moyens d’entrer plus profondément dans l’œuvre d’un philosophe majeur. On ne saurait que trop remercier l’auteur pour ce petit livre qui obéit à l’injonction de Sartre, selon laquelle on ne peut dépoussiérer une œuvre qu’à la condition de s’y donner : avec l’ouvrage de P. Cabestan, les œuvres Sartre ne ressemblent pas encore aux petites urnes d’un columbarium. Nous voudrions bien que les mânes de l’infatigable philosophe, bien des fois tourmentées, trouvent un peu de paix dans ce petit ouvrage.
[1]Philippe Cabestan, La philosophie de Sartre, Paris, Vrin, 2019, p. 13.
[2]La Philosophie de Sartre, p. 23-24.
[3]Ibid., p. 27.
[4]Ibid., p. 31.
[5]« Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl : l’intentionnalité », p. 31.
[6]Ibid., p. 34.
[7] Introduction à la vie de l’esprit, p. 4.
[8]Ibid., p. 6.
[9]Ibid, p. 21.
[10] « Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl : l’intentionnalité », p. 31-32.
[11]La Transcendance de l’Ego, p. 22.
[12]La Philosophie de Sartre, p. 34.
[13]La Transcendance de l’Ego, p. 79.
[14]La Philosophie de Sartre, p. 136.
[15]Ibid., p.40.
[16]Ibid., p. 139.
[17]Ibid., p. 42.
[18]Ibid., p. 43.
[19]Esquisse d’une théorie des émotions, p. 23.
[20]Ibid., p. 70.
[21]Ibid., p. 79.
[22]La Philosophie de Sartre, p. 134.
[23]De l’Être, Introduction, 1947.
[24]La Philosophie de Sartre, p. 145-146.
[25]Ibid., p. 143.
[26]L’Être et le néant, p. 317.
[27]Ibid., p. 329.
[28]De l’Être, introduction, p. 32.
[29]L’Être et le néant, p. 82.
[30]La Philosophie de Sartre, p. 55.
[31]L’ARC, n°30, p. 95.
[32]La Philosophie de Sartre, p. 61.
[33]Critique de la raison dialectique, p. 166.
[34]La Philosophie de Sartre, p. 64.
[35]Critique de la raison dialectique, p. 232.
[36]La Philosophie de Sartre, p. 165.
[37]Ibid., p. 165.
[38]Critique de la raison dialectique, p. 415.
[39]Ibid., p. 424.
[40]La Philosophie de Sartre, p. 77.
[41]Ibid., p. 78.
[42]Ibid., p. 147.
[43]Ibid, p. 171.
[44]Critique de la raison dialectique, p. 86.








