La première partie de la recension se trouve à cette adresse.
D : L’inertie des significations et du langage
On peut certes questionner ce sens de fondement absolu donné au projet dans l’Être et Néant. Par exemple : le projet conditionne-t-il vraiment l’affectivité ? Ne peut-on pas contre Sartre et avec Henry ou Richir distinguer plusieurs niveaux dans la compréhension de l’affectivité (l’affectivité, l’émotion, le sentiment[1]) ? Considérer que le projet lui-même se déploie au sein d’une opacité plus profonde du rapport de soi à soi ? Est-il à ce point unifié, affirmé, marqué ? Le terme de projet est-il finalement nécessaire ? Suis-je une recherche ? Une question ? Une surprise ? Un rythme que j’impulse aux formes que j’emprunte ou un vide, un écho qui les traverse, y instille des processus de métamorphoses qui me sont opaques ?
Ces objections – plus tard adressées à Sartre par une philosophie française (Derrida, Deleuze, Foucault) cherchant à penser une singularité plus incertaine, furtive et tremblante – sont d’une autre manière assumées dans l’évolution de l’œuvre du philosophe, en particulier dans la Critique de la raison dialectique[2]. Sartre prend conscience de l’inertie non seulement des choses mais des significations et du langage avec tout ce qu’il comporte de pensée pré-organisée (ce que Flaubert appelle la bêtise). Pour prendre les termes de Moati, le langage est idéal, mais le discours n’en est pas moins une réalité, qui parle parfois sans moi dans ce que je dis, plus fort que moi. Le pratico-inerte[3] exerce des effets de retour sur le projet qui cherche à le dépasser et peut le faire dévier. Les mots que j’emploie finissent par me leurrer sur ce que je poursuivais, voire à transformer mon projet. Plus profondément, la liberté n’est donc pas souveraine et s’arrache toujours sur fond d’un pratico-inerte qui risque de la dévorer de l’intérieur.
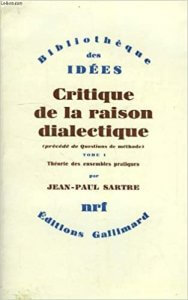
Dans cette même perspective, Sartre prend par ailleurs à travers la psychologie connaissance d’altérations possibles de la liberté elle-même, de pathologie affectant la possibilité même de l’être dans le monde, les modes d’attachement, d’implication de la conscience au monde. La question n’est donc plus celle d’une liberté absolue mais d’une individuation[4]. De la façon dont la liberté peut se regagner elle-même sur fond de tout ce qui la menace et la travaille. De ce que je peux faire de ce qu’on a fait de moi, et pourquoi pas, de la façon dont ce qu’on fait de moi me permet de trouver d’autres sens de mon projet.
E : La psychanalyse existentielle
Ces évolutions donnent peut-être aussi un sens plus concret à la psychanalyse existentielle et à ce qu’elle peut apporter. Mais il faut pour cela d’abord revenir à la description qu’en fait Sartre. En quelle mesure parler de psychanalyse, comment comprendre le passage par l’intervention d’un tiers, s’il n’y a pas d’inconscient auquel un autre devrait donner sens ? Le point est que le projet est certes vécu dans la translucidité mais par la même non connu. Je me vis comme projet mais ne peux sortir de cette adhérence pour comprendre la façon dont le projet conditionne mes actes, sous-tend et module toute ma relation au monde. Sans l’intervention d’autrui, il ne m’est donc pas possible de sortir du prisme que projette le projet sur le connaître. Mais à quelle méthode peut bien recourir l’analyste ?
Le postulat de Sartre est chargé. Le projet fondamental, rappelle-t-il, est bien la modalité première et unique selon laquelle mon existence est donnée à elle-même. Il marque toutes mes actions, toutes les manifestations de moi, de la manière dont je vis mon corps. Il constitue ma signature dans le monde, mon style, la modulation que j’apporte aux formes que je revêts, la vibration que j’impulse à mes habitus, l’empreinte dont mon existence marque l’en soi. Il signe donc aussi mon attitude empirique et peut en quelque sorte être lu de manière régressive à partir d’elle, à partir de ce que manifestent ma gestuelle, les inflexions de la parole, ma tenue, etc. Celles-ci peuvent guider le « psychanalyste » dans la recherche du thème commun que mes différentes activités « symbolisent ». Si un patient souffre de troubles d’identification, pourquoi s’identifie-t-il précisément à Napoléon plutôt qu’à César, et un certain aspect de la vie de Napoléon?
L’autre question évidemment est celle du but de cette psychanalyse. Quelle guérison ? Ce ne peut pas être de ne plus souffrir (la souffrance et la réceptivité à la souffrance est liée au projet) mais plutôt de se libérer du projet. Là encore, on pourra trouver un peu dramatique la façon dont Sartre fait d’un instant décisif de facture très kierkegaardienne la modalité de la « conversion » plutôt que d’ouvrir l’effectivité de la psychanalyse existentielle à un travail plus progressif de latences. Mais la façon dont est conçu le projet existentiel laisse peu de place aux transformations subtiles. On pourra se demander au nom de quoi inviter à cette transformation, de quel critère. Sartre qui est décidément un insupportable sophiste pense que sa charlatanerie permettra de se libérer de projets fondamentaux faisant de la mauvaise foi leur structure cardinale et de discriminer parmi nos attitudes fondamentales celles qui peuvent s’accommoder de l’authenticité.
La psychanalyse existentielle que Sartre tente au sujet de Flaubert récuse l’interprétation marxiste paresseuse faisant de celui-ci[5] un réaliste bourgeois banal (n’importe quel bourgeois n’est pas Flaubert). Mais plutôt que de comprendre l’œuvre de Flaubert comme l’expression d’un projet unique, elle tente d’analyser la façon dont Flaubert tout au long de sa vie ne cesse de se réapproprier les contraintes qui font sortir ce projet de ses gonds. Un thème la traverse certes : celui de l’irréalité. Flaubert n’a pas de place à prendre. Il souffre de n’être rien de déterminé, de son irréalité, de son manque à être, et choisi de l’assumer, de le revendiquer, d’abord en voulant être comédien. Elle répond à sa désunité intime mais l’expose à de nouvelles contraintes, liées à la structure même du monde littéraire. Flaubert déteste le réalisme, mais ne cesse non plus d’être hanté par la banalité quotidienne au sein de laquelle il devra injecter sa trace, son style comme effort permanent d’irréalisation. On pourrait sans doute prolonger ces analyses biographiques et thématiques par des considérations plus stylistes, étudiant la façon dont l’usage particulier que fait Flaubert des conjonctions, des enchainements, et juxtapositions, exprime l’irréalisation du concret.
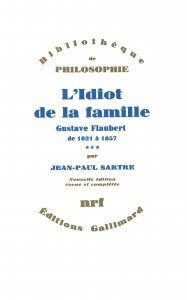
Conclusion
On soulignera à nouveau pour conclure le parallélisme profond de la démarche de Raoul Moati dans cet ouvrage et dans Evénements nocturnes[6]. Dans les deux cas, on l’a dit, il s’agit d’arracher un auteur à une grille de lecture qui ne fait pas justice au « projet fondamental » de sa philosophie, à chaque fois, en refusant de se laisser aveugler par une certaine grammaire phénoménologique, liée à l’usage du concept de phénomène. Chez Levinas, en prenant pour point de départ effectif la réalité de la rencontre d’autrui, en comprenant qu’autrui n’est en aucun cas quelque chose qui se phénoménalise, que je ne fais tout simplement pas l’expérience d’autrui d’une façon qui se laisse décrire en termes de phénomène, mais en m’adressant à lui et en l’écoutant. Ici de même, en montrant comment pour Sartre, la singularité n’est pas une simple forme, et comment la notion de projet ne conduit pas à une description phénoménologique abstraite et désincarnée mais à entrer dans la concrétude de la réalité humaine singulière de la conscience d’un humain précis.
Ces deux ouvrages mettent « en pleine lumière » des limites intrinsèques que la phénoménologie ne peut écarter par une simple extension du concept de phénomène. Evidemment – c’est la remarque de Renaud Barbaras à Raoul Moati – le concept de phénomène peut être élargi, dépris de la corrélation noético-noématique, de façon à ne plus faire écran à l’extériorité radicale qu’il révèle. Il peut l’être comme phénomène de monde (la physis s’arrachant à elle-même comme archi-événement, le phénomène est une dimension de la physis, ne fait pas écran à l’être mais appartient à l’être), ou au contraire en le déprenant de l’être vers un concept pur de phénomène (donation comme chez Marion, extériorité qu’aucun horizon, fût-il ontologique, ne mesure, ou phénoménalisation, comme chez Richir, épaisseur et opacité de l’expérience et de ce qui y sous-tend le rapport aux choses).
Mais aucun de ces élargissements ne répond à la difficulté que le terme de phénomène engendre quoi qu’il en soit par la perspective qu’il projette sur l’analyse phénoménologique. Passer par le phénomène conduit nécessairement à manquer tout ce qui de la réalité ne se laisse tout simplement pas appréhender en ces termes, à commencer la réalité individuelle d’une existence dans sa concrétude, sa socialité, le sens qu’elle prend pour elle-même.
La singularité de Sartre dans l’histoire de la phénoménologie est peut-être surtout liée à son lien à la littérature, et plus précisément au récit plutôt qu’à la seule description. Celui-ci pose en effet une question encore vive de nos jours. Si elle veut parler de la réalité et non seulement de la vérité[7], la philosophie ne doit-elle pas échapper à la limite que Barthes traçait entre elle et la littérature ? Si « la science est grossière, la vie est subtile, et c’est pour corriger cette distance que la littérature nous importe[8] », la philosophie ne doit-elle pas se déployer aussi hors du champ de la scientificité (même sous la forme réflexive de la philosophie transcendantale), se faire aussi narration et récit[9] ? N’est-ce pas sa seule option pour échapper au discours minimal et négatif dont Wittgenstein la laisse hériter ?
[1] Cf. Par exemple M. Richir, Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, Grenoble, Jérome Millon, 2006 ; Alexander Schnell, Husserl et les fondements de la phénoménologie constructive, Grenoble, Jérôme Millon, 2007.
[2] Cf. J.-P. Sartre, Critique de la raison dialectique, Paris, Gallimard, 1960.
[3] Cf. J.-P. Sartre, Critique de la raison dialectique, Paris, Gallimard, 1960.
[4] Cette question est très actuelle. Les sciences cognitives, en nous invitant à considérer la société comme le « milieu naturel » de l’humain, tendent elles aussi à renverser le problème classique de la relation entre individu et société. Il ne s’agit plus de comprendre comment un individu peut être socialisé, mais de déterminer ce qui amène l’être humain à se considérer et à agir comme un individu sans rester le jouet passif de sa socialisation. Cf. à ce sujet Laurence Kauffmann et Laurent Cordonier, « Vers un naturalisme social, A la croisée des sciences sociales et des sciences cognitives », SociologieS, 2011
[5] J-P. Sartre, L’idiot de la famille, Paris, Gallimard, 1971.
[6] R. Moati, Evenements nocturnes, Paris, Hermann, 2012.
[7] Cf. J. Benoist, Le bruit du sensible, Paris, Cerf, 2013.
[8] R. Barthes, Leçon inaugurale de 1977.
[9] C’est aussi la question que pose M. Ferraris dans Emergence, Paris, Cerf, 2018.







