Andrea San Giacomo, Professeur associé à l’Université de Groningen, propose dans ce livre en italien traduit en anglais une avancée décisive dans la conception adéquate du spinozisme. Ce dernier, longtemps assimilé à l’athéisme, l’acosmisme ou le matérialisme, a fait l’objet d’un grand malentendu depuis trois-cent cinquante ans. Andrea Sangiacomo en finit avec ces errements : le spinozisme est un panenthéisme non-dualiste.
 Le mot yoga vient du sanskrit « yuj », qui signifie « joindre ». Le yoga est l’union de l’esprit humain avec l’Absolu. Comment le spinozisme permet-il cette union ? Par une comparaison subtile avec le bouddhisme, les vedantas et le Tantrisme du Cachemire, Andrea Sangiacomo répond qu’il faut remédier à l’aliénation humaine due au problème de l’impuissance des appétits humains par l’Amour Intellectuel de Dieu. Ce dernier permet le rétablissement de la puissance d’agir quant au corps, à l’esprit et à la société. Son analyse du spinozisme est profondément vivante et pertinente.
Le mot yoga vient du sanskrit « yuj », qui signifie « joindre ». Le yoga est l’union de l’esprit humain avec l’Absolu. Comment le spinozisme permet-il cette union ? Par une comparaison subtile avec le bouddhisme, les vedantas et le Tantrisme du Cachemire, Andrea Sangiacomo répond qu’il faut remédier à l’aliénation humaine due au problème de l’impuissance des appétits humains par l’Amour Intellectuel de Dieu. Ce dernier permet le rétablissement de la puissance d’agir quant au corps, à l’esprit et à la société. Son analyse du spinozisme est profondément vivante et pertinente.
Nous en rendrons compte en suivant fidèlement l’ordre du texte.
L’analyse du spinozisme comme yoga accompagne sans doute le prélude du texte, la lettre dédicatoire. Andrea Sangiacomo y évoque le « vide impersonnel, dans le détachement total du monde », où « une étincelle prit feu ». Est-ce là une allusion à l’étincelle de l’âme de Maître Eckhart ou à la Vive flamme d’Amour de Saint Jean de la Croix ? Mystère. A moins qu’à travers l’expression « vibration profonde » Andrea Sangiacomo fasse référence au spanda des shivaïtes du Cachemire ? Double mystère.
I – Introduction : l’urgence et la désappropriation
Dans l’introduction, intitulée « Urgence et aliénation », l’auteur insiste sur le caractère essentiel pour l’humanité d’un amendement de l’entendement. Le Problème, avec un grand P, est « le fossé entre l’abondance de la puissance technique que l’humanité (ou plutôt une part d’elle) possède et l’incapacité à se connaître elle-même. » « L’animal humain » est en effet « largement conduit par les besoins, les instincts et les aspirations » qui sont « similaires à ceux des anciennes générations éteintes. » Il s’agit d’une « myopie » qui « nous rend incapables de voir au-delà de l’individualité finie, », et d’une « insensibilité qui nous coupe d’une expérience authentique de l’unité et de la compréhension du tout. » L’étroitesse d’esprit et l’égoïsme généralisés règnent dans notre société : individualisme, quand tu nous tiens.
Baruch Spinoza (1632-1677) offre sans doute une réponse psychologique et métaphysique à ce « Problème. » Dans une note de bas de page, Andrea Sangiacomo présente les buts du livre : « renouveler le débat sur les genres de connaissance, et en particulier sur l’Amour Intellectuel de Dieu », « établir un dialogue interculturel entre la philosophie spinoziste et la pensée indienne », montrer que l’Ethique est, par essence, « un guide pratique ayant pour but la transformation de la vie, de l’être, et de l’interprétation du monde » qui s’accorde avec les traditions yogiques.
Il se réfère, toujours en bas de page, à « La religion de Spinoza », de Clare Carlisle, qui défend une conception panenthéiste et non dualiste de la philosophie spinoziste : la religion n’est pas l’adhésion aux dogmes ou aux croyances, mais une vertu, une puissance, et une manière d’habiter le monde.
Contrairement aux yogas, selon lesquels la renonciation au monde permet de s’unir à la transcendance, et « au vide de l’Absolu », Spinoza voit la solution dans « l’augmentation de la puissance d’agir. » Le spinozisme est une manière de revisiter le yoga traditionnel. Tant le spinozisme que les yogas visent en effet à « déconstruire le sujet ». Pour le yoga, l’illusion est fondée « sur une peur infondée. » Il s’agit de faire l’expérience de la conscience pure, qui « n’est pas un objet », mais le fait même selon lequel il y a une expérience. Le yoga est aussi une pratique corporelle, comme dans le spinozisme.
Dans la conscience ordinaire, l’« attraction et la répulsion » deviennent « les forces fondamentales qui poussent l’individu à sa recherche précaire de stabilité, » ou à la défense de son identité. La cessation de ces forces permet « la forme suprême de la libération. » C’est la position de l’Advaita Vedanta. Le bouddhisme, lui, consiste à « défaire les structures fondées sur l’ignorance et l’oubli » métaphysiques, « sans essayer d’atteindre » un quelconque espace ou lieu.
L’approche du shivaïsme du Cachemire est privilégiée dans le livre. Il vise « l’intégration de l’expérience subjective dans l’expérience transcendante. » Pour le shivaïsme du Cachemire, la conscience doit « émerger pour une raison ». Il s’agit de dépasser la question de l’alternative entre transcendance et immanence. Le shivaïsme du Cachemire ne cherche pas à anéantir l’expression du multiple. Il reconnaît « la légitimité » « du champ entier de l’expérience. »
II – Chapitre 1 : le diagnostic spinozien : l’impuissance de l’appétit
Le fondement de la vie affective
Le fondement de la vie psychique humaine est le conatus. D’une part, « tout a une essence ». D’autre part, « une essence ne peut être en contradiction avec elle-même. » Le conatus, l’effort pour persévérer dans l’être, a pour but de « neutraliser » les « interactions avec les autres entités » lorsqu’elles pourraient le « diminuer, le nier ou l’endommager » Le fondement du conatus est l’appétit, c’est-à-dire la cupiditas, la cupidité. L’appétit peut être inconscient. L’homme n’est pas maître en sa maison. L’affection, de son côté, est la « manière dont est modifié le corps humain par un autre corps comme résultant d’une interaction causale ». L’imagination est donc « le premier guide » du conatus. L’esprit évite la tristesse et est attiré par la joie, toutes deux variations de ce dernier.
Liberté et substantialité du sujet
 De plus, la mémoire poussera le conatus à répéter la cause de la joie et à éviter celle de la tristesse. L’imitation régit l’essence de l’homme. L’imagination, en outre, nous fait croire que nous sommes libres et que nous sommes une substance. Or, la volonté est déterminée par les causes extérieures qui la régissent. Il n’y a pas, au fond, de volonté. Andrea Sangiacomo donne l’exemple de la glace au chocolat, avec un certain humour typiquement spinoziste. Je suis attiré par une glace au chocolat. « Tout ce que je sais, c’est que ressens de la joie » à son idée. J’imagine que cette joie naît librement de moi. Avec un peu d’expérience, je me rends compte que cette joie est bonne et entre en bonne composition avec moi si je consomme la glace au chocolat avec modération. La connaissance des lois régissant l’absorption de sucre en quantité trop importante « contredit le désir de consommer de la glace au chocolat. » Cette démarche convient aussi à la passion amoureuse. Spinoza, en outre, critique le dualisme cartésien pour des raisons ontologiques. L’homme n’est pas une substance, puisque la substance existe à un niveau supérieur à l’homme, et s’exprime en lui par l’appartenance à son expression via les attributs de l’étendue et de la pensée.
De plus, la mémoire poussera le conatus à répéter la cause de la joie et à éviter celle de la tristesse. L’imitation régit l’essence de l’homme. L’imagination, en outre, nous fait croire que nous sommes libres et que nous sommes une substance. Or, la volonté est déterminée par les causes extérieures qui la régissent. Il n’y a pas, au fond, de volonté. Andrea Sangiacomo donne l’exemple de la glace au chocolat, avec un certain humour typiquement spinoziste. Je suis attiré par une glace au chocolat. « Tout ce que je sais, c’est que ressens de la joie » à son idée. J’imagine que cette joie naît librement de moi. Avec un peu d’expérience, je me rends compte que cette joie est bonne et entre en bonne composition avec moi si je consomme la glace au chocolat avec modération. La connaissance des lois régissant l’absorption de sucre en quantité trop importante « contredit le désir de consommer de la glace au chocolat. » Cette démarche convient aussi à la passion amoureuse. Spinoza, en outre, critique le dualisme cartésien pour des raisons ontologiques. L’homme n’est pas une substance, puisque la substance existe à un niveau supérieur à l’homme, et s’exprime en lui par l’appartenance à son expression via les attributs de l’étendue et de la pensée.
Nous vivons en outre dans une forme de contradiction. Le désir est pris par Spinoza au sens strict. C’est l’effort du conatus pour répéter les circonstances de la possession d’une chose causant une joie, via la mémoire. La tristesse provient de l’absence de l’objet aimé (corollaire de la proposition 36 de la troisième partie). Il y a une « dissonance » dans l’esprit, une forme de contradiction interne du désir. Ainsi, nous sommes agités de bien des manières par les causes extérieures.
La puissance divine
Andrea Sangiacomo analyse ensuite la puissance divine. « Pour Dieu, sa puissance est son essence même. » Il ne peut en effet n’y avoir qu’une seule substance, et non pas deux comme le considère Descartes. « Dieu demeure le fondement immanent, mais aussi transcendant, de la totalité elle-même ». « Dieu et les modes » constituent deux ordres ontologiques de la réalité, reliés inextricablement, mais irréductibles. C’est pourquoi tout est en Dieu, et non pas tout est Dieu. Le spinozisme n’est pas un panthéisme, mais un panenthéisme (Proposition 1 de la première partie de l’Ethique). De plus, l’idée selon laquelle « l’existence et la non existence requièrent une cause ou une raison » constitue la principe de raison suffisante, pour reprendre la formule de Leibniz. Il est impossible que Dieu n’existe pas « parce qu’il est impossible de prouver sa non existence. » La puissance divine « s’actualise en une infinité de modifications déterminées ». Comment concilier le multiple et l’unité ? Par l’idée d’expression formulée par Spinoza. Par la libre nécessité de Dieu, Dieu s ‘exprime dans le multiple déterminé via les attributs de la pensée et de l’étendue. « Toutes les essences (malgré leurs différences) ont une existence en ce sens : « elles sont comprises » dans la nature de Dieu ou impliquées par celle-ci. »
Il est plus simple de justifier l’éternité que le devenir. L’expression est une manière de répondre à ce problème. Il y a « une transitivité ontologique par laquelle toutes les essences sont en relation avec chacune d’elles. » Elles forment « un réseau ou un certain ordre », ordo et connectio. La puissance n’est pas seulement l’essence de Dieu, elle s’articule à l’infinité des essences individuelles que sont les essences finies. (Proposition 16 de la première partie de l’Ethique). Dieu s’exprime à travers les modes infinis (l’intellect, le repos et le mouvement) et les modes finis (toutes les choses et les êtres.) En ce sens, les modes finis sont des manières de Dieu, comme le traduit Bernard Pautrat.
De même, dans le shivaïsme du Cachemire, Siva, l’absolu, bien qu’étant transcendant, est le principe qui produit toutes choses, par la Shakti, sa puissance. Il y a « différents degrés de réalité », mais les modes finis sont aussi réels.
Ainsi, « être une chose finie est être la puissance divine elle-même, en tant qu’acte qui se détermine » « selon ceci ou cela. » Le conatus est l’expression de l’infinie puissance d’agir de Dieu (définition 6 de la première partie de l’Ethique). Aussi le spinozisme se concentre sur la manière d’éteindre ou de faire cesser l’appétit, mais en l’orientant au profit d’un appétit plus fort encore, qui est l’Amour intellectuel de Dieu.
III – Chapitre 2 : La clef du salut : l’Amour intellectuel de Dieu
Les genres de connaissance
Classiquement, Andrea Sangiacomo analyse les trois genres de connaissance du conatus humain. L’erreur du premier genre de connaissance consiste non pas dans l’image en tant que telle, mais dans le fait de prendre l’image au sérieux sans y ajouter d’autres idées, les propriétés communes du deuxième genre de connaissance. « L’imagination a une force remarquable parce qu’elle part des représentations concrètes des individualités spécifiques. »
Dans le deuxième genre de connaissance, les « propriétés communes ont une clarté épistémique que les images des affections ne possèdent pas. Il s’agit de rapporter les modes finis aux modes infinis que sont l’intellect quant à l’attribut pensée, et le repos et le mouvement quant à l’attribut étendue. Ainsi acquiert l’esprit une puissance supérieure à l’imagination. Mais la raison y « perd en concrétude ».
Le troisième genre de connaissance remédie à cela. Il « vise à fournir une connaissance adéquate de l’essence individuelle des choses. » « L’intuition ne procède pas par déduction », mais elle procède de manière immédiate et synoptique. Ainsi, l’extension n’admet aucune limite, et est ainsi éternelle. La force par laquelle chaque chose persiste dans l’existence suit de la nécessité éternelle de Dieu. (scolie de la proposition 45 de la deuxième partie de l’Ethique.)
Dans une note essentielle, Andrea Sangiacomo écrit : « Connaître une essence individuelle consiste à voir, immédiatement, dans le champ infini du pouvoir divin l’émergence d’une vague, une vibration, unique en elle-même, et pourtant faite du même matériau que toute chose, et pour cette raison précise capable d’exprimer le tout d’une unique manière. » On reconnaît là le spanda du shivaïsme du Cachemire. Le spanda désigne le mouvement spontané de la conscience divine. C’est ce battement primordial, cette vibration première, qui anime et produit l’univers, comme le Tao du taoïsme, ou la vibration du Verbe dans le christianisme.
«Quand nous connaissons Dieu adéquatement, nous savons que Dieu est par essence une puissance, et que cette puissance est nécessairement exprimée en des formes finies et déterminées. Quand nous connaissons notre essence adéquatement, nous savons que Dieu est essentiellement puissance, et que cette puissance est nécessairement exprimée en des formes finies et déterminées. Quand nous connaissons notre essence, nous savons que dans le fond ultime de toutes choses se trouve une puissance d’agir déterminée. Connaître la relation entre Dieu et notre essence consiste à voir cette puissance d’agir déterminée en tant que déclinaison de la puissance divine, et, réciproquement, voir dans quelle mesure le pouvoir divin s’exprime lui-même en nous. »
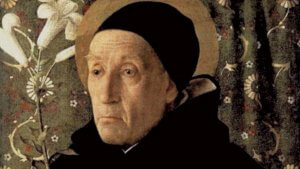 Et Andrea Sangiacomo de développer : « L’être du corps devient » « totalement transparent en révélant la puissance divine en son coeur. » On pense au coeur mystique dans les différentes traditions : Grunt de maître Eckhart, fu’âd du soufisme, coeur spirituel à droite de la poitrine du Ramana Maharshi dans l’advaita vedanta, wuxin du taoïsme.
Et Andrea Sangiacomo de développer : « L’être du corps devient » « totalement transparent en révélant la puissance divine en son coeur. » On pense au coeur mystique dans les différentes traditions : Grunt de maître Eckhart, fu’âd du soufisme, coeur spirituel à droite de la poitrine du Ramana Maharshi dans l’advaita vedanta, wuxin du taoïsme.
« Connaître intuitivement consiste à introduire un autre niveau dans l’expérience du monde, à s’immerger dans le bouillonnement infini de la puissance divine (…) ». On pense à la bullitio et à l’ebullitio de maître Eckhart.
« Cela consiste à saisir la vibration de la puissance divine dans chaque vague, écume, goutte qui émerge d’elle et à laquelle elles retournent, sans nom – puisque les noms ne sont rien d’autre que des images faites pour capturer ce qui est particulier ou général. Quoique sans nom, cette vibration est pourtant vraiment réelle. Voir le monde avec les yeux de l’intuition consiste à voir la co-appartenance de l’identité et de la différence, à les voir toutes deux ensemble, sans aucune contradiction, mais comme naturellement complémentaires. »
La vertu suprême de l’esprit
L’ « appétence vise ultimement la connaissance intuitive qui implique et présuppose la capacité de l’esprit de se connaître comme expression finie de la puissance divine. Les cupidités sont « considérées comme des vertus quand elles sont initiées ou générées par des idées adéquates. » (scolie de la proposition 4 de la cinquième partie de l’Ethique.)
« La seule condition nécessaire au développement de la connaissance intuitive est un état » « de tranquillité intérieure et de paix. » L’amour intellectuel de Dieu est sui generis. « Il émerge de la connaissance intuitive ou intellectuelle, non pas de la perception sensible, de l’imagination ou même de la raison. » L’intellect est spécifique. Il ne correspond pas à l’entendement usuel. Il fonde la spécificité de l’amour intellectuel de Dieu, qui est intérieur, au contraire de l’amour ordinaire qui est lié à l’extériorité. « En outre, un tel amour n’exclut pas non plus le corps ». L’amour intellectuel de Dieu n’est pas déconnecté du corps, ce qui conserve le parallélisme entre corps et esprit, et le caractère non dual du spinozisme, au contraire du cartésianisme. « L’amour intellectuel de Dieu n’est pas un affect sublime mais distant, mais plutôt une puissance toujours immanente à toute expérience. »
Dans le yoga, le problème est la tension « entre l’expérience subjective de la finitude (…) et l’expérience de la transcendance. » Pour le spinozisme, il y a au contraire « une transition entre les différentes sortes de connaissance. » La connaissance intuitive « commence avec la raison mais mène à la connaissance adéquate des essences individuelles. » Mais l’amour intellectuel de Dieu n’est pas seulement l’obtention individuelle d’un certain niveau de conscience. Il révèle par lui- même « une dimension cosmique », qui permet de relier « l’identité et la différence, le fini et l’infini, Dieu et ses modes. »
Gloire et amour
Dans le yoga, la « conscience cosmique est l’unité du multiple (ou plutôt l’unité dans le multiple), c’est-à-dire la coprésence simultanée et l’interpénétration de l’Un et du multiple. » On retrouve cette idée dans l’Upanishad classique : « Celui qui voit le Soi (âtman) partout dans tous les êtres/ et tous les être dans le soi, ne connaît pas d’aversion. »
Dans l’Ethique, Spinoza développe l’idée « d’un réfléchissement mutuel de l’infini dans le fini selon une manière propre ». Dans la démonstration de la proposition 36 de la cinquième partie, il écrit : « l’amour intellectuel de l’esprit pour Dieu est une part de l’amour infini dont Dieu s’aime lui-même. » Il s’agit d’une identité dans la différence. Ce n’est pas « l’esprit qui pense, mais Dieu qui pense à travers l’esprit. » « L’expression latine amor dei intellectualis comporte deux dimensions en une valence double du génitif dei, qui est objective et subjective : c’est l’amour intellectuel que Dieu possède comme objet, mais aussi en même temps l’amour intellectuel avec lequel Dieu, en tant que sujet, s’aime lui-même, et aime la totalité de l’existence en s’aimant lui-même. »
D’autre part, la Gloire est «une forme d’amour, la cause externe d’une affection spécifique, i.e. l’image de quelqu’un d’autre qui rend grâce à notre action. » La Gloire est spécifique dans l’Amour intellectuel de Dieu. Elle émerge « de l’expérience directe de notre propre puissance, qui est réfléchie simultanément en nous, dans les autres, et dans le tout. Elle est fondée sur « la relation de l’identité-à l ‘intérieur-de-la-différence entre les ces niveaux. » L’objet de l’image de la gloire est l’essence de notre esprit, en Dieu, qui est aussi intérieur qu’extérieur. L’acquiescence est donc double, à la fois intérieure et extérieure. Andrea Sangiacomo utilise une magnifique formule : « Tout est Dieu, tout est amour, tout nous fonde et nous aime, et nous rappelle que ce que nous sommes – notre nature, notre essence – est la même puissance divine qui vibre, résonne, se répand et danse. » « L’Être, considéré en lui-même, est pure positivité ; c’est le coeur de toute positivité possible. »
Dans beaucoup de courants du yoga (mais pas tous), le principe ultime est associé à trois principaux attributs : l’être ou la réalité (sat), la conscience ou la connaissance (cit), et l’extase ou la joie divine (ânanda). Dans le spinozisme, cela correspond à la Substance, la pensée et l’amour divin. L’Ethique est un entre-deux entre la conception impersonnelle de Dieu et sa manifestation concrète, son expression.
Dieu est d’une part impersonnel selon la raison. Il est d’autre part individué selon l’intuition. Il faut donc s’interroger sur la nature de l’intuition et la part éternelle de l’esprit.
Le déploiement de l’esprit
« La part éternelle de l’esprit est clairement le coeur de l’individu humain, en tant qu’il est l’idée de l’essence du corps. » C’est un point fondamental partagé par toutes les sagesses en tous temps et en tous lieux. Dans le christianisme, c’est le Royaume de Dieu à l’intérieur, le quelque chose d’incréé au fond de l’âme selon maître Eckhart. Dans l’Advaita-Vedanta, c’est le siège de la conscience, le Soi, selon le Ramana Maharshi. Pour le taoïsme, le coeur est vide, sans forme. Andrea Sangiacomo ajoute l’adverbe « clairement ». On peut le prendre aux deux sens, de la raison discursive, et de la raison intuitive.
La part éternelle de l’esprit est une part. Cette idée de part n’empêche pas le déploiement de l’esprit individuel. En tant qu’expression de l’infini, notre part éternelle permet « l’expérience intégrale de l’éternité. Il n’y a pas d’extranéité de l’infini. Cette libération existentielle existe aussi dans le shivaïsme du Cachemire. Il s’agit de « l’absorption dans le principe ultime. »
IV – Chapitre III : Les moyens de l’augmentation de la puissance d’agir : esprit, corps et société
La méditation selon Spinoza
Voilà la partie la plus originale de l’ouvrage. Andrea Sangiacomo propose des niveaux de méditation inspirés de sa propre expérience. L’amour intellectuel de Dieu n’est pas l’objet d’un effort, mais est « un état d’esprit naturel et spontané ». Cette méditation, avec ses différents degrés a pour fin d’accorder le corps et l’esprit à l’Amour intellectuel de Dieu, à l’instar d’un instrument de musique. Il existe cinq degrés de méditation.
Le premier degré consiste à « conférer à l’esprit une idée du corps. » Il donne « une forme de relaxation ». Il y a trois manières d’obtenir cette relaxation du corps. Réciter un court poème ou dire une prière, ou juste un mot est la première manière. Dans la tradition tantrique du shivaïsme, le mot Om est privilégié. La deuxième manière consiste à se concentrer sur sa respiration. La troisième consiste simplement à écouter le silence qui est « une vibration spéciale », « la pure forme de la puissance du conatus. », qui permet d’atteindre un état subtil d’accueil. On pense là au Chan Zen.
Le deuxième degré permet de passer du corps individué à l’attribut étendue. C’est là « une expérience psycho – physique » qui permet de « s’immerger soi-même dans l’infinité de l’espace dans lequel nous sommes et que nous sommes. » Dans le shivaïsme du Cachemire, notamment, on perçoit « le corps entier comme vide, la peau comme une sorte de membrane contenant ce vide », « dissoute comme une goutte d’eau dans la mer de l’espace. » Dans une perspective spinozienne, il s’agit « de percevoir l’extension infinie de laquelle le corps est un mode. »
Le troisième degré consiste à réaliser « que l’expérience de l’extension infinie ne nous est accessible que dans la mesure où nous avons une idée d’elle. » « Comme toute expérience est médiatisée par la pensée, la qualité typique de la pensée est tellement commune qu’elle devient invisible ou totalement transparente, comme l’eau à l’égard du poisson qui nage et vit en elle. » Ici, contrairement à l’advaita vedanta de Shankara, le monde n’est pas vécu comme illusoire. Il est comme la danse du monde, ainsi que le considère le shivaïsme du Cachemire.
Le quatrième degré est déjà élevé. Il va de l’idée du corps à l’idée de l’esprit, sans barrière, sans détermination. Il renvoie à la transcendance de la substance. Cela est très original, dans la mesure où habituellement, le spinozisme est vu dans sa seule dimension immanente. Le « vide apparaît comme l’arrière plan immense, indicible, inexprimable, présent dans au coeur de toute expérience possible. » L’imagination et les affects sont vidés de toute substance.
Le cinquième degré est le degré suprême. Nous « voyons soudainement l’identité » de l’arrière-plan de la pensée infinie « avec la pensée finie que constitue notre esprit. » En ce sens nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels (Scolie de la proposition 23 de la cinquième partie de l’Ethique), en tant que nous sommes la manifestation, l’expression de la Nature naturante. Il y a là à l’oeuvre l’expérience de la « relation de l’identité-à-l’intérieur de la différence. » Ainsi accédons- nous à l’Amour intellectuel de Dieu. Nous faisons ainsi l’expérience de la totalité de notre corps existant en acte comme totalité du réel. Chez Spinoza, l’amour humain est lié à une cause extérieur. Mais l’amour divin est lié à une cause intérieure, l’acquiescence en soi. Nous sentons de manière interne que nous sommes l’expression de Dieu. Ce jeu du multiple dans l’identité opère la satisfaction propre et la gloire de Dieu, qui s’applique aussi bien dans les sens de Dieu pour lui-même que pour nous de Dieu envisagé comme totalité. Nous sommes ainsi prêts à servir le monde, au lieu de le fuir (Scolie de la proposition 36 de la cinquième partie de l’Ethique.)
La conception des cinq degrés de la méditation spinozienne est absolument remarquable. Elle est l’expression de l’expérience la plus haute. C’est la première fois qu’elle est détaillée avec autant de netteté et de pertinence. Il ne reste qu’à nous incliner devant elle.
La fonction instrumentale de la raison
Pour autant, quittons-nous la dimension rationnelle ? On retrouve chez Abhinavagupta, ce mystique du shivaïsme cachemirien, ce souci de la raison concrète. L’argumentation adéquate (tarka en sanskrit) permet de chasser les idées inadéquates. Cela permet d’atteindre le niveau de la conscience infinie dans sa dimension immanente comme totalité du monde phénoménal.
Chez Spinoza, la transcendance doit être vécue comme immanence. L’imagination sépare au contraire la transcendance de la multiplicité mondaine. La raison, en tant qu’elle se fonde sur les notions communes, corrige l’imagination. Pour notre part, nous dirions qu’elle agit à la manière de lunettes correctives de la vue floue de la réalite.
Spinoza ne voit pas la raison comme tyrannie mentale, mais comme une solution de la perception adéquate de la réalité de l’esprit. Pourtant, cette dimension doit être profondément incarnée dans le corps existant en acte, et « le contact intime avec la réalité physique du corps. » Nous songeons au corps très apte de la proposition 39 de la cinquième partie de l’Ethique. Le corps passe de l’imagination dualiste à sa compréhension adéquate fondée sur la reconnaissance de l’identité du corps et de l’esprit.
L’hilaritas
L’hilaritas ne peut être excessive chez Spinoza ( proposition 42 de la quatrième partie de l’Ethique). Elle montre à l’esprit la nature de la communauté du corps.
Néanmoins, dans le shivaïsme du Cachemire, le corps est considéré comme un « instrument ». Il s’agit d’un corps subtil, « composé d’énergie pure, d’action et de conscience ». Comme l’énergie électrique qui parcourt un circuit, la force de vie flue dans le corps subtil.
Par l’union entre la base de la colonne vertébrale et du centre, l’union du corps et de l’esprit est rendue possible. Elle permet le samadhi. Et Andrea Sangiacomo de citer la proposition 39 de la cinquième partie de l’Ethique.
L’engagement politique
L’extrémisme politique, et plus généralement la division politique du corps social, est le produit de l’imagination. Ils seront modifiés par l’éducation adéquate à la connaissance intuitive et à l’Amour intellectuel de Dieu.
Selon nous, c’est peut-être sans compter sur la persistance du premier genre de connaissance. Espérons toutefois que la perspective à long terme tracée par Andrea Sangiacomo deviendra une réalité.
V – Conclusion
La longue conclusion est essentielle et superbe.
Andrea Sangiacomo commence par analyser les différentes conceptions historiques du spinozisme. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, Spinoza est considéré comme athée. Au XIXe siècle, pour Hegel, le spinozisme est un acomisme, qui nie la réalité du monde phénoménal. Au XXe siècle, la lecture mystique de Spinoza s’impose, fondée sur une analyse de l’amour intellectuel de Dieu (notamment chez Maria Zambrano). A partir des années 60, le marxisme s’intéresse au spinozisme, en tant que théorie de la démocratie absolue, marquée par le pouvoir de la multitude (notamment, en France, chez Althusser).
Le point commun de ces réceptions est marqué par le refus de caractériser le spinozisme comme un système panenthéiste. Selon cette conception, « Dieu est en toutes choses, et toutes choses sont en Dieu, mais Dieu ne se réduit pas aux choses, ni les choses à Dieu ». Spinoza « est un mystique, et voit pourtant la raison comme un instrument qui permet de fonder un pouvoir plus fort de connaissance intuitive ». Spinoza refuse la solution classique du yoga, l’abolition du désir et l’évasion du monde. Il propose une alternative, « l’amour intellectuel de Dieu, compris comme la réflexion mutuelle du fini dans l’infini. »
Il y a un paradoxe du yoga. Dans le shivaïsme du Cachemire, l’ignorance et l’oubli de Dieu sont eux-mêmes des actions par lesquelles le Divin se limite lui-même, pour se redécouvrir lui-même. Il n’y a donc à proprement parler rien de mauvais ou de bon dans le monde, rien à changer, et rien d’autre à atteindre. Et Andrea Sangiacomo de citer Abhinavagupta : « celui qui transcende tous les principes limités, de la terre à Shiva, et qui consiste en une simple conscience illimitée, celui-là est la réalité suprême, le lieu où toutes choses sont contenues, la force vitale du tout, par lequel tout respire, et ce n’est rien d’autre que le Je, par lequel je transcendance le tout, et suis fait du tout. »
On est en face d’un dilemme : d’une part, on doit admettre la désidentification, l’équanimité. D’autre part, l’acceptation de l’ignorance doit être admise en tant que telle. Cela implique que la reconnaissance de la vérité ramène à l’ignorance, afin de ne pas gêner l’expression divine qui forme cette illusion. Pour Spinoza, la « Nécessité est une autre manière de d’exprimer l’attitude non-duelle de l’acceptation radicale ». Elle est le moyen de ne pas vouloir changer les choses selon notre désir. Pourtant, la variation d’intensité du conatus, selon les degrés de connaissance, entraîne en dernière instance l’amour intellectuel de Dieu, qui constitue le maximum de puissance. Le conatus demeure le même, mais son expression change en qualité et en quantité. Il s’agit de cultiver sa puissance afin de le soumettre à l’entier service de la puissance divine et de son expression entière.
Certes, le problème est immense. Nous sommes tissés d’inadéquation. Le problème est que nous sommes une part de Dieu. Nous ne sommes pas le tout. Nous sommes incomplétude de puissance. La finitude nous caractérise. La beauté du spinozisme réside dans cette conception selon laquelle le problème est la solution. Dieu s’exprime en nous. Se concevoir comme une manière dont la puissance de Dieu s’exprime en nous est la solution. L’intuition selon laquelle nous sommes une lumière de Dieu est radicale et salvatrice. Certes, en tant que partie, la conscience est obscure. Ou plus exactement, elle pense qu’elle est sombre. Pourtant, la conscience individuelle a l’intuition qu’elle est lumière, que la lumière est dans la conscience, « brillant sur elle, autour d’elle. » Et Andrea Sangiacomo d’évoquer la conscience de la danse de la vie et du monde, qui se célèbre comme système, comme intégration des parties, un système d’esprits qui réunit les perles secrètes de la joie de l’existence dans la mer silencieuse. L’instant deviendra soudain infini.
« C’est la gloire du corps qui dans un battement de coeur de l’intuition est reconnu comme pierre, mousse, chêne, animal, humain, être, infini, substance, puissance, silence, lumière, unité, beauté, joie, ardeur, souffrance, vie – amour. »
Toute la pensée d’Andrea Sangiacomo célèbre le spinozisme. Il ne s’agit pas seulement d’un système théorique. Il s’agit d’une pratique de la méditation allant du corps à la totalité de la substance. Spinoza pratique une voie spirituelle d’union avec l’éternité. La spinozisme n’est pas un renoncement au désir, comme dans les traditions indiennes usuelles. C’est une intensification du conatus, jusqu’à la béatitude. C’est une réponse à la grave crise de la civilisation mondiale, faite de domination et de division. L’union intérieure est la solution aux divisions psychiques et politiques de l’humanité. Notre véritable nature est un lien avec le Tout de la substance. La découverte de ce lien permettra une transformation profonde de l’humanité, grâce à une connaissance libératrice et intensifiante.
Le livre d’Andrea Sangiacomo est ainsi révolutionnaire. Il tisse un lien entre la civilisation indienne et la civilisation occidentale. Il faudrait prolonger ce travail en direction de la Chine, avec le taoïsme. La tâche est immense. Celle, toujours renouvelée, du mystère de l’unité et du multiple. Conscience, Dieu, Tao, substance : ces termes désignent l’Absolu, grand défi de l’humanité. L’originalité du spinozisme réside dans la conciliation entre le rationalisme occidental et l’union mystique orientale. Par l’exercice de la vision unifiante de la Raison, le troisième genre de connaissance constitue le devenir de l’humanité. Le vingt-et-unième siècle sera mystique, et pourquoi pas, une mystique spinoziste ? Pont entre le devenir et l’Etre, entre l’unité et la multiplicité, le spinozisme d’Andrea Sangiacomo est une pratique de l’incarnation de la béatitude. En ce sens, il s’adresse à tout le monde, à chacun. Le livre est destiné à devenir un classique de la littérature spinoziste, un bréviaire philosophique à l’intention de l’humanité. L’union comme dépassement des idéologies, la méditation comme sagesse de l’amour. La redécouverte de l’amour intellectuel comme remède aux maux humains. Le triomphe du coeur comme lien à l’éternité.








