L’originalité d’une nouvelle apologétique : pourquoi ? comment ?
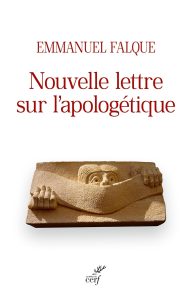 Cette Nouvelle lettre sur l’apologétique d’E. Falque, à la mémoire de Maurice Blondel et Henri de Lubac, est un texte courageux : le philosophe ose une apologétique à la lumière de son époque, depuis les problématiques humaines et spirituelles qui lui sont propres, depuis les crises qui traversent ses contemporains. En revenant à « un genre perdu » au XXIème siècle, E. Falque s’inscrit dans une tradition de théologiens et de philosophes qui, comme Pascal au XVIIème siècle, ont cherché à construire un discours argumenté pour « la défense et l’illustration de la foi chrétienne ». Le lecteur et la lectrice auront peut-être à l’esprit le « pari » de Pascal dans ses Pensées (« Pesons le gain et la perte, en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous gagnez, vous gagnez tout ; si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu’il est, sans hésiter. »). L’apologétique s’ancre ici dans tout un contexte, et Pascal s’adresse aux libertins (libres penseurs) de son temps. E. Falque en est conscient et, riche de ce passé littéraire et philosophique, lui aussi veut habiter son présent. Aussi prend-il le risque d’écrire une nouvelle lettre sur l’apologétique. Et le terme « lettre » ne sera pas passé inaperçue aux oreilles des lecteurs. Car ce livre nous est bien adressé ; il est même adressé à tout homme, croyant ou non, qui cherche à dialoguer avec justice et vérité, dans l’intégrité d’une heuristique (recherche commune) : » Contrefort ou contre-force, l’autre dans l’amour me permet de ne pas chuter sur moi (par manque de résistance) et m’interdit de l’écraser (par excès de puissance). » (p. 20).
Cette Nouvelle lettre sur l’apologétique d’E. Falque, à la mémoire de Maurice Blondel et Henri de Lubac, est un texte courageux : le philosophe ose une apologétique à la lumière de son époque, depuis les problématiques humaines et spirituelles qui lui sont propres, depuis les crises qui traversent ses contemporains. En revenant à « un genre perdu » au XXIème siècle, E. Falque s’inscrit dans une tradition de théologiens et de philosophes qui, comme Pascal au XVIIème siècle, ont cherché à construire un discours argumenté pour « la défense et l’illustration de la foi chrétienne ». Le lecteur et la lectrice auront peut-être à l’esprit le « pari » de Pascal dans ses Pensées (« Pesons le gain et la perte, en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous gagnez, vous gagnez tout ; si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu’il est, sans hésiter. »). L’apologétique s’ancre ici dans tout un contexte, et Pascal s’adresse aux libertins (libres penseurs) de son temps. E. Falque en est conscient et, riche de ce passé littéraire et philosophique, lui aussi veut habiter son présent. Aussi prend-il le risque d’écrire une nouvelle lettre sur l’apologétique. Et le terme « lettre » ne sera pas passé inaperçue aux oreilles des lecteurs. Car ce livre nous est bien adressé ; il est même adressé à tout homme, croyant ou non, qui cherche à dialoguer avec justice et vérité, dans l’intégrité d’une heuristique (recherche commune) : » Contrefort ou contre-force, l’autre dans l’amour me permet de ne pas chuter sur moi (par manque de résistance) et m’interdit de l’écraser (par excès de puissance). » (p. 20).
L’art du dialogue : promesse de co-naissance
Si le dialogue est ce rapport libre à autrui, c’est bien que nous n’y sommes pas « cramponnés » sur des vérités toutes faites, sur des systèmes de pensée fermés, ou sur des langues de bois. En effet, comment entrer dans un dialogue philosophique authentique, dans ce qu’E. Falque appelle « le combat amoureux », si l’on refuse de laisser la parole aux autres, de leur laisser la place ? C’est à l’ironie socratique qu’E. Falque nous renvoie en filigrane. Dire, comme Socrate : « Je sais que je ne sais rien », est précisément faire place à l’autre dans le dialogue, et s’engager dans une parole hospitalière, dans une écoute dynamique et attentive, une écoute qui bouscule nos préjugés, déconstruit nos schémas rassurants, et nous déloge ainsi de nos zones de confort. Car on a tôt fait de s’enliser dans des monologues où la pensée se dessèche et perd toute sa saveur, car elle se refuse à la différence. On est aussi souvent tenté par une mécanique de langage, un rabâchage ou une sophistique qui à défaut de penser se fait croire qu’elle pense, et tue le doute, le questionnement. Comme le dit Alain dans ses Propos sur les pouvoirs (§ 140) : « Le doute est le sel de l’esprit ; sans la pointe du doute, toutes les connaissances sont bientôt pourries. » En déjouant les pièges de l’irénisme, à l’instar de ceux de l’extrémisme et du sectarisme cloîtrés dans leur idéologie, Emmanuel Falque opte pour « l’en commun de la raison », dans l’héritage de Thomas d’Aquin qui se poursuit au XXème siècle avec « l’en commun de la finitude » de Martin Heidegger. C’est dans cette perspective qu’E. Falque relève le défi audacieux d’une nouvelle lettre sur l’apologétique, « pour ne pas perdre « nos vieux frères humains » avec qui nous ne cessons d’exister » se plaît-il à ajouter, en citant Les grands cimetières sous la lune de G. Bernanos.
Le lecteur aura donc compris que pour E. Falque ce qui compte dans l’apologétique c’est le logos cité à deux reprises : apologie (apo-logos) et « rendre raison » (aitionti logon) – soit une capacité pour la foi de se penser et de se formuler. Comme Platon nous le rappelle dans le Gorgias et dans le Sophiste, le logos a un double sens relativement au locuteur et à son interlocuteur. C’est tout l’art de la dialectique qui suppose une réfutation des certitudes, une recherche de la vérité et une éthique de l’écoute. E. Falque s’inscrit dans cet héritage platonicien, certes, mais fort de sa lecture de M. Merleau-Ponty (Eloge de la philosophie), il insiste sur le destinataire : « L’apologie désigne certes un écartement ou une séparation (apo) pour un discours raisonné, mais aussi une parole adressée (logos) à autrui donc l’enjeu sera d’abord de l’écouter et d’être écouté. » (p. 28)
L’écoute hospitalière : nous laisser la parole pour nous laisser transformer par la parole
Le dialogue appelle au large, et il nous appelle à nous laisser la parole, à ne pas la couper, mais à la faire largement circuler (et c’est le sens du préfixe grec « dia » du mot « dialogue »). En effet, quoi de plus déroutant, mais aussi de plus tonique qu’un dia-logue philosophiquement vécu ? Et par conséquent, quoi de plus fécond ? Mais cette fécondité dialogique de « l’en commun de la raison » porte en lui la condition de l’hospitalité cordiale. Et c’est pourquoi ce texte n’a de sens que dans une écoute mutuelle, un respect mutuel. C’est le fondement de toute naissance mutuelle à l’intelligence juste, ajustée à notre humanité : « Qui dit « apologétique » ne doit pas passer le premier par la porte, fût-elle ouverte. » (p. 143). Il reprend ainsi l’injonction d’E. Levinas dans Ethique et Infini : « Après-vous, Monsieur ! » (chap. 7 : « le visage », p. 84). « La formule de politesse n’est pas de déférence seulement nous rappelle E. Falque, mais aussi de juste distance. Car si l’on peut à juste titre vouloir influer sur le choix d’autrui, on ne saurait en aucune façon chercher à tout prix à le convaincre. » Pour Emmanuel Falque, il est toujours question de fécondité de la parole, nous l’avons dit, et cette fécondité prend la forme d’une transformation des interlocuteurs. Si le dialogue me laisse indemne, ai-je vraiment dialogué ? Est-ce que je n’ai pas parlé tout seul, ou ne me suis-je pas tenu dans mes replis, me préservant de me risquer dans l’aventure de la pensée avec autrui ? C’est tout l’inconfort de la situation dialogale auquel nous sommes conviés. Et pour nous laisser transformer par la parole, il importe de nous laisser la parole, et donc d’écouter ceux et celles qui ne pensent pas comme nous : « Ne pas s’enfermer sur soi, nous rappelle E. Falque, dans un christianisme séparé, voire sectaire, et « rester soi-même en haleine » vis-à-vis de ceux qui ne croient pas : telle est la visée profonde, et inversée (puisqu’il s’agit de me transformer moi plutôt que d’en imposer à l’autre), de l’apologétique telle qu’aujourd’hui elle pourra s’envisager »
La nouvelle apologétique est donc ici riche de son ouverture d’esprit et de son écoute de tous les autres, sans les condamner d’avance ou les enfermer dans des cases. L’autre n’est pas le « paumé » que j’ai tendance à voir, sans le dire (pour rester poli et apparemment bienveillant) : il est, existe, a sa pensée, et quelque chose à m’apporter. Tant que je pense qu’il est perdu et qu’il est loin de Dieu, dans l’erreur et l’errance, je risque fort de m’enfermer dans mon orgueil et de me couper de tout dialogue. Les rhétoriques convenues, religieusement correctes, les beaux discours qui nous donnent bonne conscience, et les fausses bienveillances, toutes nos hypocrisies auront beau faire, elles n’y feront rien : elles laisseront le terrain vide et vague.
Si nous sommes les obligés de la pensée, celle-ci nous oblige à casser nos murs, et à aller à la rencontre de tous les autres. Montaigne nous le disait lui-même. On appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage » Il convient donc de faire comme le prisonnier de la caverne de Platon et de nous détacher de nos chaînes, de nos préjugés. La religion peut faire écran à la vraie religion qui est fondamentalement l’hospitalité à Dieu et aux autres. Alors une nouvelle apologétique s’impose, monsieur Falque a raison. Et il est urgent de le dire à notre monde de plus en plus sectaire, à nos églises qui se morcellent et aux chrétiens eux-mêmes qui ont déjà tant de mal à s’accorder entre eux : « S’il est aujourd’hui un moment catholique » nous rappelle E. Falque, « son kaïros consistera moins à restaurer un « petit reste d’Israël » au regard du grand reste de l’humanité en train de s’effondrer, qu’à arpenter l’humble tracé d’une vie d’autant plus fragile qu’elle n’est jamais autant « grandie » que lorsqu’elle apprend de l’étranger ». (p. 144). Car refuser la discussion, le débat et la critique, fût-ce en matière de religion, c’est aussitôt acquiescer à toutes les formes de novlangue (Orwell, 1984), et « faire revenir les rois » (les tyrans, les sermonneurs, les intégristes) comme le dit Alain dans ses Propos sur les pouvoirs. Alors la juste « bienveillance » du catholicisme envers le monde contemporain ne peut plus suffire. Encore faut-il une révolution copernicienne, un déplacement radical, un « bouleversement de soi par autrui » (p. 145). Alors, loin de refuser l’acte de philosopher, la nouvelle apologétique doit au contraire le motiver.
Que reste-t-il de l’apologétique au XXIème siècle ?
 Le lecteur trouvera dans ce livre matière à penser et à débattre, car Emmanuel Falque a l’audace d’aborder la question de l’apologétique et de son rapport au surnaturel. Le philosophe part de la Lettre sur l’apologétique de Maurice Blondel (1896) où le philosophe répond aux critiques de C. Denis, L. Brunschvicg, et du Surnaturel d’H. de Lubac (1947) qui lui vaudra une vaste polémique et une condamnation par le Vatican. Le débat auquel ces livres ont donné lieu nous enseigne aujourd’hui l’exigence et la fécondité du « combat amoureux ». Qu’est-ce à dire ? Pour E. Falque, il ne s’agit pas tomber dans le relativisme. Si « tout ne s’équivaut pas du point de vue des contenus, nous dit le philosophe, tous se valent du point de vue des interlocuteurs… car leur commune humanité exige d’abord, et par principe, que chacun soit entendu et respecté. » (p. 19). C’est essentiel de le rappeler à notre époque où le débat a fait place à un dialogue de sourds, à l’arrogance et à l’agressivité. Où sont les vrais débatteurs aujourd’hui ? Force est de constater que les hommes se coupent la parole et n’ont de cesse de réfuter sans écouter, dans une éristique stérile où chacun veut avoir raison au mépris des autres, que l’on soit dans le domaine politique, religieux ou éducatif. On comprend ainsi que ce livre d’E. Falque est essentiel pour notre époque ; c’est un livre audacieux qui soulève les vraies questions, va au cœur des problèmes : « On aurait tort de croire, et de faire croire, que tout combat est purement réactif, comme s’il était indispensable de contrecarrer autrui pour en venir à penser : « Je suis contre (les femmes) … tout contre », dit la chanson de Guitry. Car l’amour véritable, dans le « combat amoureux », n’est pas celui qui ferait qu’on en viendrait à s’opposer dans un conflit sans fin (« je suis contre »), mais celui qui fait sur l’autre on peut s’appuyer (« je suis tout contre ») – à l’instar de la lutte de Jacob avec l’ange de Delacroix, ou du contrefort d’une cathédrale qui lui évite de s’écrouler. » (p. 20).
Le lecteur trouvera dans ce livre matière à penser et à débattre, car Emmanuel Falque a l’audace d’aborder la question de l’apologétique et de son rapport au surnaturel. Le philosophe part de la Lettre sur l’apologétique de Maurice Blondel (1896) où le philosophe répond aux critiques de C. Denis, L. Brunschvicg, et du Surnaturel d’H. de Lubac (1947) qui lui vaudra une vaste polémique et une condamnation par le Vatican. Le débat auquel ces livres ont donné lieu nous enseigne aujourd’hui l’exigence et la fécondité du « combat amoureux ». Qu’est-ce à dire ? Pour E. Falque, il ne s’agit pas tomber dans le relativisme. Si « tout ne s’équivaut pas du point de vue des contenus, nous dit le philosophe, tous se valent du point de vue des interlocuteurs… car leur commune humanité exige d’abord, et par principe, que chacun soit entendu et respecté. » (p. 19). C’est essentiel de le rappeler à notre époque où le débat a fait place à un dialogue de sourds, à l’arrogance et à l’agressivité. Où sont les vrais débatteurs aujourd’hui ? Force est de constater que les hommes se coupent la parole et n’ont de cesse de réfuter sans écouter, dans une éristique stérile où chacun veut avoir raison au mépris des autres, que l’on soit dans le domaine politique, religieux ou éducatif. On comprend ainsi que ce livre d’E. Falque est essentiel pour notre époque ; c’est un livre audacieux qui soulève les vraies questions, va au cœur des problèmes : « On aurait tort de croire, et de faire croire, que tout combat est purement réactif, comme s’il était indispensable de contrecarrer autrui pour en venir à penser : « Je suis contre (les femmes) … tout contre », dit la chanson de Guitry. Car l’amour véritable, dans le « combat amoureux », n’est pas celui qui ferait qu’on en viendrait à s’opposer dans un conflit sans fin (« je suis contre »), mais celui qui fait sur l’autre on peut s’appuyer (« je suis tout contre ») – à l’instar de la lutte de Jacob avec l’ange de Delacroix, ou du contrefort d’une cathédrale qui lui évite de s’écrouler. » (p. 20).
Dans cette perspective, comment considérer l’apologète au XXIème siècle ? Quelle place faire à l’apologétique à notre époque ? Faudra-t-il la déprécier ? Gageons avec E. Falque qu’il s’agit d’adopter une position ajustée à son temps : il ne s’agit pas de faire un copié-collé de l’apologète du XVIIème siècle, ce qui serait absurde, mais d’être dans son temps en sachant l’écouter, en se confrontant réellement au problème de l’athéisme, pour éviter les replis sectaires et les violences qu’ils impliquent. Et dans le sens de sa nouvelle lettre sur l’apologétique, le philosophe se demande s’il existe vraiment aujourd’hui un « drame » de l’humanisme athée.
L’athéisme aujourd’hui
« Sous les innombrables courant de surface qui portent dans tous les sens la pensée de nos contemporains, il nous a semblé qu’il existait un courant profond, affirme Henri de Lubac dans Le drame de l’humanisme athée, une sorte d’immense dérive, ajoute dernier : par l’action d’une partie considérable de son élite pensante, l’humanité occidentale renie ses origines chrétiennes et se détourne de Dieu. » (de Lubac, p. 7). Quel est donc ce drame de l’humanisme athée ? « Humanisme positiviste, humaniste marxiste, humanisme nietzschéen : beaucoup plus qu’un athéisme proprement dit, la négation qui est à la base de chacun d’eux est un antithéisme, et plus précisément un antichristianisme. » (de Lubac, p. 8). Mais pour H. de Lubac, il ne suffisait pas seulement d’entrer en dialogue, il fallait aussi combattre, réfuter, prendre position en rejetant catégoriquement l’athéisme. E. Falque se demande si ce rejet a encore lieu d’être aujourd’hui… : a-t-on affaire au même athéisme en 2025 qu’en 1950 ?
L’athéisme est d’un « genre nouveau », remarque notre auteur : par rapport à l’époque du père de Lubac, il présente l’anthropologie finie et enclose dans son immanence comme une évidence sereine qui précède toute affirmation ou négation de Dieu. Alors, le théologien lui aussi doit évoluer avec l’athéisme. En effet, aujourd’hui, l’athéisme n’a plus le visage de celui d’un Sartre ou d’un Camus, il est p lus proche de ce que Merleau-Ponty en dit : il ne présuppose plus que Dieu ou le Surnaturel serait toujours requis pour penser et même pour exister. Le fait de notre modernité est celui d’un athéisme, d’une existence dont la mort seule détient le dernier mot. Emmanuel Levinas constatait lui aussi le « sans Dieu (athée) comme condition pour être homme (chez soi, séparé, heureux) et donc aussi avec Dieu (créé) (Totalité et Infini, p. 158).
Si une certaine vision religieuse a fait du monde le lieu de toutes les errances, de toutes les perditions, s’il en a fait un lieu à fuir, dont le bon chrétien devrait se détacher pour ne pas se laisser contaminer par lui, E. Falque, nous rappelle que nous sommes bien dans le monde et que la réalité de notre existence terrestre ne devrait pas être coupée de celle de notre vie en Dieu. La vie du baptisé peut-elle se réduire à un divorce entre la vie temporelle et la vie spirituelle ? E. Falque déplace le propos et propose un nouveau genre d’apologète, quelqu’un qui serait capable d’aller sur le terrain de la topologie : « non plus seulement qu’est-ce que Dieu ? (métaphysique), ni qui est Dieu ? (méthode généalogique), ni comment est Dieu ? (phénoménologie), mais où est Dieu ? (topologie), remarque E. Falque. L’utopie de Dieu, non pas en guise de rêve inaccompli (l’utopique), mais comme « non-lieu » (u-topos) au double sens géographique et juridique… voilà ce qui fait notre contemporanéité et la réalité de cet athéisme cohérent qu’il nous faut aujourd’hui penser. » (p. 46). E. Falque souligne cet « athéisme d’un genre nouveau » auquel nous sommes aujourd’hui confrontés : « Il n’est pas indifférentisme, agnosticisme ou ignorance. ». Il convient de sortir de la transcendance de surplomb. Car pour beaucoup d’hommes, il est possible de vivre simplement à hauteur d’homme, sans Dieu. Que le croyant puisse l’admettre et accepter d’entrer en dialogue avec le non-croyant et « interroger son propre athéisme » (p. 48). C’est ici qu’à mon sens, le livre d’E. Falque est le plus fort : quand il remarque que ce nouvel athéisme vient déplacer le croyant et lui faire prendre conscience de ses propres manques de foi quand il se sert de Dieu comme d’une béquille, ou en fait une idole, une représentation qui le rassure et lui permet de ne plus se questionner, de ne plus conférer des mots à Dieu pour s’adresser à nous, de ne plus lire textes de l’Ecriture. Il faudrait peut-être alors éteindre nos portables pour allumer nos esprits et nos cœurs afin de revenir à l’écoute, à la parole, au dialogue. Car Dieu veut s’adresser à tous. « Il en est de son affaire à lui seul de nous convertir ou non. » (p. 53).
Le véritable danger n’est pas un prétendu ennemi sociétal ou personnel qui viendrait nous accuser, mais la faute que tous, croyants ou incroyants, nous pourrions ensemble commettre si nous ne revenons pas vers ces textes de l’Ecriture et de la culture qui nous ont façonnés. », remarque E. Falque (p. 53).
Le problème du surnaturel
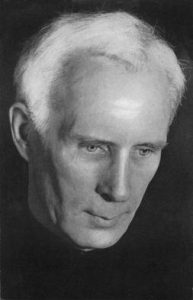 Il convient cette fois non plus de se tourner vers les aspirations de la nature vers la surnature, mais de s’en tenir à la nature comme telle. Un passage du Mystère du surnaturel le dit explicitement si l’on accepte de le lire en creux : « Peu importe que, dans les conditions actuelles de cette existence, immergé que je suis dans les choses sensibles et ignorant de moi-même, ce désir ne soit pas objectivement perçu, dans toute sa vérité et selon toute sa force : il le sera en tout cas, immanquablement, le jour où ma nature m’apparaîtra enfin telle qu’elle est en son fond – si jamais toutefois elle doit m’apparaître ainsi. » (Le mystère du surnaturel, p. 81). Lubac se rétracte-t-il ici ? Pour E. Falque, son enjeu n’est pas d’adopter une position différente, mais bien de revenir au sens de cette « gratuité réelle » du surnaturel. « Ce surnaturel totalement gratuit pour moi, dit Lubac, dans cette condition présente ». Comme Duns Scot au XIVème siècle, Lubac comprend que l’horizon de la pure contingence est la contrepartie de l’absolue gratuité de Dieu. Il n’impose pas un désir du surnaturel qui serait toujours donné, au moins objectivement perçu. Henri de Lubac va laisser libre le champ de la pure nature, et donc de la finitude. Dans sa Petite catéchèse sur nature et grâce (1980), qui admet une totale hétérogénéité entre la nature et la surnature, Lubac affirme que « le couple naturel-surnaturel doit être conçu dans un premier temps dans un rapport d’opposition, c’est-à-dire d’altérité spirituelle et d’infinie distance, mais il se résout ensuite, si l’homme s’y prête, dans un rapport d’intime union. » (p. 37). Il n’y a donc plus d’exigence donc du Surnaturel par la nature. C’est ce que montre Jean-Yves Lacoste dans Le monde et l’absence d’œuvre où le surnaturel se découvre lié au naturel sans simplement s’y surajouter. La grâce rejoint la nature et non pas l’inverse (dans un pélagianisme à éviter). Libérer la grâce du surnaturel implique de laisser la nature être la nature : le désir de voir est en l’homme un « désir de nature ». L’athéisme a donc bien changé de visage : il n’est cet « athéisme tragique » des années 1940 ni « l’athéisme militant » des années 1970. Il est un athéisme « d’un genre nouveau » : « parce qu’il ne prétend pas décrire les « conditions actuelles de cette existence », le théologoumène (surnaturel) réhabilité dans les travaux menés entre 1947 et 1965 peut laisser intactes les herméneutiques heideggériennes de la facticité. E. Falque peut ainsi faire coïncider Métamorphose de la finitude, son essai écrit en 2004 avec Mystère du Surnaturel, ce qui lui impose de « passer le Rubicon », et de ne pas enclore Lubac dans la seule zone de la théologie, ni même d’enfermer Blondel dans le seul espace de la philosophie.
Il convient cette fois non plus de se tourner vers les aspirations de la nature vers la surnature, mais de s’en tenir à la nature comme telle. Un passage du Mystère du surnaturel le dit explicitement si l’on accepte de le lire en creux : « Peu importe que, dans les conditions actuelles de cette existence, immergé que je suis dans les choses sensibles et ignorant de moi-même, ce désir ne soit pas objectivement perçu, dans toute sa vérité et selon toute sa force : il le sera en tout cas, immanquablement, le jour où ma nature m’apparaîtra enfin telle qu’elle est en son fond – si jamais toutefois elle doit m’apparaître ainsi. » (Le mystère du surnaturel, p. 81). Lubac se rétracte-t-il ici ? Pour E. Falque, son enjeu n’est pas d’adopter une position différente, mais bien de revenir au sens de cette « gratuité réelle » du surnaturel. « Ce surnaturel totalement gratuit pour moi, dit Lubac, dans cette condition présente ». Comme Duns Scot au XIVème siècle, Lubac comprend que l’horizon de la pure contingence est la contrepartie de l’absolue gratuité de Dieu. Il n’impose pas un désir du surnaturel qui serait toujours donné, au moins objectivement perçu. Henri de Lubac va laisser libre le champ de la pure nature, et donc de la finitude. Dans sa Petite catéchèse sur nature et grâce (1980), qui admet une totale hétérogénéité entre la nature et la surnature, Lubac affirme que « le couple naturel-surnaturel doit être conçu dans un premier temps dans un rapport d’opposition, c’est-à-dire d’altérité spirituelle et d’infinie distance, mais il se résout ensuite, si l’homme s’y prête, dans un rapport d’intime union. » (p. 37). Il n’y a donc plus d’exigence donc du Surnaturel par la nature. C’est ce que montre Jean-Yves Lacoste dans Le monde et l’absence d’œuvre où le surnaturel se découvre lié au naturel sans simplement s’y surajouter. La grâce rejoint la nature et non pas l’inverse (dans un pélagianisme à éviter). Libérer la grâce du surnaturel implique de laisser la nature être la nature : le désir de voir est en l’homme un « désir de nature ». L’athéisme a donc bien changé de visage : il n’est cet « athéisme tragique » des années 1940 ni « l’athéisme militant » des années 1970. Il est un athéisme « d’un genre nouveau » : « parce qu’il ne prétend pas décrire les « conditions actuelles de cette existence », le théologoumène (surnaturel) réhabilité dans les travaux menés entre 1947 et 1965 peut laisser intactes les herméneutiques heideggériennes de la facticité. E. Falque peut ainsi faire coïncider Métamorphose de la finitude, son essai écrit en 2004 avec Mystère du Surnaturel, ce qui lui impose de « passer le Rubicon », et de ne pas enclore Lubac dans la seule zone de la théologie, ni même d’enfermer Blondel dans le seul espace de la philosophie.
La question de la nature pure
La question de la nature pure fut la grande affaire de Lubac…Baius, Jansénius, puis Cajetan et Suarez sont, aux yeux d’Henri de Lubac, les initiateurs d’une « nature sans grâce » (Baius) et d’une « nature pure » (Cajetan) de sorte que l’état primitif d’Adam aurait été un état « purement naturel » sans être appelé à la « communion surnaturelle avec Dieu » : un état où l’homme serait remis à sa propre sagesse et réduit à ses propres forces. Le lecteur comprend ainsi que la nature pure est à la théologie ce que la finitude est à la philosophie, à savoir une possibilité d’être homme sans Dieu sans être un homme contre Dieu. Penser Adam sans aspiration vers Dieu, c’est faire de la tendance vers le divin un temps surajouté à la nature, et non pas un véritable surnaturel inscrit dans la nature. Le problème est celui de l’extrinsécisme. L’enjeu n’est pas de la nature pure, mais de la fin surnaturelle de l’homme naturel.
Lubac a montré comme la théologie s’est fourvoyée en ne distinguant pas nettement le surnaturel et le surajouté. Pourquoi ? « Un jour devait venir où le second de ces deux mots (surajouté) serait donné comme la définition du premier (surnaturel). Ce jour-là, pour toute une école – et presque toute l’Ecole – supernaturale sera superadditum naturae, non pas seulement au sens de bien surajouté au bien naturel, mais au sens de finalité surajoutée à la finalité naturelle. » (De Lubac, Surnaturel, chap. III, p. 375-394). Tout l’enjeu est là : car s’il devient « surajouté », le surnaturel pourrait bien devenir facultatif, voire optionnel – de sorte qu’il disparaîtra.
Alors à quoi tient le fond de la critique ? Il se tient moins dans l’accusation d’athéisme (contre Dieu) que dans l’érection de l’humanisme (à la place de Dieu). Quel est donc le véritable enjeu dans le cadre d’une « nouvelle lettre sur l’apologétique » ? Pour E. Falque, il ne faut pas le rechercher dans la négation de Dieu, mais de savoir plutôt qui et quoi on met à la place de Dieu : est-ce l’idole qu’on a forgée pour ne pas laisser paraître l’icône », pour reprendre les termes de Jean-Luc Marion dans L’idole et la distance (1977) : « Debout ! Fais-nous des dieux qui marchent à notre tête », exigen d’Aaron le peuple d’Israël en « exode » alors que Moïse tarde à revenir du mont Sinaï (Ex 3é, &). Le danger, en régime chrétien, n’est pas celui de l’insécurité, mais plutôt celui de la « mise en sécurité », y compris de Dieu sous la figure d’un faux dieu. L’hypothèse de la nature pure sera-t-elle alors complètement à invalider ?
Dans Métamorphose de la finitude, E. Falque note que « la conjecture de la nature pure conserve une certaine valeur heuristique : non pas créée sans la grâce, l’homme s’éprouve dans sa nature, indépendamment d’une telle évidence de la révélation de Dieu. Il rejoint ainsi son humanité, l’ensemble de nos contemporains capables de vivre sans Dieu. » Si pour E. Falque le concept de nature pure est acceptable, ce n’est pas en vertu de sa nécessité théologique, mais en raison de sa validité philosophique : « Atteindre le bord de la théologie pour savoir où et quand on est philosophe ; et se tenir sur la côte de la philosophie sans nécessairement tout attendre du paradis perdu de la théologie. » (p. 76). La valeur purement heuristique et philosophique de la nature pure n’en fait pas une vérité didactique et théologique. Il revient à Dieu seul de nous rejoindre, et de placer son désir de lui en nous et de nous transformer.
La résurrection change tout : l’expérience de la transformation
Falque choisit de défendre la position de la métamorphose dont le sens est le retournement du Surnaturel. Contre l’extrinsécisme, il se place à partir de la résurrection des morts, placée dès le commencement, comme le rappelle Dietrich Bonhoeffer dans Création et chute: « Le Dieu de la création, le Dieu du commencement absolu est le Dieu de la Résurrection. » (p. 32). Si la finitude est donnée au début, elle ne l’est pas en la même façon à la fin. Il y a un retournement du désir de Dieu que seule la Résurrection produit. Il ne s’agit plus alors d’accomplissement mais de conversion (de la finitude par le Surnaturel). La pure nature est un « philosophème » et en rien un « théologoumène », rappelle E. Falque, alors que c’est le contraire pour la Résurrection. Emmanuel Falque intègre la Résurrection au philosophème de la pure nature, et renverse ainsi la perspective : il y a maintenant ouverture à la transcendance et au désir de Dieu. Et cette ouverture rompt toute clôture de l’immanence, interdit toute préemption de l’infini sur le fini : « C’est par cela seul, dit E. Falque, que Dieu lui-même par sa métamorphose et la nôtre en lui, transfigure la structure du monde et met son désir de lui en nous. » (Métamorphose de la finitude, p. 150).
Contre l’humanisme, E. Falque refuse toute forme de glorification de l’humain qui prendrait lieu et place de la négation de Dieu, « dans une substitution d’autant plus dangereuse, précise notre auteur, que l’humanisme occuperait définitivement la place de l’athéisme comme son prolongement naturel, et consacrerait alors définitivement « l’utopie de Dieu » ou son « non lieu ». Produit monstrueux d’une foi qui aurait engendré son contraire : non plus un homme fait nativement pour Dieu, mais un Dieu fait exclusivement pour l’homme. » (p. 84).
Pour E. Falque c’est la Résurrection qui change tout : « Ce qui donc s’est produit pour le Verbe – sa propre métamorphose par le Père sous la force de l’Esprit – s’est donc aussi effectué dans le Verbe : c’est-à-dire pour nous-mêmes si tant est que nous nous tenons en lui. La Métamorphose de la finitude n’est pas uniquement la transfiguration de sa finitude à lui par le Père, mais la transformation de notre finitude en Lui sous l’appel du Père et la puissance de l’Esprit. » (Métamorphose de la finitude, p. 144). De même, dans Les Noces de l’Agneau, E. Falque ne cède en rien à l’humanisme. Dans la transsubstantiation de notre Chaos intérieur, de nos passions et de nos pulsions jusque dans le corps livré, le philosophe montre que le sacrifice eucharistique ne reconduit ni à l’homme ou au cosmos transfiguré ni à un état de la science encore plus avancé ; mais au Fils qui, dans sa relation au Père et sous la puissance de l’Esprit, vient uniquement nous incorporer.
Or s’il existe un a priori de l’athéisme qui ne souffre aucune contestation, et si le théologoumène surnaturel peut laisser intactes les herméneutiques heideggériennes de la facticité, y compris chez H. de Lubac, pourquoi alors le christianisme peut tout changer ?
Falque entreprend alors un dialogue avec Jean-Yves Lacoste qui admet que dans les conditions actuelles de cette existence, le désir du surnaturel ne soit pas objectivement perçu. Pour notre auteur, Lacoste est un penseur du « saut » à l’instar de Levinas, de Ricoeur et de Marion : « il y a un avant et un après, un monde « sans » Dieu et un monde « devant » Dieu, mais selon un vis-à-vis de l’ordre de l’opposition plutôt que de la transformation. » (p. 89). Est-ce à dire que l’homme sans Dieu est « sans avenir », quand bien même la liturgie n’annule pas les lois aprioriques de l’existence ?
Une autre conception de la temporalisation
Dans Note sur le temps, Jean-Yves Lacoste constate que ce qui constitue le monde comme monde est toutefois « l’oubli ou la rature de la création, la constitution d’un écart selon lequel la distance de l’homme par rapport à Dieu ne vaut plus que comme éloignement. » (p. 90). Il y a la facticité d’un côté, et l’homme devant Dieu de l’autre. Mais le révélé vient tout changer. Mais si J.-Y. Lacoste pense « le saut », E. Falque s’y refuse : « Le danger serait grand, confie-t-il dans le cadre d’une Nouvelle lettre sur l’apologétique, de partir de « l’homme devant Dieu » (coram Deo) pour viser l’homme sans Dieu. » (p. 89). E. Falque rejette ce « mode de transcendance de surplomb ». Pour lui, tout tient dans une autre conception de la temporalisation, dès lors qu’est accepté le passage à la théologie. Si pour E. Falque la « résurrection change tout », c’est le modèle de la transformation plutôt que de la rupture qu’il faut revendiquer : « On acceptera alors d’éprouver un Dieu qui vient expérimentalement, et pour nous, se donner. » (p. 92). Pour E. Falque la constance de la distance (Marion), de l’eschaton (Lacoste), de l’inespéré (Chrétien), ou de l’immémorial (Levinas), ne cesse de retarder la puissance de la transformation – ou plutôt de ne la regarder qu’à partir de la finalité. Et pourtant, comme nous le rappelle Augustin, « ton aujourd’hui, c’est l’éternité » (hodiernus tuus aeternitas). Et l’heureuse nouvelle de cette Nouvelle lettre sur l’apologétique se place du point de vue de cette éternité dont parle Augustin au livre XI des Confessions : « Si l’on part philosophiquement de la finitude, dit E. Falque, ou de notre commune humanité, une fois le Rubicon traversé, il ne faut pas craindre d’atteindre l’autre rive et de se laisser théologiquement et trinitairement transformer. » (p. 94).
Mais ce n’est pas uniquement à le penser (crédible), mais encore à le croire (croyable), que cela peut nous arriver. Et l’apologétique se dit ici « moderne » car il ne s’agit plus comme pour Blondel et Lubac, de revenir à l’apologia des anciens contre les hérétiques (On pense à Irénée et Tertullien). Car pour E. Falque il s’agit bien de dire « quelque chose qui compte pour ceux qui ne croient pas ». Et cela impose que « ceux qui ne croient pas comptent pour nous » sans que cela n’en reste à une pure façade. L’enjeu est donc bien celui d’un dialogue libre, et je suis reconnaissante envers Monsieur Falque qui fut mon professeur, d’avoir le courage de soulever un tel débat. Il est essentiel pour notre temps : car il prend à cœur la philosophie (le naturel) et le met en relation avec la théologie (le surnaturel), non dans un rapport de convenance ou dans une suppléance de l’une à l’autre, mais bien dans une dynamique féconde qui est tout l’art de cette nouvelle apologétique, il me semble : la relation vivante et féconde de la nature avec le surnaturel dans l’humble exercice journalier de philosopher et la motion de l’Esprit (le secours de la grâce de Dieu). Et ce rapport n’est jamais que de soi à soi, rappelle justement E. Falque, mais il est intersubjectif, il englobe la communauté humaine tout entière sans exclure l’un au détriment de l’autre, ou privilégier l’un plutôt que l’autre, mais en aimant, en écoutant, en discutant avec un esprit ouvert et hospitalier : ce qui peut être dit du Christ ailleurs que dans l’Eglise n’est pas secondaire mais tout aussi premier. Qu’il s’agisse de tableaux, de photos ou de films, il convient donc aussi de leur laisser la parole au même titre que la philosophie et la théologie : il convient de savoir « passer le Rubicon » sans violence, mais dans l’attention philosophique dont parlait Simone Weil dans La pesanteur et la grâce. Car la lumière de l’attention en pareille affaire est seule efficace, et elle n’est pas compatible avec une intention polémique. C’est tout le sens du « combat amoureux » qu’E. Falque défend, et qui déjoue toutes les formes intégristes et les discours sectaires, toutes nos tentations d’idolâtrie : « L’idolâtrie vient de ce qu’ayant soif de bien absolu, on ne possède pas l’attention surnaturelle et on n’a pas la patience de la laisser pousser. » (La pesanteur et la grâce). Après Weil, et avec Falque, nous ne sommes plus dans une philosophie séparée.
Comme nous le rappelle E. Falque, c’est la transcendance qu’il faut interroger aujourd’hui pour bien comprendre l’immanence. Certes de l’immanence blondélienne (ouverte sur le surnaturel) à l’immanence phénoménologique (réduite à l’ego chez Husserl ou au Dasein chez Heidegger), il n’y a aucune commune mesure, mais n’accusons pas trop vite l’immanence close sur elle-même d’immanentisme : le monde sans Dieu n’est pas un monde contre Dieu. Et tout le pari d’E. Falque est d’habiter le paradoxe de l’immanence : plus on lui donne de poids, plus devient puissante la transformation opérée par la transcendance divine. Car à trop faire du naturel une attente du surnaturel, on risque de manquer non seulement le naturel mais encore le surnaturel. Il y a finalement des proximités avec Montaigne chez E. Falque. Le philosophe du XXIème siècle pourrait dire comme le Gascon : « Notre grand est glorieux chef-d’œuvre c’est de vivre à propos. » (Essais III, 13). Tout est là : cette existence pleinement vécue dans son « très bas », cet existant qui reste à sa place et qui, comme tel, dans l’humble praxis du jour, comme celle d’écrire, d’enseigner, de discuter, peut se laisser rejoindre par le divin, s’ouvrir à l’inspiration, et devenir poète, « voyant » : « Donc le poète est vraiment voleur de feu, il est chargé de l’humanité, des animaux mêmes : il devra sentir, palper, écouter ses inventions ; si ce qu’il rapporte de là-bas a forme, il donne forme : si c’est informe, il donne l’informe. Trouver une langue. » (A. Rimbaud, Lettre à Paul Demeny dite « Lettre du Voyant »).
Comme le signifie Simon Hantaï dans son Ecriture rose (1958-1959) où les textes liturgiques et théologiques croisent les textes philosophiques (Hegel – Hölderlin – Schelling – Kierkegaard – Freud – Loyola – Goethe – Heidegger), où l’encrier de Luther croise le manteau de Marie, la croix grecque, l’étoile de David… à l’encre rouge, verte, violette et noire, la mystique est peut-être cette troisième voie qui rend possible la plus radicale métamorphose de l’Homme selon nous, un homme humble, libre et ouvert au dialogue, à l’instar de cette toile qui rassemble tout le sens de cette nouvelle apologétique dont E. Falque nous parle dans son livre. Simon Hantaï dira : le rose vient comme une promesse. Les textes sont indéchiffrables, invisibles, ils brûlent en rose sans se consumer. De tous ces milliers de mots qui s’effacent les uns sous les autres vient le rose. Voilà le mystique. C’est un tableau liturgique. Hantaï avait ce projet de réaliser en couleurs le royaume du Dieu de la philosophie.







