Les écrits de Alexandre Kojève sont hantés par la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel. Explicitement ou indirectement, ils se réfèrent quasi-exclusivement à cette œuvre que Kojève commentera tout au long de sa vie. Nous écrivons sa vie car en elle-même, l’œuvre propre de Kojève est difficile à discerner puisqu’en dehors d’articles divers, son ultime essai Le Concept, le Temps et le Discours en 1958, Kojève n’a de lui-même pratiquement rien publié d’achevé avec le premier volume de l’Essai d’une Histoire raisonnée de la philosophie païenne consacré aux Présocratiques sorti juste avant sa mort en 1968. Par ailleurs, sur le livre qui a fait sa réputation, selon Edmond Ortigues, Kojève aurait déclaré sans l’expliquer : « je n’ai jamais publié moi-même L’Introduction à la Phénoménologie de Hegel. La publication a été faite par un humoriste, Raymond Queneau. Ce point est très important pour moi » (p 14).
Mais eu égard à ce que dit Hegel dans la Préface à la Phénoménologie de l’Esprit, l’intention de Kojève a toujours été constante sur sa pratique philosophique quant à la « défaire de son nom d’amour du Savoir et d’être Savoir effectif[1] », au point qu’il a radicalement séparé Philosophie – comme accès au savoir – de la Sagesse – qu’il porte jusqu’à l’« omniscience » – ainsi que nous allons le voir avec Sophia.
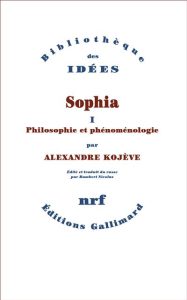 Nina Ivanoff, la seconde compagne de Kojève, a aidé à transcrire le début de ce texte rédigé en russe entre 1940 et 1941, ceci après avoir offert en 2001 à la Bibliothèque nationale le manuscrit original (toujours inédit en russe) initialement confié à Georges Bataille vers la fin de la Seconde guerre mondiale. Ce livre – qui serait aussi celui « d’une thèse de doctorat » (p 7) – se veut « une édition revue et corrigée de la Phénoménologie de Hegel à la lumière du marxisme-léninisme-stalinisme » (p 196). Et la Phénoménologie introduite dans ce premier tome annonce s’établir selon trois parties fondamentales : « six aspects ou six dimensions fondamentaux de l’existence humaine – allant par paire – sont décrits : le désir et la sensation ; la lutte et la perception (sensorielle), le travail et la réflexion (rationnelle) » (p 443). La deuxième partie serait ensuite consacrée à « l’existence historique de l’homme de l’Antiquité à nos jours » (p 447), et enfin, la troisième sur « l’existence post-historique de l’homme. Il y sera question du communisme, c’est-à-dire du futur, donc avec un caractère hypothétique » (p 448). Le présent livre introduit et prépare donc cette Phénoménologie dont l’objet est selon Kojève d’étudier « l’erreur » et « l’idéologie » (p 200), c’est-à-dire les « intérêts des classes dirigeantes » (p 183) pour accéder à la Vérité et au Savoir, tout en indiquant à la fin « que l’on pourrait franchement la sauter » (p 457) après avoir lu ce volume.
Nina Ivanoff, la seconde compagne de Kojève, a aidé à transcrire le début de ce texte rédigé en russe entre 1940 et 1941, ceci après avoir offert en 2001 à la Bibliothèque nationale le manuscrit original (toujours inédit en russe) initialement confié à Georges Bataille vers la fin de la Seconde guerre mondiale. Ce livre – qui serait aussi celui « d’une thèse de doctorat » (p 7) – se veut « une édition revue et corrigée de la Phénoménologie de Hegel à la lumière du marxisme-léninisme-stalinisme » (p 196). Et la Phénoménologie introduite dans ce premier tome annonce s’établir selon trois parties fondamentales : « six aspects ou six dimensions fondamentaux de l’existence humaine – allant par paire – sont décrits : le désir et la sensation ; la lutte et la perception (sensorielle), le travail et la réflexion (rationnelle) » (p 443). La deuxième partie serait ensuite consacrée à « l’existence historique de l’homme de l’Antiquité à nos jours » (p 447), et enfin, la troisième sur « l’existence post-historique de l’homme. Il y sera question du communisme, c’est-à-dire du futur, donc avec un caractère hypothétique » (p 448). Le présent livre introduit et prépare donc cette Phénoménologie dont l’objet est selon Kojève d’étudier « l’erreur » et « l’idéologie » (p 200), c’est-à-dire les « intérêts des classes dirigeantes » (p 183) pour accéder à la Vérité et au Savoir, tout en indiquant à la fin « que l’on pourrait franchement la sauter » (p 457) après avoir lu ce volume.
Dans l’économie générale des ouvrages de Kojève cités plus haut, la publication de ce livre est essentielle pour comprendre la structure de sa pensée inspirée par la pensée de Hegel, laquelle s’achève donc avec Le Concept, le Temps et le Discours – Introduction au Système du Savoir rédigé en 1952. Dans cette perspective, si l’on reprend la chronologie à partir de 1931 avec son important article « Note sur la langue et la terminologie hégéliennes », puis ses célèbres cours sur la Phénoménologie de Hegel de 1933 à 1938, on peut dire que Sophia (novembre 1940-1941) constitue la matrice générale permettant de comprendre le projet même de ce que Kojève veut essayer de développer. Sophia permet ainsi d’accéder à l’Histoire raisonnée de la philosophie païenne en l’articulant à l’Introduction au Système du savoir publiée en 1958. En effet, dans la préface de ce dernier ouvrage, de la même manière qu’avec Sophia, Kojève se propose d’effectuer une « mise à jour des textes hégéliens », Hegel « étant le premier sage, il est le dernier philosophe en général et le dernier « homme historique » au sens propre du mot[2]. »
Si l’on accepte cette assertion de Kojève qui revient pratiquement telle quelle dans Sophia, en plus de relire et répéter Hegel, qu’est-ce qui nécessite une réécriture de la Phénoménologie de Hegel ? Etant donné le statut que Kojève voit en Hegel, quel est le sens historique de cette reprise annoncée dans Sophia ? Kojève ne risque-t-il pas de tomber dans la « vanité » que Hegel dénonçait dans ses Cours d’Histoire de la philosophie en prévenant que « quand une époque traite tout historiquement, s’occupant toujours d’un monde qui n’existe plus, ne vagabondant que dans des tombes, l’esprit renonce à sa vie propre qui consiste à penser[3] » ? Et si par ailleurs « l’esprit s’approfondit en lui-même pour prendre conscience de soi [4]», comment Kojève peut-il donc légitimement penser Hegel en prétendant le reprendre et le mettre à jour ?
Sophia s’établit selon une structure dont les titres et sous-titres du livre se distribuent d’abord en « Idéal de la sagesse », « Savoir « parfait » comme sagesse », puis la « Philosophie comme chemin vers le savoir parfait », avant d’ouvrir sur une seconde partie dite « Phénoménologique » qui devrait donc être publiée prochainement. Il faut interroger le statut de ces phases pré-phénoménologiques, car si la première partie de l’ouvrage est consacrée au « Savoir parfait ou la « Sagesse » puis à « la philosophie comme aspiration au savoir parfait » (p 49), pourquoi Kojève distingue-t-il jusqu’à la séparation la perfection du Savoir qu’il identifie à la Sagesse d’une part, de la Philosophie comme simple aspiration, devoir-être vers le Savoir d’autre part, ce qui n’a pourtant pas de sens dans le Système du Savoir absolu de Hegel dont pourtant Kojève se réclame ? Pourquoi une telle séparation dans ce projet qui se veut inspiré ou tributaire du système hégélien et que, par ailleurs, selon Kojève « la fausseté c’est l’unilatéralité » (p 433) ?
- Omni-science, accès au Savoir et logique marxiste-léniniste-staliniste
Comme Kojève y reviendra souvent, la nécessité de se réclamer de Hegel, le « premier sage », tout en le mettant à jour tient tout d’abord à l’importance d’une prise de conscience de la vie humaine dont l’activité même est une actualisation philosophique qui exprime le « développement d’une époque historique donnée » (p 209) ; elle transforme donc l’auteur en Philosophe, ceci « en lui offrant la possibilité de répondre en principe de façon philosophique à toutes les questions qu’un homme appartenant à une époque donnée peut poser sur lui-même » (p 211). Par ricochet, elle transforme aussi le lecteur de cette Phénoménologie, donc son temps en « une époque qui est alors capable de prendre conscience de soi » selon cette fois-ci une « philosophie systématique » (ibid.). Or, le temps dans lequel Kojève écrit est celui de la Seconde guerre mondiale, en tant que russe vivant – certes à distance, à Paris – sous le régime de l’Union des républiques socialistes soviétiques dirigée par Staline.
Aussi cet essai s’intitule-t-il « introduction dialectique à la philosophie sur la base de la Phénoménologie de Hegel interprétée à la lumière du marxisme-léninisme-stalinisme », avec pour dédicataire le dirigeant de l’URSS dont l’activité est louée comme étant la « preuve » d’une vie philosophique communiste selon laquelle « non seulement il fait toujours (comme communiste) ce qu’il dit, mais il parle aussi toujours (comme philosophe) de ce qu’il fait » (p 61). Kojève précise cependant dans une note que le philosophe ne se soumet pas au représentant de la société en tant que tel mais à la société qu’il représente : « ce n’est pas parce que Joseph Vissarionovitch l’a dit que le philosophe accepte ce jugement. En effet, l’opinion personnelle de Joseph Vissarionovitch est tout aussi suspect que n’importe quelle opinion en générale » (note 119 page 494). Aussi, si l’entreprise du présent livre est de penser l’époque et justifier la société socialiste soviétique, il convient de déterminer et préciser selon quel type de reconnaissance historico-sociale cette vérité est « garantie », et selon quelle phase « révolutionnaire » celle-ci se « conforme » (ibid.) et s’exprime. Mais peut-être qu’ironiquement Kojève avoue lui-même qu’il vient un peu trop tôt pour cette garantie dans la mesure où selon lui « l’existence stable et durable d’un État prouve la vérité des idées sur lesquels il repose » (p 154).
Comment comprendre cet engagement de Kojève, et encore une fois, comment peut-il s’inscrire dans une phénoménologie qui prétend « mettre à jour » Hegel ? Quel que soit ce que connaissait ou non Kojève à l’époque, nous devons prendre la mesure de cette référence directe à Staline, et la manière dont elle est convoquée avec les débats internes au régime, ce qui nous introduira aussi au type Phénoménologique et dialectique que propose Kojève.
 La Sagesse dont parle Kojève s’identifie à une phase temporelle de l’histoire humaine. Elle s’incarne au niveau d’un régime politique avec ce que celui-ci représente et actualise en tant que prétention révolutionnaire puis établissement de son gouvernement. Et selon Kojève, cette Sagesse comme omniscience exhaustive a « son accès assuré en principe, grâce à la vérification technique et politique », c’est-à-dire la combinaison de la « connaissance cosmologique » et « anthropologique » (p 159). Ce qui signifie que la Sagesse s’accomplit temporellement comme Action, car « si l’homme n’est rien d’autre qu’une « action réalisée », alors on peut dire de lui qu’il est aussi du temps réalisé » (p 383) qui s’inscrit politiquement et techniquement dans le monde. Ce n’est donc pas un savoir abstrait ou même une généralisation structurelle idéale que vise Kojève, mais une connaissance concrète, totale, exhaustive et complète, inscrite historiquement dans le monde humain.
La Sagesse dont parle Kojève s’identifie à une phase temporelle de l’histoire humaine. Elle s’incarne au niveau d’un régime politique avec ce que celui-ci représente et actualise en tant que prétention révolutionnaire puis établissement de son gouvernement. Et selon Kojève, cette Sagesse comme omniscience exhaustive a « son accès assuré en principe, grâce à la vérification technique et politique », c’est-à-dire la combinaison de la « connaissance cosmologique » et « anthropologique » (p 159). Ce qui signifie que la Sagesse s’accomplit temporellement comme Action, car « si l’homme n’est rien d’autre qu’une « action réalisée », alors on peut dire de lui qu’il est aussi du temps réalisé » (p 383) qui s’inscrit politiquement et techniquement dans le monde. Ce n’est donc pas un savoir abstrait ou même une généralisation structurelle idéale que vise Kojève, mais une connaissance concrète, totale, exhaustive et complète, inscrite historiquement dans le monde humain.
Mais comment ne pas y voir là malgré tout qu’un simple idéal abstrait, un simple devoir-être, ou un « focus imaginarius » kantien dont le but est certes réel comme orientation, mais jamais réalisé, donc en principe inaccessible ? Si Kojève porte la Sagesse à ce paroxysme, c’est parce qu’il le lie au régime politique même, c’est-à-dire à l’ensemble des interactions humaines qui conditionne et organise concrètement le Savoir, autrement dit, au caractère essentiellement « social » du Savoir, au-delà du simple individu atomique sujet, à commencer par son seul son dirigeant. Le Savoir dont parle Kojève change donc de sens si l’on quitte l’apparence des expressions immédiatement cumulatives faites à l’échelle strictement individuelle du Savoir parfait conçu comme intégralité subjective. Il faut donc systématiquement interpréter l’omniscience dont parle Kojève selon sa production sociale générale et sa dynamique historico-dialectique. Pour donner un exemple de la manière de suivre Kojève sur ce point, voici un passage éclairant ses intentions sur le sens de l’identification de la Sagesse à l’omniscience, c’est-à-dire à la capacité à répondre de façon complète et sensée à toutes les questions possibles :
Descartes saisissait la dialectique comme un processus cognitif purement subjectif se déroulant dans la conscience d’un philosophe isolé du monde. Au contraire, en revenant à Platon, Hegel insiste sur le caractère social de la dialectique, qui apparaît comme le résultat de la communication entre les hommes. (…) l’homme isolé du monde naturel et du monde historico-social, ne saurait atteindre le savoir, mais ne pourrait même pas se faire des opinions. (…) l’humanité toute entière est le sujet et l’objet du processus dialectique aboutissant au savoir. La dialectique n’est plus un processus purement théorique, idéal ou relevant du seul discours (logique) mais c’est un processus actif ou réel. Le philosophe ne crée pas la dialectique par ses discours. Dans la partie dialectique de sa philosophie, il prend seulement conscience de ce processus actif-et-réel d’une part, social-et-historique de l’autre. Il décrit ainsi ce processus qui transforme les opinions humaines en savoir et qui, en dernière instance, conduit l’homme à la vérité. (p 170-171).
La vérité que comprend la Sagesse doit donc effectuer philosophiquement deux dépassements principaux dans la subjectivité : d’une part l’apparence du moment historique (p 411), et d’autre part le simple accomplissement théorique de la pensée de Hegel, lequel, selon Kojève, ne sert que de « de point de départ au processus actif et historique qui réalise l’accomplissement progressif et conscient du communisme » (p 49).
Le premier dépassement est de l’ordre du travail phénoménologique, et le second est une prise de conscience historique, laquelle se compose dans son ensemble de deux processus parallèles, c’est-à-dire se concrétise de la façon suivante :
1. du processus réel-et-actif et sociopolitique conduisant à instaurer le régime sociopolitique « idéal » et définitif sur la terre entière ;
2. et du processus idéal-et-cognitif correspondant idéalement au premier, dépendant de lui et incluant la philosophie comme expression de la conscience de soi de cette humanité qui réalise le premier processus. » (p 50).
Cet accomplissement de la Sagesse est adossé à une réalisation historique en cours en URSS (1940-41) intrinsèquement liée, selon Kojève, à la phase « socialiste » dont le dépassement advient avec la société sans classe du communisme, fruit de la prise de conscience révolutionnaire généralisée où le prolétaire « connaît ses intérêts réels » (p 45), et connaît les causes qui le poussent à agir (p 40). Cette prise de conscience qui consiste à répondre à toutes les questions possibles (p 212) est donc révolutionnaire dans sa lutte et son travail vers ce que Kojève appelle « la société communiste qui est du point de vue marxiste-léniniste-staliniste, l’idéal définitif de toute l’humanité » (p 38).
Mais tout en montrant que cet idéal est Sagesse concrète, Kojève continue à le thématiser systématiquement comme accès, parce qu’il est lié à l’activité strictement philosophique. Il est alors en tant que tel (c’est-à-dire abstrait), toujours individuel et subjectif dans sa contemplation « inactive » (p 45). Comment faire de la Philosophie une pratique « active » malgré cet accès contemplatif à la Sagesse ? Faire de la Philosophie est-il condamné à la seule préparation à la Sagesse ?
La solution toute prête de Kojève réside dans la méthode dialectique hégélienne (qu’il présente presque constamment à la façon de la triade thèse-antithèse-synthèse d’un Victor Cousin). Et cependant, Kojève continue à la considérer elle aussi comme un simple idéal logique, donc encore une fois comme un simple « accès » qu’il expose selon les termes kantiens de « condition de possibilité » (p 264) : mais alors où est donc la réalisation qu’il prétend reprendre et mettre à jour ? Ne serait-ce pas plutôt là une sorte de projection future liée à la prochaine « société » « communiste » simplement postulée ?
Nous insistons sur ce point car Kojève retrouve ce problème régulièrement, notamment au sein de débats néomarxistes-léninistes du régime stalinien dont il tente à chaque fois de transcender les termes avec la dialectique, mais qu’il est difficile de ne pas les considérer in fine comme artificiels. Nous citons ici entièrement un passage qui résume une bonne partie des tensions de cet ouvrage :
l’observation de la dialectique historique montre que l’idée révolutionnaire ne s’intègre jamais entièrement à l’idéologie post-révolutionnaire. Les hommes « ayant fait » la révolution sont presque aussi hostiles à ses résultats définitifs que les tenants de l’ancien régime sociopolitique. Pourquoi ? Précisément parce que le nouvel État n’accueille pas entièrement ce qu’ils considéraient comme définitivement vrai. En effet, le résultat d’une révolution ne penche jamais complètement en faveur de l’« antithèse » révolutionnaire au détriment de la « thèse » prérévolutionnaire. Au contraire, ce qui est établi est une certaine « synthèse » dans laquelle la « thèse » et « l’antithèse » se neutralisent pour ainsi dire mutuellement, entrent dans un « composé chimique », et forment un nouveau corps sociopolitique. Que les « purs » révolutionnaires voient dans la synthèse une « trahison » <note de l’éditeur : allusion nette à Trotsky et à son essai La Révolution trahie > de l’idée révolutionnaire, il n’en demeure pas moins que le philosophe considérera comme savoir vrai uniquement les aspects que cette synthèse a conservés. (…) La « vérité » post-révolutionnaire, dans son ensemble, ne sera à nouveau pour la philosophie qu’une idéologie et non un savoir définitif. Néanmoins, on peut considérer que ce qui a été conservé de l’idée révolutionnaire sous cette synthèse est un savoir, certes partiel, mais définitif. (P187-188)
Plus loin, étant donné le dédicataire de ce livre, on est probablement là encore à la limite de l’idéologie (dans tous les sens du terme) quand Kojève affronte le sens léniniste-staliniste de sa « dialectique » révolutionnaire :
Il ne fait aucun doute que la négation révolutionnaire d’une effectivité donnée ouvre, par l’intermédiaire des révolutionnaires qui la nient, des possibilités illimitées. Il ne s’agit, toutefois, que de possibilités. En revanche, dans l’effectivité les révolutionnaires sont limités par le caractère positif du régime nié par la révolution. La tentative de réaliser toutes les possibilités posées dans la négation conduit au désastre (le « trotskisme »). Leur indétermination et leur infinité vont à l’encontre des lois de l’existence (finie) et, partant, une telle tentative (« utopique ») conduit au « non-être ».
En ce sens la logique formelle a raison : une « pure » négation ne peut exister. Cependant, dans la mesure où le révolutionnaire n’est pas un utopiste, c’est-à-dire pour autant qu’il tient compte des circonstances données (Lénine-Staline contre Trotsky), il réalise la négation. Mais les circonstances en question limitent la possibilité et, ce faisant, déterminent le résultat de la négation. Et, par conséquent, le résultat de la Révolution ne se répète pas être la non-existence de l’Etat (l’anarchie), mais une nouvelle existence – pleinement déterminée – de celui-ci : non-A s’avère être B (c’est-à-dire in fine C). (P 345-346)
On peut déjà se demander si Kojève est cohérent avec ce qu’il écrit ensuite : « La liberté, c’est le choix de ce qui n’est pas. (…) C’est pourquoi le choix de ce qui n’est pas est conditionné non pas par ce qui est choisi, mais par celui qui choisit. Réaliser ce qui n’est pas encore, c’est l’action » (P 375). Si l’on compare cela à ce qu’il dit plus haut, pense-t-il donc en fait que la révolution n’est pas une Action ? Si la liberté est choix de ce qui n’est pas, ne porte-t-elle donc pas d’emblée, comme résultat réel, cet acte même ? ou bien alors, si elle n’est pas plus qu’une ouverture de possibles, donc de déterminations sans choix réels, alors elle n’est pas plus qu’une illusion.
Cette finitude que Kojève pense via la logique formelle contre le trotskysme a un sens très ambivalent puisque chaque détermination étant finie, la négation qu’elle porte n’a pourtant, dans un processus dialectique, plus de sens en termes de limite unilatérale ou définition « donnée ». Et c’est pourtant semble-t-il ce sens que Kojève pose quand il est question des « limites » extérieures à la possibilité d’un acte « libre » qu’il réinscrit dans et selon l’état « naturel » des « lois de l’existence (finie) », c’est-à-dire une condition, un donné « non-dialectique » « qui en détermine le résultat », alors même que, par exemple, il en dénonce la cohérence quand il est question de la liberté de l’homme comme négativité dont le sens est identique au processus révolutionnaire (p 366). Si Kojève était sur ce point fidèle à Hegel, pourquoi n’a-t-il pas pensé de même que « la conscience est pour soi-même son propre concept, ce qui fait qu’elle est immédiatement dépassement du borné, et donc, étant donné que ce borné lui appartient, dépassement de soi-même [5]» ?
Le sens de cette finitude tient donc d’abord à la part de logique non-dialectique donc non-hégélienne que Kojève veut garder selon des canons formels « classiques » où le « non-dialectique » est la « loi positive » de « l’être naturel » (note 192 p 518). Mais à la fin de sa longue note 191, Kojève indique pourtant que « L’homme « hégélien » ne dépend pas du monde naturel », tout en reprochant juste après à Hegel d’être tombé dans un « excès dialectique » (p 518). Kojève dira ensuite sans plus de détail que « Hegel s’est trompé » à cause de cet excès : « cette erreur l’a conduit à son monisme dialectique (erroné), c’est-à-dire à affirmer que tout être quel qu’il soit est dialectique » (note 194 p 518), alors même qu’auparavant Kojève écrivait que « ce n’est pas la conscience de l’être mais l’être même qui est dialectique » (p 301).
Si l’on reprend les évocations des débats Staline/Trotsky sur la Révolution permanente ou le renforcement de l’État, ou bien encore sur la destruction ou conservation de la famille (p 179), la description de la Phénoménologie de l’Esprit aurait pu semble-t-il dialectiquement aider Kojève à penser les deux côtés – et les reprendre, si l’on peut dire – notamment quand il est question de la guerre qui
est l’esprit et la forme en lesquels le moment essentiel de la substance éthique, la liberté absolue de l’essence éthique radicalement autonome par rapport à toute existence, est donné dans son effectivité et son avération. Dès lors que, d’un côté, elle fait sentir la force du négatif aux systèmes singuliers de la propriété et de l’autonomie personnelle, ainsi qu’à la personnalité singulière elle-même, cette essence négative, précisément, s’élève d’autre part, dans la guerre, comme conservatrice du Tout [6]
D’autre part, cette réinsertion de la logique formelle qui prédétermine le négatif a, au final, pour conséquence de donner un sens unilatéral à la Sagesse que Kojève veut apparemment tenir comme réalisation mais dont l’accomplissement de l’idéal n’a de sens que hors, ou comme acte de la « fin de l’Histoire ». Or, si son processus logique n’a qu’un sens « fini », alors il fait face à l’accomplissement tout en le niant, mais d’une façon purement formelle, et en tant que tel, il ne peut donc pas pré-déterminer une quelconque réalisation. Kojève est pris dans le reproche qu’il faisait à Hegel. Ce qui donne non plus une déduction, mais plutôt, disons-le encore, une sorte de postulat imaginaire dans une projection fictive qu’il répète régulièrement en ces termes :
l’étude du caractère de la dialectique historique montre qu’il s’agit d’un processus fini. Prise à l’échelle de l’humanité, la lutte révolutionnaire édifie une société dépourvue de classe, une société communiste dans laquelle toutes les contradictions sociopolitiques seront éliminées.
On peut donc dire que le savoir détenu par cette société ne sera autre que l’omni-science, car l’homme qui lui appartiendra cessera de changer après avoir réalisé dans cette société l’ensemble de ses possibilités de vie. (p 191)
- Phénoménologie et Fin de l’Histoire
A cause de cette considération unilatérale de la dialectique comme « processus fini », Kojève en vient donc à exiger et convoquer dans ce système sa célèbre et nécessaire « Fin de l’Histoire ». En d’autres termes, si l’on veut accepter un instant ce paradoxe, cette nécessité est une sorte d’inconditionnelle condition où la société sans classe actualise le « savoir parfait », la « Sagesse » ou « l’omni-science », parce qu’elle est enfin dans un état « stable » vis-à-vis des réalisations des possibilités, où « l’opinion » n’existe plus (p 184), où chacun travaille effectivement, c’est-à-dire selon ses besoins sociaux réels puisque les intérêts et les opinions des classes dirigeantes sont dépassés par le travail effectif du Savoir, Savoir dont la généralisation concrète a un sens nécessairement anhistorique selon Kojève. Il croit voir cette fin ultime dans sa lecture de Hegel, en lui reprochant souvent même de l’avoir vu « trop tôt », ou bien de n’être encore qu’un moment, mais comme simple « accomplissement logique du processus idéel historique du développement de la philosophie » (p 49), donc une projection formelle comme indiquée plus haut.
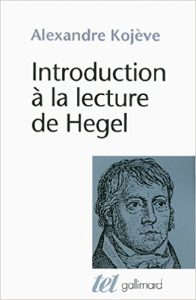 Ce qui est difficile à tenir, c’est que dans cet état anhistorique d’omni-science, alors même qu’ « en dernière instance, le processus dialectique doit aboutir à un savoir qui ne se prête déjà plus à un traitement dialectique » (p 168), Kojève considère que l’on doit aussi y retrouver des problématiques de types « historiques » puisque l’omniscience comprend (et com-prend) également le faux, donc une forme de « savoir partiel » (ibid.) : si la philosophie dépasse l’opinion de classe, elle départage aussi le vrai du faux (p 185), et cela appartient donc in fine au Savoir parfait, même si cela est su hors Histoire. Jusqu’à son dernier ouvrage, en se voulant fidèle à Hegel, Kojève a tenu à cette nécessité de la « Fin de l’Histoire » ; et dans cette perspective, tout en prenant réellement en compte certains éléments de la pensée hégéliennes, il a rendu ceux-ci très problématiques, par exemple dans Le Concept, le temps et le discours :
Ce qui est difficile à tenir, c’est que dans cet état anhistorique d’omni-science, alors même qu’ « en dernière instance, le processus dialectique doit aboutir à un savoir qui ne se prête déjà plus à un traitement dialectique » (p 168), Kojève considère que l’on doit aussi y retrouver des problématiques de types « historiques » puisque l’omniscience comprend (et com-prend) également le faux, donc une forme de « savoir partiel » (ibid.) : si la philosophie dépasse l’opinion de classe, elle départage aussi le vrai du faux (p 185), et cela appartient donc in fine au Savoir parfait, même si cela est su hors Histoire. Jusqu’à son dernier ouvrage, en se voulant fidèle à Hegel, Kojève a tenu à cette nécessité de la « Fin de l’Histoire » ; et dans cette perspective, tout en prenant réellement en compte certains éléments de la pensée hégéliennes, il a rendu ceux-ci très problématiques, par exemple dans Le Concept, le temps et le discours :
Le Système du savoir hégélien identifie donc le Concept et le Temps, et on verra que c’est précisément cette identification du Temps et du Concept qui distingue le Savoir propre à la Sagesse (Sophia) de toute Philo-sophie quelle qu’elle soit, qui, n’étant pas encore Sagesse, sépare le Temps, où elle évolue en tant que recherche du Concept uni-total auquel elle aspire comme au terme final de son évolution, de ce Concept lui-même, qui est pour elle, par définition, au-delà du Temps auquel elle a elle-même affaire.[7]
En fait, Kojève tient peut-être aussi à cette idée parce qu’il demeure attaché aux termes classiques des débats qu’il a pu avoir avec notamment Léo Strauss[8] dont le dialogue sur la tyrannie exemplifie les tensions, notamment sur le risque du scepticisme que Kojève veut sincèrement éviter et dépasser. Et dans Sophia, Kojève accuse régulièrement de « scepticisme total » ou de « positivisme sceptique » les « hégéliens bourgeois » qui refusent son concept de Fin de l’histoire parce qu’ils lui préfèrent l’idée d’un développement et d’une « poursuite éternelle » du processus historique (p 183). Ceux-ci refusent l’idée même de vérité et de « savoir définitif », et n’en font selon Kojève qu’une « opinion sociale » (ibid.). Si selon Hegel « le temps est, certes, l’action corrosive du négatif, mais l’Esprit est lui-même tel qu’il dissout tout contenu déterminé[9]», l’unilatéralité de cette idée de « Fin de l’histoire » comme état « stable », sans changement qui garantit la vérité même du discours actuel (donc partiel), et du Savoir comme raison de son développement, tout cela semble cependant difficile à tenir en dehors des débats avec Strauss dont nous reproduisons ici un extrait qui résume et éclaire sur ces points l’argumentation générale de Sophia :
si l’on admet l’athéisme radical hégélien d’après lequel l’Être lui-même est essentiellement temporel (Être=Devenir) et se crée, en tant que révélé discursivement, au cours de l’histoire (ou en tant qu’histoire : Être révélé = Vérité = Homme = Histoire), et si l’on ne veut pas sombrer dans le relativisme sceptique qui ruine l’idée même de Vérité et donc de sa recherche ou de la Philosophie, il faut fuir la solitude et l’isolement absolus du « jardin » ainsi que la société restreinte (solitude et isolement relatifs) de la « République des lettres » et fréquenter, comme Socrate, non pas les « arbres » et les « cycades », mais les « citoyens de la Cité » (cf. Le Phèdre). Si l’Être se crée (« devient ») au cours de l’Histoire, ce n’est pas en s’isolant de celle-ci qu’on peut le révéler (le transformer par le Discours en Vérité que l’homme « possède » sous forme de Sagesse). Pour le faire, le philosophe doit au contraire « participer » à l’histoire[10]
Si ce raisonnement fonctionne au niveau historique sur la nécessité du dialogue – contre le mépris épicurien, l’isolement sceptique et les soliloques stoïciens – et si cela reste à peu près cohérent au niveau restreint du conseil philosophique sur la tyrannie (nous disons « à peu près » puisqu’au final, Kojève fait du Savoir et de l’Action un « conflit sans issu » de l’époque moderne en se référant là-dessus aux tragédies de Faust et Hamlet[11]), cela semble en revanche condamner jusqu’à la prétention à l’interprétation hégélienne. Pour le dire plus grossièrement, le problème qui se pose, c’est que Kojève identifie le sens de l’Être au Temps, mais il n’en comprend le sens vrai que dans la nécessaire négation absolue de cette identification, la Fin de l’Histoire.
A notre humble avis, cette nécessité montre que Kojève en reste à un mode de pensée issu de la représentation, qui thématise le Savoir de façon unilatérale comme « présence donnée », alors que la pensée spéculative travaille le sens de son surgissement comme « don de la présence[12] ». Et par voie de conséquence, Kojève indique aussi qu’à ce stade, il ne sort pas du dispositif conscience-objet, dont il reproduit une phénoménologie selon la « faculté » de type kantienne, comme possibilité et épuisement (ou remplissement) de celle-ci. Kojève l’écrit clairement :
Le thème de la phénoménologie coïncide avec le thème des trois Critiques de Kant. Leur objet est le savoir humain et la cognition qui conditionne ce dernier. C’est Kant qui est le premier à avoir formulé clairement la proposition suivant laquelle le savoir philosophique est impossible sans la connaissance préliminaire de ce qu’est la connaissance et de ce qu’est la cognition qui y conduit. (p 241)
Certes, plus loin, Kojève conclu : « Kant établi une distinction parfaitement juste entre la connaissance et la réalité que la cognition exprime. Mais il a maintenu cette séparation. » (p 243). Peut-être que le prochain livre sera différent de cette introduction, mais le problème, c’est qu’à ce stade, Kojève a thématisé exactement de la même manière sa phénoménologie selon le maintien de cette séparation. En un sens, et à « ce stade historique » de la « conscience », il est fidèle à son interprétation de Hegel comme il est rapporté dans ses cours d’entre-deux guerres : « l’aspect « métaphysique » de la PhG décrit la Conscience en tant que révélant l’Objet, mais non pas l’Objet lui-même révélé par la Conscience. (…) la Conscience qui se sent être opposée à l’Objet lui est réellement opposée en tant que Sujet réel, c’est-à-dire en tant qu’Homme[13] » : et dans Sophia, Kojève maintient partout cette configuration sujet-objet dans un sens kantien où connaissance et « « réalité » » procèdent d’une séparation d’entendement radicale et non dialectique.
Pourquoi Kojève en est-il arrivé à ce genre d’écriture et d’étude tout en continuant à se réclamer de Hegel ?
En dehors de la crainte du relativisme et du problème du scepticisme que pose l’identification du Temps à l’Être, il y a également la manière dont Kojève a voulu réexposer la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel par souci pédagogique : dans la note 137, il indique avoir lu ce livre « quatre fois » « sans comprendre de quoi il était question » (p 499). Toujours par souci de compréhension, son projet est de réécrire une Phénoménologie qui propose une méthode d’exposition qui distingue ce que Hegel a su styliser dialectiquement. Avec une honnêtement désarmante, Kojève développe plus loin les problèmes structurels que cela pose vis-à-vis de sa lecture personnelle et de sa propre reprise de Hegel dont l’
extraordinaire talent stylistique lui a permis d’écrire son livre de telle manière que presque chaque phrase décrit simultanément (en fonction de l’interprétation que l’on en fait) à la fois une étape du développement du savoir découvrant la réalité et un élément de l’aspect du réel qui se découvre dans cette étape du savoir. En outre, cet aspect est décrit simultanément sur un plan ontologique et sur un plan cosmologique. La Phénoménologie de Hegel prépare non seulement la possibilité du savoir, mais fournit aussi le matériel pour le mettre en œuvre dans la philosophie systématique. Mais cette manière d’exposer les choses rend le livre pratiquement illisible. C’est pourquoi j’ai séparé les deux aspects. Or puisqu’une exposition claire et largement accessible du second aspect aurait au moins doublé ce livre, j’ai refusé d’y exposer celui de la réalité. Certes, je serai contraint dans la partie systématique de reconstituer chaque fois l’aspect réel de l’étape correspondante. Cependant, il me semble que procéder ainsi facilitera la compréhension de la Phénoménologie même, mais aussi de la logique de la Cosmologie.
Malheureusement, je ne suis pas parvenu à exclure complètement l’aspect réel, autrement dit ma Phénoménologie n’est pas parfaitement homogène. (Note 144 page 501)
Si l’on suit cette note, nous avons donc avec Sophia le témoignage d’un échec stylistique avoué et l’annonce d’une partie Phénoménologique qui risque fort d’être unilatérale.
Conclusion :
Kojève veut concrètement créer par l’écriture d’une Phénoménologie un état produisant un « type d’existence humaine conscientisé » (p 295) qui doit aider, par sa lecture, à faire accéder au Savoir, c’est-à-dire à la Sagesse, à l’omniscience. Son livre Sophia, dont encore une fois nous n’avons pour le moment que le premier tome en ce début d’année 2026, veut prendre en compte les conditions d’existence passées et présentes de l’époque de sa rédaction pour que leurs compréhensions en produisent de nouvelles, travaillent à de multiples prises de conscience, et luttent pour être aptes à l’ultime moment de la Sagesse, c’est-à-dire à la Fin de l’Histoire. Ce processus de prise de conscience généralisée est dialectique selon Kojève, dans la mesure où « la dialectique n’est rien d’autre que cette interaction prise dans son ensemble, c’est-à-dire l’interaction comprenant ensemble l’homme qui produit l’interaction et le monde historique que l’homme a produit » (p 317).
Mais au-delà des remarquables talents pédagogiques de Kojève, de la variété cultivée de ses analyses, et de l’originalité de ses exemples foisonnants pour aborder n’importe quel concept ou figure de l’histoire de la philosophie, le problème principal avec Sophia, c’est que Kojève veut produire cette interaction par une reprise et une réécriture de Hegel, tout en reprochant à Hegel d’avoir « refusé de faire de la dialectique un intermédiaire pour trouver la vérité philosophique et <Hegel> se mit à y voir uniquement un objet de recherche philosophique » (p 305). Ainsi, l’exposé de Hegel que Kojève a voulu réécrire en souhaitant le rendre compréhensible pour et selon les besoins de sa cause, Kojève n’a pu le faire qu’à l’aide d’incompréhensions du système hégélien. Il y a là une honnêteté indéniable et encore fois, peut-être qu’il faut encore attendre la suite de ce tome pour juger réellement cette œuvre, puisque la Phénoménologie « en étudiant l’idéologie et les erreurs, se donne pour but de trouver le savoir et la vérité. » (p 200).
A ce stade cependant ce qu’il reste pour le moment de ce volume introductif et de ses reprises de Hegel, c’est l’aveu d’insuffisances que Kojève admet lui-même dans ses notes de bas de page, en annonçant proposer une phénoménologie partielle et abstraite, dans une écriture de son processus unilatérale. Et peut-être est-ce là l’intérêt principal de la lecture de ce livre, de cette lecture de Hegel, ainsi que de la pratique philosophique en générale avec tout ce que cela engage pour atteindre ce qui fut (ou sera encore) pour longtemps le premier et le dernier mot de la Sagesse : savoir que l’on ne sait rien.
***
[1] Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, Préface VI-VII, trad. J-P Lefebvre, ad. Aubier 1991, page 30
[2] Kojève, Le concept, le Temps et le Discours, Introduction au Système du Savoir, Préface, ed. Gallimard Nrf, pages 31 et 30
[3] Hegel, Leçons sur l’histoire de la Philosophie 1. Introduction d’après les leçons de Hegel (1823-1827-1828), A, II Application de ces déterminations à l’histoire de la philosophie, ed. Gallimard Nrf coll. Idées, page 157
[4] Ibid.
[5] Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, Introduction, 12, trad. Lefebvre, ed. Aubier (1991), page 85
[6] Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, Introduction, 12, trad. Lefebvre, ed. Aubier (1991), page p 324
[7] Kojève, Le Concept, le temps et le discours, op.cit, page 68
[8] « Si constamment en mouvement que soient toutes choses, le niveau le plus élevé auquel puisse atteindre la pensée humaine – mouvement et repos – est stable… Si le mouvement et le repos sont les choses les plus anciennes, ils dépassent ou incluent les dieux. » Léo Strauss, La cité et l’homme, chapitre III « Guerre des Péloponnésiens et des Athéniens de Thucydide », page 205
[9] Hegel, La raison dans l’Histoire, ed. Plon coll. 10/18 (1965) page 209
[10] Strauss, De la tyrannie, Tel, Gallimard, (1983), p 242-243
[11] Strauss, De la tyrannie, Tel, Gallimard, (1983), p 264
[12] Jean-Luc Nancy, L’inquiétude du négatif, « Devenir » page 18
[13] Kojève, Introduction à la lecture de la Phénoménologie de Hegel, cours 1938-39, coll. Tel, page 369







