A. Le scepticisme au Moyen Âge ? Explication de la démarche
Dès les premières lignes de l’introduction de son ouvrage1, Ch. Grellard ne manque pas de signaler que l’histoire du scepticisme médiéval reste très largement une terra incognita. Tout se passe en effet comme si cette école de pensée, en particulier son versant néo-académicien, avait allègrement sauté par-dessus le Moyen Âge, pour ne retrouver sa vitalité qu’à la Renaissance et à l’époque Moderne. Un tel phénomène n’étonnerait d’ailleurs que peu, ironise encore Ch. Grellard, car comment une période aussi dogmatique et hiératique que le Moyen Âge aurait-il pu assimiler une démarche qui lui serait essentiellement et irrémédiablement exogène2.
La démarche de l’auteur vient démentir ces préjugés historiographiques en s’appuyant sur deux axes d’analyse. Le premier concerne la question de la transmission de la doctrine sceptique « originelle » (pyrrhonisme, mais surtout académisme, comme nous le verrons) et son intégration au sein des œuvres philosophiques médiévales. Cette thématique de l’héritage textuel et de la préservation des écrits antiques dans leurs singularités et leur hétérogénéité, est indissociable de ce que l’on a nommé « humanisme ». Pourtant, toute la dynamique de Jean de Salisbury et la renaissance médiévale du scepticisme consiste, comme son titre l’indique, à patiemment montrer qu’une méthodologie comparable est encore ou déjà3 à l’oeuvre chez Jean de Salisbury, et de surcroît de manière consciente et explicitement thématisée.
Le second axe, annoncé pour un prochain livre, concerne ce que Ch. Grellard ne craint pas de désigner sous l’expression de « problème sceptique », qu’il décrit comme « la mise au jour des voies par lesquelles les médiévaux, par accumulations successives des arguments, et sédimentations textuelles, enrichissent le concept de scepticisme au point de rendre possible le passage d’une conception antique à une conception moderne du scepticisme4 ».
Dès les premières pages du présent ouvrage, le lecteur se fait donc une idée de la tâche, colossale, qui attend le chercheur en ces parages : il s’agit d’explorer le terrain encore peu balisé de la thématique du scepticisme médiéval, mais aussi d’établir de façon concomitante une méthode de recherche assez ouverte pour ne pas laisser passer quelque indice ténu, et néanmoins suffisamment informée pour détourner des faux-semblants. Dans son introduction, l’auteur évoque donc en toute transparence son objet de recherche, la genèse de sa construction, mais également l’inévitable conflit entre ce que P. Vignaux a nommé la méthode a priori et la méthode a posteriori5. Conscient des risques évidents de la première méthode (amoindrissement des enjeux proprement philosophiques, contresens historiques), l’auteur nous invite donc à survoler une première fois avec lui les particularités du scepticisme médiéval. Il en distingue à grands traits deux tendances : l’une, courante et insérée dans une tradition scolaire, qui use du scepticisme comme d’une arme méthodologique contre le matérialisme avec Saint Augustin comme guide de lecture, et l’autre, plus en marge de l’institution scolaire, humaniste, probabiliste et éthique, sous le patronage de Cicéron, et à laquelle se rattache clairement Jean de Salisbury.
La présentation liminaire de la vie et de l’oeuvre de Jean de Salisbury par Christophe Grellard est succincte. On pourrait tout d’abord s’en étonner, tant sont nombreuses les citations, provenant de plusieurs ouvrages différents (Policraticus6, Metalogicon7, Entheticus8, Correspondance9…) et importante la considération de la constitution même de l’oeuvre de Jean pour comprendre la démarche que reconstruit Christophe Grellard. En réalité, la rapide exposition qui court sur les pages 25 à 33 suffit pour entrer dans le vif su sujet, puisque l’auteur distillera ensuite au fil des analyses les éléments nécessaires pour comprendre la personnalité philosophique de Jean de Salisbury.
Ainsi, dans la première partie de l’ouvrage, qui en comprend quatre, Ch. Grellard expose les sources sceptiques antiques dont a pu disposer Jean. La profusion de références et de citations que l’on trouve dans son œuvre doit être réévaluée avec minutie nous prévient-il : si l’on peut examiner les catalogues des bibliothèques auxquelles Jean a pu avoir accès, on ne peut pas connaître avec certitude les ouvrages qu’il a consulté et leur version, et la présence de citations dans son texte ne signifie pas non plus obligatoirement qu’il ait consulté l’ouvrage dans son intégralité, mais peut-être davantage des florilèges. Commence alors une délicate entreprise de dénombrement et analyse des occurrences, en parallèle avec une lecture plus globale de l’oeuvre de Jean de Salisbury. A la lumière de ce travail, Christophe Grellard est en mesure d’identifier les sources directes principales de Jean : Aristote (Catégories et Topiques), Platon (texte partiel du Timée dans la version de Calcidius), mais surtout Cicéron (Des devoirs), auquel il faut ajouter Augustin (La cité de Dieu, De la doctrine chrétienne, Contre les académiciens).
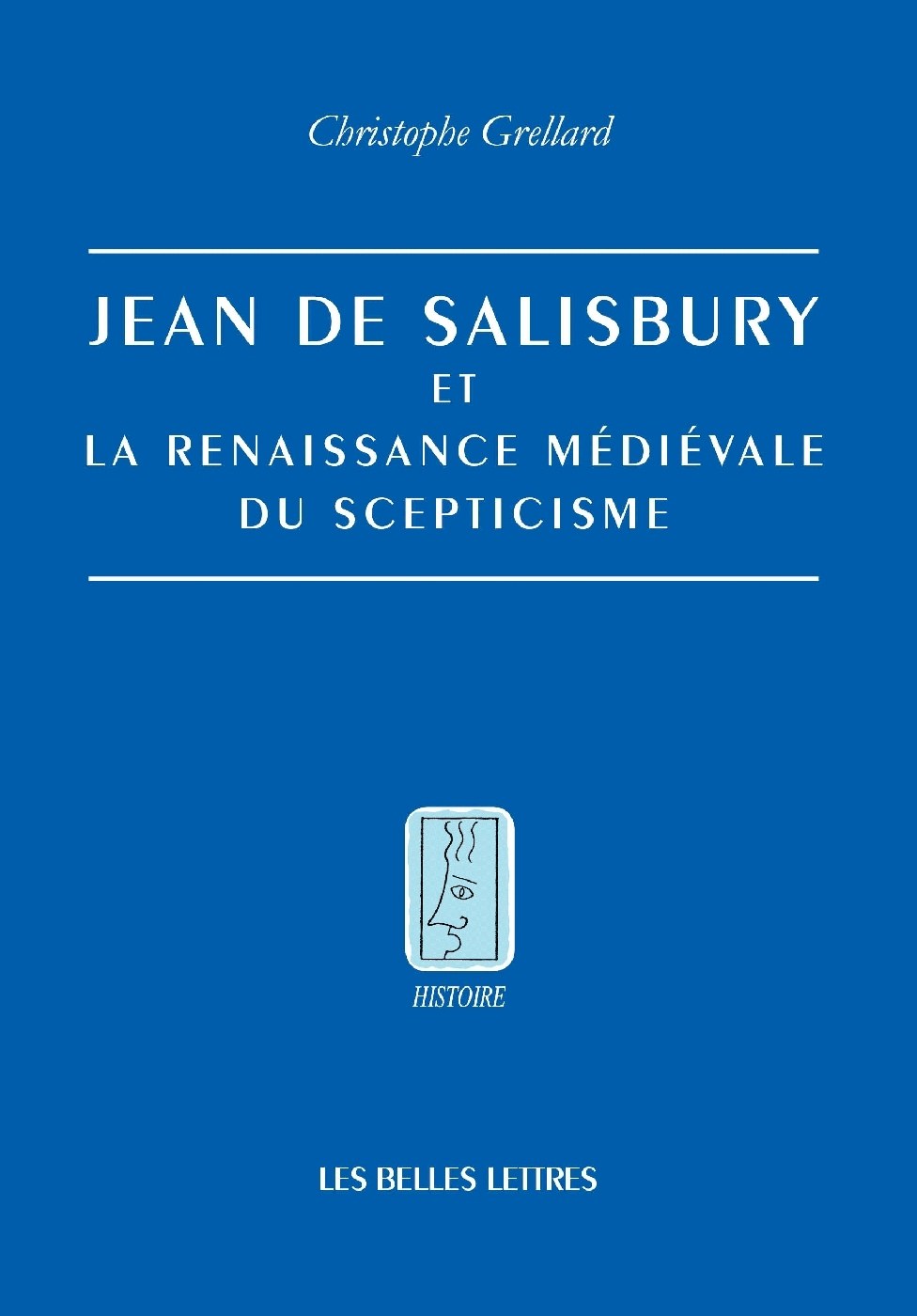
S’il a finalement eu un accès assez limité aux textes antiques directement, Jean de Salisbury a su véritablement se les approprier, et faire de leur usage l’une des dynamiques majeures de son œuvre10. C’est pour cette raison que Christophe Grellard désire attirer notre attention sur le sous-titre de l’ouvrage le plus célèbre de Jean, le Policraticus, « sive de nugis curialium et de vestigiis philosophorum11», en insistant sur le fait qu’il s’agit moins d’un traité de philosophie politique que d’un traité politique en lui-même, basé sur une épistémologie probabiliste précisément conçue.
B. Une épistémologie probabiliste et faillibiliste
Si la finalité de l’oeuvre de Jean de Salisbury est clairement politique – et eschatologique dans la mesure où il revendique une certaine adéquation de la morale philosophique et des devoirs du chrétien – son scepticisme ne se résume pas à une précaution méthodologique, simplement énoncée avant d’entrer au cœur d’un discours philosophique dogmatique. Au contraire, ce scepticisme est actif, et bâti sur une théorie de la connaissance particulière, à l’analyse de laquelle Ch. Grellard consacre la deuxième partie de son ouvrage.
En ouvrant ce chapitre par une citation du début du Policraticus, l’auteur nous donne déjà quelques indices sur l’attitude de Jean à l’égard du scepticisme12. Celui-ci se pose en effet en continuateur des académiciens, favorable à un probabilisme de mise étant donnée les limites de l’homme après la Chute et sa condamnation à seulement approcher la vérité s’il s’en remet à ses moyens naturels, et esquissant cependant l’idée d’un optimiste progrès de l’humanité dans sa quête asymptotique de connaissance. En toute logique, rien en effet ne peut davantage garantir le progrès vers la vérité que son approximation toujours améliorée. Mais si, dans la perspective chrétienne qui est celle de Jean, le scepticisme rejoint l’idée que l’homme entaché par la Chute doit faire preuve de modestie, il est par ailleurs tout à faire exclu de céder à un scepticisme radical, qui mènerait à l’apraxie, et plus encore au rejet de la certitude des principes de la foi. Plus encore, Jean reconnaît l’existence de donnés de la raison13 et même des sens, indubitables, et pour les établir il utilise habilement les arguments d’Augustin dans le Contre les Académiciens pour servir sa propre cause, ce que Ch. Grellard appelle un « scepticisme local14 ». Comme il l’indique en effet, le doute chez Jean de Salisbury est donc strictement encadré, d’une part par des impératifs éthiques, d’autre part par une épistémologie, certes probabiliste, mais qui reconnaît à l’homme la possibilité de la certitude.
De façon fort intéressante, l’auteur met en évidence l’importance de la recherche méthodique chez Jean de Salisbury. Il expose ainsi que si Jean rejette le scepticisme radical, c’est en raison de l’immodestie qui le sous-tend, mais également parce qu’il repose sur « une absence de méthode dans le doute et l’examen des choses15 ». Parallèlement, il se distingue également de ceux dont il condamne un scepticisme qualifié de dogmatique16, qui provient d’un attrait immodéré pour l’examen logique, qui conduirait à ne reconnaître de certitude que dans le domaine mathématique. Il prône donc une forme modérée de scepticisme, motivé tant par des impératifs moraux qu’épistémologiques.
Christophe Grellard propose donc de suivre l’établissement de l’épistémologie de Jean, exposée dans le Metalogicon, et de comprendre le qualificatif de « faillibiliste » qui lui est accolé.
Ce dernier reconnaît tout d’abord que toute connaissance provient des sens. La sensation, grâce à la mémoire des perceptions passées, met au jour des constantes, des synthèses, donnant naissance à ce une « expérience » ordonnée selon des règles, qui engendre à son tour un art, lui-même disposant à une « capacité scientifique ». Celle-ci repose sur la capacité créatrice de l’imagination, qui suscite en l’âme des représentations, indépendantes des choses perçues une fois la sensation acquise. C’est cette faculté qui permet à l’homme de s’abstraire de l’immédiateté des perceptions sensibles, et de former des jugements. Cependant, ceux-ci ne reçoivent que le nom « d’opinions » dans la conception salisburienne. En effet, cette autonomisation vis-à-vis du particulier sensible, condition nécessaire à la formation des jugements scientifiques, charrie avec elle la possibilité de l’erreur, puisqu’elle substitue à l’objet indubitable une image de celui-ci. Jean de Salisbury propose un remède à ces errements possibles du jugement : la prudence, définie comme « la vertu de l’âme dont l’objet est la recherche, la perception et l’utilisation perspicace de la vérité17 ». Pour prévenir les problèmes éventuellement induits par la sensation et l’imagination, il suffirait donc de s’en remettre à l’action de la prudence, couplée à celle de la raison, conçue quant à elle comme une faculté discursive, synthétisant, analysant et combinant les perceptions en vue de justifier dans le langage les connaissance acquises.
Cependant, comme l’exprime l’auteur, « une telle capacité à faire usage à la fois de la prudence et de la raison est le fait d’un petit nombre d’hommes seulement18 ». Il s’agit d’un horizon optimiste dans la philosophie de Jean de Salisbury, mais d’un horizon seulement, même s’il contribue à donner une tonalité particulière à ses écrits. Il reconnaît pourtant l’existence d’une faculté éminente, l’intellect, qui offre une appréhension immédiate des essences de certaines choses à certains élus dont la recherche de vérité est secourue par la grâce, et qui aboutit non plus seulement à la science mais à la sagesse puisqu’ils ne sont plus alors tournés vers le monde mais vers le divin qui l’ordonne.
Si l’on en reste au champ d’action de la raison, on peut donc dire comme le fait Christophe Grellard, que pour Jean de Salisbury toute connaissance s’élabore par approximation, « extension progressive du cercle de nos connaissances19 », puisque cette faculté, comme on l’a vu, procède en analysant, synthétisant, comparant, les objets sur lesquels elle se penche (Jean reprend pour décrire une telle action l’expression boécienne d’inspectio praedicamentalis, enquête catégorielle). Dans cette perspective, il convient alors de distinguer divers degrés de justification des jugements, et c’est ainsi que se profile la nécessité du probabilisme salisburien.
L’élaboration des énoncés de la philosophie naturelle doit reposer non pas sur une logique dite démonstrative, réservée aux mathématiques, mais sur la logique probable qui s’appuie sur la considération de la vraisemblance. Celle-ci, rappelle Ch. Grellard se fonde autant sur l’apparence de conformité de ces énoncés avec le réel que sur leur capacité à convaincre le plus grand nombre ou les plus sages20. Et s’il y a lieu de parler de « logique », c’est qu’il s’agit d’un outil de constitution d’énoncés réglé, qui délivre ceux-ci de leur condamnation au statut d’opinion que nous avons évoqué plus haut, pour leur faire accéder à celui, plus digne d’assentiment, de sententia.
Mais cette mécanique de la connaissance naturelle ne doit pas masquer l’un des aspects primordiaux de la philosophie de Jean de Salisbury. Comme l’avait rappelé très clairement Christophe Grellard au début de son ouvrage21, le scepticisme médiéval serait plutôt lié au fidéisme qu’à l’athéisme, même si ce dernier terme donne l’idée d’une tendance plutôt que d’une réalité, difficilement rencontrée au Moyen Âge. Et en effet, la conception chrétienne de l’homme et du monde n’est pas une simple toile de fond chez Jean, mais constitue le pivot de son scepticisme.
A cet égard, il est tout à fait bienvenu que l’auteur rappelle p. 86 : « La théorie de la vérité de Jean de Salisbury, est fondée sur l’idée, topique pour un philosophe chrétien, que Dieu est la vérité ». Ce simple rappel, glissé à un moment opportun de cet exposé technique de l’épistémologie de Jean, nous permet de mesurer le caractère inévitable de séparation entre science humaine et science divine. Et puisque Dieu/la vérité divine, est immuable, et que l’homme est, lui, soumis au changement, il ne peut avoir accès qu’à une connaissance incomplète, faillible, mais aussi par définition éternellement perfectible en raison même de l’infinie incommensurabilité entre sa condition et celle de con créateur. Or, cette faillibilité étant scellée par la Chute, et entérinée par le péché de vanité qui n’a pas cessé même après l’avènement du Christ selon Jean22, la fin de la foi et celle de la connaissance philosophique se rejoignent, ou plutôt se complètent dans un processus dialectique, puisque se tourner vers l’enquête philosophique revient à se tourner vers Dieu pour celui qui est conscient de ces limites. Or, celui-ci n’est autre que le sceptique modéré, qui n’est pas animé par une vaine libido sciendi, mais qui pressent Dieu et sa condition en même temps qu’il appréhende les objets de son enquête. L’homme qui serait simplement soumis au doute dans ses enquêtes n’aurait de surcroît aucun moyen de départager les énoncés probables qui s’offrent à sa considération, et serait donc incapable de choix, et d’action. Celui qui se rend attentif à la « loi divine » en revanche, saura discriminer, et opter pour, si ce n’est le vrai, du moins l’utile, l’expédient, et c’est que Jean nomme sagesse, but ultime de la vie humaine.
C’est cette dialectique du scepticisme, cette tension entre l’héritage de Cicéron et celui d’Augustin, que Christophe Grellard parvient à nous rendre palpable chez Jean, et qui constitue à ses yeux le renouveau médiéval du scepticisme. Ainsi qu’il l’exprime à la fin de cette deuxième partie : « Cette tension est révélée par le double usage du scepticisme qu’il met en œuvre, à la fois critique et apologétique23 ».
C. Humanisme et exempla
Le terme de « renouveau » du scepticisme n’est pas innocent, et résonne immédiatement dans l’esprit du lecteur avec la thématique annoncée par le titre du troisième chapitre de ce ouvrage : « L’humanisme comme éducation au scepticisme ». Cependant, de manière fort habile, Christophe Grellard prend le contrepied de ce que l’on attendrait après l’histoire du scepticisme médiéval et renaissant qu’il a brossé à grands traits dans son introduction. Il s’agit en fait de situer Jean de Salisbury dans le cadre de la Renaissance du XIIe siècle et non pas de le comparer aux XVe et XVIe siècles.
Exprimant d’abord quelques réticences à employer le terme d’humanisme pour qualifier le siècle de Philippe Auguste, « dans la mesure où la vision du monde reste de part en part théocentrée, et dans la mesure également où l’assimilation des auteurs anciens ne s’accompagne pas véritablement d’un souci philologique24 », l’auteur modère ensuite son jugement en considérant le respect pour l’homme et les humanités durant cette période25. Déclarant s’inspirant des critères établis par P. Boyancé26 pour caractériser l’humanisme, il en retient trois, qui peuvent d’ailleurs aisément être repérés dans l’oeuvre de Jean de Salisbury : la considération structurante de la condition humaine, l’importance de la bienveillance et celle de la culture.
C’est à ce dernier aspect que l’auteur va principalement s’intéresser dans ce chapitre, auquel le précédent prépare parfaitement le lecteur. On se souvient en effet que le processus de constitution d’énoncés probables chez Jean dépend de sa capacité à susciter l’assentiment, autant par sa vraisemblance objective que par la qualité rhétorique (mais non sophistique) des témoignages en ce sens, et leur quantité. Cette manière de procéder qui pourtant, et Christophe Grellard l’a bien remarqué, dérive certainement de la pratique universitaire médiévale de l’argumentation in utramque partem, est bien la porte d’entrée du scepticisme singulier et anti-dogmatique de Jean. Ce qu’il préconise dans ses ouvrages correspond en effet à sa pratique d’auteur : multiplier les points de vue, les citations, les témoignages, afin d’une part de se garantir d’une adhésion précipitée et vaniteuse et d’autre part de se confronter à un maximum de thèses pour parvenir grâce à elles à se rapprocher petit à petit de la vérité, en prenant des chemins parfois surprenants.
Pour cela il est nécessaire de posséder une bonne connaissances des « classiques », réservoirs d’arguments pour eux-mêmes mais aussi pour les discussions antérieures qu’ils ont pu susciter. Afin de montrer la récurrence de ce motif de l’éducation humaniste dans les écrits de Jean, Ch. Grellard navigue durant toute la troisième partie entre le Metalogicon, l’Entheticus et le Policraticus, et si cette méthode permet bien de repérer des constantes fortes sur ce thème, il est parfois un peu difficile, pour qui n’est pas spécialiste de Jean de Salisbury d’identifier les particularités de chacun des textes. Cependant, s’il convenait de le souligner, ce défaut est bien mineur par rapport à ce que la navigation ainsi entreprise permet de comprendre de la démarche humaniste de Jean et de son caractère frondeur.
L’auteur montre en effet à l’aide de ces extraits combien Jean de Salisbury s’oppose à l’enseignement des logiciens, qui permet de discuter formellement de tout mais n’aide pas pour autant à se diriger sur le chemin de la connaissance, et qui, de surcroît, finir par instiller dans l’esprit de ceux qui la pratiquent assidûment un orgueil démesuré, incompatible avec cette tâche de toute façon. Mais si cette manière de disputer ne trouve pas grâce aux yeux de Jean, qui valorise bien plus, en s’appuyant sur sa propre expérience, des enseignements tels que ceux de Guillaume de Conches27, prévient également son lecteur contre toute forme d’affiliation à une école, quel que soit l’attachement affectif qu’elle ait suscité chez l’étudiant, car cela mettrait insidieusement en péril sa liberté et sa capacité de discernement28.
L’équilibre est donc délicat : d’un côté, il faudrait ne pas compter sur ses seules ressources intellectuelles personnelles (ingenium) pour aborder des problèmes de philosophie, et de l’autre, il faudrait en même temps s’abstenir de toute aliénation…Effectivement, la seule solution acceptable au regard des conceptions salisburiennes est l’humanisme, la culture. Cela peut se comprendre au sens où la multiplication des points de vue sur une même vérité, indubitable et évidente, permettrait de la cerner plus rapidement et plus précisément, mais ce n’est pas le seul sens retenu par Christophe Grellard. Il évoque également « la diversité des visages de la vérité29 », l’idée selon laquelle la vérité serait nécessairement voilée aux yeux de l’homme, et accessible seulement par diverses allégories et fictions qu’il serait, dès lors, fertile de multiplier pour procéder à un dévoilement progressif, par la négative30.
Mais cette conception de l’établissement du savoir n’en reste pas chez Jean de Salisbury au niveau de la déclaration d’intention. Il en théorise précisément les modalités en s’appuyant sur les Topiques et les Seconds Analytiques d’Aristote pour valoriser l’induction, distinguée en deux types. D’une part l’induction dialectique, qui à partir d’une réflexion sur des semblables mène à la considération d’un universel, d’autre part l’induction rhétorique, réflexion ab uno ad unum, qui se permet de passer allégrement d’un cas particulier à un autre en se basant sur l’exemple pour emporter l’assentiment. Cependant, ce n’est pas parce qu’elle est qualifiée de rhétorique que cette forme d’induction est disqualifiée par Jean, comme nous le montre Christophe Grellard : « Cependant la référence à Socrate semble souligner, en même temps, la valeur pédagogique de cette méthode, ce qui justifie son usage au-delà du seul domaine de la rhétorique, pour le domaine éthique et politique31 ». L’exemplum en effet joue un rôle indéniable dans le cadre de l’argumentation probabiliste évoquée précédemment, puisqu’il a le pouvoir de clarifier une pensée, de constituer un guide sur le chemin de la vie bonne et juste, et surtout d’émouvoir l’interlocuteur. Pour posséder une telle efficacité, cet exemplum doit non seulement être pertinent, mais également être familier à l’interlocuteur ou au lecteur, et l’on se retrouve donc de nouveau confronté à la nécessité de la culture dans le cas des jugements éthiques.
D. Une éthique de la distance
On ne peut qu’admirer la construction de l’ouvrage de Christophe Grellard, qui amène tout naturellement, après l’exposition de ce modèle qu’il qualifie de « jurisprudentiel32 » à la finalité déclarée de la philosophie pour Jean de Salisbury : la vie bonne. Au sein de ce dernier chapitre s’articulent tous les éléments précédemment évoqués : la menace de l’apraxie sceptique, la nécessité de la conversion vers Dieu comme vérité, le soutien de la grâce dans l’entreprise de compréhension du monde, la condition humaine post-lapsaire et les obstacles qu’elle induit…
Mettant en œuvre la méthode qu’il prône et qu’il a thématisée, Jean trouve en effet en examinant les thèses de diverses écoles de pensée la confirmation que la fin de l’éthique est le bonheur, et que celui-ci s’atteint au moyen de la vertu. L’épicurisme, comme le stoïcisme, trouvent grâce à ses yeux, nous montre Christophe Grellard, car bien qu’essentiellement rendues caduques après la Révélation et discutables sur bien des points, elles admettent une relecture chrétienne, un encadrement « par la foi et la loi33 », qui ne retient d’elles que cet aspect fondamental : le mépris des vanités du monde. Cependant, là où ces philosophies étaient nécessairement viciées parce qu’elles ne comptaient que sur les capacités naturelles de l’homme pour découvrir les moyens de s’orienter vers une vie vertueuse, la philosophie de Jean, elle, reconnaît la nécessaire intervention de la grâce pour soutenir la vertu. Comme le résume Christophe Grellard : « Si la vertu profite de la science, une éthique strictement intellectualiste, telle que celle développée par les païens, est néanmoins vouée à l’échec en raison de la faiblesse humaine, dont on a déjà vu les conséquences épistémologiques34 ».
On doit saluer le fait qu’ici, l’auteur ne se contente pas d’exposer la position de Jean de Salisbury, mais l’intègre dans un tableau distinguant les grandes tendances du XIIe siècle sur la question du rapport entre vertu naturelle et grâce. Sans prétendre à l’exhaustivité bien-sûr, cette typologie qui prend Abélard, Rupert de Deutz et Alain de Lille comme points de repère permet non seulement d’esquisser les avantages et problèmes de chaque solution en lui donnant corps (pure naturalité de l’usage de la vertu chez Abélard, nécessité indépassable de la grâce chez Rupert, actualisation des capacités de la vertu par la grâce chez Alain de Lille), mais aussi d’inscrire Jean de Salisbury dans son temps.
Le chapitre qui suit, « Une éthique de la distance : la tranquillité de l’âme », constitue l’un des temps forts de Jean de Salisbury et la renaissance médiévale du scepticisme. En effet comme on l’a vu, la philosophie de Jean comporte un versant intimiste. Il est nécessaire à celui qui veut approcher la vérité de se tourner vers Dieu, de retourner en lui-même, et de laisser de côté les choses mondaines. Mais dans le même temps, la pensée et les écrits de Jean sont d’essence politique, explicitement dédiés aux courtisans et hommes d’action aux prises avec le monde et ses vanités. Il faut donc saluer le fait que Christophe Grellard parvienne à expliquer cette apparente tension sans pour autant la nier, et à rendre palpable le fait que c’est même de celle-ci que provient la dynamique de cette pensée singulière : « Ce n’est plus tant l’intériorisation spirituelle qui intéresse Jean que la constitution d’un sujet responsable de ses pensées et de ses actes, à travers une théorie sceptique du jugement et du conseil, comme condition nécessaire d’un double espace, privé et public, séparés malgré leurs interactions35 ». Ainsi, rassemblant toutes les analyses ponctuelles qu’il avait produites jusque là, il met à jour la dialectique suivante chez Jean de Salisbury : on comprend que la connaissance de soi, sans fard et sans orgueil, mène à l’amour de soi comme image de Dieu et non plus dans notre insignifiance personnelle et donc à l’amour du bien, et mène au désir de l’acte bonne. Tout cette anthropologie est donc dirigée vers l’action politique.
L’ouvrage se termine sur un examen de l’exemplification et, il faut bien le dire, l’idéalisation de la figure de Thomas Becket dans la Vita36 que lui a consacré Jean de Salisbury. La reconstruction de cette personnalité par Jean correspond non seulement à un acte politique, mais également à un témoignage du fait qu’il est possible de concilier les apparences de la mondanité et les exigences du spirituel. Plus encore, conformément aux principes d’acquisition de connaissances en matière de politique et d’éthique qu’il a lui-même établis, Jean fait véritablement de l’archevêque de Canterbury un exemplum37 de cette éthique de la distance, qui requiert le détachement, et non la négation des affaires humaines, et une attention éminente à l’égard de son intériorité.
Enfin, dans un dernier retournement, ou plutôt une dernière étape de l’exploration de la profondeur de l’anthropologie salisburienne, Christophe Grellard s’attache à montrer que cette distanciation n’a pas nécessairement pour conséquence l’isolement, mais qu’au contraire, Jean valorise l’attention à autrui, la caritas. C’est encore l’une des réponses étonnantes, issues de l’apport éminemment chrétien, de ce scepticisme médiéval.
E. Un nouvel horizon de recherches
Avec Jean de Salisbury et la renaissance du scepticisme médiéval, Christophe Grellard offre un ouvrage dont on ne peut que saluer la clarté et la construction. Mais ce livre n’a pourtant pas en lui-même sa propre finalité, et c’est raison pour laquelle il serait malvenu de parler de monographie à son endroit. Certes, il traite de Jean de Salisbury, et de manière extrêmement fluide car très documentée, mais les textes de ce philosophes sont également traités comme une porte d’entrée vers un nouvel horizon d’études, celui du scepticisme médiéval.
- Christophe Grellard, Jean de Salisbury et la renaissance médiévale du scepticisme, Paris, Les Belles Lettres, 2013, 335 pages
- Introduction, p. 11.
- Il est toujours fort délicat d’employer ce type de marqueurs temporels dans une analyse d’histoire de la philosophie et les termes « encore » et « déjà » méritent donc clarification : Il ne s’agit pas de qualifier Jean de Salisbury de « continuateur du scepticisme antique » ou de « précurseur du scepticisme renaissant », dans la mesure où la formule est, fondamentalement, vide et où, d’autre part, la Renaissance dont il est ici question à mots couverts est celle du XIIe. Au contraire, sans suggérer une fulgurance médiévale d’un tropisme sceptique, le terme « déjà » renvoie à la nécessaire reconnaissance d’une tradition textuelle ininterrompue entre Antiquité et Renaissance, bien que toujours transfigurée par un contexte, et la lecture propre à un individu. D’ailleurs, à plusieurs reprise dans cet ouvrage, l’auteur jouera de la polysémie des termes de « renaissance » et « d’humanisme », afin de nous amener implicitement à réévaluer nos préjugés historiographiques.
- Introduction, p. 12.
- Voir Paul Vignaux, « Les problématiques médiévales peuvent-elle éclairer le nominalisme actuel ? », Revue des sciences philosophqiues et théologiques, 75, 1977, p. 295-331, cité par Ch. Grellard, op. cit., p. 12.
La première méthode consisterait à établir a priori ce que serait « le » scepticisme, et à analyser dans un second temps les textes médiévaux pour y chercher ce qui se conforme à cette définition. La seconde méthode quant à elle procède par acclimations aux textes médiévaux, pour en faire ressortir directement un scepticisme propre à cette période.
- Policraticus, Livres I à IV, éd. K.S.B. Keats-Rohan, Corpus Christianorum Continuatio Medievalis, 117, Turnhout, Brepols, 1993. Livres V-VIII : éd. C.C.J. Webb, Oxford, 1909, vol. 2.
- Metalogicon, éd. J.B. Hall et K.S.B. Keats-Rohan, Corpus Christianorum Continuatio Medievalis, 98, Turnhout, Brepols, 1991.
- Entheticus de dogmate philosophorum : Entheticus Maior et Minor, éd. et tr. J. van Laarhoven, « Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters », 17, Leiden, Brill, 1987.
- The Letters of John of Salisbury, éd. et tr. W.J. Millor et H.E. Butler, Oxford Medieval Texts, Oxford, Clarendon Press, 1979 et 1986, 2 vols.
- p. 35.A ce sujet, l’auteur renvoie à Ch. Grellard, « La seconde acculturation chrétienne de Cicéron : la réception des Académiques du XIe au XIIe siècles », Astérion, 11, 2013, http://asterion.revues.org/2350
- Policraticus, ou « les frivolités de la cour et les traces des philosophes ».
- Ibid., I, prologue, p. 25, l. 132-138, cité p. 37, trad. Ch. Grellard : « …et sur les questions philosophiques, disputant en Académicien dans les limites de la raison, j’ai adhéré à ce qui apparaissait probable. Et je ne rougis pas d’affirmer compter parmi les Académiciens moi qui, à propos des choses douteuses au sage, suit leurs traces. En effet, bien que cette secte semble introduire l’obscurité sur toutes choses, nulle n’est plus fiable dans l’examen de la vérité, selon Cicéron qui dans sa vieillesse s’est tourné vers elle, nulle n’est plus parente du progrès ».
- Sur les bornes au scepticisme que constituent les certitudes de foi et celles des principes mathématiques aux yeux de Jean, voir également p. 81.
- p. 46.
- p. 51.
- p. 51.
- Metalogicon, IV, 12, p. 150, l. 3-4, cité par Ch. Grellard p. 59.
- p. 60.
- p. 64.
- p. 65 à 67.
- p. 13.
- Metalogicon, IV, 33, p. 170, 6-10, cité p. 92, n. 53.
- p. 97.
- p. 107.
- Rappelons la célèbre formule de Bernard de Chartres que l’on trouve dans le Metalogicon, III, 4 : Bernard de Chartres a dit que nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants, et ainsi nous pouvons voir plus de choses et plus loin qu’eux, non pas grâce à l’acuité de notre vision ou à la hauteur de notre corps, mais parce que nous sommes surélevés et amenés à une hauteur gigantesque».
- P. Boyancé, Études sur l’humanisme cicéronien, Bruxelles, Latomus, 1970.
- Metalogicon, II, 10, p. 71, l. 42-45, cité p. 111.
- Policraticus, VII, 9, p. 122-123, l. 20-2, cité p. 112.
- p. 125.
- Ce thème très intéressant de l’integumentum et du figmentum est abordé p. 82-83.
- p. 134-135.
- p. 151.
- p. 165.
- p. 167.
- p. 172.
- Vita Sancti Thomae : Giovanni di Salisbury, Anselmo e Becket. Due Vite, Milan, Jaca Book, 1990.
- p. 189 : « Ce qui nous importe ici, c’est la volonté constante de Jean de faire de Thomas un exemplum qui permette de montrer comment une certaine philosophie , d’inspiration sceptique, peut être solidaire d’une vie consacrée à l’action politique ».








