Claude Romano est phénoménologue et professeur de philosophie à Sorbonne-Université et à l’ACU de Melbourne. Il a reçu le grand prix de philosophie de l’Académie française pour l’ensemble de son oeuvre. Elle se compose de plusieurs grands chantiers. Tout d’abord la question de l’événement, dans le diptyque L’Événement et le monde[1] et L’Événement et le temps[2], repris en un seul volume en 2021 sous le titre L’Événement et le monde[3]. Puis des ouvrages rassemblant des articles d’histoire de la phénoménologie, Il y a[4] et L’Inachèvement d’Être et temps[5]. Un ouvrage un peu à part de lecture phénoménologique de l’oeuvre de Faulkner, Le Chant de la vie[6]. Enfin, les deux grands chantiers qui occupent Claude Romano sont, d’une part, l’élaboration d’une phénoménologie réaliste du monde de la vie, commencée dans Au coeur de la raison[7], puis poursuivie dans Les Repères éblouissants[8] ainsi que De la couleur[9], et d’autre part une philosophie de l’identité personnelle et de l’authenticité commencée dans Être soi-même[10], qui retrace l’histoire de l’idée d’authenticité, puis prolongé dans La Liberté intérieure[11] et L’Identité humaine en dialogue[12], et complétée par La Révolution de l’authenticité à l’âge du romantisme[13]. Cette année paraît son nouveau livre, L’Appartenance au monde[14], qui prolonge l’élaboration de la phénoménologie réaliste du monde de la vie.
 L’ouvrage s’ouvre sur une préface qui constate que la philosophie nous a fait, depuis 25 siècles, nous dissocier de notre corps, que l’apparaître d’autrui n’est qu’un signe extérieur de sa présence et que le monde dans lequel nous vivons au quotidien n’est qu’une apparence derrière laquelle se cache la réalité en soi. Le projet de l’ouvrage est de rompre radicalement avec cette tradition, il veut « nous enseigner à retrouver notre place dans le monde » (p. 10). Le titre du livre s’éclaire : il s’agit de nous reconduire à notre appartenance au monde sensible par notre corps. Cela passe par une déconstruction de la conception de la nature héritée de la révolution galiléenne et de ses présupposés métaphysiques : la distinction entre une intériorité et une extériorité, l’idée selon laquelle le monde est représenté et la scission entre un corps-objet et un corps-vécu. C’est contre cette conception qu’il faut rendre ses droits au monde de la vie pré-scientifique, mais d’une manière toute différente de l’idéalisme husserlien qui partage les présupposés métaphysiques des sciences de la nature, ce qui implique d’en fournir une interprétation réaliste montrant que la Lebenswelt est le monde réel : « l’élaboration de ce réalisme phénoménologique est l’objectif principal de ce livre » (p. 13). La méthode est descriptive, puisqu’elle est phénoménologique, mais la grande originalité de Claude Romano est de mettre en place aussi une méthode argumentative. Toutes les thèses du livres sont argumentées, les arguments sont distingués, chaque argument est analysé, et l’auteur expose lui-même les objections pour y répondre. Il montre par l’exemple qu’une phénoménologie qui argumente est possible, donc que la phénoménologie peut répondre aux reproches de dogmatisme qu’on lui a parfois adressés. La grande originalité de l’ouvrage tient aussi au fait qu’il s’agit d’une phénoménologie qui ne se contente pas d’argumenter avec ou contre Husserl, Heidegger et Merleau-Ponty, mais aussi avec et contre tout un ensemble de philosophes anglo-saxons de tradition analytique. Claude Romano prouve par l’exemple que faire de la phénoménologie, ce n’est pas être ignare dans le domaine de la philosophie analytique, que la phénoménologie peut entrer en discussion de manière féconde avec cette tradition et qu’elle a de quoi répondre à ses objections : « Elle [la méthode] s’efforcera de conserver le meilleur des deux traditions qui se sont longtemps partagé la scène philosophique tout en s’ignorant mutuellement » (p. 14).
L’ouvrage s’ouvre sur une préface qui constate que la philosophie nous a fait, depuis 25 siècles, nous dissocier de notre corps, que l’apparaître d’autrui n’est qu’un signe extérieur de sa présence et que le monde dans lequel nous vivons au quotidien n’est qu’une apparence derrière laquelle se cache la réalité en soi. Le projet de l’ouvrage est de rompre radicalement avec cette tradition, il veut « nous enseigner à retrouver notre place dans le monde » (p. 10). Le titre du livre s’éclaire : il s’agit de nous reconduire à notre appartenance au monde sensible par notre corps. Cela passe par une déconstruction de la conception de la nature héritée de la révolution galiléenne et de ses présupposés métaphysiques : la distinction entre une intériorité et une extériorité, l’idée selon laquelle le monde est représenté et la scission entre un corps-objet et un corps-vécu. C’est contre cette conception qu’il faut rendre ses droits au monde de la vie pré-scientifique, mais d’une manière toute différente de l’idéalisme husserlien qui partage les présupposés métaphysiques des sciences de la nature, ce qui implique d’en fournir une interprétation réaliste montrant que la Lebenswelt est le monde réel : « l’élaboration de ce réalisme phénoménologique est l’objectif principal de ce livre » (p. 13). La méthode est descriptive, puisqu’elle est phénoménologique, mais la grande originalité de Claude Romano est de mettre en place aussi une méthode argumentative. Toutes les thèses du livres sont argumentées, les arguments sont distingués, chaque argument est analysé, et l’auteur expose lui-même les objections pour y répondre. Il montre par l’exemple qu’une phénoménologie qui argumente est possible, donc que la phénoménologie peut répondre aux reproches de dogmatisme qu’on lui a parfois adressés. La grande originalité de l’ouvrage tient aussi au fait qu’il s’agit d’une phénoménologie qui ne se contente pas d’argumenter avec ou contre Husserl, Heidegger et Merleau-Ponty, mais aussi avec et contre tout un ensemble de philosophes anglo-saxons de tradition analytique. Claude Romano prouve par l’exemple que faire de la phénoménologie, ce n’est pas être ignare dans le domaine de la philosophie analytique, que la phénoménologie peut entrer en discussion de manière féconde avec cette tradition et qu’elle a de quoi répondre à ses objections : « Elle [la méthode] s’efforcera de conserver le meilleur des deux traditions qui se sont longtemps partagé la scène philosophique tout en s’ignorant mutuellement » (p. 14).
L’introduction, « Les trois corps du philosophe », débute le travail de déconstruction de la métaphysique moderne par l’examen du problème du corps. La phénoménologie a voulu opposer deux corps : le corps comme substrat matériel expliqué par les sciences de la nature, c’est-à-dire le corps-objet, le Körper, et le corps-propre ou corps vécu par l’ego, c’est-à-dire la chair, le Leib. Claude Romano trouve dans Descartes l’origine de cette distinction réinterprétée par Husserl, et cette distinction repose elle-même sur la grande distinction entre la nature matérielle et l’esprit impliquée par la nouvelle image de la nature qui prend forme avec la révolution scientifique moderne : « il est difficile de séparer la chair husserlienne, dans son contraste avec le Körper, de tout le cadre de la philosophie moderne tel qu’il résulte de l’adoption d’une physique mécaniste à partir de Galilée et de la grande scission qu’elle instaure entre nature et esprit » (p. 27). L’impasse dans laquelle tombe cette tradition est alors l’incapacité à comprendre comment le corps physique et le corps vécu peuvent ne faire qu’un seul corps, le mind-body problem se trouvant redoublé par un body-body problem. Ces deux corps font surgir le problème d’un troisième corps qui est celui d’autrui et qui est tout aussi énigmatique car sa constitution est circulaire, puisqu’elle a lieu sur le fondement de sa chair mais autrui ne peut être constitué comme chair que s’il apparaît déjà comme autrui, pas comme Körper. C’est l’aporie du solipsisme insurmontable sans dépassement des présupposés de la métaphysique moderne.
Le premier chapitre, « L’image moderne de la nature », entend rendre compte de l’émergence galiléenne de cette image et de sa conséquence essentielle, le fait de rejeter le monde phénoménal comme une illusion subjective. C’est cette rupture avec les images antérieures de la phusis qui a conduit à l’expulsion de l’esprit hors de la nature. Elle consiste en une mathématisation qui ambitionne pour la première fois de ménager un accès à une nature en soi, affranchie de toute relativité à nous-mêmes, ce qui signifie l’expurger de toutes les qualités sensibles qui peuplent le monde phénoménal. La conséquence est que les phénomènes ordinaires nous voilent le monde véritable et que c’est la physique mathématisée qui lève le coin du voile. Le monde phénoménal n’est plus phénoménal car apparaissant, mais bien phénoménal car apparent. Il est phénoménal car tissé de phénomènes entièrement subjectifs, les qualités sensibles comme la couleur, le goût ou la chaleur. La science doit expliquer ces qualités à partir de la nature mathématisée, ce qui signifie en réalité les éliminer de la réalité physique. L’émergence de cette nouvelle image de la nature est donc l’instauration de « cette dichotomie qui s’instaure entre deux mondes, celui de notre expérience quotidienne et celui que nous présente la science » (p. 41). C’est le lieu d’origine de la distinction entre qualités premières et qualités secondes. Les qualités secondes, à titre de sensations, ne sont plus des qualités de la nature mais des qualités relevant de l’esprit humain lui-même chassé de la nature. C’est une erreur des sens que cette projection par l’esprit humain de ses sensations sur le monde pour en faire des propriétés des choses. Non seulement l’image manifeste du monde ne coïncide pas avec son image scientifique mais ces deux images sont mêmes incompatibles, de sorte que la vérité de l’image scientifique implique la fausseté de l’image manifeste. C’est cette implication que conteste Romano. L’idéalisme d’un Kant ou d’un Husserl apparaît comme une solution à ce problème qui tente de réconcilier les deux images du monde en rapatriant le monde dans l’esprit pour le faire coïncider avec sa représentation, restaurant ainsi le caractère direct de notre connaissance du monde en changeant celui-ci en idée. Romano remarque que l’idéalisme qui dénie à la nature son indépendance par rapport à l’esprit et le réalisme scientifique qui n’accorde d’existence réelle qu’aux particules de la physiques partagent l’essentiel en cela que le monde de la vie quotidienne est privé de sa réalité indépendante pour devenir une production de notre esprit ou de notre cerveau. Le matérialisme neuronal fait du monde phénoménal une création du cerveau, donc de l’esprit humain. Cette proximité vient de leur présupposé commun, celui de l’incompatibilité entre les deux images du monde. C’est ce présupposé qu’il faut surmonter pour rendre au monde phénoménal toute sa réalité. Il faut affirmer que ce qui a été tenu pour des qualités secondes simplement subjectives constitue bien des propriétés objectives du monde, ce qui suppose de distinguer deux concepts d’objectivité, la thèse de la subjectivité des qualités secondes reposant sur la confusion entre ces deux concepts. Tout d’abord, est objectif ce qui est vrai indépendamment de nos croyances. C’est un concept d’objectivité impliqué par l’idée même de vérité. Mais la physique mathématique est aussi objective en un second sens. Par opposition à une vérité relative à un observateur de type « le ciel est bleu par beau temps », donc des vérités de forme relative, la physique établit des vérités de forme absolue, car sa description ne fait plus référence à notre expérience, elle dit ce qu’est la nature en elle-même. C’est la mathématisation de la nature qui permet ce passage à l’absolu, c’est le passage à la limite que le Husserl de la Krisis appelle « idéalisation ». Éliminer les qualités secondes, c’est éliminer les qualités que les choses nous présentent du point de vue de notre expérience. L’idée d’après laquelle l’image du monde phénoménal ne peut qu’être subjective si l’image scientifique du monde est objective procède d’une confusion entre ces deux sens de l’objectivité. Une description du ciel de forme relative qui dit qu’il est bleu par beau temps est certes de forme relative, relative à l’appareil perceptif visuel du vivant qu’est l’homme, mais elle n’en est pas moins parfaitement indépendante de mes croyances et de ma perspective particulière, de sorte qu’elle est tout à fait objective : « Une vérité de forme relative est parfaitement objective au sens le plus fondamental du terme, c’est-à-dire indépendante de nos croyances » (p. 66). Il y a cependant un lien entre ces deux sens de l’objectivité, et partant entre les vérités du monde de la vie et celles des sciences, car les vérités des sciences procèdent de l’idéalisation des vérités du monde de la vie qui en constituent les approximations. Ces deux espèces de descriptions sont objectives et il n’y a pas d’incompatibilité entre elles. Et en réalité la description scientifique présuppose celle du monde de la vie pour procéder sur elle à son opération d’idéalisation, de sorte qu’elle ne l’invalide pas : « les vérités de la science présupposent les vérités ordinaires et se fondent à leur tour sur elles » (p. 75).
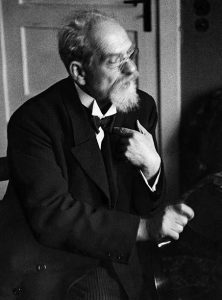 Cette reprise des idées husserliennes de monde de la vie et d’idéalisation pourraient laisser penser que Romano n’est qu’un épigone du Husserl de la Krisis découvrant l’eau tiède. Il est donc nécessaire, dans un deuxième chapitre, de montrer la spécificité de son concept de monde de la vie, et en quoi il est plus pertinent que celui du dernier Husserl. Romano rappelle que l’idéalisme et le matérialisme conduisent à une commune réduction du monde de la vie à une représentation subjective, intérieure et mentale, donc dépendante de l’esprit. Là-contre, il s’agit de montrer « qu’il est ontologiquement indépendant de l’esprit de celui qui l’appréhende » (p. 78). En cela, la conception romanienne du monde de la vie n’est plus celle de Husserl. Ce dernier caractérisait la Lebenswelt comme « subjective-relative » et dépendante de la conscience en vertu de l’idéalisme transcendantal. Au contraire, Romano avance un réalisme du monde de la vie qui rend à ce monde son objectivité. Il critique en effet la manière dont Husserl a voulu surmonter le dualisme monde de l’esprit-monde de la nature par « un tour de passe-passe » (p. 95) qui ne restaure l’unité du monde qu’en faisant de celui-ci un corrélat des opérations subjectives de l’ego transcendantal, perdant définitivement dans l’épochè le monde de l’attitude naturelle. La démarche de Husserl est paradoxale car l’idée de Lebenswelt doit permettre de montrer la compatibilité des deux images du monde alors que l’idéalisme est une tentative de surmonter l’opposition entre ces deux images, qui suppose donc ce que l’idée de Lebenswelt permet de dissoudre : « l’idéalisme subjectif admet sans discussion la thèse de l’incompatibilité des deux images du monde » (p. 96). L’idéalisme subjectif est une catastrophe car il annule les promesses du concept de Lebenswelt. Il continue à penser le monde de la vie comme subjectif sur fond d’incompatibilité entre les deux images du monde et il nous fait perdre le monde naïf au profit d’un monde qui n’est que le corrélat de la subjectivité transcendantale. La Lebenswelt husserlienne ne tient pas ses promesses et c’est la nouvelle conception de Romano qui doit les tenir à sa place. Cette position est celle du réalisme du monde de la vie qui consiste à soutenir à la fois l’objectivité et l’indépendance ontologique de ce monde vis-à-vis de nous mêmes tout en maintenant la différence de ce monde avec l’univers physique. Ce monde n’est ni subjectif ni objectif au sens de la physique, il n’est ni réductible à un ensemble de représentations mentales ni réductible à la nature en soi mathématisée, il est indépendant de notre esprit et distinct de l’univers physique. La doctrine de l’a priori matériel aurait dû conduire Husserl à un tel réalisme car elle montre qu’il y a une cohérence nécessaire du monde indépendante de notre esprit, mais il a reculé et préféré l’idéalisme transcendantal justifié par la fiction de l’anéantissement du monde qui est pourtant en contradiction avec l’idée d’une légalité a priori nécessaire du cours de l’expérience indépendante de notre esprit. Il y a là « une contradiction massive logée au coeur de la phénoménologie husserlienne » (p. 102). Le caractère phénoménal du monde de la vie n’est pas contradictoire avec son indépendance ontologique si l’on comprend que, certes, il y a une composante perspectiviste dans toute perception, car le mode d’apparition dépend de la conscience et du corps, mais le monde lui-même qui apparaît sous cette perspective n’en dépend pas. C’est bien dans son indépendance à l’égard de toute perspective particulière que le monde nous apparaît sous une perspective particulière. La dépendance du mode d’apparaître n’implique aucune dépendance de cela qui apparaît, et c’est ce que ne comprend pas Husserl dans sa doctrine du noème lorsqu’il affirme que l’arbre brûle mais pas son noème, passant d’une dépendance du mode d’apparaître à une dépendance de cela qui apparaît. Husserl avançait une primauté du monde de la vie sur le monde de la science dans le cadre d’un épistémologie fondationnaliste de type cartésienne, le monde de la vie étant un domaine d’évidences indubitables. Romano abandonne ce cartésianisme et repense cette primauté. Il y a une objectivité des couleurs selon des critères d’objectivité phénoménologiques qui précèdent en droit leur explication en termes physiques de sorte que l’objectivité scientifique présuppose l’objectivité qui est celle du monde de la vie.
Cette reprise des idées husserliennes de monde de la vie et d’idéalisation pourraient laisser penser que Romano n’est qu’un épigone du Husserl de la Krisis découvrant l’eau tiède. Il est donc nécessaire, dans un deuxième chapitre, de montrer la spécificité de son concept de monde de la vie, et en quoi il est plus pertinent que celui du dernier Husserl. Romano rappelle que l’idéalisme et le matérialisme conduisent à une commune réduction du monde de la vie à une représentation subjective, intérieure et mentale, donc dépendante de l’esprit. Là-contre, il s’agit de montrer « qu’il est ontologiquement indépendant de l’esprit de celui qui l’appréhende » (p. 78). En cela, la conception romanienne du monde de la vie n’est plus celle de Husserl. Ce dernier caractérisait la Lebenswelt comme « subjective-relative » et dépendante de la conscience en vertu de l’idéalisme transcendantal. Au contraire, Romano avance un réalisme du monde de la vie qui rend à ce monde son objectivité. Il critique en effet la manière dont Husserl a voulu surmonter le dualisme monde de l’esprit-monde de la nature par « un tour de passe-passe » (p. 95) qui ne restaure l’unité du monde qu’en faisant de celui-ci un corrélat des opérations subjectives de l’ego transcendantal, perdant définitivement dans l’épochè le monde de l’attitude naturelle. La démarche de Husserl est paradoxale car l’idée de Lebenswelt doit permettre de montrer la compatibilité des deux images du monde alors que l’idéalisme est une tentative de surmonter l’opposition entre ces deux images, qui suppose donc ce que l’idée de Lebenswelt permet de dissoudre : « l’idéalisme subjectif admet sans discussion la thèse de l’incompatibilité des deux images du monde » (p. 96). L’idéalisme subjectif est une catastrophe car il annule les promesses du concept de Lebenswelt. Il continue à penser le monde de la vie comme subjectif sur fond d’incompatibilité entre les deux images du monde et il nous fait perdre le monde naïf au profit d’un monde qui n’est que le corrélat de la subjectivité transcendantale. La Lebenswelt husserlienne ne tient pas ses promesses et c’est la nouvelle conception de Romano qui doit les tenir à sa place. Cette position est celle du réalisme du monde de la vie qui consiste à soutenir à la fois l’objectivité et l’indépendance ontologique de ce monde vis-à-vis de nous mêmes tout en maintenant la différence de ce monde avec l’univers physique. Ce monde n’est ni subjectif ni objectif au sens de la physique, il n’est ni réductible à un ensemble de représentations mentales ni réductible à la nature en soi mathématisée, il est indépendant de notre esprit et distinct de l’univers physique. La doctrine de l’a priori matériel aurait dû conduire Husserl à un tel réalisme car elle montre qu’il y a une cohérence nécessaire du monde indépendante de notre esprit, mais il a reculé et préféré l’idéalisme transcendantal justifié par la fiction de l’anéantissement du monde qui est pourtant en contradiction avec l’idée d’une légalité a priori nécessaire du cours de l’expérience indépendante de notre esprit. Il y a là « une contradiction massive logée au coeur de la phénoménologie husserlienne » (p. 102). Le caractère phénoménal du monde de la vie n’est pas contradictoire avec son indépendance ontologique si l’on comprend que, certes, il y a une composante perspectiviste dans toute perception, car le mode d’apparition dépend de la conscience et du corps, mais le monde lui-même qui apparaît sous cette perspective n’en dépend pas. C’est bien dans son indépendance à l’égard de toute perspective particulière que le monde nous apparaît sous une perspective particulière. La dépendance du mode d’apparaître n’implique aucune dépendance de cela qui apparaît, et c’est ce que ne comprend pas Husserl dans sa doctrine du noème lorsqu’il affirme que l’arbre brûle mais pas son noème, passant d’une dépendance du mode d’apparaître à une dépendance de cela qui apparaît. Husserl avançait une primauté du monde de la vie sur le monde de la science dans le cadre d’un épistémologie fondationnaliste de type cartésienne, le monde de la vie étant un domaine d’évidences indubitables. Romano abandonne ce cartésianisme et repense cette primauté. Il y a une objectivité des couleurs selon des critères d’objectivité phénoménologiques qui précèdent en droit leur explication en termes physiques de sorte que l’objectivité scientifique présuppose l’objectivité qui est celle du monde de la vie.
Romano entend préciser le sens de son réalisme du monde de la vie dans un troisième chapitre. Il entend dépasser l’opposition entre un réalisme indirect et un idéalisme issue de la scission entre les deux images du monde. Le réalisme indirect affirme que nous devons inférer l’existence du monde en soi sur la base des représentations mentales et l’idéalisme entend combler ce gouffre en niant l’indépendance d’un monde en soi réduit alors à nos représentations mentales. Dans les deux cas, nous n’avons jamais accès qu’à une représentation du monde. C’est à cette « métaphysique de la représentation mentale » (p. 120) qu’il faut s’attaquer, celle qui est présupposée par la théorie représentationnelle de la perception. C’est elle que l’on retrouve de nos jours dans les sciences cognitives pour lesquelles la réalité perçue est générée par le cerveau. Pour la dépasser, il faut montrer que nous avons accès au monde lui-même, pas à une représentation du monde, et aussi qu’une autre position que le réalisme indirect ou l’idéalisme est compatible avec l’image scientifique du monde, celle du réalisme direct comme réalisme du monde de la vie. Ce réalisme qui porte sur les objets du monde de la vie n’est pas le réalisme scientifique qui porte sur les objets de la théorie physique, mais il est compatible avec lui. C’est là une précision tout à fait essentielle sur le rapport de la phénoménologie avec l’épistémologie. Le réalisme phénoménologique du monde de la vie n’implique en rien l’adhésion à un antiréalisme en philosophie des sciences, c’est-à-dire un instrumentalisme selon lequel les quarks et les électrons ne seraient que des modèles prédictifs sans rien qui leur corresponde dans la réalité. C’est la thèse de l’incompatibilité des deux images qui oblige à choisir entre le réalisme à propos du monde de la vie et l’antiréalisme à propos de l’univers de la physique d’une part et l’antiréalisme à propos du monde de la vie et le réalisme à propos de l’univers de la physique d’autre part. La thèse de la compatibilité des deux images permet d’affirmer les deux réalismes à la fois. Ce réalisme direct implique de surmonter toute théorie représentationnelle de la perception. La perception n’est pas une connaissance, elle ne s’effectue pas indirectement par l’intermédiaire d’une représentation mentale, elle constitue une prise corporelle sur le monde, et Romano se revendique ici de Merleau-Ponty. Le perception implique l’existence du perçu car elle est un contact direct avec les chose qui les saisit en chair et en os, ne laissant aucune place à quelque chose de tel qu’un doute sceptique. La perception n’est pas représentation, elle est ouverture au monde, être-au-monde. Rien ne s’y interpose entre nous et les objets réels, qu’on appelle ces interfaces idées, sensations ou données des sens. C’est l’occasion pour Romano d’opposer en tout point son réalisme au réalisme spéculatif. Le réalisme spéculatif est un réalisme métaphysique qui entend accéder à la réalité en soi grâce aux mathématiques en dépassant le corrélationnisme. On prétend avoir franchi le gouffre instauré par la philosophie moderne et sa métaphysique de la représentation. Le réalisme du monde de la vie prétend qu’il n’y a aucun gouffre et il n’est pas métaphysique, il est strictement phénoménologique, il procède de la description phénoménologique de notre perception du monde. Cela nous permet de comprendre que la phénoménologie de Claude Romano n’est pas une métaphysique, contrairement à d’autres phénoménologies contemporaines (par exemple celle de Renaud Barbaras), mais bien une phénoménologie anti-métaphysique qui défait grâce à la description phénoménologique les faux problèmes de la métaphysique. Le réalisme phénoménologique du monde de la vie, surmontant la métaphysique de la représentation, ne saurait donc non plus être un réalisme causal qui entend combler le gouffre entre la représentation et la réalité extérieure représentée par un lien de causalité. Le réalisme du monde de la vie est un réalisme direct, du sens commun, non causal et descriptif. C’est un réalisme naïf en cela qu’il défend une thèse proche de celle que nous adoptons naïvement dans notre vie quand nous ne philosophons pas. Bien que descriptif, il peut être défendu par des arguments et Romano en présente quatre. Le premier est la préséance de la manifestation directe dans la perception sur toute représentation. Toute représentation du monde présuppose une présentation du monde dénuée de tout intermédiaire mental. Le second porte sur la corporéité. La relation perceptive est une relation corporelle au monde, elle repose sur l’appartenance au monde du corps et présuppose donc que le monde soit. Les troisième et quatrième arguments sont une reprise des arguments déjà exposés dans Au coeur de la raison, que sont la conception disjonctive et holistique de la perception. Il n’y a rien de commun entre la perception et l’hallucination et la perception peut être fausse dans le détail mais jamais en totalité comme elle porte toujours sur le monde comme tout, elle n’est pas la somme d’atomes de perceptions qui pourraient s’enchaîner de manière cohérente ou se dissoudre dans un chaos d’esquisses.
Conformément à l’exigence d’une méthode argumentative qui vient compléter la méthode descriptive en phénoménologie, Romano consacre le quatrième chapitre à une réponse à des objections, celle reposant sur la causalité, à laquelle il répond en montrant qu’elle repose sur des fictions théoriques contredites par l’état des connaissances empiriques sur le cerveau, et celle reposant sur l’hallucination, à laquelle il répond par une phénoménologie de l’hallucination s’appuyant sur les travaux d’Henri Ey. Nous n’entrons pas ici dans le détail.
Naïf, direct, descriptif, non-causal, le réalisme du monde de la vie est caractérisé au cinquième chapitre comme étant un externalisme, qui s’oppose à l’internalisme, c’est-à-dire à la métaphysique de l’esprit cartésienne faisant de celui-ci une sphère close sur elle-même où la relation à la chose devient interne, car relation à des représentations, idées, sensations, données des sens. L’internalisme affirme donc que la perception est un processus tout entier intérieur, alors que l’externalisme affirme que la perception atteint l’extériorité même. Pour dépasser l’internalisme, il faut cesser de faire de la conscience une chose, une res cogitans, sphère d’immanence refermée sur elle-même. Nous ne sommes pas une conscience qui a un corps, nous sommes un corps qui a conscience du monde. La conscience n’est pas une chose, elle est un processus, un ensemble de capacités du corps comme celle de percevoir le monde. De ce point de vue, il faudrait parler de la conscience non plus en utilisant un substantif, qui fait signe vers une chose, mais un adverbe, « consciemment », qui fait signe vers quelque chose de fait, d’accompli par le corps. Il s’agit par-là de « rompre avec la métaphysique cartésienne de l’esprit » (p. 222). Il n’y a aucune sphère d’être close sur elle-même, la perception nous ménage un accès direct aux choses dans leur indépendance sans aucun intermédiaire mental. Pour surmonter l’internalisme, il faut comprendre d’où il vient. C’est la mathématisation de la nature par la physique moderne qui réduit le monde à la pure res extensa qui rabat tout ce qui n’en relève pas dans une intériorité forte, celle de la res cogitans. L’internalisme est un produit de la scission entre les deux images, conçues comme incompatibles. Surmonter cette incompatibilité permet de surmonter l’internalisme. Cette métaphysique de l’internalisme n’est pas nécessairement spiritualiste ou idéaliste, on la retrouve aussi bien dans le subjectivisme neuronal matérialiste selon lequel le monde est une représentation en nous générée par le cerveau. Cependant, une première tentative pour affirmer que la perception porte sur la réalité extérieure plutôt que sur une représentation immanente existe déjà, car c’est tout l’enjeu de la conception husserlienne de l’intentionnalité. Pourtant, Romano montre que cette conception échoue à être un véritable externalisme et n’est qu’un internalisme élargi, qui élargit la sphère d’immanence réelle jusqu’à l’immanence intentionnelle. Husserl affirme bien que la perception est une présentation où la chose est donnée en personne, et non un intermédiaire mental immanent qui serait son image ou son idée. C’est l’arbre existant dans le jardin que nous percevons, pas une représentation interne d’arbre. Mais en même temps Husserl fait de l’intentionnalité visant l’objet une caractéristique intrinsèque de la conscience quoi qu’il en soit de l’existence ou de la non-existence de l’objet : « telle est la contradiction insoluble dans laquelle s’empêtre Husserl » (p. 230). Husserl veut rompre avec l’internalisme en affirmant que nous percevons la chose extérieure elle-même en personne, mais il recule devant le réalisme direct en affirmant que lorsque nous percevons l’arbre nous percevons l’arbre dépendant de notre conscience, c’est-à-dire un noème, un perçu d’arbre qui est distinct de l’arbre en tant que tel, car l’un peut brûler et l’autre pas. L’objet se dédouble à nouveau et le noème est séparé par un abîme de l’objet real. Nous percevons un arbre identique à celui qui est dans jardin et à la fois nous percevons un noème d’arbre qui n’est pas identique à cet arbre : « Ici, le paradoxe devient contradiction pure et simple » (p. 233). Le réalisme direct est incompatible avec l’idéalisme transcendantal, ce dernier ne pouvant aboutir qu’à un internalisme élargi aux corrélats objectifs (les noèmes), mais jamais à un externalisme où l’objet perçu est l’objet réel dans son indépendance à nous. Romano examine ensuite la conception de l’intentionnalité de John Searle pour montrer qu’il s’agit là aussi d’un internalisme élargi qui échoue à fonder un authentique externalisme. L’externalisme défendu par Romano affirme que le contenu de la perception est la chose-même et non une représentation, c’est un externalisme non-causal et c’est aussi un externalisme qui « comprend la conscience perceptive comme fondamentalement pré-linguistique » (p. 253) (contre différentes formes d’intellectualisation de la perception comme celles de John McDowell et Snowdon). C’est un externalisme du contenu affirmant que le contenu de l’expérience perceptive est la chose même dans son extériorité à l’esprit. Il est aussi un externalisme du véhicule, c’est-à-dire un externalisme du corps, qui affirme que la perception est fondamentalement une activité corporelle exploratoire de l’environnement extérieur. Cela s’oppose à la fiction du cerveau dans la cuve qui percevrait le monde, car c’est le corps tout entier avec sa motricité par laquelle il explore le monde qui est impliqué dans l’expérience perceptive. La perception ne procède pas de l’activité d’un corps-cerveau, mais d’un corps-dans-le-monde. Cette activité exploratoire ne vise pas seulement le fait de se mouvoir dans le monde pour aller saisir les choses avec nos mains, mais aussi et avant tout la manière dont dans l’expérience visuelle l’oeil est continuellement en mouvement pour balayer le champ visuel pour en extraire l’information visuelle. La vision est donc tout entière une opération corporelle qui s’accomplit dans le monde, jamais une opération de l’esprit ou du cerveau élaborant une image privée du monde dans une conscience fermée (internalisme) : « voir, ce n’est pas reproduire le visible : c’est se porter à sa rencontre par le regard, c’est le faire naître à lui-même en le regardant comme il faut, en permettant aux éléments pertinents de ressortir » (p. 263). Si nous devions élaborer une image interne du monde pour le percevoir, cette image devrait elle aussi être regardée pour saisir l’information qu’elle recèle, il faudrait elle aussi l’explorer visuellement avec nos yeux, alors que nous le faisons sur le monde lui-même en nous passant complètement de cette image superflue : « une image du monde est parfaitement superflue pour rendre compte de la vision, attendu que, pour que vision il y ait, il faudrait pouvoir regarder cette image, en rendre l’information disponible au moyen d’une orientation convenable du regard, la balayer des yeux pour y discerner ce qu’elle contient, et que, par conséquent, l’existence de cette image ne permet toujours pas d’expliquer le fait de voir » (p. 266).
Le réalisme du monde de la vie étant bien compris, on peut alors revenir dans le chapitre six sur les implications qu’il a sur la phénoménologie du corps qui était le point de départ de l’introduction. Ce chapitre reprend implicitement le propos de l’article « Après la chair » des Repères éblouissants pour le développer et le pousser plus loin. Il va s’agir de critiquer phénoménologiquement et argumentativement l’opposition devenue classique depuis Husserl et reprise par la quasi-totalité des approches phénoménologiques du corps entre le Körper et le Leib, le corps physique et le corps de chair, le corps-objet et le corps propre. Cette opposition est un pur produit de la scission entre les deux images du monde pensées comme incompatibles. Surmontant cette incompatibilité le réalisme du monde de la vie doit du même coup pouvoir surmonter cette opposition. Romano repart du célèbre par. 36 des Ideen II dont il fournit un commentaire serré tout à fait remarquable par sa clarté. Husserl y montre que notre corps est d’abord un Körper qui doit être constitué comme Leib par l’ego transcendantal, mais cela n’advient pas dans l’expérience visuelle, où notre corps n’est qu’un Körper parmi d’autres, cela advient dans l’expérience tactile de l’auto-contact ou expérience de la réversibilité touchant-touché. La main gauche est d’abord une chose physique posée dans l’espace objectif, et quand la main droite la touche, la main touchée s’anime tout à coup car se localise en elle une série de sensations sur le trajet de la main touchante, « comme si elle sortait d’une longue léthargie, telle la Belle au bois dormant sous le baiser du prince » (p. 272). Tout à coup, « es wird Leib », elle devient chair. La comparaison avec la Belle au bois dormant laisse déjà deviner que pour Romano, cette description a beau être saisissante, elle n’en relève pas moins du conte de fée. En effet, il est problématique de partir du Körper comme si notre chair ne l’était pas dès le départ. Jamais notre corps ne nous apparaît comme pure chose physique. Le point de départ de Husserl est en fait cartésien, et donc issu de la scission moderne entre les deux images du monde : l’ego est d’abord dissocié de son corps pour pouvoir ensuite les réunir. Pour Husserl, il est tout à fait possible de penser un ego sans chair et l’incarnation de l’ego est une caractéristique contingente et secondaire. L’ego transcendantal ne peut pas être identifié à sa chair puisqu’il est pur, non mondain, constituant, il est le centre d’où rayonne l’intentionnalité, il est une transcendance dans l’immanence, caractéristiques que ne possède pas la chair puisqu’elle est mondaine, donnée dans l’immanence réelle, constituée, caractérisée comme un objet. L’ego transcendantal a une chair, il n’est pas sa chair. Le dernier Husserl, celui du Lebenswelt, précise lui-même que les corps perçus dans le monde de la vie ne sont pas les corps de la physique, qui sont issus d’opérations d’idéalisation. Dès lors, le point de départ de la constitution de la chair, à savoir la donation de notre corps comme chose physique, entre en contradiction avec l’expérience du monde de la vie. On peut alors comprendre le Körper non plus comme le corps physique, mais le corps biologique, mais en réalité les concepts de la biologie comme ceux de cellule ou de métabolisme n’ont pas plus du place dans le monde de la vie. Romano commente de manière détaillée l’analyse husserlienne de l’expérience du touchant-touché réversible. Lorsque ma main droite touche ma main gauche, la main gauche s’éveille, elle est le siège de nouvelles sensations, et le toucher est redoublé car les deux mains s’éprouvent tour à tour comme touchantes et touchées. Les sensations s’éveillent et elles sont des données immanentes de la conscience, donc elles ne sont pas localisées dans l’espace objectif, elles relèvent d’une proto-localisation qui fait advenir une localité illocalisable qui est celle de l’ici absolu de la chair. Touchant ma main gauche, l’impression est sensation touchante de ses propriétés objectives et cette sensation est aussi impression tactile d’être touché. C’est la même sensation qui est appréhendé différemment alternativement. Mais Romano conteste le privilège de l’auto-contact : quand je touche une boule de plomb, il y a sensations de lisse, de froid, de sphéricité, mais elles sont tout autant des sensations d’être touché par cette chose froide, lisse et ronde. Ce sont donc des présupposés philosophiques non questionnés et non une attention aux phénomènes qui conduisent Husserl à accorder un privilège à l’auto-contact. Accordant à cette chair une pré-spatialité dans un ici absolu illocalisable qui fait qu’elle n’a plus de limites dans l’espace objectif, elle « devient un espèce de corps angélique, un épiphénomène de la conscience, et peut-être même un autre nom de celle-ci » (p. 287). Romano cite une formule inédite dans laquelle Michel Henry vend la mèche : « il n’y a aucune différence entre chair et âme » (p. 289). Loin d’incorporer l’âme, la chair spiritualise le corps jusqu’à lui faire perdre sa corporéité même : « L’invention phénoménologique de la chair est une tentative pour spiritualiser le corps au point de le dissoudre » (p. 289-290). Dès lors, le Körper et le Leib sont séparés par un abîme, leurs déterminations s’opposent terme à terme, de sorte que leur unité devient un problème insoluble, une contradiction pure et simple. Pour « sortir de cette impasse, il […] faut tout reprendre à zéro » (p. 291).
 Le chapitre sept reprend tout à zéro pour fournir une tout autre description du corps. Il n’y a aucune dualité du corps, il y a une unité d’emblée donnée. Dans le monde de la vie, les corps ne sont jamais donnés comme de simples réalités physiques, ils sont des corps vivants, des hommes ou des animaux, et ces corps sont l’auto-présentation de ces vivants. La conscience n’est pas une chose mais un ensemble de capacités du corps, donc ces corps vivants dans le monde de la vie ne s’associent pas à des âmes dans une mystérieuse unité. Chaque vivant est identique à son corps qui est le siège de ses capacités, même les plus intellectuelles. Le corps n’apparaît pas du tout dans le monde de la vie comme une annexe de la conscience, mais comme moi-même en tant que j’appartiens au monde. Cette identité de l’homme à son corps ne signifie pas une adhésion au matérialisme, car ce dernier identifie l’esprit au corps au sens que lui confère la physique, alors qu’il n’y a pas de tel corps dans le monde de la vie. La démarche de Romano refuse donc les dualisme Körper–Leib et corps-âme, elle part de l’unité indissoluble du corps phénoménal. Contre l’idée d’un privilège du sens tactile dans l’appréhension de notre chair, il faut affirmer que les sens ne sont pas séparés dans notre expérience perceptive, celle-ci étant toujours multimodale, c’est-à-dire qu’en elles les sens communiquent toujours entre eux, et il n’y a pas de sensations isolées. Par conséquent, plutôt que de distinguer différents sens, Romano va distinguer deux registres de la sensibilité. Le premier est pathique et autocentré, le second est gnosique et allocentré. La première est une sensibilité tournée vers soi, la seconde est une sensibilité tournée vers le monde. La sensibilité gnosique nous fait connaître les propriétés du monde indépendantes de nous-mêmes et donc objectives, tandis que la sensibilité pathique porte sur nos propre états et nous les manifeste connotés positivement ou négativement. Romano analyse de près l’exemple éclairant de la différence qu’il y a entre sentir du froid et avoir froid. La sensation de froid nous renseigne sur une propriété objective d’un corps froid, alors que la sensation d’avoir froid ne nous renseigne que sur notre hypothermie. C’est une sensibilité affective car ce qui nous est découvert est toujours vécu comme agréable ou désagréable. Un autre exemple est la différence entre la sensation de chaleur et la sensation de brûlure, celle entre la sensation d’être effleuré par une plume et la sensation de chatouillement, la perception d’une lumière vive et la sensation d’éblouissement, etc. La sensibilité pathique nous met en contact avec nos propres états corporels, en elle nous nous sentons. Par exemple, ressentir la fatigue, c’est se sentir fatigué : « Sentir équivaut ici à se-sentir » (p. 299). Cela signifie que ces sensations sont des sensations d’être placé dans un état corporel. Le seul lieu où se fait jour ces sensations-états est mon corps, de sorte qu’il est d’emblée absolument distinct de tout le reste sans qu’on ait besoin pour le distinguer des autres corps de faire appel au sens tactile. Il n’y a aucune confusion possible entre mon corps et les autres corps puisqu’« il est le site même où se localisent un certain nombre de sensations-états qui différent toto caelo de toutes les autres et ne trouvent place qu’en lui » (p. 300). Nous avons aussi accès à notre corps par notre sensibilité allocentrée, par exemple par la vision ou l’audition, mais dans ce cas une erreur d’identification est toujours possible alors qu’avec la sensibilité pathique, il n’y a pas d’erreur d’identification possible, car dès que je ressens un état de mon corps, par exemple un état douloureux, je sais toujours déjà de qui c’est l’état sans même avoir besoin de me l’attribuer. Il ne s’agit pas de dire, comme Descartes, que nous avons une compétence infaillible pour dire dans quel état est notre corps, mais qu’il n’est pas possible de se tromper à propos de la question de savoir de quel corps c’est l’état. La sensibilité pathique est ce sentir existentiel qui nous met en contact avec nous même en-deçà de tout doute. Elle me fait éprouver que je suis mon corps,et que mon corps n’est pas mon appendice comme il l’est de l’ego transcendantal. Sentant, nous nous sentons corporellement, nous sommes dans l’état que nous ressentons du fait même de le ressentir (fatigué, douloureux, etc.) et cette appréhension de soi-même ne passe pas par une objectivation comme c’était le cas dans l’expérience du toucher redoublé. Mon expérience de mon corps dans la sensibilité pathique n’est donc pas l’expérience d’un objet fût-il particulièrement intime comme l’est la chair selon Husserl. Ce sentir pathique existentiel est celui d’un nouveau cogito que Romano formule en latin : « Sentio corpum habere, ergo sum » (p. 303). Cela signifie que ce sentir atteste immédiatement, et sans aucune inférence, l’existence corporelle du sujet, et non son existence tout court. C’est ce que n’a pas vu Descartes en faisant du sentir une pensée de sentir attribuable à la res cogitans dépourvue de corps. Cette sensibilité pathique distingue d’emblée mon corps des autres choses du monde sans aucune opération d’appropriation mais il est lui aussi une chose du monde de sorte qu’il n’est pas un corps glorieux spiritualisé. Prenant place dans ce corps et dans ce corps seulement, la sensibilité pathique le délimite et en fait une enveloppe corporelle séparant un dedans d’un dehors, de sorte qu’« un tel corps vivant se situe aux antipodes de la chair ubiquiste de Husserl, dépourvue de limites assignables dans le monde et même coextensive au monde lui-même, rayonnant jusqu’aux étoiles » (p. 310). Cette distinction entre les deux régimes de la sensibilité permet à Romano de réinterpréter l’expérience de l’auto-contact. Il articule les deux dimensions de la sensibilité : quand nous touchons, c’est la sensibilité gnosique, quand nous sommes touchés, c’est la sensibilité pathique. L’expérience de l’auto-contact perd alors son mystére et son privilège. En réalité, quand je touche un objet extérieur, je suis aussi touché par lui, il y a à la fois la sensibilité gnosique et la sensibilité pathique. Dans l’auto-contact, ce phénomène est redoublé mais nous n’avons pas besoin de cela pour éprouver notre incarnation, la sensibilité pathique suffit dans tous les cas, même sans auto-contact. La sensibilité pathique fait de mon corps se sentant une intimité qui n’a plus rien à voir avec l’intériorité privée de la métaphysique internaliste. C’est l’intimité d’un corps enclos dans ses propres limites et appartenant au champ phénoménal comme son pôle subjectif auquel s’oppose une extériorité comme son pôle objectif. C’est une intimité spatiale et mondaine, contrairement à l’intériorité de la conscience. Le monde phénoménal articule les deux dimensions jumelles de l’intériorité corporelle et de l’extériorité à mon corps, il abrite mon corps qui est lui aussi une chose du monde. Dans cette conception, il n’y a plus ces deux corps que sont le Körper et le Leib, il y a l’unité du corps phénoménal donné à la fois selon les deux régimes de la sensibilité comme une intériorité corporelle identique à moi-même et comme une chose dans le monde homogène aux autres choses mondaines.
Le chapitre sept reprend tout à zéro pour fournir une tout autre description du corps. Il n’y a aucune dualité du corps, il y a une unité d’emblée donnée. Dans le monde de la vie, les corps ne sont jamais donnés comme de simples réalités physiques, ils sont des corps vivants, des hommes ou des animaux, et ces corps sont l’auto-présentation de ces vivants. La conscience n’est pas une chose mais un ensemble de capacités du corps, donc ces corps vivants dans le monde de la vie ne s’associent pas à des âmes dans une mystérieuse unité. Chaque vivant est identique à son corps qui est le siège de ses capacités, même les plus intellectuelles. Le corps n’apparaît pas du tout dans le monde de la vie comme une annexe de la conscience, mais comme moi-même en tant que j’appartiens au monde. Cette identité de l’homme à son corps ne signifie pas une adhésion au matérialisme, car ce dernier identifie l’esprit au corps au sens que lui confère la physique, alors qu’il n’y a pas de tel corps dans le monde de la vie. La démarche de Romano refuse donc les dualisme Körper–Leib et corps-âme, elle part de l’unité indissoluble du corps phénoménal. Contre l’idée d’un privilège du sens tactile dans l’appréhension de notre chair, il faut affirmer que les sens ne sont pas séparés dans notre expérience perceptive, celle-ci étant toujours multimodale, c’est-à-dire qu’en elles les sens communiquent toujours entre eux, et il n’y a pas de sensations isolées. Par conséquent, plutôt que de distinguer différents sens, Romano va distinguer deux registres de la sensibilité. Le premier est pathique et autocentré, le second est gnosique et allocentré. La première est une sensibilité tournée vers soi, la seconde est une sensibilité tournée vers le monde. La sensibilité gnosique nous fait connaître les propriétés du monde indépendantes de nous-mêmes et donc objectives, tandis que la sensibilité pathique porte sur nos propre états et nous les manifeste connotés positivement ou négativement. Romano analyse de près l’exemple éclairant de la différence qu’il y a entre sentir du froid et avoir froid. La sensation de froid nous renseigne sur une propriété objective d’un corps froid, alors que la sensation d’avoir froid ne nous renseigne que sur notre hypothermie. C’est une sensibilité affective car ce qui nous est découvert est toujours vécu comme agréable ou désagréable. Un autre exemple est la différence entre la sensation de chaleur et la sensation de brûlure, celle entre la sensation d’être effleuré par une plume et la sensation de chatouillement, la perception d’une lumière vive et la sensation d’éblouissement, etc. La sensibilité pathique nous met en contact avec nos propres états corporels, en elle nous nous sentons. Par exemple, ressentir la fatigue, c’est se sentir fatigué : « Sentir équivaut ici à se-sentir » (p. 299). Cela signifie que ces sensations sont des sensations d’être placé dans un état corporel. Le seul lieu où se fait jour ces sensations-états est mon corps, de sorte qu’il est d’emblée absolument distinct de tout le reste sans qu’on ait besoin pour le distinguer des autres corps de faire appel au sens tactile. Il n’y a aucune confusion possible entre mon corps et les autres corps puisqu’« il est le site même où se localisent un certain nombre de sensations-états qui différent toto caelo de toutes les autres et ne trouvent place qu’en lui » (p. 300). Nous avons aussi accès à notre corps par notre sensibilité allocentrée, par exemple par la vision ou l’audition, mais dans ce cas une erreur d’identification est toujours possible alors qu’avec la sensibilité pathique, il n’y a pas d’erreur d’identification possible, car dès que je ressens un état de mon corps, par exemple un état douloureux, je sais toujours déjà de qui c’est l’état sans même avoir besoin de me l’attribuer. Il ne s’agit pas de dire, comme Descartes, que nous avons une compétence infaillible pour dire dans quel état est notre corps, mais qu’il n’est pas possible de se tromper à propos de la question de savoir de quel corps c’est l’état. La sensibilité pathique est ce sentir existentiel qui nous met en contact avec nous même en-deçà de tout doute. Elle me fait éprouver que je suis mon corps,et que mon corps n’est pas mon appendice comme il l’est de l’ego transcendantal. Sentant, nous nous sentons corporellement, nous sommes dans l’état que nous ressentons du fait même de le ressentir (fatigué, douloureux, etc.) et cette appréhension de soi-même ne passe pas par une objectivation comme c’était le cas dans l’expérience du toucher redoublé. Mon expérience de mon corps dans la sensibilité pathique n’est donc pas l’expérience d’un objet fût-il particulièrement intime comme l’est la chair selon Husserl. Ce sentir pathique existentiel est celui d’un nouveau cogito que Romano formule en latin : « Sentio corpum habere, ergo sum » (p. 303). Cela signifie que ce sentir atteste immédiatement, et sans aucune inférence, l’existence corporelle du sujet, et non son existence tout court. C’est ce que n’a pas vu Descartes en faisant du sentir une pensée de sentir attribuable à la res cogitans dépourvue de corps. Cette sensibilité pathique distingue d’emblée mon corps des autres choses du monde sans aucune opération d’appropriation mais il est lui aussi une chose du monde de sorte qu’il n’est pas un corps glorieux spiritualisé. Prenant place dans ce corps et dans ce corps seulement, la sensibilité pathique le délimite et en fait une enveloppe corporelle séparant un dedans d’un dehors, de sorte qu’« un tel corps vivant se situe aux antipodes de la chair ubiquiste de Husserl, dépourvue de limites assignables dans le monde et même coextensive au monde lui-même, rayonnant jusqu’aux étoiles » (p. 310). Cette distinction entre les deux régimes de la sensibilité permet à Romano de réinterpréter l’expérience de l’auto-contact. Il articule les deux dimensions de la sensibilité : quand nous touchons, c’est la sensibilité gnosique, quand nous sommes touchés, c’est la sensibilité pathique. L’expérience de l’auto-contact perd alors son mystére et son privilège. En réalité, quand je touche un objet extérieur, je suis aussi touché par lui, il y a à la fois la sensibilité gnosique et la sensibilité pathique. Dans l’auto-contact, ce phénomène est redoublé mais nous n’avons pas besoin de cela pour éprouver notre incarnation, la sensibilité pathique suffit dans tous les cas, même sans auto-contact. La sensibilité pathique fait de mon corps se sentant une intimité qui n’a plus rien à voir avec l’intériorité privée de la métaphysique internaliste. C’est l’intimité d’un corps enclos dans ses propres limites et appartenant au champ phénoménal comme son pôle subjectif auquel s’oppose une extériorité comme son pôle objectif. C’est une intimité spatiale et mondaine, contrairement à l’intériorité de la conscience. Le monde phénoménal articule les deux dimensions jumelles de l’intériorité corporelle et de l’extériorité à mon corps, il abrite mon corps qui est lui aussi une chose du monde. Dans cette conception, il n’y a plus ces deux corps que sont le Körper et le Leib, il y a l’unité du corps phénoménal donné à la fois selon les deux régimes de la sensibilité comme une intériorité corporelle identique à moi-même et comme une chose dans le monde homogène aux autres choses mondaines.
Le chapitre huit prolonge ces analyses en s’intéressant au problème spécifique de la mobilité corporelle. L’enjeu est ici de surmonter la conception husserlienne de la chair comme un ici absolu qui ne peut se mouvoir. La chair n’occupant aucune place dans l’espace objectif, elle ne peut pas non plus changer de place. Seul le Körper se meut, ou plutôt est mû, puisqu’il occupe une place dans l’espace objectif et peut donc en changer. Là-contre, Romano montre que notre corps appartenant au monde perçoit son propre mouvement tout autrement que celui des autres corps, car le champ optique subit une modification continuelle qui est une expansion depuis un foyer situé devant nous à l’horizon et une contraction d’un foyer symétrique situé à l’arrière de nous. Cette expansion du champ visuel ne peut correspondre qu’à notre propre locomotion, jamais au mouvement des choses. Husserl ne peut pas rendre compte de la mobilité corporelle car il fait de la chair un objet sur lequel s’exerce l’efficace de l’ego transcendantal de sorte que le corps de chair ne se meut jamais, il est mû par l’ego. Ce n’est pas le corps qui est l’agent de sa propre locomotion, donc on ne peut pas rendre compte du mouvement spontané du corps. Le mouvement spontané ne peut pas s’analyser comme le mouvement conféré au corps par l’ego pur, car en lui je me meus moi-même, j’accomplis ce mouvement, mais je ne me mets pas en mouvement. Je n’effectue pas une action transitive sur mon propre corps. Ma puissance d’agir ne s’exerce pas par le moyen du corps, mon corps en est le lieu même. Se mouvoir n’est pas agir sur son corps. Pour pouvoir agir sur son corps, il faut de toute façon pouvoir agir tout court, et seul un corps peut être doté d’une telle spontanéité d’action. Il me faudrait un corps pour agir sur mon corps, et l’on tomberait dans une régression à l’infini. Dans le mouvement corporel, l’action est intransitive, elle n’est pas exercée sur le corps, elle est exercée par le corps qui est de plein droit le sujet de l’action : « Au sens strict, je ne peux rien sur mon corps, c’est lui qui peut tout ce que je peux, et c’est pourquoi il n’y a pas de différence à faire entre lui et moi, entre mon propre pouvoir sur lui et son efficace sur les choses » (p. 337). On ne peut pas rendre compte de la mobilité corporelle à partir d’une action de l’ego sur le corps qui aurait pour résultat un mouvement physique. Le mouvement corporel ne procède pas de commandes motrices et de leur exécution. Le mouvement ne fait pas intervenir à chaque étape la représentation conscience d’un but. Dans la plupart de nos mouvements, il n’y a aucun plan d’action explicite, aucun idée présente pour diriger notre action. C’est le couplage en un système du corps avec son milieu antérieur à tout contrôle conscient qui permet au mouvement de se dérouler de manière fluide. L’approche de Romano est une fois de plus holiste. Le mouvement forme un tout et ses paramètres comme la figure qu’il prend ou bien sa vitesse ne sont pas commandés séparément. Si je décide d’écrire plus vite, la forme des lettres change, si le cheval passe du trot au galop, le schéma de coordination change. Quand nous contrôlons un paramètre, il y a parallèlement l’impossibilité de contrôler la plupart des autres. Le mouvement est donc fluide parce qu’il s’accomplit pour ainsi dire « tout seul », lorsque l’agent ne cherche pas à contrôler la totalité de ses paramètres. Romano s’appuie sur les travaux de Buytendijk, von Weizsäcker et Straus pour montrer que le mouvement vivant unit en un seul tout le temps et l’espace. Dans le cas du saut en longueur, il y a un là-bas éloigné dans le temps et dans l’espace qui est immanent à l’ensemble des phases et dicte la forme du saut. Le sauteur n’intervient pas sur la forme de son saut par un contrôle fait d’ajustements posturaux incessants, il faut justement qu’il intervienne le moins possible pour ne pas casser la fluidité de son mouvement. Il n’y a pas une addition de commandes motrices indépendantes qui produiraient le mouvement en totalité, il y a d’emblée une totalité indécomposable qui est plus que la somme de ses parties. Le mouvement vivant n’est jamais une succession de mouvements parcellaires : « un holisme gestuel répond donc au holisme perceptif : le mouvement doit jaillir d’une seule pièce » (p. 343). Les exemples sportifs comme le joueur de baseball ou le tennisman sont particulièrement parlants mais Romano montre aussi que l’analyse est valable dans le domaine de l’art où le geste de peindre le mieux maîtrisé est celui qui se produit d’un seul tenant, sans réalisation d’un plan conçu à l’avance, donc dans une forme d’improvisation. Tout cette analyse holiste du mouvement vivant montre que notre corps n’est pas un appendice de nous-même et que le mouvement corporel n’est pas conféré à ce corps de l’extérieur, ce qui n’est compréhensible que si je suis mon corps se mouvant spontanément.
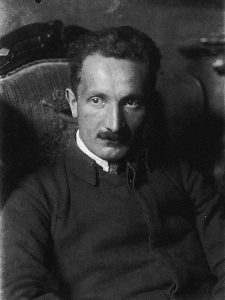
Portrait of Martin Heidegger (1889-1976) , circa 1927. Private Collection. Creator: Anonymous. (Photo by Fine Art Images/Heritage Images via Getty Images)
Le neuvième et dernier chapitre peut revenir au problème des trois corps posé dans l’introduction. Cet éclatement procède de l’incompatibilité entre les deux images du monde produisant l’objectivisme d’un côté et la métaphysique internaliste de l’esprit de l’autre. Le corps tombe alors des deux côtés de la scission en tant que corps-objet relevant de l’image du monde de la physique et chair relevant de la métaphysique internaliste de l’esprit. Le troisième corps est alors celui d’autrui, qui n’est pas le corps subjectif appelé « chair » mais n’est pas non plus réductible au corps-objet du monde de la physique. Le statut de ce corps est aporétique, comme le montre l’échec de la cinquième méditation cartésienne à rendre compte de sa constitution. Cette constitution se présuppose inévitablement elle-même car je ne pourrais transférer à autrui le sens d’ego que s’il se présente à moi sous forme de chair, mais on n’arrive pas à rendre compte de la possibilité d’un tel apparaître en chair dont nous n’avons aucun auto-contact. Il faudrait pouvoir distinguer le corps d’autrui d’un simple automate pour le constituer en chair, mais il faudrait qu’il apparaisse déjà comme une chair pour pouvoir le distinguer d’un simple automate. Au dédoublement du corps de l’ego transcendantal répond le dédoublement du corps d’autrui. Ce dernier se présente à moi comme un Körper qui n’est pas encore un autre ego, mais seulement le signe de celui-ci. Mais d’autre part, autrui est lui aussi un Leib mais qui me demeure inaccessible, car il est le sous-bassement hylétique de sa conscience à lui. La conséquence inévitable est qu’autrui demeure fondamentalement inaccessible. Si nous voulons affirmer que nous avons un accès direct à autrui, nous nions son altérité car il devient immanent à notre propre conscience. Nous pouvons, en maintenant ce cadre métaphysique, prendre notre parti de la différence radicale d’autrui et soutenir qu’il transcende toute phénoménalité, c’est la position de Levinas. Pour Romano, cette solution n’en est pas une, car elle ne peut pas rendre compte de ce qui devrait être la donnée de départ de toute phénoménologie d’autrui, à savoir le fait irrécusable qu’autrui m’apparaît dans le monde sans l’interposition de signes ou d’indices d’aucune sorte. Le seul moyen de sortir de cette impasse sceptique où rien ne nous assure de l’existence d’autrui est de surmonter la métaphysique internaliste qui nous y plonge. Romano s’appuie sur Heidegger et Wittgenstein pour la dépasser. Le premier montre dans Sein und Zeit que la théorie de l’Einfühlung ne fonctionne pas, car elle prétend combler le gouffre entre moi et autrui et prend ainsi son point de départ dans un problème mal formulé. Pour résoudre ce problème, il faut cesser de définir la conscience comme un système d’être fermé sur soi, car c’est cette conception qui crée un abîme infranchissable entre moi et autrui. La phénoménologie de notre expérience d’autrui nous dévoile l’accessibilité fondamentale d’autrui dans le corps qu’il nous présente. Wittgenstein montre que dans le corps manifeste d’autrui, ses pensées, ses émotions et ses intentions se donnent à voir sans appel à la moindre interprétation. Nous n’avons pas besoin de vivre les expériences d’autrui, et donc d’être lui, pour pouvoir percevoir directement ses pensées et ses émotions sur son corps, et de manière privilégiée sur son visage. Il s’agit bien de perception, pas du tout d’une conjecture. Romano entend aller plus loin que Heidegger et Wittgenstein, car il entend montrer ce qui, dans le cadre théorique de l’internalisme nous conduit à ses conséquences désastreuses. C’est l’interprétation objectiviste de l’image du monde héritée de la révolution scientifique moderne qui nous condamne à l’échec. Le problème de l’existence d’autrui est forgé de toute pièce par cette métaphysique qui fait de l’esprit une région d’être fermée sur soi. Le réalisme naïf et direct du monde de la vie peut montrer là-contre que dans la perception nous sommes au contact d’autrui lui-même, jamais d’une représentation d’autrui. Par plus que n’importe quelle chose autrui ne se présente à nous par le truchement d’intermédiaires mentaux, il se présente en personne. Pourtant, autrui est un corps vivant et le seul corps qui nous apparaisse comme vivant grâce à notre sensibilité pathique, c’est le nôtre. Mais cette objection repose sur la présupposition fausse que pour percevoir autrui, il faudrait que je vive ses expériences. J’ai un accès perceptif direct à autrui sans avoir besoin pour cela de vivre ses expériences à sa place. Ce qui nous fait supposer un tel besoin est l’idée selon laquelle autrui serait enfermé dans sa sphère d’intériorité que nous devrions alors pouvoir pénétrer pour la connaître. Mais c’est cette idée qu’il faut abandonner. Je suis donné corporellement d’une manière différente de celle dont autrui m’est donné corporellement, mais autrui n’en reste pas moins donné directement à moi, et jamais par l’intermédiaire d’une représentation. Ce n’est pas parce que je ne peux pas ressentir le corps de l’autre tel qu’il le ressent lui-même que je n’ai pas directement accès à ce corps, car je n’ai pas du tout besoin de cela. La prémisse sur laquelle repose tout le problème est celle d’après laquelle le monde devrait être représenté pour être perçu, donc être subjectif. Si je dis que le monde est subjectif, alors inévitablement autrui ne peut y apparaître directement puisqu’il n’est pas une composante de ma subjectivité, de sorte qu’autrui est seulement représenté dans mon expérience, mais il n’y est pas présent en personne, et on peut toujours douter de son existence au-delà de cette représentation, et le piège solipsiste se referme. Le réalisme direct et naïf du monde de la vie a surmonté cette prémisse, le monde n’est subjectif en aucun sens que ce soit et la perception nous ménage un accès direct à lui. Nous percevons le monde depuis notre perspective, mais un monde indépendant par rapport à toute perspective. Dès lors, le problème d’autrui s’est dissipé avec l’internalisme. N’étant rien de subjectif, le monde est le même monde pour moi et pour autrui, il est d’emblée un monde commun auquel nous appartenons tous les deux : « le seul point de départ légitime d’une phénoménologie d’autrui est que nous apparaissons, lui et moi, dans le même monde – c’est-à-dire dans le monde même » (p. 363). Romano peut en conclure que ce réalisme phénoménologique nous montre que le monde est tel qu’il se présente à nous, et cela est aussi valable pour autrui.
L’ouvrage se termine sur la formule suivante : « Nous avons retrouvé la sortie du labyrinthe et nous pouvons marcher en pleine lumière » (p. 370). Cette lumière est celle du monde de la vie. Mais cette conception des problèmes philosophiques comme des labyrinthes dont les descriptions phénoménologiques nous feraient sortir est intéressante. C’est la dimension proprement anti-métaphysique de la phénoménologie de Romano. Il y a là quelque chose qui fait penser à Wittgenstein, et Romano est un connaisseur très précis de l’oeuvre de Wittgenstein avec laquelle il s’explique dans plusieurs ouvrages. Wittgenstein faisait de la philosophie une activité foncièrement thérapeutique qui dissout les faux problèmes de la métaphysique en montrant qu’ils reposent sur des non-sens, c’est-à-dire un mauvais usage du langage, qui n’est pas conforme à la grammaire de nos jeux de langage. Or, à plusieurs reprises au long de l’ouvrage reviennent des formulations selon lesquelles telle thèse « n’est pas simplement fausse, elle est absurde » (p. 122), elle est « dépourvue de sens » (p. 294), « ne fait pas sens » (p. 306, note 2), ou « fait aussi peu sens » (p. 328). Il nous semble que l’ambition de la phénoménologie de Romano est la même que celle de Wittgenstein, débusquer les non-sens de la métaphysique pour nous en guérir, mais avec pour méthode la description phénoménologique de notre expérience naïve de sens commun, non encore déformée par les constructions intellectuelles des philosophes. La phénoménologie de Romano est un réalisme naïf qui donne raison au point de vue du sens commun contre la métaphysique : le monde est tel que nous le voyons, nous pouvons y « marcher en pleine lumière » (p. 370) de manière apaisée.
[1] L’Événement et le monde, Paris, PUF, 1998.
[2] L’Événement et le temps, Paris, PUF, 1999.
[3] L’Événement et le monde, Paris, PUF, 2021.
[4] Il y a, Paris, PUF, 2003.
[5] L’Inachèvement d’Être et temps, Argenteuil, Le Cercle herméneutique, 2013.
[6] Le Chant de la vie, Paris, Gallimard, 2005.
[7] Au coeur de la raison, Paris, Gallimard, 2010. L’ouvrage est repris cette année en Tel Gallimard. À cette occasion, Claude Romano complète le titre en ajoutant « et son avenir » à « la phénoménologie ».
[8] Les Repères éblouissants, Paris, PUF, 2019.
[9] De la couleur, Paris, Gallimard, 2021.
[10] Être soi-même, Paris, Gallimard, 2019.
[11] La Liberté intérieure, Paris, Hermann, 2020.
[12] L’Identité humaine en dialogue, Paris, Seuil, 2022.
[13] La Révolution de l’authenticité à l’âge du romantisme, Paris, Mimesis, 2023.
[14] L’Appartenance au monde, Paris, Seuil, 2025. On peut voir sur YouTube les enregistrements des conférences d’une journée d’étude consacrée au livre à l’ENS. La journée se conclut par une importante communication de Claude Romano qui complète le livre. https://youtu.be/vWxzW0_aMhc?si=sQk6fv6_DjJi_a4q







