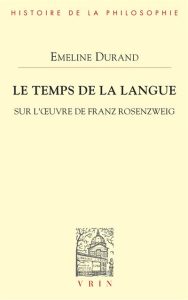 Le très beau livre d’E. Durand élabore une analyse à la fois savante et pensante de la question de la langue dans la pensée de F. Rosenzweig. Mais au-delà de ce seul auteur, il s’agit d’abord de « rappeler la philosophie à sa condition linguistique « (p. 9) : il y a inauguralement dans le livre une thèse sur un « temps de la langue » qu’il s’agirait de rejoindre. Ce temps serait celui où la philosophie cesse d’être un « monolinguisme », indifférent à la langue qu’elle parle, suivant la règle récapitulée par Levinas : « le discours cohérent est un. Une pensée universelle se passe de communication. Une raison ne peut être autre pour une raison » (p. 10, citant Levinas, Totalité et infini, Livre de Poche, p.. 69). Au contraire, une certaine crise de la philosophie – sous sa forme achevée : la pensée de Hegel – aurait ouvert un moment de l’histoire où, à nouveau, ou pour la première fois, la langue entre en question, non comme un medium mais comme une source : « la pensée se forme en choisissant ses mots parmi ceux que lui offre la langue commune, laquelle nourrit l’invention conceptuelle plutôt qu’elle ne lui fait obstacle » (p. 10). Penser, ce n’est pas seulement penser dans une langue, mais penser la langue dans laquelle on pense et la langue doit apparaître comme le fondement même de la pensée. Cela conduit la philosophie à prendre la forme réflexive d’une herméneutique, d’un « Sprachdenken » (p. 11). Cela suppose, dit l’A., une « confiance dans la langue que la Sprachphilosophie allemande – de Herder et Humboldt à Rosenzweig et Heidegger – a rendu particulièrement féconde » (p. 11). Il y aurait donc continuité entre ces penseurs et entre leurs pensées. Peut-on établir philosophiquement une telle continuité ? L’entreprise de l’idéalisme allemand, assimilant la langue à une œuvre de l’esprit, se situe-t-elle sur le même plan, au moins formellement – mais c’est déjà beaucoup dire –, que la pensée de Heidegger qui tient la langue pour la « maison de l’Être », pour l’abri de sa vérité, et que l’effort de Rosenzweig pour articuler la langue à la trace historique de la Révélation ? Telle sera l’hypothèse qui sera de toile de fond à l’ouvrage, particulièrement tournée vers ce dernier effort : Rosenzweig apporterait, à sa manière, une contribution – mais cela veut dire : une contribution parmi d’autres – au Sprachdenken. La singularité de ce que pense Rosenzweig ne s’en trouve-t-elle pas, d’emblée interprétée, c’est-à-dire elle-même traduite dans un horizon purement philosophique, celui, justement, d’un « temps de la langue » ? Est-ce alors comme contribution à un tel « temps » que la pensée de Rosenzweig peut être lue et proprement comprise ? Ou bien faut-il, au contraire, reconnaître dans cette pensée un accomplissement qui vient justement rompre l’unité du « temps de la langue » et conduire ce dernier devant les alternatives radicales auxquelles ce temps doit se confronter ?
Le très beau livre d’E. Durand élabore une analyse à la fois savante et pensante de la question de la langue dans la pensée de F. Rosenzweig. Mais au-delà de ce seul auteur, il s’agit d’abord de « rappeler la philosophie à sa condition linguistique « (p. 9) : il y a inauguralement dans le livre une thèse sur un « temps de la langue » qu’il s’agirait de rejoindre. Ce temps serait celui où la philosophie cesse d’être un « monolinguisme », indifférent à la langue qu’elle parle, suivant la règle récapitulée par Levinas : « le discours cohérent est un. Une pensée universelle se passe de communication. Une raison ne peut être autre pour une raison » (p. 10, citant Levinas, Totalité et infini, Livre de Poche, p.. 69). Au contraire, une certaine crise de la philosophie – sous sa forme achevée : la pensée de Hegel – aurait ouvert un moment de l’histoire où, à nouveau, ou pour la première fois, la langue entre en question, non comme un medium mais comme une source : « la pensée se forme en choisissant ses mots parmi ceux que lui offre la langue commune, laquelle nourrit l’invention conceptuelle plutôt qu’elle ne lui fait obstacle » (p. 10). Penser, ce n’est pas seulement penser dans une langue, mais penser la langue dans laquelle on pense et la langue doit apparaître comme le fondement même de la pensée. Cela conduit la philosophie à prendre la forme réflexive d’une herméneutique, d’un « Sprachdenken » (p. 11). Cela suppose, dit l’A., une « confiance dans la langue que la Sprachphilosophie allemande – de Herder et Humboldt à Rosenzweig et Heidegger – a rendu particulièrement féconde » (p. 11). Il y aurait donc continuité entre ces penseurs et entre leurs pensées. Peut-on établir philosophiquement une telle continuité ? L’entreprise de l’idéalisme allemand, assimilant la langue à une œuvre de l’esprit, se situe-t-elle sur le même plan, au moins formellement – mais c’est déjà beaucoup dire –, que la pensée de Heidegger qui tient la langue pour la « maison de l’Être », pour l’abri de sa vérité, et que l’effort de Rosenzweig pour articuler la langue à la trace historique de la Révélation ? Telle sera l’hypothèse qui sera de toile de fond à l’ouvrage, particulièrement tournée vers ce dernier effort : Rosenzweig apporterait, à sa manière, une contribution – mais cela veut dire : une contribution parmi d’autres – au Sprachdenken. La singularité de ce que pense Rosenzweig ne s’en trouve-t-elle pas, d’emblée interprétée, c’est-à-dire elle-même traduite dans un horizon purement philosophique, celui, justement, d’un « temps de la langue » ? Est-ce alors comme contribution à un tel « temps » que la pensée de Rosenzweig peut être lue et proprement comprise ? Ou bien faut-il, au contraire, reconnaître dans cette pensée un accomplissement qui vient justement rompre l’unité du « temps de la langue » et conduire ce dernier devant les alternatives radicales auxquelles ce temps doit se confronter ?
On ne saurait répondre sans établir préalablement quelle est la tâche exacte que s’impartit Rosenzweig lui-même. Celui-ci, cherchant à élaborer une « philosophie de la Révélation », (p. 17), « s’efforçant de faire place à la Révélation dans le discours philosophique », nous invite à nous demander quelle est l’essence d’un tel discours et dans quelle mesure celui-ci peut être susceptible d’accueillir celle-là. De prime abord, nous pourrions alors demander : la Révélation, comprise dans sa dimension linguistique, ne vient-elle pas heurter le projet même d’une « philosophie de la langue », quand bien même celle-ci pourrait inclure en elle une considération de l’« expérience religieuse » ? En effet, si la Révélation est divine, sainte, si elle est la manifestation d’un Verbe préalable à tout discours humain, elle ne peut, par principe, être mesurée à aucune autre langue ni incluse dans des possibilités du langage qui pourraient être posées préalablement à elle et hors d’elle. Toutefois, que la Révélation ne puisse être un moment parmi d’autres de l’herméneutique n’implique pas que, de son côté, le « temps de la langue » dont l’A. affirme l’avènement soit dénué de sens : il pourrait en effet, au contraire, recevoir spécifiquement son sens de l’identification, par la philosophie, de l’essence de la langue dans et par son appartenance à la Révélation. Or, telle est bien la manière dont l’A. semble interpréter la démarche rosenzweigienne. L’A. rappelle que cette démarche reçoit sa nécessité d’une histoire, celle de la crise des totalités systématiques culminant dans l’œuvre de Hegel : la philosophie, à l’âge de la guerre mondiale, ne peut plus « se vouloir impersonnelle et atemporelle », ne peut plus accomplir la « disparition » ou « l’engloutissement » de la « singularité individuelle » (p. 12) mais ne peut plus manquer de faire droit, à l’inverse, à un « concept plus riche de l’expérience » (id.), tournée en particulier vers « l’expérience historique et le destin individuel » (id.). Qu’appelle-t-on penser à l’heure où l’acte même de penser est mis en question ? La réponse est nécessairement : interroger le langage, « la langue effective » (p. 14), celle que l’on parle et qui se montre susceptible d’abriter la connaissance. Mais la langue parlée n’est-elle pas aussi celle qui se tourne vers Dieu, sous la forme de la profession de la loi ou de la confession de la foi ? La religion, fondée sur ses « sources scripturaires » (p. 13), n’est-elle pas nécessairement rencontrée par la philosophie du langage, et demandé autrement : « le renouveau de la philosophie, s’il a pour but l’enrichissement des concepts de l’expérience et de la connaissance, ne doit-il pas justement provenir d’une expérience directe de la Révélation et d’une écoute de sa parole » (id.) ? Directe, c’est-à-dire : non plus subordonnée à la « fondation de la raison » mais à la méditation du « sens » que peuvent encore revêtir pour nous la loi voire la présence de Dieu – car si la parole sainte est susceptible d’avoir un sens, c’est que le sens, de son côté, ne va pas sans se constituer dans un rapport à Dieu.
 Or, « la plénitude de la présence divine » n’a-t-elle pas cédé devant « le néant obsédant de son absence » (p. 15) ? Et « une crise du langage » n’est-elle pas « le symptôme le plus flagrant de ce retrait de la Révélation », « les difficultés de la langue des hommes » reflétant « le tarissement de la parole de Dieu » (id.) ? La Bible, devenue « inaccessible et muette », ne parle plus à la philosophie, et dans ce mutisme, la manifestation de Dieu n’a plus cours. Dès lors, la tentation est grande pour la philosophie d’ouvrir « un chemin de retour à la manifestation de Dieu » qui « n’aurait plus que sa parole pour guide » (id.). Telle est l’entreprise de F. Rosenzweig : la parole n’est-elle pas à même de « phénoménaliser » la Révélation, d’offrir demeure à la manifestation ? Question qui porte autant sur la langue que sur la Révélation, puisqu’il est nécessaire à celle-ci que celui-là, le langage, « donne à penser à toute philosophie en vertu des propriétés révélantes qui sont les siennes » (p. 16). Il s’agira donc d’inscrire la Révélation dans la langue et la langue dans la Révélation, c’est-a-dire de penser leur coappartenance : mais n’est-elle pas d’abord fondée sur la détermination de la langue comme communication, « relation qui préserve la séparation » des interlocuteurs, qui, s’adressant l’un à l’autre, sont présents l’un devant l’autre, se révélant l’un à l’autre sans pour autant s’identifier ? « C’est dans l’espace de cette transcendance préservée que peuvent apparaître les signes », en sorte que « l’expérience de la parole possède déjà la structure du phénomène de la Révélation » (p. 16), thèse dont Levinas se fera, sans nul doute, l’héritier.
Or, « la plénitude de la présence divine » n’a-t-elle pas cédé devant « le néant obsédant de son absence » (p. 15) ? Et « une crise du langage » n’est-elle pas « le symptôme le plus flagrant de ce retrait de la Révélation », « les difficultés de la langue des hommes » reflétant « le tarissement de la parole de Dieu » (id.) ? La Bible, devenue « inaccessible et muette », ne parle plus à la philosophie, et dans ce mutisme, la manifestation de Dieu n’a plus cours. Dès lors, la tentation est grande pour la philosophie d’ouvrir « un chemin de retour à la manifestation de Dieu » qui « n’aurait plus que sa parole pour guide » (id.). Telle est l’entreprise de F. Rosenzweig : la parole n’est-elle pas à même de « phénoménaliser » la Révélation, d’offrir demeure à la manifestation ? Question qui porte autant sur la langue que sur la Révélation, puisqu’il est nécessaire à celle-ci que celui-là, le langage, « donne à penser à toute philosophie en vertu des propriétés révélantes qui sont les siennes » (p. 16). Il s’agira donc d’inscrire la Révélation dans la langue et la langue dans la Révélation, c’est-a-dire de penser leur coappartenance : mais n’est-elle pas d’abord fondée sur la détermination de la langue comme communication, « relation qui préserve la séparation » des interlocuteurs, qui, s’adressant l’un à l’autre, sont présents l’un devant l’autre, se révélant l’un à l’autre sans pour autant s’identifier ? « C’est dans l’espace de cette transcendance préservée que peuvent apparaître les signes », en sorte que « l’expérience de la parole possède déjà la structure du phénomène de la Révélation » (p. 16), thèse dont Levinas se fera, sans nul doute, l’héritier.
Il y aurait donc « homologie du langage et de la Révélation » (id.) et, partant, « il faut envisager que le renouveau espéré de la philosophie consiste à l’ouvrir à la Révélation – au sens large de la vertu révélante de tout langage, et au sens strict de la Parole d’alliance, de justice et de vérité venue du Dieu de la Bible » (p. 17) – la question du passage de ce sens large à ce sens strict restant alors à poser : ne consiste-t-il pas à confondre philosophie et théologie, et inversement, à historiciser radicalement la Révélation biblique en l’inscrivant dans les « langues humaines » ? Ne dénature-t-on pas, autrement dit, à la fois la philosophie et la Révélation en prétendant élaborer les conditions de leur rencontre ?
Répondre négativement suppose d’avoir médité le dénominateur commun de l’une et de l’autre : la langue, sous les « figures contradictoires » qu’elle prend chez Rosenzweig : « parole et mutisme, vocalité et silence, oralité et écriture » (p. 19). En quoi, sous ces formes, le langage peut-il révéler ? Et pourquoi le peut-il sinon parce qu’il est d’abord « la parole d’un texte », et spécialement sous la forme de la Bible, « langue effective » (p. 20). Encore faut-il comprendre de quelle effectivité la Bible est porteuse, et telle est alors la tâche de la philosophie : « l’élément juif » en devient alors non seulement « l’objet » mais la « méthode » puisqu’il permet de « suivre cette piste que la parole trace dans la pensée » (id.), autrement dit de « penser dans le langage » (p. 21). Le Sprachdenker n’est plus alors tant celui qui pense le langage que celui qui « s’en remet » à lui (id.).
En quoi la langue peut-elle constituer une méthode et si toute méthode conduit à un résultat, que résulte-t-il d’une pensée cherchant à s’installer dans la révélation, et même dans cette Révélation dont le langage est vecteur ? D’abord la restitution du caractère insubstituable d’une expérience en première personne, « expérience de la parole divine dans la prière et le rituel » (p. 31). Ensuite la récusation d’une théologie exclusivement historiciste, oublieuse de la « disproportion infinie entre le Dieu qui fait don de lui-même et l’indignité de l’humain qui le reçoit » (p. 33) », transcendance qui apparaît à l’inverse à Rosenzweig comme la condition d’un « sens supérieur de l’histoire » (p. 34). Enfin, et plus décisivement encore, la découverte d’un trait essentiel de la parole humaine, à savoir qu’elle doit être une « confession de soi » (p. 38), c’est-à-dire un monologue par lequel « l’individu avoue qu’il est au monde (protologie) et qu’il aspire à être sauvé (eschatologie) » (p. 38). Ce double aveu, qui correspond à la structure du grand livre de Rosenzweig L’étoile de la rédemption, ouvrant sur la Création et se refermant sur la Rédemption, constitue la structure essentielle du langage, comme monologue personnel mais aussi comme « dialogue universel » puisque « ces monologues isolés forment tous ensemble un vaste dialogue : tel est »le grand secret universel, le manifeste, le révélé, le contenu de la Révélation » » (id., citant L’étoile de la rédemption, tr. fr. p. 103). Et ce dialogue entre les hommes constitue précisément l’espace de leur histoire, en sorte que la Révélation est essentiellement historique.
La Révélation ne saurait toutefois être l’essence de la langue sans en être aussi la « grammaire » (p. 41), en sorte qu’une « méthode grammaticale », « théorie des formes linguistiques » (id.), est requise. Mais pas de grammaire qui ne soit appliquée à un texte : « les propriétés grammaticales de la langue ne peuvent jamais se déchiffrer que dans un discours », « lequel discours devra manifester qu’il est lui-même la Révélation ». Or, ce texte, c’est la Bible, lieu comparable à nul autre où la langue devient proprement et explicitement Révélation. Toutefois, comment le texte biblique peut-il être révélateur malgré, et dans, la diversité des langues naturelles ? Il s’agira donc « d’envisager le système complet des idiomes humains » (p. 42) pour en interroger l’unité, « au-dessus de la grammaire jusqu’à l’essence du langage » (p. 43). Cette unité suppose un « esprit » qui unifie les langues au-delà de leur « lettre », et en contient les « promesses », supérieures à la seule « logique » (p. 44-45) : cet esprit de la langue ne lui est cependant pas extérieur et la langue ne peut en être tenue pour le seul moyen : « une juste compréhension des catégories philosophiques implique la conscience de leur ancrage grammatical » (p. 45). La pensée de Rosenzweig se distingue ainsi du système hégélien où « les positions sont interchangeables à l’infini », dans le « mouvement perpétuel du sujet de la connaissance » (p. 47). Au contraire, il convient de « situer » à nouveau la philosophie « dans la personne du philosophe » (id.), qui n’est pas « possédé mais « rencontré » par l’Absolu, c’est-à-dire « interpellé par sa voix » (p. 48). La Révélation se détermine ainsi comme « l’événement d’une parole qui ouvre la surdité du cœur humain à l’expérience de l’altérité » (id.).
 Cet événement donne la mesure de la philosophie même puisqu’elle en est, par son interpellation, l’origine. Cette proposition contrevient toutefois, à nouveau, au système hégélien dans lequel la voix singulière de chaque philosophe disparaît sous le mouvement de l’ensemble. La question se présentant donc à Rosenzweig est la suivante : comment laisser entendre cette voix singulière après Hegel ? D’abord – c’est l’incipit de L’Etoile : par la mort, dont l’urgence coupe court, par avance, à tout idéalisme (p. 52), en rappelant la pensée à son devoir de « présupposer la réalité du néant » (p. 53), et donc, contrairement à la prétention idéaliste, de ne pas rien présupposer. Comme le résume l’A., « sous le nom d’idéalisme, Rosenzweig dénonce donc la solidarité entre le projet d’un déni – de l’existence en sa singularité mortelle –, l’autorité d’un présupposé qui ne dit pas son non – celui du Tout pensable –, et le désir d’une hégémonie sur le savoir – conduisant à l’exclusion des autres sources de la connaissance, éminemment la Révélation » (p. 53). Il faut alors conclure que « l’idéalisme ne peut prendre fin que dans une philosophie qui fasse voler en éclats le présupposé de la totalité pensable » (p. 59), et telle est la philosophie de Rosenzweig lorsqu’elle affirme, hors du tout, une singularité « métaéthique », celle de l’homme, en sorte que « l’identité de l’être et du penser se fragmente à son tour » (id.), laissant « surgir » un « monde métalogique », « extérieur à la pensée », et un Dieu « métaphysique », dont « l’essence se tient par-delà toute nature mondaine » (id.). Seule « l’expérience de la Révélation » peut cependant maintenir la scientificité d’une recherche qui tendrait à semblable singularité (p. 60). Mais si cette expérience relève de la théologie voire, personnellement, des théologiens, la philosophie n’en a pas moins pour rôle d’établir les « préconditions objectives » susceptibles de rendre cette Révélation pensable (p. 61), et ces conditions, visant à « ériger l’entier édifice de la théologie », prétendant à un « savoir du monde dans sa complétude systématique », se confondent nécessaire avec l’affirmation de la Création, qui contient la possibilité d’un tel système. Autrement dit, la seule manière de tenir ensemble subjectivité de l’expérience et objectivité de la description, c’est d’affirmer que la foi peut constituer, « tout contre Hegel », « la source de la pensée » (id.), et à condition d’entendre d’abord la pensée comme « métaphysique de la Création » (p. 62). C’est ainsi qu’il s’agit d’entendre la différence entre Rosenzweig et Hegel : en plaçant la Création au centre, on ne « force pas l’événement de la Révélation à entrer dans une totalité pensable » mais on laisse place à « un savoir qui place lui-même à son fondement un concept fondamental de la foi » (id., citant L’étoile, tr. p. 153). La philosophie, dès lors qu’elle cesse d’être idéalisme, c’est-à-dire de poser « le concept d’un engendrement du réel par l’absolu », et qu’elle commence à se tourner vers « ce que dessine le récit de la Genèse », ne peut plus « se poser en rivale de la Révélation », ni « se targuer de répondre aux mêmes questions que le texte sacré » : elle doit nécessairement se tourner vers ce texte lui-même, archisource du sens. Et de fait, « entre l’image idéaliste d’un monde engendré et la doctrine du monde créé, il n’y a en vérité qu’une différence de langue – il y a, en vérité, toute la différence d’une langue » (p. 62) : l’idéalisme hégélien subordonne en effet la langue à la pensée, à « la mise en œuvre de la pensée pure et de la méthode qui lui est propre, la dialectique » (p. 63), dont Rosenzweig soutient qu’elle est « étrangère au sol naturel de la langue » (id., citant L’étoile, tr. p. 204). Pourquoi étrangère ? Parce que « placer au principe du monde un engendrement de l’objet par le sujet », c’est « forcer la pensée à accepter une relation que la grammaire récuse », c’est plus précisément ignorer la différence, aussi grammaticale, entre le sujet et l’objet, qui est « la véritable grammaire de la Création » (id.). L’idéalisme reste sourd à la « voix de cet absolu lui-même qui établit le monde dans l’être, révèle à l’homme les moyens de sa connaissance, et promet au monde et à l’homme la rédemption qu’ils donneront l’un à l’autre » (p. 64) : posant l’absolu comme sujet et comme objet, il dénie la différence de l’un et de l’autre à même la langue, et prononce ce déni par abus de langage. Par sa surdité, l’idéalisme se prive alors de la confiance de la langue, doublement source d’une « Révélation annoncée et promise, puis proférée pour délivrer un savoir » (p. 65), et, privé de sol, aboutit à ce que « le grand édifice de la réalité est détruit : Dieu et l’homme s’évanouissent dans le concept-limite d’un sujet de la connaissance, le monde et l’homme dans celui d’un simple objet de ce sujet, et le monde…devient purement un pont entre ces deux concepts-limites » (p. 65, citant L’étoile, tr. fr. p. 210) : faute d’assise dans la nature même de la langue, l’idéalisme est donc pauvre en monde, et ne crée pas ce dont il n’a pas posé la Création.
Cet événement donne la mesure de la philosophie même puisqu’elle en est, par son interpellation, l’origine. Cette proposition contrevient toutefois, à nouveau, au système hégélien dans lequel la voix singulière de chaque philosophe disparaît sous le mouvement de l’ensemble. La question se présentant donc à Rosenzweig est la suivante : comment laisser entendre cette voix singulière après Hegel ? D’abord – c’est l’incipit de L’Etoile : par la mort, dont l’urgence coupe court, par avance, à tout idéalisme (p. 52), en rappelant la pensée à son devoir de « présupposer la réalité du néant » (p. 53), et donc, contrairement à la prétention idéaliste, de ne pas rien présupposer. Comme le résume l’A., « sous le nom d’idéalisme, Rosenzweig dénonce donc la solidarité entre le projet d’un déni – de l’existence en sa singularité mortelle –, l’autorité d’un présupposé qui ne dit pas son non – celui du Tout pensable –, et le désir d’une hégémonie sur le savoir – conduisant à l’exclusion des autres sources de la connaissance, éminemment la Révélation » (p. 53). Il faut alors conclure que « l’idéalisme ne peut prendre fin que dans une philosophie qui fasse voler en éclats le présupposé de la totalité pensable » (p. 59), et telle est la philosophie de Rosenzweig lorsqu’elle affirme, hors du tout, une singularité « métaéthique », celle de l’homme, en sorte que « l’identité de l’être et du penser se fragmente à son tour » (id.), laissant « surgir » un « monde métalogique », « extérieur à la pensée », et un Dieu « métaphysique », dont « l’essence se tient par-delà toute nature mondaine » (id.). Seule « l’expérience de la Révélation » peut cependant maintenir la scientificité d’une recherche qui tendrait à semblable singularité (p. 60). Mais si cette expérience relève de la théologie voire, personnellement, des théologiens, la philosophie n’en a pas moins pour rôle d’établir les « préconditions objectives » susceptibles de rendre cette Révélation pensable (p. 61), et ces conditions, visant à « ériger l’entier édifice de la théologie », prétendant à un « savoir du monde dans sa complétude systématique », se confondent nécessaire avec l’affirmation de la Création, qui contient la possibilité d’un tel système. Autrement dit, la seule manière de tenir ensemble subjectivité de l’expérience et objectivité de la description, c’est d’affirmer que la foi peut constituer, « tout contre Hegel », « la source de la pensée » (id.), et à condition d’entendre d’abord la pensée comme « métaphysique de la Création » (p. 62). C’est ainsi qu’il s’agit d’entendre la différence entre Rosenzweig et Hegel : en plaçant la Création au centre, on ne « force pas l’événement de la Révélation à entrer dans une totalité pensable » mais on laisse place à « un savoir qui place lui-même à son fondement un concept fondamental de la foi » (id., citant L’étoile, tr. p. 153). La philosophie, dès lors qu’elle cesse d’être idéalisme, c’est-à-dire de poser « le concept d’un engendrement du réel par l’absolu », et qu’elle commence à se tourner vers « ce que dessine le récit de la Genèse », ne peut plus « se poser en rivale de la Révélation », ni « se targuer de répondre aux mêmes questions que le texte sacré » : elle doit nécessairement se tourner vers ce texte lui-même, archisource du sens. Et de fait, « entre l’image idéaliste d’un monde engendré et la doctrine du monde créé, il n’y a en vérité qu’une différence de langue – il y a, en vérité, toute la différence d’une langue » (p. 62) : l’idéalisme hégélien subordonne en effet la langue à la pensée, à « la mise en œuvre de la pensée pure et de la méthode qui lui est propre, la dialectique » (p. 63), dont Rosenzweig soutient qu’elle est « étrangère au sol naturel de la langue » (id., citant L’étoile, tr. p. 204). Pourquoi étrangère ? Parce que « placer au principe du monde un engendrement de l’objet par le sujet », c’est « forcer la pensée à accepter une relation que la grammaire récuse », c’est plus précisément ignorer la différence, aussi grammaticale, entre le sujet et l’objet, qui est « la véritable grammaire de la Création » (id.). L’idéalisme reste sourd à la « voix de cet absolu lui-même qui établit le monde dans l’être, révèle à l’homme les moyens de sa connaissance, et promet au monde et à l’homme la rédemption qu’ils donneront l’un à l’autre » (p. 64) : posant l’absolu comme sujet et comme objet, il dénie la différence de l’un et de l’autre à même la langue, et prononce ce déni par abus de langage. Par sa surdité, l’idéalisme se prive alors de la confiance de la langue, doublement source d’une « Révélation annoncée et promise, puis proférée pour délivrer un savoir » (p. 65), et, privé de sol, aboutit à ce que « le grand édifice de la réalité est détruit : Dieu et l’homme s’évanouissent dans le concept-limite d’un sujet de la connaissance, le monde et l’homme dans celui d’un simple objet de ce sujet, et le monde…devient purement un pont entre ces deux concepts-limites » (p. 65, citant L’étoile, tr. fr. p. 210) : faute d’assise dans la nature même de la langue, l’idéalisme est donc pauvre en monde, et ne crée pas ce dont il n’a pas posé la Création.
Toutefois, l’idéalisme n’est-il pas la seule voie possible de la philosophie, une voie qu’il s’agit donc de « sauver » en la dépassant, et « en lui faisant entendre, dans cette Révélation à laquelle il prétend demeurer sourd, la source de son propre savoir » (p. 67) ? Sans doute, et c’est pourquoi Rosenzweig, tout en condamnant l’idéalisme, lui fait entièrement place – mais en plaçant cette fois en son centre, non l’opération de la pensée mais le langage, « capable de dire le singulier dans les mots de tous, ancré dans la condition naturelle des hommes et premier signe de leur liberté », en sorte qu’il est bien « le lien recherché, »ce point qui relie la subjectivité la plus extrême…, l’ipséité sourde et aveugle, et la lumineuse clarté de l’objectivité infinie » » (p. 69, citant L’étoile, tr. fr. p. 155).
Mais en quoi est-il possible d’interpréter la langue comme manifestation de la Révélation ? Cela n’est possible que si l’essence de la langue abrite intrinsèquement cette possibilité : cela suppose d’atteindre une « langue d’avant la langue », c’est-à-dire de proche en proche ce qui est « plus que langue » (p. 71, citant L’étoile, tr. p. 160 et 414) ; et que si la langue, précisément, « apparaît puis s’accomplit » dans la Révélation : « ce que L’Etoile décrit, n’est-ce pas le devenir de la langue à travers la série des expériences par lesquelles elle se donne ? » (id.).
Or, « ce parcours se présente, d’une manière encore toute extérieure, comme le mouvement qui conduit du mutisme de l’origine au silence de l’accomplissement », et la langue tient le « »milieu entre deux états dépourvus de langage », à savoir entre le »ne-pas-encore-pouvoir-parler » et le »ne-plus-avoir-besoin de parler », ou encore »entre le mutisme de la pierre et le silence de Dieu » » (p. 72, citant une lettre écrite par Rosenzweig en 1918). Le silence inaugural est celui d’une « langue muette, purement formelle, composée de concepts et de symboles qui ne forment pas encore une parole vivante » : le « logos philosophique ». Le silence final est celui de « la prière de la communauté et du geste liturgique », « abandon du langage au profit de la pure vision rédemptrice, devant laquelle toute parole semble devoir se taire » (id.). Au centre, entre ces deux extrémités, la langue, qui n’est autre que « le temps présent de la Révélation » (p. 73). Mais c’est dire aussi que, de manière inessentielle, « nombre de phénomènes sonores ou langagiers », la langue elle-même lorsqu’elle est hors d’elle-même, donc, peuvent se produire hors de la Révélation, écartant langue et révélation l’un de l’autre : ainsi, on peut parler dans une « »sphère de mutisme pur et souverain » » (p. 73, citant L’Etoile, tr. p. 117), et telle est la situation de l’homme privé de Dieu, c’est-à-dire privé de la possibilité d’une « sortie de soi par le dialogue avec autrui ». La langue peut être solitaire, c’est-à-dire tragique, langue d’une « ipséité humaine avant sa rencontre avec Dieu » (id.), devant être déliée et ouverte. Elle peut aussi être « silence partagé », « apprendre à se taire ensemble » (p. 74, citant L’Etoile, tr p. 431). Dès lors, die wirkliche Sprache est, selon Rosenzweig, cette langue qui « se réalise dans une parole vivante, bordée de part et d’autre par le silence de la »langue d’avant la langue » et du »plus-que-langue » » (p. 74), et dont le propre d’être toujours « parole adressée, attendant une réponse », « vie perpétuelle coextensive au monde de la Révélation » (p. 75).
Qu’y-a-t-il au commencement, avant la langue et la logique ? Non pas, comme dans l’idéalisme, l’identité de l’être et du penser mais « le néant », au regard duquel « l’émergence du savoir » est « affirmation du non-néant (Oui), négation du néant (Non), et conjonction de l’affirmation et de la négation (Et) », ces trois mots constituent les « mots originaires » (p. 76), lesquels peuvent être combinés et « appliqués systématiquement aux éléments » (p. 76), à commencer par Dieu et la création dont il devient possible de proposer une théologie reposant sur un « parler d’avant le parler », sur des mots qui ne sont pas encore une « grammaire de l’effectivité » mais la rendent possible (p. 77), « vie souterraine sur laquelle est érigée la langue » (p. 78) « en un temps où il n’y a pas encore de langue » (L’Etoile, tr p. 212), et que la langue parole manifestera. Dès lors, L’Etoile constitue rien moins qu’une « phénoménologie de la langue », en cela que, de la manifestation, « la langue est à la fois l’objet, puisqu’elle-même apparaîtra en diverses figures dont nous faisons chaque fois l’expérience, et le sujet, puisque la langue fait à son tour apparaître les objets de l’expérience » (p. 80). De fait, la langue « témoigne d’elle-même », « ce qui revient à porter la Création, la Révélation et la Rédemption à la manifestation » (id.).
En quel sens ? D’abord en ce que le « monde métalogique » n’est pas un monde de formes inertes mais « profusion imprévisible », « pouls inépuisable d’où surgit le monde en tant que vie » (p. 80) : le phénomène est nouveauté pure, « factualité miraculeuse » qui récuse l’idéalisme en « témoignant de ce que le monde est plus que ce que la pensée peut connaître de lui » (p. 81), et surtout qui détermine la manifestation comme révélation, « arrachement à la nuit du néant » de « quelque chose apparaissant dans le monde » (L’Etoile tr p. 76) : « le sens véritable de la manifestation ne s’atteint donc qu’avec le concept de révélation, avant même que la détermination biblique de cet événement ne soit précisée » (p. 81). Si « l’apparaître exige le devenir manifeste » (p. 82), c’est que la phénoménalité est essentiellement mystère et miracle, « mouvement de sortie de soi dans le visible » (id.). Miracle ? C’est-à-dire : non pas « événement extraordinaire » mais « signe venant confirmer ce qui a été prophétisé ». Le miracle est un signe : celui de « l’accomplissment de la prédiction, la confirmation d’une promesse » (id.). Or, quel est cet accomplissement sinon l’existence de créatures pouvant prendre la parole, faire écho, dans l’Ecriture, à cette « entrée de l’être dans la relation » (p. 83) ? Le véritable miracle est donc la manifestation de la Révélation en tant que telle dans la parole, Révélation au regard de laquelle la Création apparaîtra comme le « passé » (p. 84) justement accompli par le miracle de la langue, tandis qu’en tant que passé, la Création « prédit » quant à elle la Révélation, en constitue la promesse. Toutefois, comment une pensée de la création pourrait-elle reconnaître la Révélation voire témoigner en sa faveur ? Parce qu’il y a la langue, qui est « le commencement, le centre et l’horizon » (p. 86), « rappelle son commencement créé », « est la vie même de l’humanité dans le présent de la Révélation », « et « porte en elle l’espérance de la compréhension parfaite », ce qui annonce la Rédemption (p. 86). La langue est donc, pour l’entreprise rosenzweigienne, l’unique fil conducteur. Mais une telle thèse n’est soutenable qu’à condition que la langue soit identique à la Révélation, que « les formes linguistiques soient immédiatement contemporaines des événements qu’elles décrivent, et originairement identiques à eux », autrement dit que la langue « épouse le réel en tant qu’il nous est révélé », qu’elle soit « elle-même la description de ce qui est » (p. 87) : statut comparable à nul autre qui exclut que la langue soit seulement symbolique ou représentative, quoique ces deux pouvoirs lui appartiennent aussi (sous la forme respective de la mathématique et de la liturgie).
Où cette « homologie de la langue et de la Révélation » (p. 88) devient-elle expérimentable ? Pour le théologien, dans le dialogue entre l’homme et Dieu, qui, reposant à la fois sur l’union et la séparation, suppose une « séparation liante », « préservant la transcendance sans empêcher la rencontre » (p. 88-89) : l’amour. Si la Révélation est « l’ato-négation d’une pure essence muette par une parole sonore » (L’Etoile, p. 231), elle est, en effet, amour, si aimer veut dire « s’anéantir et ressusciter sous une figure nouvelle », celle de « l’amant d’un autre en lequel il voudrait venir se perdre et renaître sans fin » (p. 89). On comprend à nouveau qu’amour et parole sont coextensifs, puisque l’amour est « l’expression hors de soi » (L’Etoile, p. 284), ce qui implique que la langue est originairement manifestante en tant qu’elle est « expression », « qui a pour lieu originaire la rencontre amoureuse » (p. 90). Si la Révélation consiste aussi à donner connaissance, ce second sens est néanmoins subordonné à l’amour, erôs que la Révélation essentiellement nous révèle et qui inclut aussi, sans s’y restreindre, la miséricorde et la charité, c’est-à-dire l’agapê (p. 90-91). A l’amour donné par Dieu répond l’amour fidèle de l’homme consistant à « se laisser aimer » (p. 91), « calme éclat d’un grand Oui » (L’Etoile, p. 243) qui n’est autre que l’essence de la foi, « pas l’adhésion à un dogme, mais la quiétude de l’âme dans sa fidélité à l’amour de Dieu » (id.) qui lui donne à son tour la parole.
L’amour a-t-il cependant un fondement ? Assurément, et c’est la Création : aimer, c’est créer, être aimé, c’est se savoir créé par Dieu, d’abord sous la forme du nom : être appelé, personnellement, par Lui (p. 92). Mais si le nom est la vérité de la Révélation, pour Dieu, se révéler, c’est dire son propre Nom : « fondement de la Révélation, tout ensemble centre et commencement, telle est la Révélation du Nom divin » (L’Etoile, p. 266). Mais celle-ci est, selon Rosenzweig, l’Ecriture elle-même, « miracle au cœur du miracle, l’événement-signe auquel la Révélation doit d’être l’accomplissement de ce qui fut prédit dans la Création » (p. 94). La langue, ainsi, atteste non seulement, en général, le sens de la Révélation mais aussi son historicité : autrement dit, la Bible est une grammaire des significations. Mais comment la philosophie, demande E. Durand, peut-elle accueillir la singularité du texte sacré « sans en assourdir une fois de plus la voix », sans lui substituer une théorie générale du langage ? (p. 95).
- Durand souligne la difficulté. Comment justifier le passage du général au singulier, du langage à un texte particulier ? « N’y-a-t-il pas forçage dans cette séquence qui conduit du langage à la parole de Dieu, de cette parole au texte de la Bible, de la Bible à sa langue, de cette langue à la grammaire, et de la grammaire au savoir du philosophe ? » (p. 97) Et autrement demandé, « ce que Rosenzweig a découvert dans la langue de la Bible aurait-il pu se dire de toute autre langue ? » (p. 98) De surcroît, n’est-ce pas ici, dans cet appel au texte saint, une « mise sous tutelle de la philosophie » qui s’opère insidieusement – à moins qu’au contraire la philosophie, faisant de la Bible un document, en altère la singularité.
Rappelant que L’Etoile est présentée par son auteur même comme « le souvenir d’un commentaire de la Bible, dont l’intention originelle aurait été effacée par le retranchement du texte commenté » (p. 99), E. Durand établit la manière dont Rosenzweig affronte ces multiples difficultés, c’est-à-dire en rendant « le propos philosophique, d’abord présenté comme autonome », comme « dépendant de l’exégèse et conditionné par elle » (p. 101), ce qui n’est envisageable que dans la mesure où « les événements de la Révélation peuvent être retrouvés dans la grammaire de notre langue », où il y a, à nouveau, « homologie du langage et de la Révélation ». La forme même du livre épouse donc son contenu. Mais cette homologie n’est possible que parce que Dieu, créateur, s’est fait parole, sous la forme d’un texte susceptible de parler, d’être lu, redit et d’appeler une parole humaine. « La parole est une, qu’elle nous soit adressée ou que nous l’adressions nous-mêmes, qu’elle résonne en notre cœur ou qu’elle émane de la bouche de Dieu » (p. 102). Mais, il faut y insister, ce n’est pas au sens où Dieu se serait servi de la langue humaine comme d’un moyen d’expression : au contraire, c’est « la langue des hommes », « récit, dialogue et choeur », qui « offre le témoignage des événements de la parole de Dieu » (p. 103 et 104). Il s’agit « d’accéder au langage lui-même tel qu’il est effectivement parlé dans ces événements », ce qui exclut qu’on leur attribue une structure linguistique qui serait tirée de l’extérieur (p. 106). Et comment est-il parlé ? Dans la Création, comme « une langue qui raconte et rend compte, installant les choses dans l’être » ; dans la Révélation, comme « une langue qui parle », « dans l’appel et la réponse » (p. 108) ; enfin, dans la Rédemption, comme louange « que le monde et l’homme pourront prononcer à l’unisson » : choeur (p. 109). Nulle lecture littérale ici : il ne s’agit que de souligner « la relation qui se noue entre la langue et la réalité dont elle est la »symbolique originaire », afin que la Parole soit entendue et lue des philosophes » (p. 111) – relation dont le Cantique des cantiques, parce qu’il parle « la langue de l’amour humain », mais en laissant « résonner la transcendance de l’amour » puisque, comme le présuppose ici l’interprétation, « la langue de l’amour humain se trouve immédiatement transcrite dans la parole de Dieu » (p. 112), est alors typiquement le théâtre.
A partir du seul parler de la langue, il devient alors possible, puisqu’il anticipe la réalité, que la grammaire « contienne en germe une théorie de la connaissance », à travers la Création, « une psychologie (au sens d’une description de la subjectivité en tant qu’âme », dans la Révélation qui rend le sujet « capable de dire Je et d’embrasser l’entière responsabilité de sa personne », et « une éthique », à travers la Rédemption (p. 118 et 117). Réciproquement, « les problèmes humains » peuvent être « conduits jusqu’à leur expression théologique » (p. 118), en sorte que « la philosophie joue ici un rôle propédeutique à l’expérience vécue dans la langue, telle que la Bible la configure » (p. 119). Cela dit, « seule une nouvelle traduction de la Bible pourra accomplir ce geste » par lequel le texte originel sera proprement reconnu, sans être recouvert par autre chose que lui et même par l’analyse grammaticale censé en ouvrir l’intelligibilité (p. 120).
Le Royaume, ouvert dans la « grammaire de la Rédemption », « ne sera jamais figuré dans L’Etoile que comme une communauté de langue » (p. 122) : mais celle-ci « attend encore la réconciliation de Babel », puisque la langue, liant l’humanité, la sépare en communautés particulières. Il s’agit donc, comme s’y ingénie la troisième partie de L’Etoile, de fonder cette « congrégation orante » qui sera, in fine, « plus-que-langue » puisqu’elle dépassera la parole et le dialogue proprement dits. Mais il faut d’abord demander : en quoi une telle langue peut-elle rédimer ? Et avant encore : que signifie pour Rosenzweig et ici la rédemption ? Avant tout un appel à la responsabilité : il s’agit pour la liberté humaine d’être mise à l’épreuve de ses propres possibilités, à commencer par l’amour du prochain (p. 123). La Rédemption n’est donc ni un avenir ni un refus de la mortalité présente : elle est transformation de ce temps « heute schon », anticipant l’éternité puisqu’il s’agit de saisir l’avenir, dès à présent et en totalité, dans l’aujourd’hui (p. 123). La Rédemption est ainsi « présente en tant qu’éternellement à venir » (id.), pour autant que la parole individuelle, c’est-à-dire aussi la foi, s’élève jusqu’à « l’âme de tous, définition la plus profonde de la communauté religieuse » (p. 125). Plus profonde, c’est-à-dire : débordant la « religion », comprise ici comme « systèmes de représentations – croyances, dogmes, mythes fondateurs », en direction de son essence, en sorte que « judaïsme et christianisme » n’apparaissent plus comme des religions différentes mais comme « les deux formes de la congrégation de Dieu » (id.), c’est-à-dire de l’horizon de cette « question d’une éternité existante » (citant Foi et savoir, p. 164).
Judaïsme et christianisme n’apparaissent plus alors comme deux choses distinctes mais comme « deux manière de se rapporter à l’éternité pour triompher du temps : par l’existence de fait du peuple dont la vie est éternelle, et par l’événement de l’incarnation, fondateur d’une communauté qui déploie dans le monde un éternel chemin » (p. 125), chemin au fil duquel « les figures liturgiques », « renonçant à toute contemporanéité avec ce qu’elles montrent, sont les signes d’une réalité qui demeure espérée » (p. 126). Ainsi, la liturgie chrétienne, par la prière, « figure exemplaire » de « la puissance d’anticipation qui réside dans la langue », annonce le Royaume semble accomplir la méditation rosenzweigienne de l’homologie entre langue et Révélation. Toutefois il n’en est rien car une figure plus haute encore lui succède : le silence, sous la forme primitive de « l’apprentissage de l’écoute » puis sous celle du « geste accompli en commun » (p. 128 et 129). Le geste liturgique est alors « plus-que-langue », puisqu’il « permet une compréhension qui ne se réduit plus à l’intellection d’un contenu de sens » : il est au contraire « pure auto-présentation de celui qui exécute » (p. 129), il est la figure même, dans la communauté, de « l’immédiate proximité de Dieu ». Or, ce faisant, la division des langues, fait indépassable, est surmontée : « Rosenzweig fait de la langue unique un théologoumène, et de la compréhension parfaite » que permet le geste « l’horizon rédempteur auquel tend toute langue » (p. 130). Dès lors, la langue, accomplie dans le silence du geste, tend à la Rédemption, et si celle-ci est « plus-que-langue », elle n’est pas pour autant, loin s’en faut, étrangère à la langue dont elle accomplit justement la nature véritable, celle d’être « paix du Royaume, au double sens d’une concorde et d’une compréhension universelle » (p. 130). Cela ne vaut toutefois, à l’évidence, que dans le cadre de la communauté des croyants : jamais la langue, à elle seule, ne deviendra universelle, « la »lèvre pure » » qui nomme cette messianique langue universelle et rédemptrice « est éternellement à venir » (p. 131) : l’homologie entre langue et Révélation repose donc moins sur la première que sur la seconde et si la langue est anticipation et annonce du Royaume, si le « silence liturgique du peuple juif et la faconde missionnaire d’une Eglise qui parle toutes les langues » sont les « figures-limites de la parole », c’est parce que celle-ci a pu être sanctifiée, appartient à l’histoire sainte, dont l’hébreu est la langue proprement juive et la Pentecôte spirituelle, le moment proprement chrétien. Et si « la promesse d’une Rédemption par la parole… revient à l’alternative entre se taire », pour les Juifs, et « traduire », pour les chrétiens, c’est avant tout parce que cette alternative est rendue possible par l’histoire sainte elle-même. Bref, les analyses menées par Rosenzweig ne reconduisent-elles pas, plutôt qu’à un « temps de la langue », aux moments décisifs et irréductibles de la Révélation et de la Pentecôte, c’est-a-dire au domaine de la foi plutôt qu’au domaine d’une philosophie du langage, fût-elle mémoire de ce que le langage, dans l’histoire sainte, a pu devenir ? Sans nul doute et cela n’échappe en rien à l’A. qui reconnaît dans « l’ultime livre de L’Etoile » « la contemplation de la vérité éternelle en Dieu » (p. 139). Mais n’est-ce pas dire que « la collaboration de la philosophie et de la théologie grâce à cet organon qu’est la langue » « n’aura été qu’une préparation à l’achèvement du savoir dans une intuition plus haute de la figure du vrai », et donc, que Rosenzweig n’est pas, en vérité, un philosophe du langage ? Objection qui remettrait, de proche en proche, en cause le projet même de l’A. de le comprendre comme contributeur d’un « temps de la langue » : si la pensée de Rosenzweig consiste d’abord en un témoignage de foi, et en une méditation, propre à ce témoignage, sur la nature même de la foi, est-ce vraiment le langage en ce qu’il a de propre qui y est médité ?
L’A. examine, pour conclure la première partie de son travail, cette difficulté, et y répond en soulignant que la démarche même de Rosenzweig, en ce qu’elle est « le Oui, l’Amen, le Wahrlich de la foi » (p. 144), demeure elle-même un acte de parole, un acte de « confiance dans la langue ». La foi, « acte qui donne la vie », serait donc « un acte à la fois linguistique et épistémique », au sens où la langue elle-même devient en vérité effective dans ce « Oui à la parole de Dieu » qui en constitue alors la plus haute possibilité. Toutefois, est-il possible d’en conclure, comme l’A., que « la philosophie qui a choisi de faire confiance à la langue » s’est « donc laissée sauver par elle » (p. 145) ? Rien n’est moins sûr, d’une part, car la foi et la philosophie ne se confondent pas et que faire confiance à la langue pour dire Oui à Dieu ne signifie pas que le Oui à Dieu repose essentiellement et exclusivement sur la confiance en la langue, d’autre part car parler et répondre à Dieu n’est pas se laisser sauver par la langue, mais par Sa Parole. Si Rosenzweig mène bien, dans son grand livre, une « expérience de la langue », si cette expérience proprement linguistique est celle qui ouvre l’intelligibilité de la Création, de la Révélation et de la Rédemption, s’il est vrai encore de dire que « l’ouvrage a transformé la langue en une méthode pour la pensée » cela ne signifie pas pour autant que « le système de L’Etoile s’est tenu tout entier dans la langue » (p. 145) puisque cela supposerait que la langue et la parole de Dieu se confondent, ce qui n’est vrai que de l’hébreu – ou, dans le christianisme, que depuis la Pentecôte. Si « la langue est le milieu révélant par excellence » (p. 146), ce n’est pas en tant que langue mais en tant que Verbe divin qu’elle possède proprement cette excellence, qui est aussi, souligne l’A., une équivocité : la langue sainte abrite de multiples possibilités, prend de multiples formes auxquelles elle ne se réduit pas – « langue muette des origines », « parole vive de la Révélation », « lèvre pure qui est l’annonce du Royaume » (p. 146). Mais cette excellence et cette équivocité supposent le Royaume lui-même : « l’homologie de la langue et de la Révélation implique ainsi la détermination de la langue par la Révélation », conclut alors à juste titre l’A. Dès lors, ne doit-on pas renoncer à l’idée d’une compréhension proprement philosophique de la langue, indépendamment de cette « langue de confiance » qu’est l’hébreu de la Bible ? Pour l’A., telle n’est pas la conclusion que Rosenzweig nous invite à formuler : selon elle, le penseur continue, alors même qu’il affirme qu’ « il n’y a qu’une seule langue », qui serait celle de la Bible, à être ainsi « hanté par la figure de la langue unique » (p. 148), qui implique qu’ « aux mots juifs pourraient alors, de l’aveu de Rosenzweig, se substituer d’autres mots », autrement dit que la langue biblique soit elle-même traductible en d’autres langues : ce serait alors, non plus la langue qui serait déterminée par la Révélation mais la langue de la Révélation qui serait déterminée par l’essence même du phénomène linguistique, et la nécessité philosophique de reconnaître que le « temps de la langue » doit advenir recevrait alors toute son urgence.
La première partie de l’ouvrage, dont nous avons volontairement suivi de près le déroulement, s’achève alors sur un paradoxe irrésolu. D’un côté, il a été montré que l’homologie entre langue et Révélation, telle qu’elle est rejointe par Rosenzweig et reconstruite par l’A., repose sur le caractère saint de l’hébreu, c’est-a-dire non sur des propriétés universelles du langage mais sur la singularité de cette langue que Dieu parle et dont il écrit, par l’acte créateur, par sa manifestation et par la rédemption, l’unique et incomparable grammaire, qui peut alors devenir celle du témoignage, de la liturgie, du silence même de la communauté. Seul le christianisme, en substituant à la langue d’un peuple, à une langue singulière, l’universalité de la Pentecôte qui seule fonde la pluralité spirituelle des langues, peut opérer le dépassement du singulier en faisant de toute langue la structure signifiante de la vérité : mais alors, c’est moins l’essence du langage qui est atteinte que sa transfiguration par l’Esprit saint, et si le judaïsme peut donner lieu à une méditation de la sainteté du langage, tel n’est pas le cas du christianisme dont la vérité ne repose en rien sur la langue et en tout sur l’Esprit. Pourtant, d’un autre côté, l’A. semble, à rebours de ses propres démonstrations, maintenir l’idée d’une primauté de la langue même sur les expériences qu’elle est susceptible d’abriter. Mais, dès la fin de cette première partie, peut-on encore parler d’un « temps de la langue » et lier la pensée rosenzweigienne à l’avènement d’un tel temps ? Rien n’est moins sûr si ce n’est pas tant la langue que cette langue qui est celle de l’Ecriture qui opère dans la mémoire de la Révélation, dans la profession de la loi ou la confession de la foi. Cette tension donne alors à l’A. le programme de son entreprise : ne lui faut-il pas mettre à l’épreuve la possibilité de traduire la sainteté de l’hébreu dans une autre langue, sans éprouver « la leçon de la rencontre des langues » (p. 148), et finalement interroger la traduction et la traductibilité d’une langue à l’autre comme possibilité d’ouvrir une dimension commune dans laquelle la structure révélante de l’hébreu trouverait elle-même une vérité supérieure et plus originaire que le seul renvoi à sa nature divine ?
Tel est alors l’enjeu de la seconde partie du livre, dans laquelle la traduction vient proprement en question comme lieu propre d’un « temps de la langue » qui ne serait pas seulement celui de l’hébreu et du monde juif mais celui dans laquelle toute langue se tient et devient possible.
Si l’expérience que rend possible la langue, telle qu’elle est reconstruite par Rosenzweig du moins, doit l’attester comme « milieu originaire » de la philosophie et de la Révélation, c’est-a-dire de la philosophie comme de la Révélation et au même titre qu’elle, alors il est bien nécessaire, philosophiquement, de manifester la possibilité de parler d’une seule langue, universellement traductible. Nécessité reconnue par Rosenzweig lui-même : celui-ci n’affirme-t-il que l’hébreu, langue sainte, est la seule langue ? Est-ce alors au sens où l’hébreu « recueillerait l’esprit de Dieu » et pourrait ainsi « donner son fondement à l’homologie entre langue et Révélation » (p. 153) ? Précisément non, soutient l’A., qui invoque le fait que le peuple juif est toujours déjà en exil de sa propre langue, ne la parle jamais de manière propre mais toujours depuis des « langues d’emprunt » (p. 155). L’hébreu est donc susceptible de traduction, ce qui laisserait supposer qu’il relève d’une dimension, propre à la langue, plus haute et plus ample que lui. Ne faut-il pas d’ailleurs rappeler que l’hébreu n’est que « saint par élection », élection qui, seule, en fonde l’éternité et le privilège (p. 157) ? Si l’hébreu a été élu, c’est cependant qu’il est au préalable une langue parmi d’autres ; et « s’il s’agit de restituer au langage sa dimension messianique », celle-ci ne peut être exclusive à l’hébreu, puisqu’elle fonde au contraire la possibilité que l’hébreu puisse devenir une langue singulière, sainte. Dès lors, et c’est là que l’A. exprime au fond sa véritable intention, « il faudrait donc pouvoir renverser le sens de cette particularité [de la langue sainte] afin d’y reconnaître, d’après l’expression de J. Derrida, une »mise en perspective générale » de l’expérience des langues » (p. 158). Au regard de ce cahier des chazrges, toutefois, Rosenzweig, quoiqu’il ait « pressenti qu’aucune langue ne peut faire l’objet d’une possession assurée », aurait « échoué à soutenir cette mise en perspective », puisqu’il pose malgré tout un « ancrage du sujet dans la langue », sous la forme de l’affirmation de la singularité des idiomes que « parle le peuple juif dans son exil » (p. 159). Rosenzweig, en d’autres termes, aurait ainsi à être dépassé par Derrida, puisqu’à la thèse suivant laquelle il est une langue sainte et effective, il faudrait substituer l’autre thèse suivant laquelle « je n’ai qu’une langue et ce n’est pas la mienne » (p. 159 citant Derrida, Le monolinguisme de l’autre, p. 92). En effet, dans cette dernière formule, la confiance dans la langue donnée – pour ne rien dire de sa sainteté – cache et obère la structure générale du langage, qui est d’échapper toujours, et par principe, au locuteur, d’en différer toujours, en sorte que le langage transcende ses propres conditions d’énonciation, abrite en lui un déphasage qui est le jeu même dans lequel il devient traduisible, et où il peut alors constituer une révélation. Rosenzweig aurait reculé devant cette vérité proprement philosophique de la différance caractéristique du langage et n’en aurait entrevu, sous la forme de son analyse du judaïsme, qu’un exemple à la fois indirect et incomplet. Interprétation qui aurait, pour l’A., le mérite de situer Rosenzweig dans un « temps de la langue » dont il deviendrait alors, et conformément à l’annonce introductive du livre, un contributeur parmi d’autres et susceptible d’être complété ou surmonté par d’autres.
N’est-ce pas précisément ce qu’entend l’A. quand elle soutient que Rosenzweig rejoindrait en fait un « concept-limite de la langue » (p. 159), qui, tout en menant la description d’une « expérience singulière, celle du peuple juif », conduirait à « opérer la critique de toute expérience nationale des langues » ? Sans doute Rosenzweig, comme l’établit l’A. à partir des textes, refuse-t-il catégoriquement d’identifier langue et nation, sans doute la critique rosenzweigienne des revendications sionistes s’inscrit-elle dans une compréhension de la langue qui interdirait d’identifier celle-ci à une possession culturelle – mais resterait à déterminer la portée de ce refus. Et si l’hébreu demeure, en sa « temporalité sainte » (p. 166), un héritage divin – « l’essence de cette langue se trouve au-delà son être-parlé, dans l’éternité de l’Ecriture, c’est-a-dire dans la transmission ininterrompue d’un héritage » (p. 169), peut commenter l’A. -, n’est-ce pas que loin d’être le cas particulier d’un peuple, voire l’exemple d’un langage parmi d’autres, la langue sainte de la Bible parle d’une manière irréductible à toutes les autres, en sorte que l’homologie qui la rapporte à la Révélation ne saurait en aucun cas constituer un « cas-limite », et que le refus du nationalisme ne s’enracine en rien dans la dimension inatteignable, différante, de la langue mais plutôt dans l’appartenance du peuple élu à la parole de Dieu, appartenance excluant de penser à l’inverse que la parole appartient au peuple ?
Sans doute les analyses menées dans cette deuxième partie demeurent-elles éclairantes lorsqu’il s’agit notamment de montrer comment l’hébreu, loin d’être une langue fermée sur elle-même, « se traduit dans chacune de »nos langues » en diaspora, venant nourrir les idiomes des peuples » (p. 173), à l’image de « l’influence directe de l’hébreu de la Bible sur le classicisme allemand » (p. 172). Mais à nouveau, qu’est-il alors montré, sinon la singularité de la parole biblique, plutôt que la seule traductibilité universelle des langues depuis leur fonds commun ? De même, si la poésie s’avère, comme il est montré dans le chapitre suivant portant sur Juda Halévi, susceptible de traduire la relation de l’homme à la Révélation, quoique poésie et langue biblique doivent être tout à fait distinguées, c’est dans la mesure où « catégories théologiques » et « langue de l’expérience humaine » s’avèrent passer, par le biais de la traduction, l’une dans l’autre (p. 194), est-ce parce que le langage constitue le dénominateur de l’une et de l’autre ou plutôt, et sans doute plus probablement, parce que la Révélation inspire simultanément la parole du philosophe qui cherche à la penser et du poète qui tente d’en garder mémoire ? La manière dont le dialogue de la philosophie et de la poésie, si cher à Heidegger et rejoint ici avec la même ampleur que chez ce dernier, est ici pensé, ne devrait-il pas d’abord reposer sur l’antériorité du texte du texte sacré sur toutes ses traductions ? Et n’est-ce pas parce que la dimension événementielle du poème obéit à la grammaire même de la Révélation, « prioritaire sur tout contenu révélé » (p. 183), que poésie et philosophie ici se rejoignent ? Et s’il est vrai que le poème, en montrant « l’expérience que les hommes font dans la Révélation », n’est pas lui-même une langue sainte, et permet ainsi de « convertir » le « problème théologique – faut-il, pour rendre justice à son essence et à son expérience, définir Dieu comme le Tout-autre ? », en un « problème humain – comment pouvons-nous approcher Dieu ? – par l’intermédiaire d’une vérité paradoxale que le cœur humain connaît par expérience – Dieu est tantôt le plus proche, tantôt le plus lointain » (p. 193), cette conversion ne suppose-t-elle pas l’intelligence préalable de la Révélation, de l’histoire sainte, sans laquelle « l’ancrage phénoménal déterminé » de l’expérience humaine, « ici offert par l’expérience de la souffrance et de l’exil », n’aurait aucune signification ? La langue poétique n’est-elle pas ainsi la traduction de la langue biblique à la seule condition de l’antécédence radicale de celle-ci sur celle-là ? Ce serait ainsi la traduction qui dépendrait de la Révélation, et non la « propriété révélante de la langue » qui serait déterminée par une expérience de la traduction dont l’expérience biblique serait un objet possible entre d’autres.
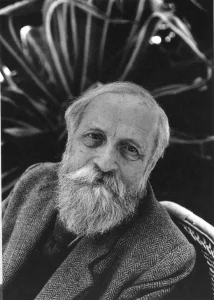 Telle n’est pourtant pas la thèse de l’A. pour qui la méditation de la traduction du premier livre de la Bible hébraïque par Rosenzweig et Buber conduit à l’affirmation selon laquelle que la Révélation, dans l’esprit des traducteurs, dépendrait de la traduction elle-même. « Buber et Rosenzweig », écrit l’A., « semblent avoir transformé en profondeur le sens de la Révélation : elle se produit dans l’expérience de la lecture plutôt que dans un temps historique, et elle a pour sujet l’individu chaque fois singulier qui éclaire le texte par sa vie » (p. 213). L’entreprise rosenzweigienne se situerait en ce sens dans l’exacte continuité de la traduction luthérienne de la Bible en allemand, laquelle se fonderait « sur un principe herméneutique » : de même que selon le chrétien Luther, « sans la foi que donne l’intelligence du Christ, la connaissance des langues n’est rien » (p. 206), de même donc que selon Luther l’expérience du lecteur est décisive dans la reconnaissance du texte révélé et révélant du texte, « c’est dans l’expérience de la lecture que se produit ce que Rosenzweig et Buber entendent désormais sous le nom de Révélation » (p. 208). A nouveau, il s’agit ici de soutenir la grande thèse suivant laquelle traduire, c’est révéler : la Révélation se situerait donc dans la langue, à condition d’entendre par langue non une réalité toute faite mais l’expérience dialogique de la traduction et de la compréhension d’une parole adressée devenue parole reçue. Soit, mais en conclure que « la Révélation appelle une »herméneutique projective » » (p. 213), qu’elle n’a lieu que pour celui qui la reçoit, est-il suffisant pour renverser la priorité du Verbe sur la langue, de la Révélation sur la parole qui l’abrite et dans laquelle elle se donne, et ainsi pour tenir la dimension de la langue pour antérieure et plus essentielle à la Révélation qu’elle serait, par elle-même, susceptible de communiquer ? N’est-ce pas au contraire parce que la Révélation en détermine et en inspire l’entreprise que « traduire la Bible », c’est-a-dire « transformer une langue du monde, qui n’est d’abord qu’une langue de mots, en une véritable langue de la foi » (p. 228) devient possible ? Sans doute cela conduit-il à « rendre le texte à son historicité authentique », et donc, à soumettre les mots saints à la possibilité de leur traduction, mais dire que le texte révélé appartient à la langue n’implique en rien que la Révélation elle-même y appartienne puisqu’elle préside précisément à la diction et à la signification du texte. Autrement dit, ce n’est pas toute langue, mais la langue de la Bible qui s’avère traduisible, qui porte en elle la possibilité ainsi comprise et décrite de la traduction, et ce qui vaut de la réception de la Révélation dans et par le langage ne saurait être élargi à une réflexion à « l’acte de traduire et de parler en général » (p. 249) sans que la singularité de la langue biblique ne soit aussitôt altérée.
Telle n’est pourtant pas la thèse de l’A. pour qui la méditation de la traduction du premier livre de la Bible hébraïque par Rosenzweig et Buber conduit à l’affirmation selon laquelle que la Révélation, dans l’esprit des traducteurs, dépendrait de la traduction elle-même. « Buber et Rosenzweig », écrit l’A., « semblent avoir transformé en profondeur le sens de la Révélation : elle se produit dans l’expérience de la lecture plutôt que dans un temps historique, et elle a pour sujet l’individu chaque fois singulier qui éclaire le texte par sa vie » (p. 213). L’entreprise rosenzweigienne se situerait en ce sens dans l’exacte continuité de la traduction luthérienne de la Bible en allemand, laquelle se fonderait « sur un principe herméneutique » : de même que selon le chrétien Luther, « sans la foi que donne l’intelligence du Christ, la connaissance des langues n’est rien » (p. 206), de même donc que selon Luther l’expérience du lecteur est décisive dans la reconnaissance du texte révélé et révélant du texte, « c’est dans l’expérience de la lecture que se produit ce que Rosenzweig et Buber entendent désormais sous le nom de Révélation » (p. 208). A nouveau, il s’agit ici de soutenir la grande thèse suivant laquelle traduire, c’est révéler : la Révélation se situerait donc dans la langue, à condition d’entendre par langue non une réalité toute faite mais l’expérience dialogique de la traduction et de la compréhension d’une parole adressée devenue parole reçue. Soit, mais en conclure que « la Révélation appelle une »herméneutique projective » » (p. 213), qu’elle n’a lieu que pour celui qui la reçoit, est-il suffisant pour renverser la priorité du Verbe sur la langue, de la Révélation sur la parole qui l’abrite et dans laquelle elle se donne, et ainsi pour tenir la dimension de la langue pour antérieure et plus essentielle à la Révélation qu’elle serait, par elle-même, susceptible de communiquer ? N’est-ce pas au contraire parce que la Révélation en détermine et en inspire l’entreprise que « traduire la Bible », c’est-a-dire « transformer une langue du monde, qui n’est d’abord qu’une langue de mots, en une véritable langue de la foi » (p. 228) devient possible ? Sans doute cela conduit-il à « rendre le texte à son historicité authentique », et donc, à soumettre les mots saints à la possibilité de leur traduction, mais dire que le texte révélé appartient à la langue n’implique en rien que la Révélation elle-même y appartienne puisqu’elle préside précisément à la diction et à la signification du texte. Autrement dit, ce n’est pas toute langue, mais la langue de la Bible qui s’avère traduisible, qui porte en elle la possibilité ainsi comprise et décrite de la traduction, et ce qui vaut de la réception de la Révélation dans et par le langage ne saurait être élargi à une réflexion à « l’acte de traduire et de parler en général » (p. 249) sans que la singularité de la langue biblique ne soit aussitôt altérée.
L’A. envisage cependant, dans le dernier chapitre de son étude, une ultime possibilité, permettant selon elle à la fois de faire droit à cette singularité de la langue révélée et d’y voir une contribution à un « temps de la langue » qui ne soit pas exclusivement subordonné à la mémoire de la foi. C’est le concept d’ « expérience », concept par ailleurs omniprésent dans l’ouvrage puisque la langue et la Révélation y sont systématiquement rassemblées sous le dénominateur commun de l’expérience, qui en fournit le fil conducteur. Rosenzweig a en effet professé, dans ses derniers textes, une « philosophie de l’expérience », une « confiance dans l’expérience » (p. 251 et 252) qui, plus encore que la Révélation elle-même, est supposée en maintenir l’intelligibilité : l’expérience que nous faisons « de Dieu, du monde et de l’homme » ne saurait en effet conduire à les isoler les uns des autres mais au contraire, à reconnaître les « jonctions » (p. 254), « le Et de leur rencontre », au sein desquels ils prennent sens les uns au regard des autres. Dès lors, Dieu, tel qu’il se donne dans l’expérience, est à la fois « le Dieu éternel » et « notre Dieu » (p. 261) : idée contradictoire mais néanmoins effective dans le témoignage que nous rendons de lui. L’idée de Dieu importe alors moins que la manière dont nous parlons de lui : l’expérience de Dieu se ramène finalement à une expérience de la langue, à un « commencement que la parole trouve chez chacun de ses locuteurs » (p. 267) et qui « délivre l’homme en l’unissant à son monde et à Dieu dans le temps » (p. 268). Dès lors, « Rosenzweig en appelle à la traduction des concepts théologiques dans la langue du quotidien et à la refondation de la philosophie sur l’expérience quotidienne » (p. 269) : la vérité compte alors moins que la manière dont elle se laisse retracer, herméneutiquement, par les paroles humaines, dans les circonstances de leur énonciation et de leur adresse, « à partir de l’expérience telle que la langue nous la donne » (p. 272). La pensée devra ainsi « s’ancrer dans une langue chaque fois donnée ». Ainsi serait finalement démontrée la priorité, l’antécédence de la langue sur la Révélation, puisque seule la première, en tant que fait d’expérience, donnerait à entendre la Révélation, et constituerait « la condition transcendantale de l’expérience théologique » (p. 271). Autrement dit, selon l’A., il devient possible de conclure d’après les dernières recherches de Rosenzweig, qu’une expérience, celle du témoignage et de la réception du témoignage, précède l’autre, celle de Dieu, de sa Révélation, et de sa vérité. Penser, c’est alors essentiellement écouter : la philosophie « exige l’écoute d’une langue originaire », « le choix d’une langue propre » (p. 272) qui constituerait « la situation particulière du penseur » (p. 273). Et c’est ainsi que s’expliquerait la dépendance dans laquelle Rosenzweig se place à l’égard des « mots juifs », lorsqu’il affirme : « j’ai reçu la pensée nouvelle dans ces mots anciens ; c’est pourquoi je l’ai redonnée et retransmise en eux » (Foi et savoir, p. 163, cité p. 272) : l’inspiration biblique de la pensée rosenzweigienne ne devient-elle pas alors un exemple parmi d’autres, un cas particulier de la dépendance de la philosophie à l’égard d’une expérience de la langue qui lui serait préalablement donnée et dans et devant laquelle elle aurait à se traduire, pour alors la traduire ? Telle semble être la pensée de l’A., qui remarque que « d’autres penseurs [ont eu] vocation à se tourner vers la langue du Nouveau Testament, voire vers une langue qui n’est plus celle d’un texte sacré » (p. 273). Qu’est-ce à dire, sinon que la priorité de la Révélation sur la langue s’en trouverait absolument renversée ?
Plus encore, pour l’A., « c’est parce que la langue est parlée par Dieu, le monde et l’homme » qu’elle ouvre l’espace commun de leur rencontre, et Dieu est donc soumis à la langue. « D’où vient que Dieu, le monde et l’homme parlent la langue ? Si la langue est le milieu qui les rassemble et le pont qui les relie, ne faut-il pas y voir le signe d’une facticité plus originaire qui interdit de la soumettre à toute détermination théologique, mondaine ou anthropologique ? », demande l’A., notant alors, à titre de conséquence de cette question : « c’est de leur appartenance à la langue qu’ils recevraient leur être ». Dieu est-il finalement un « phénomène linguistique », une « figure déjà dérivée » de cette « originarité » de la langue « qui l’élève au-dessus » de tout ce qui s’inscrit en elle ? La langue est-elle finalement plus haute que Dieu lui-même, à titre de simple mot doté d’une signification traduisible et communicable ?
On ne saurait toutefois admettre sans réserve une telle conclusion, qui conduirait, de proche en proche, non seulement à une complète déthéologisation de l’entreprise rosenzwegienne, qui deviendrait une expérience de la langue parmi d’autres plutôt que la méditation des « mots juifs » qu’elle aura pourtant prétendu constituer, mais aussi et plus radicalement encore à la mort de Dieu, réduit à un simple nom. Si Rosenzweig persiste toujours à « refuser que la langue fût plus et autre chose que le milieu des relations temporelles où l’élémentaire passe à l’effectivité sous le triple nom de Dieu, du monde et de l’homme » (p. 275), s’il « s’arrête toutefois au seuil » de ce que l’A. tient pour la « facticité originaire » de la Révélation elle-même alors tenue pour un phénomène linguistique parmi d’autres – n’est-ce pas que cet « arrêt », loin d’être un recul devant la prétendue originarité de la langue, appartient à la chose même, et que c’est essentiellement à la langue sainte de la foi que Rosenzweig soumet ses analyses de l’expérience, excluant la possibilité de leur élargissement et de leur sécularisation ? Il en irait alors, non pas d’un « arrêt » mais d’une « décision quant au type de rapport ou de relation auquel nous donne accès l’expérience de la langue » (p. 275). Rosenzweig n’est-il pas à ce titre l’ennemi radical d’une pensée qui prendrait la langue pour elle-même, comme celle de Heidegger y faisant apparaître « le rapport de tous les rapports » en « s’étant voulue libre de Dieu, du monde et de l’homme » ? Et n’est-ce pas aussi pour cette raison que chez Rosenzweig, le dialogue de la pensée avec la poésie ne repose pas, contrairement à ce qui se produit chez Heidegger, sur la traductibilité de celle-là dans celle-ci ? Peut-être, mais dès lors, si cette dernière démarche était propre à un « temps de la langue », la pensée de Rosenzweig y serait alors restée, pour cette raison même, tout à fait étrangère.
L’A. place finalement, puisque c’est le titre de sa conclusion, son travail sous le signe de cette « troisième langue » méditée par J. Derrida dans Les yeux de la langue. Cette décision théorique est-elle bien la même que celle qui la conduit à reconnaître dans une philosophie s’en remettant au langage un chemin qui mène « au site originaire de la Révélation » (p. 278) ? Rien n’est moins sûr. Mais cela ne tient-il pas d’abord à ce scrupule par lequel l’A. présente comme un « risque » qu’ s’agit de « supporter » le fait que « la refondation espérée » de la pensée « la subordonne à l’expérience religieuse » (p. 278) ? En formulant ainsi les coordonnées de la question rosenzweigienne, en assimilant la Révélation à une expérience et la théologie à la religion, l’A. n’obère-t-elle pas, de proche en proche, le sens de l’entreprise de L’Etoile qu’elle aura préalablement reconstruit, entreprise dans laquelle ce n’est pas la relation de la religion à la langue, mais celle de l’hébreu à l’histoire sainte, et donc entreprise de part en part, sans nul doute, théo-logique ? Autrement demandé, l’A. ne recule-t-elle pas devant la radicalité même de sa propre découverte, en estimant que « l’intégrité de la démarche philosophique » s’y trouve remise en cause ? Depuis quelle détermination de la philosophie est-il en effet possible d’opposer la subordination à la théologie à son intégrité, sinon, à tout le moins, une compréhension de la tâche de la pensée qui n’est pas celle de Rosenzweig ?
Sans doute accordera-t-on, sans réserve, à l’A. que la mise au jour de « l’essence dialogique du langage » (p. 279) par Rosenzweig permet véritablement de mettre en question l’essence de la langue. Mais n’est-ce pas toujours alors, et précisément, par le biais d’un langage divin, révélé et à ce titre révélant, que cette mise en question se produit ? Peut-on alors élargir hors de toute source scripturaire ce qui est ici rejoint au sujet de la langue ? Et plutôt que de chercher à dériver une philosophie du langage d’une pensée de la Révélation alors nécessairement conçue comme l’un de ses cas particuliers – n’aurait-il pas fallu à l’inverse reconnaître, comme Levinas, le mot Dieu comme doté d’une signification irréductible à tout autre, et offrant au langage ses possibilités les plus propres et les plus puissantes ? Si, « dans le texte biblique lui-même », peut se lire « la description de l’expérience humaine en tant que parole » (p. 280), comme le reconnaît à juste titre l’A., n’est-ce pas que la seconde est incluse dans les circonstances – saintes – de l’énonciation du premier ? Et n’est-ce pas encore que la sainteté de la langue que celle-ci tire la possibilité de devenir traductible, c’est-a-die de laisser résonner « la description de la relation nouée, dans la parole, entre le Dieu éternel, l’âme vivante et le monde présent » (p. 280) ?
Soulignons l’enjeu de ces questions. Comprendre l’appartenance de la Révélation à la langue comme un cas particulier d’une traductibilité universelle du langage elle-même inatteignable, c’est, de proche en proche, ne faire aucun cas du caractère inspiré de l’hébreu, aucun cas de la vérité même de la Bible. Lorsque l’A. retient de « l’identification », « tout au long de l’oeuvre rosenzweigienne », « entre die Sprache et la langue de la Bible », dont elle souligne à bon droit qu’elle « n’aura jamais été démentie », mais qu’elle interprète aussitôt cette identification comme « la conviction d’après laquelle le langage (…) ne parle jamais que dans un texte où une voix s’adresse à une autre pour lui dire quelque chose » (p. 281), n’assimile-t-elle pas Dieu à une voix parmi d’autres et la Révélation à une chose comme une autre ? Autrement dit, ne proclame-t-elle pas silencieusement la mort de Dieu, seule condition pour que la langue dont laquelle il parle lui soit ainsi soustraite, pour être rendue à une structure sui generis ?
 C’est alors la tâche que l’A. a tenu depuis le commencement pour sienne, celle d’identifier un « temps de la langue » dont Rosenzweig serait parmi d’autres penseurs un pionnier, qui se trouve engagée. « La confiance de la langue peut-elle se passer de la foi dans la Révélation ? », demande-t-elle (p. 283) : autrement demandé, peut-on penser la langue sans se tourner vers l’histoire sainte qui lui aura précisément conféré les déterminations que l’ensemble de l’ouvrage lui aura reconnues ? Poser cette question, c’est questionner la pertinence de cette « hypothèse de la troisième langue » formulée par Derrida dont on comprend finalement qu’elle constitue le véritable fil conducteur de la recherche. Suivant alors, un instant, le raisonnement derridien, l’A. en reconstruit le principe : pour dire à la fois que la langue peut être sacrée et qu’elle peut être profane, pour ainsi produire la différence entre une langue sacrée et une langue « sécularisée », ne faut-il pas un « opérateur de passage entre les langues » (p. 284), ne faut-il pas précisément une tierce langue qui ne soit ni sacrée ni profane mais soit le dénominateur commun du sacré et du profane, et ainsi, préserve et abrite la distinction de l’un et de l’autre ? Ne faut-il pas atteindre ainsi une troisième langue, « neutre » à l’égard de Dieu comme de sa « corruption » lorsque celui-ci devient un simple mot (p. 285) ? L’A., avec Derrida, souligne aussitôt le caractère problématique d’une telle proposition, « à bon droit », selon elle, « objet de soupçon » puisqu’elle fait courir le « risque de la neutralité », qu’elle oppose alors au « risque de la sacralité » (p. 285 et 286). Mais c’est aussitôt pour préciser qu’entre ces deux risques, il n’y aurait, selon elle, finalement en rien à « choisir » puisque « ces dimensions » apparaissent selon elle, au terme de l’étude, comme « indissociables en toute expérience de la langue » (p. 285). Est-ce toutefois vraiment ce qui a été montré et en affirmant pour finir que « la confiance dans la langue ne se réduit pas à la croyance en la sacralité d’une langue : c’est à l’inverse l’expérience du sacré qui peut être comprise à partir de la propriété révélante de la langue » (p. 286), l’A. n’a-t-elle pas d’ores et déjà elle-même établi une dissociation du sacré et de la langue, au privilège de la seconde et sur la base d’un dénominateur commun qui serait l’expérience de la traduction ? N’aura-t-elle pas au fond visé à « écarter l’opposition du sacré et du profane » au profit d’une « troisième langue » qui serait, pour conclure l’ouvrage, « la langue des écrivains et des poètes, lorsque les philosophes la lisent et la traduisent » – « expérience du passage où c’est la langue de l’autre qui parle à travers moi (p. 286) ? Cette neutralité de la langue dont l’A. dénie qu’elle constitue un véritable « risque » puisqu’elle devrait ne pas exclure la mémoire de la Révélation, et qui pourtant conduit bien à en faire une expérience traductible parmi d’autres, c’est-a-dire à l’abolir, n’est-elle pas, en vérité, présupposée par l’écriture même de ces propositions ?
C’est alors la tâche que l’A. a tenu depuis le commencement pour sienne, celle d’identifier un « temps de la langue » dont Rosenzweig serait parmi d’autres penseurs un pionnier, qui se trouve engagée. « La confiance de la langue peut-elle se passer de la foi dans la Révélation ? », demande-t-elle (p. 283) : autrement demandé, peut-on penser la langue sans se tourner vers l’histoire sainte qui lui aura précisément conféré les déterminations que l’ensemble de l’ouvrage lui aura reconnues ? Poser cette question, c’est questionner la pertinence de cette « hypothèse de la troisième langue » formulée par Derrida dont on comprend finalement qu’elle constitue le véritable fil conducteur de la recherche. Suivant alors, un instant, le raisonnement derridien, l’A. en reconstruit le principe : pour dire à la fois que la langue peut être sacrée et qu’elle peut être profane, pour ainsi produire la différence entre une langue sacrée et une langue « sécularisée », ne faut-il pas un « opérateur de passage entre les langues » (p. 284), ne faut-il pas précisément une tierce langue qui ne soit ni sacrée ni profane mais soit le dénominateur commun du sacré et du profane, et ainsi, préserve et abrite la distinction de l’un et de l’autre ? Ne faut-il pas atteindre ainsi une troisième langue, « neutre » à l’égard de Dieu comme de sa « corruption » lorsque celui-ci devient un simple mot (p. 285) ? L’A., avec Derrida, souligne aussitôt le caractère problématique d’une telle proposition, « à bon droit », selon elle, « objet de soupçon » puisqu’elle fait courir le « risque de la neutralité », qu’elle oppose alors au « risque de la sacralité » (p. 285 et 286). Mais c’est aussitôt pour préciser qu’entre ces deux risques, il n’y aurait, selon elle, finalement en rien à « choisir » puisque « ces dimensions » apparaissent selon elle, au terme de l’étude, comme « indissociables en toute expérience de la langue » (p. 285). Est-ce toutefois vraiment ce qui a été montré et en affirmant pour finir que « la confiance dans la langue ne se réduit pas à la croyance en la sacralité d’une langue : c’est à l’inverse l’expérience du sacré qui peut être comprise à partir de la propriété révélante de la langue » (p. 286), l’A. n’a-t-elle pas d’ores et déjà elle-même établi une dissociation du sacré et de la langue, au privilège de la seconde et sur la base d’un dénominateur commun qui serait l’expérience de la traduction ? N’aura-t-elle pas au fond visé à « écarter l’opposition du sacré et du profane » au profit d’une « troisième langue » qui serait, pour conclure l’ouvrage, « la langue des écrivains et des poètes, lorsque les philosophes la lisent et la traduisent » – « expérience du passage où c’est la langue de l’autre qui parle à travers moi (p. 286) ? Cette neutralité de la langue dont l’A. dénie qu’elle constitue un véritable « risque » puisqu’elle devrait ne pas exclure la mémoire de la Révélation, et qui pourtant conduit bien à en faire une expérience traductible parmi d’autres, c’est-a-dire à l’abolir, n’est-elle pas, en vérité, présupposée par l’écriture même de ces propositions ?
Cette question décisive donne la mesure de la retenue avec laquelle nous accueillons le questionnement final de l’A. sur une « troisième langue » qui aura été, contre Rosenzweig lui-même, présupposée plus que proprement montrée, et dont la présupposition aura conduit à proclamer silencieusement la possibilité de dépasser ou de déborder la langue sainte en vue d’un « milieu différenciant » qui va à l’encontre de la possibilité même de la singularité même de la Révélation. Or, si le témoignage rosenzweigien ne permet pas de souscrire à la nécessité de cette « troisième langue », c’est, avec elle, l’urgence même d’une compréhension de la tâche de la pensée à partir d’un « temps de la langue » qui se trouve, de proche en proche, concernée. Si, à l’issue de l’étude, le statut saint de la langue, et avec lui, le propre de la voix de Dieu, reste indécidable, énigmatique, l’entreprise visant à faire de la méditation de cette voix un moment du « temps de la langue » ne devient-elle pas inoffensive ? Et Rosenzweig ne nous invite-t-il pas, au contraire, comme l’aura reconnu Levinas, à tenir la langue pour essentiellement sacrée, pour porteuse d’une expérience de la « signifiance » de Dieu insubstituable et donnant alors à la philosophie la tâche de devenir, non un Sprachdenken mais plutôt une éthique ?
À moins qu’il ne soit possible et même nécessaire, par ailleurs, de revenir sur la question du langage, non à partir de la relation d’adresse et d’interpellation dans laquelle – mais sans doute non à partir de laquelle – signifie la Révélation, mais plutôt à partir de la façon dont la langue constitue « »le rapport de tous les rapports » qui, plus originairement que toute relation intramondaine, laisse apparaître et tient ensemble les contrées du monde » (p. 275). Cette « autre expérience de ou avec la langue, qui s’est voulue libre de Dieu, du monde et des hommes », expérience qui forme le programme tracé par la dernière pensée de Heidegger, et qui « engage la philosophie dans la direction d’un tout autre commencement », tout en requérant, elle aussi et différemment, le dialogue de la philosophie avec la poésie et les écrivains, d’où reçoit-elle pour sa part son urgence ? Une philosophie qui se comprendrait comme « temps de la langue » ne doit-elle pas au fond prendre en charge cette question, qui est, nous l’avons vu, celle de la « décision quant au type de rapport ou de relation auquel nous donne accès à l’expérience de la langue » ? Penser et peser cette « décision », en toute sa charge, n’est-il pas alors la seule manière de mettre à l’épreuve cette éventuelle « troisième langue » qui envisagerait à la fois la possibilité d’une langue sainte, révélatrice au sens biblique du terme, et d’une langue qui serait absolument originaire – si toutefois cet « à la fois » relève de la dimension du pensable ?







