L’ouvrage de Etienne Balibar Spinoza Politique, le transindividuel est un recueil d’articles et d’essais publiés de 1984 à 2012 repris sous diverses formes. Une première édition de ce livre avait été proposée en 2018, dédiée à Emilia Giancotti, traductrice de l’édition italienne de l’Éthique, ainsi qu’à François Zourabichvili, uns des anciens élèves de Etienne Balibar. Issus des mêmes débats sur la recherche « d’une démocratie sans exclusion, pensée à la fois comme une capacité instituante et comme genre de vie commun » (p 2), cette réédition est cette fois-ci faite en souvenir de Antonio Negri, dont le livre principal, L’Anomalie sauvage, avait été édité par Etienne Balibar en 1982.
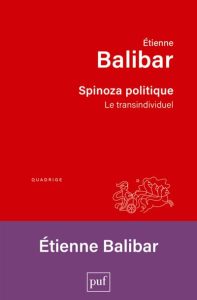 Le livre se divise en trois parties : la première consacrée aux positions politiques de Spinoza que Etienne Balibar interprète comme une « anthropologie de l’action commune, plus encore que de l’être commun » (p 8) ; la deuxième partie qui approfondi celle-ci par le concept repris à Simondon de « transindividualité » (p 9) chez Spinoza par oppositions aux pensées intersubjectives contractualistes rousseauistes ou hégéliennes ; et enfin, la troisième partie tente de dépasser les problèmes de la transindividualité sur les modes de communication pour penser ce qui serait chez Spinoza une « politique de la vérité » (p 11), notamment sur la constitution, l’institution et l’énonciation de la loi chez Spinoza (par contraste avec Hobbes principalement).
Le livre se divise en trois parties : la première consacrée aux positions politiques de Spinoza que Etienne Balibar interprète comme une « anthropologie de l’action commune, plus encore que de l’être commun » (p 8) ; la deuxième partie qui approfondi celle-ci par le concept repris à Simondon de « transindividualité » (p 9) chez Spinoza par oppositions aux pensées intersubjectives contractualistes rousseauistes ou hégéliennes ; et enfin, la troisième partie tente de dépasser les problèmes de la transindividualité sur les modes de communication pour penser ce qui serait chez Spinoza une « politique de la vérité » (p 11), notamment sur la constitution, l’institution et l’énonciation de la loi chez Spinoza (par contraste avec Hobbes principalement).
D’une manière très générale, le nœud problématique légué par les œuvres politiques (en partie inachevées) de Spinoza est le paradoxe suivant : le Traité théologico-politique selon lequel « la fin de l’État est la liberté » (p 116) face au déplacement qu’opère ensuite le Traité politique : « La fin de la société civile n’est rien d’autre que la paix et la sécurité » (ibid.). Pour penser cette évolution et en solutionner les potentielles contradictions ou apories, Etienne Balibar va offrir dans un premier temps une analyse historique absolument passionnante sur l’histoire de la Hollande et les positions politiques des proches de Spinoza. Puis en deuxième partie, la thématisation de la transindividualité va tenter de résoudre l’inquiétude principale du problème politique de Spinoza, à savoir la nécessité d’une stabilité sociale commune et collective grâce à des institutions qui peuvent combiner un rapport à l’autorité équilibré, qui ne soit pas de l’ordre de la superstition ou de la crainte, sans pour autant mener à la sédition. En résumé, comment se concilient souveraineté de l’État et liberté individuelle (p 88) chez Spinoza ?
Le fil argumentatif de Etienne Balibar pour expliquer cette tension va consister en une interprétation communicationnelle de l’individu en première partie, puis transindividuelle et enfin en une reprise des relations et organisation États-individus selon les conceptions singulières des « notions communes. »
Mais disons-le tout de suite, Etienne Balibar va avouer au milieu de l’ouvrage – avec une honnêteté intellectuelle peu rependue – un aspect intenable de cette conception anthropologique transindividuelle lorsqu’elle sera mise en regard de la connaissance du troisième genre. Penser la sociabilité dans sa forme collective tout en maintenant l’autonomie individuelle, telle est la dynamique spinoziste dont le concept de transindividualité de Etienne Balibar va cependant relativiser l’opposition entre les formes de sociabilité passionnelle et rationnelle, ou faire la vérité de l’une sur l’autre « en imaginant un processus téléologique de transformation de l’une dans l’autre » (p 335).
Plus grave, Etienne Balibar reconnaît – toujours dans le chapitre 3 de la IIème partie avec l’article « Philosophie du transindividuel : Spinoza, Marx, Freud » – que l’individu pensé comme composé de relations passionnelles et rationnelles dépasse certes les ontologies classiques de type contractualiste quand il est question de la constitution de la stabilité du régime politique. Or ce concept dynamique communicationnel ne tient plus, ne rend plus compte du système spinoziste, lorsque celui-ci aborde le troisième genre de connaissance : car à partir de là, il n’est plus question de « vertu » et « d’amitié » fondées sur l’utilité, mais de « béatitude » et de « sagesse ».
J’ai longtemps cru pour ma part (et j’ai écrit dans Spinoza et la politique) qu’on pouvait résoudre ces problèmes en définissant « le troisième genre de connaissance » non seulement comme un genre de vie, mais comme un « mode de communication ». Cette possibilité ne me semble plus tenable dès lors qu’on va au fond des implications de la proposition 39 de la Vème partie qui fait correspondre à l’éternité (« partielle ») de l’âme une augmentation de la capacité d’être affecté du corps propre. Cela ne veut pas dire que le sage spinoziste soit un être isolé ou hors société, mais que l’augmentation de puissance évoquée intensifie l’individualité comme telle, et non – du moins pas directement – la relation qui fait intervenir l’instance du « semblable ». (p 356)
C’est pourquoi Etienne Balibar finira par proposer le concept de « quasi-individualité » (p 336) pour décrire le sens spinoziste des ensembles politiques. Ce qui est alors pensé à travers ce concept, c’est à la fois ce qui est constitutif de l’individu et de la collectivité tout en ayant un « excès » « transgressif » dans ce rapport constitutif lui-même (p 365). Car c’est là un des traits principaux selon Etienne Balibar de la pensée politique de Spinoza qui revient de manière obsédante dans son œuvre à travers la citation de Tacite « Terret vulgus, nisi metuat » (Annales, I, 29), « La foule est terrible quand elle est sans crainte ». En effet, Spinoza la reprend dans le Traité politique (VII, 27) et l’Ethique IV, scolie prop 54) parce que la crainte des masses est le problème politique immédiat par excellence, l’État devant pour commander exprimer son « imperium », se stabiliser en « combinant des moyens passionnels (piété, dévotion patriotique) et rationnels (utilité, donc propriété privée) » (p 25). Cet excès est donc aussi constitutif que transgressif, et Spinoza n’en fait pas une simple thématisation strictement théorique des groupements humains ; il en montre l’historicité même, et c’est sous cet angle que l’histoire du peuple Hébreux est analysée en détail et prise en exemple par Spinoza. Aussi, l’essence politique est-elle en cela théologique puisque ce commandement des masses, l’imperium de la multitudo, se fait par l’institution de loi qui parlent aux affects et à l’imagination afin de constituer un nationalisme : « pas de nation sans imperium, sans État, mais pas d’État sans nation. » (p 410). Et Etienne Balibar commente : « L’histoire du peuple hébreux « qui, comme le dit Jérémie, ne commence pas tant avec la fondation d’une ville qu’avec l’institution des lois », est le laboratoire de l’analyse du nationalisme… Il ne fait pas de doute que toutes les nations eurent leurs Prophètes, et que le don prophétique ne fut pas propre aux Juifs » (TTP p 50) » (p 411).
C’est ce cheminement de la pensée politique de Spinoza interprétée par Etienne Balibar que nous allons donc essayer de suivre avec cet ouvrage dense, intègre, et d’une richesse conceptuelle presque intimidante offerte à chaque article de ce livre.
- Spinoza et la politique.
 Afin de déterminer où commence la réflexion politique de Spinoza et de montrer en quoi celle-ci n’est pas issue d’une abstraite confrontation conceptuelle avec Hobbes mais d’une véritable expérience pratique, Etienne Balibar entreprend un remarquable résumé de la situation historique de la Hollande. Depuis 1565, dans sa forme colonialiste et mercantiliste, la Hollande avait toujours été en guerre, sans État national réellement stable, tiraillé entre les familles proches des Orangistes, investis du commandement militaire, et le groupe des Régents, administrateur des villes et gérant des finances publiques (p 75). L’une et l’autre famille prennent successivement le dessus – les orangistes mettant fin à la République en 1672, Jan de Witt, ami de Spinoza, est alors massacré par la foule – chaque parti consacrant une religion ou une interprétation particulière, qui au final constitue une sorte de « patriotisme calvinistes qui rejette Rome et l’Espagne, puis la France » (p 76). Après son excommunication, Spinoza fut accueilli en 1656 par une bourgeoisie proche des Régents qui posait donc dans ce contexte trois demandes : « celle de la science cartésienne, de la religion non confessionnelle et de la politique républicaine. Mais s’il entend bien ces demandes, Spinoza les déplacera sans répondre à aucune conformément à son attente car le « parti de liberté » est en fait à créer. » (p 82).
Afin de déterminer où commence la réflexion politique de Spinoza et de montrer en quoi celle-ci n’est pas issue d’une abstraite confrontation conceptuelle avec Hobbes mais d’une véritable expérience pratique, Etienne Balibar entreprend un remarquable résumé de la situation historique de la Hollande. Depuis 1565, dans sa forme colonialiste et mercantiliste, la Hollande avait toujours été en guerre, sans État national réellement stable, tiraillé entre les familles proches des Orangistes, investis du commandement militaire, et le groupe des Régents, administrateur des villes et gérant des finances publiques (p 75). L’une et l’autre famille prennent successivement le dessus – les orangistes mettant fin à la République en 1672, Jan de Witt, ami de Spinoza, est alors massacré par la foule – chaque parti consacrant une religion ou une interprétation particulière, qui au final constitue une sorte de « patriotisme calvinistes qui rejette Rome et l’Espagne, puis la France » (p 76). Après son excommunication, Spinoza fut accueilli en 1656 par une bourgeoisie proche des Régents qui posait donc dans ce contexte trois demandes : « celle de la science cartésienne, de la religion non confessionnelle et de la politique républicaine. Mais s’il entend bien ces demandes, Spinoza les déplacera sans répondre à aucune conformément à son attente car le « parti de liberté » est en fait à créer. » (p 82).
Les problèmes spinozistes prennent chair et s’animent donc selon ces déchirements et constitutions politico-religieuses où unité et communauté sont une nécessité dont il faut penser l’organisation en acte. Comment ? Si la puissance est toujours celle de la multitude, du peuple, la structuration de la puissance revient à un commandement, l’imperium (p 28) dont la forme étatique est l’expression. Mais selon Etienne Balibar, la difficulté – qui en définitive clôture selon lui le Traité théologico-polique sur une aporie – c’est que si la masse du peuple est potentiellement cause de ruine, et que toute sédition est par nature nuisible et à prévenir, cela ne mène au final qu’à la tyrannie qui elle-même est autodestructrice et sans continuité réellement stable (p 26-27). Ce qu’il faut donc trouver, ce sont les moyens d’une libération de la puissance qui ne soit pas séditieuse, qui ne mettent pas en danger l’imperium, et que réciproquement l’imperium puisse garantir et maitriser cette puissance de la multitude, de la masse, sans pour autant verser dans la tyrannie puisqu’elle met également la structure du pouvoir en danger, car « l’esclavage généralisé n’est pas un État » (p 95).
A ce point du cheminement, la question devient : y-a-t-il une obéissance qui ne soit pas de la « servitude volontaire » ? Etienne Balibar va y revenir de façon plus ou moins insistante à travers l’ouvrage en déployant des trésors de distinctions et de changements de plans pour différencier Spinoza de La Boétie ; il pose le problème ainsi :
Trois problèmes de l’obéissance : quel est son mécanisme psychique ? Quel rapport entretient-elle avec la crainte (ou la contrainte) et l’amour ? Comment s’articulent l’obéissance et la connaissance et, corrélativement, quels rapports peuvent exister entre les savants et les ignorants, entre le savoir et le pouvoir ? Pour Spinoza ces problèmes n’en font qu’un.
Passion et raison sont des modalités de communication entre les corps, et entre les idées des corps. De même, les régimes politiques doivent être conçus comme des régimes de communication : les uns conflictuels et instables, les autres cohérents et stables. (P 168)
Les États incluent donc ces tendances transgressives et stabilisatrices parce que les affects des individus interagissent, communiquent. Selon Etienne Balibar, l’idée de Spinoza est de trouver dans les pratiques mêmes comment peut émerger un État fort, c’est-à-dire stable par la vie de ses institutions puisque « la vertu de l’État, c’est la sécurité » (Traité politique, I, 6). L’équation est donc complexe puisque la force dont il s’agit est constituée par la multitude, et ne peut pas être tyrannique et arbitraire si elle veut durer et générer l’obéissance. La question posée est donc : comment la multitude peut-elle se gouverner elle-même (p 124), c’est-à-dire canaliser ses propres passions ? Les éléments de la solution de ce problème sont paradoxaux puisque Spinoza identifie la puissance au droit, donc à l’élément potentiellement séditieux lui-même.
Ici, Etienne Balibar offre de plusieurs développements quelque peu dialectiques pour montrer en quoi Spinoza se distingue des contractualistes : « deux conceptions de droits sont donc exclues : celle qui autorise certaines actions, possessions et en interdit d’autres ; et celle qui en fait la manifestation d’une volonté libre, droit subjectif comme capacité universelle exigeant d’être reconnue. » (p 127). Chaque individu a part à la puissance de la Nature, chaque individu agit donc sur les parties de la Nature. La forme de l’État est donc une recherche de stabilisation et d’équilibre dans ces complexes de puissances propres aux individus (p 128).
Les institutions étatiques doivent ainsi se constituer selon les intérêts de tous parce qu’elles permettent la conservation de tous. Et l’intégration à cet ordre est donc le fruit de la puissance individuelle, c’est-à-dire de la liberté véritable lorsque la raison maîtrise ses passions et atteint son indépendance (p 130).
Mais l’expérience montre que les individus ne décident que rarement en connaissant les mobiles qui les déterminent. Et la multitude comme puissance contradictoire et divisée ne décide de rien du tout. Le problème est donc de faire émerger une « volonté », une puissance de décision au niveau de l’État (p 139-140). Ici la réponse spinoziste classique est liée au régime démocratique comme forme de gouvernement la plus propre à faire émerger une loi commune, donc de constituer le principe majoritaire régulier des assemblées délibératrices (p 142). Etienne Balibar considère ainsi que le système spinoziste ouvre et s’engage dans des processus de démocratisation continuels s’il veut durer (p 143).
C’est pourquoi, la réflexion et l’interprétation de la pensée politique de Spinoza par Etienne Balibar se développe sur la communication sociale et individuel, donc sur ce qu’il appelle le transindividuel.
- Le transindividuel
Au début du chapitre 5 « politique et communication », Etienne Balibar identifie trois problèmes traditionnels de la pensée de Spinoza : avec l’identification de Dieu à la Nature, dans quelle mesure ne détruit-on pas toute valeur morale ? Avec cette identification, quelle est l’autonomie de l’homme alors que Spinoza prétend amener l’homme à une libération par la connaissance intellectuelle ? Comme nous l’avons vu plus haut, Spinoza pose que le droit est identique à la puissance, mais il prétend en faire la fondation de la liberté civile avec l’État : or, il écrit deux Traités aux conclusions différentes : l’un limite le pouvoir de l’État, l’autre en thématise l’absoluité nécessaire.
Si la question des « notions communes » – sur laquelle Etienne Balibar reviendra de manière plus ou moins directe dans la troisième partie de son recueil – peut résoudre celle de la limitation de l’État avec son caractère absolu dans la mesure où le tout et la partie communiquent (p 176), on n’explique pas pour autant comment cette communication s’opère, c’est-à-dire comment une théorie de la connaissance s’actualise en tant que théorie du rapport social.
Tout le problème de ce « corps social » composé d’individu relativement autonome est donc d’amener leur complexion à maîtriser les passions, alors même que la sociabilité passionnelle est nécessairement conflictuelle (p 191). Spinoza dépasse en cela l’alternative classique de « l’homme est un loup pour l’homme », ou bien « l’homme est un dieu pour l’homme ». La cause de la sociabilité est l’utilité réciproque issue du désir des hommes à se conserver, parce qu’aucun homme n’est complet et autosuffisant (p 215). Mais sur quel type de convenance et d’équilibre « s’opère » (p 222) cette sociabilité, c’est-à-dire cette communication stabilisatrice des rapports entre individus ? L’accord rationnel est libre mais rare, ce qui amène Spinoza à s’intéresser dans ce contexte au deuxième genre de connaissance, à un accord mixte des affects, c’est-à-dire dépendante d’un imaginaire, donc, au fond, d’une culture. Etienne Balibar le condense ainsi :
l’idée de l’équilibre métastable, c’est que toute individuation reste dépendante d’un potentiel pré-individuel dont l’individu a émergé au cours de successives « structurations » qui sont autant de « distances prises avec l’environnement ». L’existence même d’un individu reste donc toujours « problématique », elle exprime une « tension ». C’est cette tension que les individus cherchent à résoudre – ou à comprendre – en acquérant, par la construction de collectivité, un degré supérieur d’individualisation. Cependant une collectivité vivante n’est ni un simple agrégat ni une fusion des individus préexistants : elle doit être une culture (Simondon l’appelle spiritualité, Spinoza complexe de raison et d’imagination), une solution dynamique des problèmes individuels. (p 236 note 1)
 Cette solution dynamique du culturel est donc une étude de ses rapports synergiques, des rapports de convenance et non de dépendance (p 238) entre les individus. Selon l’imagination, son processus mimétique fait que nous nous identifions aux autres individus, et ainsi, nous projetons nos propres affections en même temps que nous recevons les leurs sur nous-même (p 244). Au niveau de la raison, la connaissance adéquate fait que nous percevons non seulement les affects utiles pour notre conservation, mais également l’activité réelle qui rend à chacun ses forces non plus selon un usage instrumental (p 248), mais également commun, donc instituant une nécessaire communauté. Dans les cas mode, un individu supérieur est donc produit, soit par imitation, soit par convenance.
Cette solution dynamique du culturel est donc une étude de ses rapports synergiques, des rapports de convenance et non de dépendance (p 238) entre les individus. Selon l’imagination, son processus mimétique fait que nous nous identifions aux autres individus, et ainsi, nous projetons nos propres affections en même temps que nous recevons les leurs sur nous-même (p 244). Au niveau de la raison, la connaissance adéquate fait que nous percevons non seulement les affects utiles pour notre conservation, mais également l’activité réelle qui rend à chacun ses forces non plus selon un usage instrumental (p 248), mais également commun, donc instituant une nécessaire communauté. Dans les cas mode, un individu supérieur est donc produit, soit par imitation, soit par convenance.
Le transindividuel au sens de Etienne Balibar interprétant les problèmes spinozistes de relation entre individu et communauté est donc une considération des relations « en transitions de l’imagination à la raison, d’une moindre à une plus grande puissance d’agir » (p 252-253).
Ici, Etienne Balibar avoue sa dette deleuzienne, au point de s’y être sans doute un peu trop fié étant donné que cette interprétation est sans doute valable au niveau du deuxième genre de connaissance (qui est peut-être le stade définitif du politique), mais dans l’économie du système spinoziste, ne rend pas raison du troisième genre de connaissance « qui pose comme nécessaire les singularités comme telles » (p 250) à travers l’intuition des notions communes.
Comme nous l’avons vu en introduction, Etienne Balibar va tourner longuement autour de ce problème avant d’admettre les limites de son concept (bien qu’il considère comme toujours valable le mode argumentatif lié au transindividuel). Il résume donc ainsi la difficulté qu’il a lui-même produit :
Il faudrait donc démontrer que pris à la lettre, un autre « genre de connaissance » est aussi un autre « genre de communauté » (ou de communication). Je pense que c’est bien le cas, mais je ne suis pas certain que le texte de l’Éthique suffise à l’établir. L’autre possibilité que nous avons, c’est de considérer l’Éthique et notamment la Vème partie comme un texte incomplet, voire aporétique. (p 253)
C’est ainsi que la dernière partie compile un approfondissement des trois genres de connaissance après que Etienne Balibar ait conclu avec une certaine élégance : « le troisième genre constitue un « point de fuite » par rapport à la structure relationnelle, révélant une possibilité d’individualité qui serait en excès par rapport à la transindividualité elle-même. » (p 357).
- Les trois genres de connaissance
Dans cette dernière partie, Etienne Balibar assemble des articles très hétéroclites mais qui, eu égard au précédents chapitres, récapitulent et approfondissent plusieurs problèmes, notamment liés à l’imagination comme structure prophétique et législatrice constitutive des États ; ainsi que les différences entre la pensée de Spinoza avec celle de Hobbes, comme lorsqu’il est question de « l’institution de la vérité », article remarquable qui reprend et discute un article de non moins remarquable de Gérard Lebrun.
Dans le premier article, « Jus – Pactum – Lex », Etienne Balibar reprend le paradoxe spinoziste selon lequel l’État n’absorbe pas l’individu puisque celui-ci a une part incompressible de puissance dans son droit, mais qu’en tant que membre, l’individualité n’est rien hors de l’État (p 376).
Etienne Balibar récapitule les différents problèmes de ce « pacte » spinoziste dont les principaux caractères sont 1. Réunion en vue de l’utilité commune. 2. Transfert absolu des droits et liberté de chacun pour la constitution de l’imperium. 3. Organisation complète de l’ordre juridique.
Mais la définition spinoziste du pacte comme unification des forces individuelles ne cesse pas de présenter des termes contradictoires : l’appétit exclusif des individus et le calcul rationnel qui « dicte » la préférence pour cette forme de paix qu’est la société civile ; la soumission absolue au souverain et l’affirmation inconditionnelle de l’intérêt propre. La définition de Spinoza peut être considérée comme dialectique en ce sens que le passage de l’abstrait au concret comme le développement des contradictions de la formule initiale relèvent identiquement d’une étude historique (p 377).
Essayons donc de remonter ce fil problématique proposé par Etienne Balibar. Il est à noter que dans la mesure où la pensée de Spinoza ne thématise aucune faculté mais la force des affects – c’est pourquoi Spinoza ne fait par exemple que constater que « l’homme pense » et ne dit pas « l’homme est substance pensée » – le pacte social n’est pas le fruit d’un consentement de volonté individuelle modelée selon le droit privé comme chez Hobbes. « Ce que le pacte institue est une puissance collective qui prend après coup la forme d’un rapport entre des volontés » (p 394). La volonté n’est donc pas un préalable, mais un effet « rétroactif » (ibid.) des puissances de Droit qui se métamorphose en Loi, et c’est de celle-ci qu’il y a essentiellement Histoire. L’Histoire du peuple hébreux n’est pas prise par Spinoza selon son histoire personnelle, mais précisément parce que la structure imaginaire politico-théologique de ce peuple exprime cette métamorphose du Droit vers la Loi par la voix Prophétique. Etienne Balibar en décrit alors les deux extrêmes :
D’un côté celle que représente Moïse : extériorisation maximale de la Loi, aliénation presque totale des volonté individuelles, l’intériorité étant concentrée dans la foi du Prophète lui-même, sujet et medium d’une véritable hallucination collective. A l’autre extrême, celle que représente la figure du Christ, « modèle de vie vraie pour tous les hommes », os Dei c’est-à-dire Voix de la Voix qui légifère en général, intériorisation maximale de la Loi et de l’énonciation par tous et par chacun en particulier, mais toujours référée au Nom de Dieu. (p 401)
Prenant acte de cette structure essentielle, l’obsession de Spinoza sera de proposer une conception qui tente d’équilibrer ces deux extrêmes historiques de particularisation et d’universalisation. Car en effet, comme l’indique l’histoire des Hébreux, introduire aussi explicitement la religion est à double tranchant : c’est un moyen efficace pour activer l’obéissance par la fidélité et la croyance, mais de l’autre, c’est risquer la contestation de la légitimité de l’interprète divin.
Le droit étant l’expression de la puissance et la loi représentant la conscience « révélée » en tant que volonté (dans le sens indiqué ci-dessus), le pacte spinoziste va formaliser ces deux expressions pour tenter de prévenir tout retour à une conception de type imaginaire (théologique) de la loi, mais aussi, en thématisant la volonté, en se gardant de conceptualiser de façon illusoire un État purement physique, sans imaginaire, maîtrisant absolument et définitivement l’affect passionnel (triste ou joyeux).
Mais dans la mesure où encore une fois cette proposition spinoziste n’est pas purement théorique, ou pensée selon une impossible abstraction du théologique, lequel réapparait systématiquement par l’imaginaire, Etienne Balibar pose la question suivante : « quel ciment historique peut rendre compte de la relative stabilité du pacte, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer d’autre cause que le complexe théologico-politique lui-même ? Spinoza nous le dit d’une façon extraordinairement tranchante : c’est le nationalisme. » (p 406).
Les lois et les mœurs forment ce complexe « idéo-passionnel » (p 408) qui produit la cohésion même des États par : 1. La suite des générations 2. Le sol 3. Les mœurs (le rite, les signes extérieurs du culte) 4. La langue parce qu’elle est conservée par le vulgaire dont elle exprime la cohésion et traduit l’imaginaire.
Construire et conserver un État, c’est donc former ce « pacte réel-imaginaire » (p 413) capable de produire et instituer ce nationalisme au sens spinoziste selon Etienne Balibar. C’est ce qui fait qu’on peut lui obéir durablement, c’est-à-dire que sa loi est intériorisée et pratiquée comme puissance individuelle propre, comme identification à la passion nationale (p 417). On ne sort donc jamais d’un imaginaire théologique dans la constitution d’un État, ni de la teneur religieuse qui l’affirme, de quelle que forme qu’elle prenne, n’est pas un simple moyen au service d’une virtu patriotique comme chez Machiavel, mais un « ressort nécessaire » à la durée des États (ibid.).
Comme l’indique le point 4, ce ressort tient essentiellement dans la langue, laquelle exprime cet imaginaire : c’est la langue qui porte ces modes nationalistes qui est donc l’enjeu politique final du pacte. C’est pourquoi Etienne Balibar aborde ce problème dans le chapitre 3 de son livre son article « L’institution de la vérité : Hobbes et Spinoza » (p 459-480). Il y reprend et résume avec admiration l’article de Gérard Lebrun paru en avril 1983 dans Manuscrito, VI/2. Selon Gérard Lebrun interprétant Hobbes :
Ce que fait le souverain n’est pas de « créer » la vérité, mais de l’instituer, de rendre possible son effectivité, en arrachant les dénominations à l’influence abusive des passions individuelles, et en les rendant ainsi à l’univers de leurs enchaînements nécessaires. Grâce à sa décision, les hommes – ou plutôt les citoyens – peuvent enfin, au sens fort, s’entendre. Le langage est bien le lieu de la vérité, mais seulement en tant que régulé par le pouvoir de l’État. (p 463)
De la même manière, serait-ce donc également ce que le pacte spinoziste qui régule, institue dans la langue et exprime dans les modes nationaux d’un État ? Là encore, Etienne Balibar va opposer à cette institution par l’État le fait que, selon Spinoza, le langage est toujours « hanté par la narration théologique » (p 475), donc un fond passionnel irréductible qui fait que le langage n’est pas le « lieu de la vérité » mais son « procès » qui « scande » les trois genres de connaissance » (ibid.). L’entente sociale possible ne se fait donc pas par une démonstration garantie par l’institution étatique de la vérité, mais par le fond passionnel des affects, lesquels forment la sédimentation même du langage, donc les Lois.
Si selon Etienne Balibar, Hobbes comme Spinoza proposent « deux nominalismes » qui sont deux tentatives de « laïcisation de la vérité » (p 478), dans cette perspective, Spinoza s’intéresse surtout aux effets de vérité sur l’âme et à ce qui augmente la capacité à agir (p 479). Et comme le fond imaginaire est toujours présent, l’enjeu réel est pour l’individu d’atteindre le troisième genre de connaissance, c’est-à-dire son style singulier, non pas dans un sens mystique, mais réellement pratique (p 513).
Conclusion :
Même si le concept de « transindividuel » que propose donc Etienne Balibar durant les deux tiers de son ouvrage ne se révèle opérant que jusqu’à un certain point, qu’il en montre en partie les limites en approfondissant la proposition 39 de la Vème partie de l’Éthique de Spinoza sur le troisième genre de connaissance, il n’en demeure pas moins que nous avons à travers cette réunion d’articles de très remarquables approfondissements de la pensée politique de Spinoza. La mise en perspective de sa pensée en tant que pratique est expliquée avec un magnifique développement sur l’époque de Spinoza et le contexte historico-politique et religieux de la Hollande, avec les problèmes et urgences auxquels Spinoza s’était attelé à répondre pour les penser concrètement. Actuellement, nous ne pouvons que retravailler cette pensée politique et relire avec profit ces interprétations de Etienne Balibar, notamment sur la forme intrinsèquement théologique de toute communauté politique, puisqu’elle est celle où les humains qui s’aiment les uns les autres et se rendent mutuellement utiles « font Dieu, ou produisent le divin » (p 506).







