Catapulter Hegel au milieu d’Andromède
L’essai de Jean-Clet Martin, Logique de la science fiction, a fait le choix d’interroger la science-fiction comme une logique métaphysique, ou comme une philosophie de l’astronomie. Il semble que cette inclinaison trouve un écho certain dans un besoin largement exprimé par le cinéma contemporain 1 et les séries numériques (l’un des premiers vecteurs de fiction actuelle). Pour une raison ou pour une autre, le voyage cinématographique dans l’espace fascine beaucoup depuis dix ans, et l’imagination s’y accroche pour déborder, avec lui, les limites de notre monde. « Cette liberté de formes qui se surpassent est évidemment ce que la science-fiction ne cesse d’anticiper suivant une innovation attentive au Tout qu’elle déborde, autant du côté de la science, de l’image, de l’information, que des créations littéraires. Aussi l’écriture de notre livre, cette fois-ci philosophique, ne pouvait se faire autrement qu’en épousant son objet et la profusion de ses perspectives idéelles. » 2 L’essayiste ne nous propose pas autre chose : un périple hors des conceptions géostationnaires de la méthode philosophique et une quête : rechercher (plutôt que trouver) ce qui définirait l’homme lorsqu’il n’a plus rien avec quoi se mesurer 3.
Dans ce voyage qui nous aspire au milieu des étoiles littéraires de la science-fiction, et nous traîne entre les idées-planètes (organisées dans une série de systèmes gravitationnels 4), l’auteur parvient à nous plonger dans le silence immense de la pensée entre chaque idée, qui sait aussi être le silence froid de l’espace inter-planétaire. Les comparaisons, les métaphores, les analogies fusent comme de comètes et les connexions qu’elles nouent entre les idées rencontrées désarçonneraient sans doute un lecteur trop attaché à une rationalité régulière — universitaire (p. 131), selon le mot de l’auteur, pour dire ce que n’est pas son approche de la Logique de Hegel 5.
De fait, et Jean-Clet Martin le martèle, rien n’est rassurant dans l’espace au-delà de notre atmosphère et il n’y a rien qui résiste à la vitesse, aux effets de la gravité, aux masses formidables et photo[n]phages des trous noirs, qui sont les grandes énigmes de l’existence. « [Le trou noir du film Interstellar] est comme le miroir de la voie lactée. Il contient un écho, une empreinte de tous les flux de la galaxie qu’il absorbe, qu’il intériorise et met en mémoire. On peut supposer que son bord contient nécessairement un reflet, une « image » ou une « idée » de tous les événements, et par conséquent enregistre les flux les plus contingents. Alors les pensées, les « idéations » se comportent comme des atomes d’évidence, des circulations entre éléments. Ici, des passages et influx relèvent d’une intelligence diffuse : une « âme du monde », pour reprendre l’expression de Schelling relativement à ses visions cosmo-théologiques. » 6 Schelling cosmo-théologien, et Hegel, cosmo-naute ? Cela n’est pas insensé, si l’on en croit la démonstration de Jean-Clet Martin. Dès les premières pages de la métaphysique, Hegel est un astronaute projeté dans les champs galactiques, explorateur qui cherche, qui pourchasse de nouvelles étoiles, de nouveaux savoirs spatiaux, « à l’affût de récits, d’objets culturels amassés au cours de l’Histoire comme dans une grande galerie d’images mythiques ». 7 D’ailleurs, l’auteur nous dit comme certains des plus grands auteurs de science fiction se revendiquent ouvertement de cet aventurier :
« Mitchell ne justifie pas à lui seul ce détour par Hegel. Van Vogt, auteur qui rend le genre véritablement emblématique, se souviendra lui aussi de cet étonnant hégélianisme des pionniers de la science-fiction. Il nous faut rappeler, en effet, que Van Vogt, traduit par Boris Vian, porte son regard sur le terrain d’une Logique qui déborde de loin la seule succession des événements. Ce n’est pas la consécution tranquille du rapport de la cause à son effet, rapport toujours si suivi, si ordonné, qui l’intéresse. Il adopte les idées de contradiction, d’opposition, d’infinité qui font la curiosité de ses propres innovations. Comme Mitchell en appelle à une lunette astronomique un peu spéciale, l’historioscope, visant vers des temps différents, Van Vogt va fracasser le cours du récit entre des images parallèles, des montages simultanés pour mettre sur le même plan des époques différentes. L’ordre des causes se voit mis à mal, se détourne de la succession […]. Van Vogt est bien l’auteur, en 1945, d’une forte intrigue réclamant une nouvelle Logique. » 8
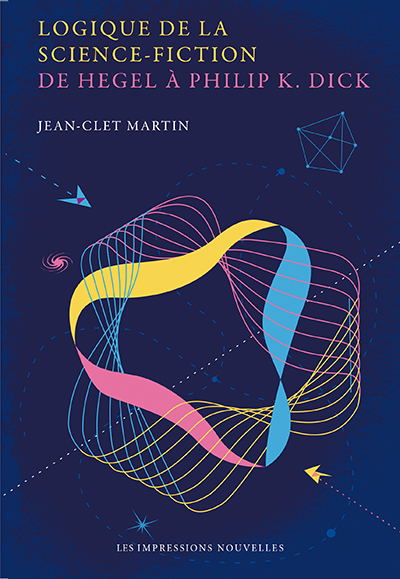
Mais avant de poursuivre plus loin dans la trace de cet Hegel cosmonaute, il faut faire quelques remarques sur le genre de l’essai, et dégager, peut-être, une tradition à laquelle pourrait appartenir la pratique métaphysique de l’hétéroclite qui, anoblissant les modes nouveaux de pensée, produit du savoir dynamique : une méthode du mouvement. Plutôt que de parler immédiatement de « science-fiction », Jean-Clet Martin convoque d’abord l’idée de « science spéculative », explicitement distinguée du champ du merveilleux 9. Ce n’est ni de la magie ni une inquiétante étrangeté, mais de la science spéculant sur les limites du réel, sur sa conception, sur sa phénoménologie. « Elle emprunte ses modèles à la science, à la philosophie pour témoigner d’une vie possible. Elle est une expérience de la limite, des confins proposant aux concepts philosophiques des espaces et des durées jamais abordés dans l‘ordre de la chronologie. » 10 On connaît les contes philosophiques qui seraient une sorte de « philosophie spéculative » ; en face, il y aurait une littérature des « sciences spéculatives ». D’ailleurs, peut-être que les deux ne sont pas si éloignées, grâce à ce rapprochement entre Hegel-cosmonaute et un K. Dick-philosophe, dont le rapprochement semble simplement obéir lois de la gravitation épistémologique.
Rapide travelling tournoyant sur le genre de l’essai
Certains essais font date et deviennent des outils utilisés ou des perspectives suivies par les générations suivantes ; comme cela put être le cas en sémiologie pour le Σεμειωτικήμ, Recherches pour une sémanalyse 11, publié par la sémiologue Julia Kristeva. Depuis lors, au moins tous les étudiants de Lettres Modernes connaissent et pratiquent le concept de l’intertextualité 12. Cette intertextualité que la lecture conjointe de la science-fiction et de Hegel donne pour une évidence ombilicale, selon une image vraiment élégante déployée par l’auteur : « Qu’il y ait un lien ombilical nouant tous ces « uni/vers », tous ces uns, cela ne fait aucun doute. Il s’agit d’une continuité entre les mondes qui est réalisée par des couloirs, des ascenseurs assez extraordinaires, minces passerelles qui font la beauté de chaque aventure conceptuelle, de chaque voyage fictif. » 13 Paul Ricœur forgea un outil aux répercussions semblables en philosophie, lorsqu’il modélisa la question de l’altérité dynamique à partir du concept double de l’ipse et l’idem14. L’observation attentive de la part mobile de l’individu, l’ipséité, permet à l’herméneutique de produire une analyse véritable de tout objet ou sujet — il est question d’individus comme de récits et, notamment, de mythe. La mêmeté, en revanche, contient tous ses caractères immobiles qui structurent l’identification du même. N’est-ce pas le rêve, cet espace qui, à la fois, cultive, mélange et pervertit la covalence entre ipséité et mêmeté ? Que peut-il arriver en cas d’échec de la balance équilibrant l’ipséité et la mêmeté ? Jean-Clet Martin l’évoque indirectement, lorsqu’il cite le maître de la ville de Providence, dans l’œuvre duquel le rêve est l’un de ces espace qui nie tout espoir de mêmeté. Lovecraft réduit ou condamne ses personnages à la folie, les vouant à regarder leur intelligence se briser sur l’inintelligibilité radicale d’un environnement non-euclidien — même pas hostile : monstrueusement indifférent.
« Ce monde monstrueux, précurseur du siècle à venir, a quelque chose d’un rêve, celui que nous évoquions dans le sillage de Lovecraft. Ainsi « dans les rêves les plus profonds (…) Gilman sentait que les abîmes crépusculaires autour de lui étaient ceux de la quatrième dimension. Ces entités organiques dont les mouvements paraissaient moins manifestement aberrants devaient être des projections de formes vivantes (…). Quant aux autres [formes] il n’osait pas même s’interroger sur ce qu’elles pouvaient être dans la ou les sphères dimensionnelles auxquelles elles appartenaient. Deux des êtres mouvants les moins déroutants — un assez agrégat de bulles irridescentes plus ou moins sphériques et un polyèdre beaucoup plus petit aux couleurs inconnues et dont les angles changeaient à vue d’œil — semblaient remarquer sa présence, le suivant ou flottant devant lui tandis qu’il évoluait parmi les prismes gigantesques, les labyrinthes, les grappes de cubes et de plans, les constructions cyclopéennes. » (Lovecraft, La Maison de la sorcière, page 471) Quel texte ! Nul doute que la Logique de Hegel soit une de ces constructions cyclopéennes, un labyrinthe dans lequel se croisent des formes par degrés, selon des quantas différents et des qualités innombrables. » 15
D’autres essais se caractérisent par l’apparent chaos qui compose leur objet et par l’ordre qu’ils nomment dans une succession de potentialité, l’intelligibilité qu’ils organisent à partir de rien, dans des dimensions épistémologiques jusque là insaisissables ou confuses. Ainsi du travail de Tzvetan Todorov, paru en 1970 : Introduction à la littérature fantastique16. L’auteur y propose une définition décisive de la littérature fantastique : un texte vaut dans le registre fantastique lorsque son récit oscille incessamment entre merveilleux explicite et réalisme rationnel sans que l’on puisse cantonner le registre à un seul monde. Toute fiction dont on ne saurait définir clairement les limites du pacte de lecture (et notamment l’ampleur de la fameuse formule de la « suspension volontaire de la crédulité »), jouant avec les limites du merveilleux, comme Le Horla, de Maupassant, appartient du domaine du fantastique tel que le définit Todorov. On voit bien comme la science-fiction échappe à ce dualisme générique et, dans le même mouvement, complexifie la problématique qui était à l’origine de son énoncé.
Répondre à l’angoisse par la revitalisation du rêve
Notre époque, dont on débat pour savoir s’il s’agit encore de la modernité, si elle appartient à la post-modernité, voire à l’hyper-modernité — d’autres parlent d’une antimodernité —, est caractérisée par l’angoisse. Comme beaucoup d’époques, la nôtre s’affirme par son économie de l’anxiété, et, en témoignaient déjà les littératures apocalyptiques juives de l’antiquité, l’eschatologie chrétienne médiévale et les interminables fins du monde17 qui essaiment depuis lors, nous ne cessons pas de déployer, consommer et renouveler des dialectiques de la vie et de la survie afin de lutter contre cette angoisse.
Hegel comme la science-fiction, dont Jean-Clet Martin propose le pacte d’une similarité empirique, produisent des pressurisations, construisent des espaces de gravité artificiellement exagérée, suffocante, et intensifient l’angoisse dont la stratégie de fuite conditionne les individus et les sociétés. La lecture de l’une comme l’école de l’autre sont des expériences de la jetée radicale dans le vide, et elles confrontent la plénitude humaine au risque de l’indéfini ; l’espace dans lequel tout est phénoménologie et alphabet à déchiffrer, jeté comme un caillou dans l’eau d’une mare, et dont on attendrait qu’il apprenne à sortir en produisant à la fois le concept nécessaire et comprenne son usage. Hegel et la science-fiction, devant le manque de foi de Kant, répondent qu’il n’y a qu’à l’inventer. Aussi difficile que soit cette démarche, elle reste spéculativement possible. L’expérience de la science-fiction brutalise l’infinité de cette potentialité par des conditions extrêmes ; nul doute, avec Jean-Clet Martin, qu’un caillou de l’espace saurait sortir de cette mare prosaïquement terrestre.
« Ce n’est pas seulement l’horreur, mais l’interstice de l’être qui s’ouvre et nous force à penser dans une forme de carence, de détresse absolue. Et ce n’est pas en cela un espace comme la mer, ce n’est pas seulement l’océan tempétueux sur lequel se perd un navire. Il s’agit plutôt d’un océan d’absence. »18 La science-fiction ne se contente pas de réduire l’action de l’homme à des occasions devenues insaisissables dans cet « océan d’absence », elle exige surtout de lui qu’il dépasse tout ce dont il se pensait capable, afin d’aller dans cet au-delà de lui-même qui est le propre du surpassement et qu’il réactualise sa propre potentialité. Lorsque dans cette scène du film de Kenneth Branagh, l’astrophysicienne Jane Foster s’émerveille de trouver dans un livre de mythes nordiques une lecture qui rende intelligible les différents phénomènes qu’ils observent depuis plusieurs années, le professeur Éric Selvig, son collègue, la pousse dans ses retranchements dialectiques en réduisant cette nouvelle potentialité analytique à des mythes, à des poèmes et de la magie 19. « Well, magic’s just science that we don’t understand yet. », répond-elle. Le court dialogue qui suit va même plus loin encore dans le sens de Jean-Clet Martin puisqu’elle cite l’exemple de l’écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke — dont notre essayiste ne convoque pas moins de six livres au cours de sa réflexion — qui était également inventeur et écrivain scientifique. Il a « in some case » été « a precursor of science fact », concède de mauvaise grâce le Dr Selvig. En somme, les écrivains de science-fiction se projettent dans l’avenir, par le biais de l’anticipation technologique, mais ils peuvent aussi résoudre des énigmes et impasses scientifiques en mêlant l’imagination (la poésie) à la rationalité scientifique. Et s’ils ne résolvent pas scientifiquement les problèmes, ils ouvrent des voies à partir de la pluridisciplinarité des ressources.
Défendre la science-fiction et Hegel, c’est, semble-t-il, les défendre de la « sécheresse » anti-poétique de Kant. Son « argument […] contre la métaphysique est un peu sec », nous dit Jean-Clet Martin. Les voyages silencieux entre les planètes forcent à l’instinct contemplatif, dont ne sont jamais très loin ni la rêverie ni la spéculation. L’essai pourrait même se lire comme plaidoyer contre une trop grande rigueur d’époque, confinant au refus d’une épistémologie poétique qui soit sérieuse et intellectuellement opérationnelle. Ce rejet de toute autre intelligence que mathématique et logique serait propre à la méthode kantienne, délaissant toute imagination, et jusqu’au rêve lui-même20. « Par une approche si peu spéculative que celle de Kant, toute possibilité fictive se voit contester sa forme surprenante, réduite au constat d’existence le plus prosaïque […]. On dirait que Kant ne connaît que le caractère mécanique de l’existence réduite à son poids et qu’il ignore tout des rêves de collection qui s’y associent, de l’image qui s’y imprime, de la valeur ajoutée par la dimension symbolique […]. » 21
Naturellement, pour rêver, il faut dormir. Quoi de mieux que les longs sommeils des cryogénies interstellaires ? Ces grands espaces d’inconscient laissé libre, dans lequel chaque individu rêve et attend l’heure de sa destination en voyageant à des vitesses merveilleuses, sont des mesures, des étalons stables qui permettent à l’homme de ne pas se dissoudre dans l’immensité du vide de l’univers. Dans le rêve, les dormeurs attendent un espace, et le temps n’est plus qu’une relativité ontogénétique : le temps d’un rêve, le temps de deux rêves, etc. Bien sûr, le rêve altère et déforme, mais ce sont encore des repères qui demeurent dans une mêmeté relative, relative mais efficiente — et rassurante.
Dieu lui-même (ou le monolithe dans 2001 l’Odyssée de l’Espace, qui, contrairement à l’inconscient, est un miroir du néant, une ponctuation morbide de la narration filmique) est tellement inassimilable qu’il en devient force d’aliénation. « On pourrait penser alors qu’avant tout conflit, tout combat, ce monolithe vaut comme « être pur », mais sans propriété remarquable en s’annonçant dans le réel en une neutralité inassimilable, quelque chose de si indifférent qu’il n’est pas loin de fusionner avec le néant, de creuser un effacement dans tout ce qui va le toucher et qu’il force à la réflexion, à se réfléchir et, par là, à réfléchir. Alors la négation s’empare des hommes qui le contemplent et en assimilent le pouvoir de destruction. » 22
La carte n’est pas le territoire
Que trouverait-on contre cette destruction qui gagnerait le voyageur, contemplatif mais sans rêverie ? Hegel et la science-fiction. Cette dernière avantageusement hissée parmi les romans allégoriques. Tout signe s’y fait l’occasion d’une épreuve du sens. Qu’il s’agisse des souterrains d’un vaisseau, de l’intimité poétique qui surprend le sujet qu’elle habite, ou qu’il s’agisse d’épaisseur dans la trame du néant, d’une expérience de l’existence ou d’une tentative de « déterritorialisation » 23 vis-à-vis de l’évidence de l’existence, tout est occasion d’une revalorisation du système signifiant. Le personnage de science-fiction pourchasse jusqu’à la trace de sa propre existence — ou plus précisément l’absence, et l’absence de trace, d’existence comme de voyage intersidéral, se confond avec la trajectoire du « devenir » hégélien. Van Vogt, sans doute l’un des auteurs fondateurs de la science-fiction, reprend comme une antienne de fond la célèbre formule très performative de Korzybski, « La carte n’est pas le territoire » 24 : « Et le récit littéraire, fût-il placé dans un avenir de Hegel, offre sous le nom de la SF une histoire non-aristotélicienne, celle de l’identité confrontée à la différence, à la négation. C’est clairement le cas de Van Vogt, qui cherche un recours auprès de la logique, notamment en s’aidant de la sémantique d’Alfred Korzybski, hégélien en son genre, même s’il ne fait nulle part état de cette influence. » 25
Si la représentation n’est pas l’objet, autrement dit, si le phénomène ne se réduit pas à son intelligibilité humaine (ou, corollaire théologique, si celle-ci ne suffit pas à définir l’origine du phénomène), comment l’être humain peut-il se définir lui-même ? Si son épistémologie n’est qu’une construction toute relative, dont tout discours de vérité serait à exclure, que devient l’individu, comment peut-il construire sa propre mesure ? C’est là une des problématiques importantes de la question de l’Être (pp. 27-123) chez Hegel que Jean-Clet Martin laisse ouverte sur celle de l’Essence (pp. 127-237) et conclue ainsi : « Cette persistance de l’Être dans l’Essence constitue finalement un lent chemin de clarification presque impossible pour le lecteur, mais rendu possible par l’image, par le délire d’absolu qui habite les auteurs de science-fiction. » 26 La science-fiction, ce vecteur fictionnel spéculatif qui permet de résoudre des schémas dialectiques à l’étrangeté trop radicale, aux espaces trop absolus, vertigineux et inhumains (comment représenter l’Être dans l’Essence ?), permettrait d’envisager, par ses images et ses schèmes, les articulations d’une logique difficile d’accès. En d’autres termes, l’étrangeté radicale des mondes spéculatifs ouverts par la Logique donne des espaces dans lesquels les dynamiques de l’Absolu deviennent envisageable sous forme d’expérience : les images de la science-fiction.
« « L’art, c’est une pensée par images. » […] La poésie est un mode de pensée spécifique, à savoir un mode de pensée par images ; lequel mode engendre une certaine économie des forces mentales, « une sensation de relative facilité de l’opération », et cette économie se traduit par le sentiment esthétique. […] Potebnia et sa nombreuse école tiennent la poésie pour une forme de pensée spécifique — une pensée opérant à l’aide d’images — et considèrent que les images sont faites pour aider au groupement d’objets ou d’actions hétérogènes et à l’explication de l’inconnu par le connu. » 27
La science-fiction doit nécessairement partir du connu puis décoller, s’arrachant aux gravités terrestre, rationnelle et scientifique, qui soumettent la pensée des hommes, pour aller dans cet inconnu dont Jean-Clet Martin nous montre qu’y a la préfiguration — voire même une des sources — dans la Logique hégélienne. La science-fiction est un encouragement à l’expérience philosophique par la destruction des repères (quelle carte du ciel permettrait à un cosmonaute de rallier Jupiter ou Alpha du Centaure, et fondée sur quel socle cartographique, sur quel référentiel, sur quelle économie des distances et du temps ?). Ce faisant, l’Être n’est plus un instant figé mais un devenir 28, au contact de la science-fiction, l’Être n’est définitivement pas ou plus quantitatif mais dynamique :
« […] Hegel dirait que « non seulement une quantité peut changer, mais qu’elle doit nécessairement changer ; qu’elle n’est pas une limite qui est, mais une limite qui devient. C’est ce devenir qui amène d’abord le progrès de la fausse infinité quantitative. » Elle est fausse parce que ne réussit pas à se départir d’elle-même et changer de métrique. Sous ce rapport […] Hegel cherche à sortir de la constance numérique. Il abandonne la monotonie pour retrouver, sous sa stabilité apparente, non pas la durée, mais le devenir entraînant la quantité dans une dialectique nouvelle, lui imposant des requalifications qu’elle croyait dépassées. S’introduit donc une bifurcation entre le réel et le possible. Les seuils de l’être, la ventilation des mondes seront du même coup différentiels , de sorte qu’on ne saurait changer d’espace sans sauter vers des formes nouvelles, traverser des cadres inédits, des puissances irréductibles. » 29
En somme, les environnements parfaitement expérimentaux de la science-fiction, et leurs conditions extrêmes qui n’ont que l’imagination pour limite, convertissent la problématique immobile de l’Être en expérience mobile du devenir. « Devenir » dont Jean-Clet Martin propose de reconnaître la puissance, poétique, métaphysique aussi, contre la certitude de ce que l’on peut expérimenter avec Kant. Ce devenir, cet exercice d’une science-fiction allégorique, ou d’une fiction spéculative à partir de la science, ne peut s’envisager que dans l’absence, non dans la perte, ni dans la dissolution mais bien dans l’absence radicale et primordiale des repères de l’existence ; c’est-à-dire dans l’expérience du vide de l’espace. Par la démarche esthétique du plongeon fictionnel, à laquelle s’adonne spontanément tout lecteur qui lit un roman, la science-fiction semble offrir une épreuve directe au cœur dialectique de la Logique de Hegel.
« Nous voici dans un monde d’avant l’espace et le temps, dans un monde où se déroule une tout autre expérience… un devenir qui est autant une forte dérive. Et ce devenir est non seulement l’unité de l’être et du néant, « mais leur unité essentiellement mobile », unité qui se nie en retombant dans l’essence la plus noire pour en extraire un trajet, une dérive. Sur le sombre fond luit un trait presque indistinct : une errance, la ligne d’une trajectoire, un arrachement mutuel du clair et de l’obscur, leur différenciation. Et c’est une nouvelle figure qui advient sous un tel rapport, une forme que Hegel va nommer « existence » ou « être là ». » 30
Ainsi que l’on traverserait le centre d’une planète, comme dans les premières science-fiction de Jules Verne, l’expérience spéculative permet l’émergence d’une nouvelle intelligibilité du phénomène qui ne laisse pas de trace dans son voyage, qui est sans historicité, dans le vide du néant interstellaire, interplanétaire, une nouvelle « figure », nous dit Jean-Clet Martin, qui est cette existence dont la certitude (la cartographie) est rendue problématique.
L’expérience de l’insoutenable pour connaître
La carte permet l’historicité du trajet. À tel instant, nous étions ici sur la représentation que nous avons du chemin parcouru, ou, tout à l’heure, nous serons là, à l’endroit auquel correspond ce pixel précis de la virtualisation du territoire. Les modules GPS très contemporains peuvent même enregistrer tous nos déplacements, utilisant le référent certes virtuel mais fonctionnel d’une carte qui sert de consensus géographique. Le voyage d’une planète l’autre, mais aussi depuis une planète vers l’espace, sans nécessairement de destination connue, ne convoque ni les mêmes angoisses ni le même héroïsme que le voyage sur la surface — même inconnue — d’une seule planète.
« [D]e telles conditions [de voyage] sont rarement envisagées par la littérature de voyage parce qu’on séjourne ici dans un monde sans destination, dont aucune coordonnée ne répond aux paramètres déjà constitués en notre corps, en nos sensations. Ce n’est pas seulement l’horreur, mais l’interstice de l’être qui s’ouvre et nous force à penser dans une forme de carence, de détresse absolue. Et ce n’est pas en cela un espace comme la mer, ce n’est pas seulement l’océan tempétueux sur lequel se perd un navire. Il s’agit plutôt d’un océan d’absence. »31
Le voyage d’un point A vers un point B, en effet, peut être dangereux, il n’empêche que la destination est une certitude, un repère à quoi l’individu peut se mesurer, et à partir duquel évaluer la relativité du temps, la proportion d’espace qu’il demeure à franchir, tout cela fonctionnant même dans l’échec du voyage. L’existence philosophique, ou héroïque, se trouve à bord d’une fusée plutôt que dans l’antique navire odysséen, du point de vue de la Logique hégélienne ; car les roulis de la Méditerranée, c’est-à-dire d’une mer parfaitement cartographiée, « ronflent » du souffle ordinaire du réel et rien ne vient troubler son rythme. « Quand s’installe le ronflement continu du quotidien, une fissure vient rompre le charme, et le « périr » remonte soudainement dans la gorge de celui qui se croyait sauf. Pour tenter de rétablir le lien avec la terre, réparer l’antenne en panne, l’astronome philosophe doit chaque fois ressortir de l’aéronef, mais sans se laisser aller aux certitudes de l’existence : « doucement, il fallait aller doucement, ne jamais se hâter. S’arrêter et réfléchir : telles étaient les règles de sécurité dans l’espace. » 32 Quelques lignes plus loin, Jean-Clet Martin synthétise : « Cette existence ralentie de l’attention n’est évidemment guère que celle de la Logique, par lequel tout commence dans le noir, se regroupe sous la figure que Hegel nomme « Qualité », nous rendant « attentifs » à l’aspect qualitatif de l’être et de l’existence que le devenir déloge en effet de toute sécurité. » 33
On dit volontiers que le marin est forgé par la mer, son caractère, son physique même, portent la marque d’un compagnonnage titanesque, celui de la mer — ou de l’océan. Dans l’espace, l’homme intègre en lui l’immensité de l’infini spatial et n’a pas d’autre choix que de s’y mesurer : ni parfum spécifique ni quête nourricière, simplement la vie en cellule et l’horizon vide derrière un hublot. L’individu, en tant qu’il est une unité finie de conscience, enfle d’une angoisse terrible à la soudaine perception de l’infini comme réalité véritable et non plus comme objet spéculatif ou théologique. Un face à face avec Dieu. Dans tout ce qu’il a d’inconnu et d’immense et, surtout, nous l’avons déjà lu, d’indéfinissable, ni comme début, ni comme fin, ni radicalement, ni comme expérience simplement possible pour l’individu fini. L’astronaute en liberté dans l’espace, c’est l’unité finie dans l’infini. Il s’y trouve pulvérisé s’il n’a pas une tâche spécifique et intense à y réaliser (réparer, par exemple) ; il est sans signification s’il ne peut produire de justification de sa présence hors de l’habitacle, alors être coïncide de nouveau avec l’acte à venir. C’est la nécessité aristotélicienne de l’être.
L’infini qui s’ouvre à la perception, ou à son incapacité, c’est l’infini dans le fini et c’est là que l’individu est écartelé en milliards de parcelles dans ce vide ; il se dissout. Cette intrication produit l’activité d’un principe réciproque de modulations intelligibles ; l’un et l’autre se déployant mutuellement en l’un et l’autre. « Au lieu de les prendre chacun en soi, indépendamment de l’autre, le fini et l’infini se relativisent au bénéfice d’une Idée qui les fera davantage varier l’un par rapport à l’autre, laissant exploser les cadres de la mesure. Cette manière de repenser le rapport du fini et de l’infini, certes complexe, en appelle au dispositif de la SF, pour lui donner corps. Elle désigne peut-être ce que Hegel nomme idéalisme. Mais l’idéalisme n’est qu’une autre lecture du réel, une plongée dans la réalité qui en refuse la limitation. » 34 Puis quelques lignes plus loin : « Ce pourquoi celle-ci [l’idéalisation] déplace en effet toute limite dans l’ouverture de l’infini mais réintègre également l’infini dans la contraction d’une unité. Fini et infini se mêlent. » 35
Mais l’infini, c’est surtout l’occasion de traverser l’angoisse du temps, qui, pour l’homme du moins, l’individu ou sa société, est parfaitement fini :
« Sur la pente d’un temps devenu fou, décliné en accordéon, la science-fiction aborde plusieurs manières de traverser l’infini. Il s’agit parfois d’un infini étalé : une surface faite d’événements plus intéressants que d’autres, de pics surplombant l’obscurité, émergeant comme certaines falaises visibles de loin. Il est question alors de sauter de crête en crête, comme si le temps faisait des vagues et que le voyage recoupait leur sommet en ligne droite, de façon stroboscopique. Alors, par un tel survol, on entrerait soit dans une espèce de patchwork, dans un cubisme informel que le héros rencontre comme autant d’épisodes décousus 36, passant d’un monde à l’autre un peu comme on pourra le voir peut-être dans la BD, où il nous faut sauter les cadres et les marges, les « entre-images ». Soit, au contraire, on dévale de manière continue la pente du temps en gagnant l’infinité dans le fini par une vitesse relativiste. S’ouvrent alors des gouffres qui sont comme des portes temporelles, des trouées dynamiques. Les deux tendances constituent une alternative en laquelle la SF se clive, suivant des concessions de l’éternité qui hésitent, indécises entre le chaos nietzschéen, fait d’instantanés, ou le concept hégélien fait de cycles — et la SF procède régulièrement par cycles comme sa formule la plus prometteuse. » 37
Ces différentes voies de traversée temporelle, de sa problématique ou des limites de sa problématisation, ces différentes méthodes interrogent la question du temps. Elles permettent d’envisager en images ce qui constitue la réalité du temps. La science-fiction souligne ici une évidence existentielle, et brise du même mouvement la facilité avec laquelle tout un chacun l’admet, la familiarité que l’on peut avoir avec la notion de temps qui passe.
Le concept comme fin, l’expérience comme reliquat
La fiction spéculative, conformément à l’ambition hégélienne de la Logique, spécule : sur les dynamismes qui doivent présider à l’Être (au devenir) ; sur les limites de la seule raison (le refus de la sèche dialectique kantienne, qui bannit le rêve et l’imagination) ; sur l’expérience de l’univers pour se définir comme singularité (que seul le trou noir empêche, bouche avide qui engloutit tout) ; sur les mécanismes conflictuels de l’existence (lesquels deviennent des occasions de construction, par la résolution dans la poésie), mais aussi sur les systèmes entiers d’expérience et de représentation (la carte n’étant pas le territoire). Dans le « vaste palais issu d’un rêve géant dont les chambres sont sans fin et les terrasses capables de recevoir des monstres ailés ou des barbares incompréhensibles » 38 de la science-fiction, devant ce maelström qui détruit tout repère, avec une indifférence qui ajoute à la puissance du processus, on peut penser au mot du personnage de Matrix, Morpheus, lorsqu’il accueille pour la première fois Néo dans une démonstration de la Matrice, qui n’est encore qu’une illusion intermédiaire, mais qui constitue une étape nécessaire pour la réalisation du voyage, pour préserver l’esprit de son propre éclatement, lui éviter de finir comme les personnages de Lovecraft, éduquant Néo à son propre déplacement épistémologique et, en même temps, ontologique : « Welcome to the desert of the real. » 39
Il en va de cette pédagogie comme de celles des auteurs de science-fiction qui deviennent des passerelles pour leurs lecteurs vers une connaissance de l’instinct scientifique40, si tant qu’il y en ait un qui survive à la confrontation du vide ; si tant est, là encore, que le désert du réel présenté à Néo par Morpheus soit le réel ultime, au-dessus duquel il n’en existerait aucun. Quelques pages plus loin, l’auteur évoque l’atomisme, alors objet de spéculation, que la science dure, la physique, donnera bientôt pour vérité physique ou plutôt pour représentation véritable et juste du phénomène à l’œuvre. Les spéculations sur la science sont autant de modélisations possibles d’une spéculation sur l’existence : par exemple, la métaphysique de l’être se libère au contact poreux de la physique quantique 41. L’essayiste condense ainsi la conception hégélienne des quantités, premier objet scientifique : « Hegel, en ce sens, considère que la quantité est un universel, quelque chose dont les unités restent bien des unités malgré une modification d’échelle, malgré une variation dans la grandeur ou dans la géométrie traversée. D’où le sentiment d’une indifférence absolue par-delà les gouffres de l’espace, quand bien même n’y régneraient que des différences de quantité et que les différences qualitatives deviendraient incompréhensibles. » 42
Aujourd’hui, on rapprocherait volontiers la méthodologie spéculative de l’atomisme hégélien de la physique quantique. Cette dernière fascine la philosophie et inspire des modélisations inédites. Une sorte de philosophie-fiction poétise un réel scientifique, et, précédant/anticipant la modélisation véridique scientifique, elle engendre de véritables structures de sens, dès lors fortes de leurs logiques intrinsèques. Si elles sont éliminées par les physiciens ou les astrophysiciens, ces représentations permettent toutefois de rendre moins inaccessibles des concepts extrêmement abstraits. Ce qui est une erreur du point de vue de la rigueur de Kant n’en demeure pas moins une source de progrès. « L’atome fabrique son unité dans le rejet des espaces infinis. L’atomisme « réside dans la notion même de l’Un ; mais ce qui rassemble les Uns ce n’est pas (…) l’attraction, c’est le hasard, c’est-à-dire un principe irrationnel ». Et cet entrechoquement des unités et cette guerre ne sont pas seulement effectives au niveau des mathématiques. Ni même au niveau des atomes de la physique qui, pour le moins, se magnétisent en proportion de leur rejet, trouvant ainsi un équilibre. Entre les nombres, tassés chacun sur soi, entre les atomes, règnent le vide et la belligérance de sorte que, « dans les temps modernes, l’atomisme a acquis une bien plus grande importance dans les sciences politiques que dans la physique » 43 ; preuve, s’il en fallait, de la pertinence de la spéculation fictionnelle comme virtualité, comme puissance d’intelligibilité.
Or c’est peut-être là le sens fondamental, s’il devait n’y en avoir qu’un, que Jean-Clet Martin nous invite à trouver dans l’intrication de la science-fiction et de la Logique de Hegel. Si la seconde semble appartenir à la généalogie de la première, la première va nettement plus loin que les seuls champs ouverts par la Logique et, se l’appropriant comme méthode, transforme en nouvelle habitude le fait de déborder l’intelligibilité naturelle de son environnement par l’homme. Comme rendant à la philosophie ce qu’elle empruntait d’abord à Hegel, une paternité mais aussi une inspiration, un souffle, il semble bien que la science-fiction soit largement prête à se faire source de philosophie, mais aussi à proposer une figure méthodologique pour envisager cette nouvelle épistémologie ; une épistémologie qui prendrait la fiction au sérieux, comme Deleuze l’a généralisé avec le roman proustien en particulier mais avec le roman en général. « L’image se mue ici en matière et la matière en image. Elle ouvre le labyrinthe dans lequel on peut plonger et voyager pour y découvrir des mondes inédits, des synthèses et des syllogismes numériques qui ne ressemblent plus au Livre, à la bibliothèque comme c’est encore le cas du diamant de Stross, capable de consigner tous les événements de manière finalement statique. » 44
La Logique n’est plus tant un livre qu’une bibliothèque, qu’une perspective épistémologique d’où jaillit une intention, celle du débordement. Cela répond sans doute à ce terrible hubris dont le châtiment condamne le titan à voir son foie dévoré chaque jour. Cette ivresse du « délire » de l’auteur de science-fiction, c’est un peu celle de Prométhée, celle de toutes les figures émancipatrices de l’homme, qu’il s’agisse du dépassement de la nature, des espaces, comme de la nature humaine.
« La science-fiction, dans son récit, connaît ainsi un enrichissement incomparable. Elle trace l’histoire fragmentée d’une multiplicité dynamique, le panorama inépuisable de cosmos qui n’entrent pas dans un cadre sans le déborder de partout. Et, dans un tel cadre, naît une vie qui s’élève de degré en degré vers une libération, une liberté qui se veut esprit. « Je sens en moi (reconnaissait Hölderlin dont Hegel s’est évidemment inspiré) une vie qu’aucun Dieu n’a créée ni aucun autre mortel engendrée. Je crois que nous sommes par nous-mêmes et que c’est seulement par libre délectation que nous sommes si intimement lié au tout. » (Hyperion, Vol. II, Stuttgart, 1822, p. 149 ; ici Jean-Clet Martin fait un rapprochement avec le discours final de l’androïde du premier Blade Runner, 1982) » 45
- Chaque trimestre, plusieurs films sont projetés sur les écrans à propos de l’espace, la colonisation, les voyages, l’affrontement extra-terrestre, et parmi eux, on compte notamment Interstellar pour l’année 2014, réalisé par Christopher Nolan avec l’incroyable performance de Matthew McConaughey ; la trilogie de la dernière interprétation de Star Trek, dont les trois opus réalisés par J. J. Abrams sont respectivement parus en 2009, 2013 et 2016 ; les nouveaux films de l’univers Star-Wars, avec l’Épisode VII, réalisé par J.J. Abrams sorti en 2015, l’Épisode VIII de Rian Johnson en 2017 et Rogue One de Gareth Edwards sorti en 2016 ; Ridley Scott quant à lui a réalisé Seul sur Mars en 2015, Alien : Covenant en 2017, qui est le sixième opus d’une série de films sur les xénomorphes les plus célèbres de la galaxie, suite directe de Prometheus paru en 2012 ; James Cameron réalisait Avatar en 2009, qui est un film sur la colonisation d’une planète lointaine ; en 2013, Gavin Hood réalise l’adaptation cinématographique du roman La stratégie Ender, que Jean-Clet Martin évoque, page 142. La littérature contemporaine et les séries ne sont pas en reste. Il y a objectivement une explosion de la quête dans l’espace — notons que nous avons sélectionné un échantillon de films de voyages dans l’espace qui ne forme qu’une partie, qu’une catégorie spécifique de la science-fiction. Notons simplement que ce choix écarte des films comme la trilogie Matrix, qui, pourtant, est une pure speculative fiction cinématographique, et peut-être parmi les plus efficaces qui soient.
- Jean-Clet Martin, Logique de la Science-Fiction, de Hegel à Philip K. Dick, page 335, éditions Les impressions nouvelles, 2017.
- Le sous-titre La mesure occupe les pages 114 à 121.
- La table des matières fonctionne selon le modèle d’une cartographie des systèmes, et chacun donne lieu à sa propre économie orbitale. Par exemple, pour Le Concept (pp. 241-325) on donne les sous-titres La notion, Jugement, La chose, La vie, De la matière à l’Idée, Infinité et L’Idée absolue. Il en va ainsi de chaque chapitre, et chaque sous-titre est découpé en occurrences textuelles et thématiques.
- « Il n’est pas sûr que l’on gagnerait quelque chose sur la voie du commentaire, dont la bibliographie est sans doute déjà excellente, fort épaisse par ailleurs », Jean-Clet Martin, op. cit., page 131.
- Ibid, page 217.
- Ibid, page 32.
- Ibid, pp. 8-9.
- Peut-être que l’auteur confond à ce propos le terme anglophone et le terme français dont les usages sur la distinction générique entre merveilleux et fantastique varient légèrement d’une langue à l’autre. « Une telle appellation montre en tout cas que cette fiction ne relève pas du genre « fantastique » qui tend aujourd’hui à la recouvrir, dans la veine de Tolkien. Le fantastique, c’est de l’iréel, du prodigieux. »Ibid, page 16. Le genre de l’héroïque fantasy recouvre en effet cette définition et émane de toute la littérature de fan-fiction, et d’auteurs véritables, qui se sont inscrits par la suite dans le sillage de Tolkien. Le merveilleux, en revanche, correspond exactement à la définition dont Jean-Clet Martin veut distinguer, à fort juste titre, le genre de la speculative fiction.
- Jean-Clet Martin, op. cit., page 17.
- Éditions du Seuil, 1969.
- Le dictionnaire du littéraire donne les pages 392 et 393 à la définition de l’intertextualité et la résume ainsi : « Au sens strict, on appelle intertextualité le processus constant et peut-être infini de transfert de matériaux textuels à l’intérieur de l’ensemble des discours. Dans cette perspective, tout texte peut se lire comme étant à la jonction d’autres énoncés, des liens que la lecture et l’analyse peuvent construire ou déconstruire à l’envi. En un sens plus usuel, intertextualité désigne les cas manifestes de liaison d’un texte avec d’autres. », Le dictionnaire du littéraire, p. 392, ouvrage collectif sous la direction de Paul Aron, Denis Saint-Jacques et Alain Viala, collection Quadrige, éditions Presse Universitaire de France, 2e édition, 2012, Paris.
- Jean-Clet Martin, op. cit., page 117.
- Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, éditions du Seuil, 1996, Paris.
- Jean-Clet Martin, op. cit., page 112.
- Paru aux éditions du Seuil, la dernière réédition de l’essai, aux Seuil toujours, date de 2015.
- Titre d’un remarquable ouvrage écrit par David Hamidovic, paru aux éditions du Cerf en 2016, Paris.
- Jean-Clet Martin, op. cit., page 37.
- « I’m taking about science, not magic ! », 1h01’, Thor, Kenneth Branagh, 2011.
- L’œuvre de Neil Gaiman s’articule pourtant autour et à partir du rêve, et notamment son roman graphique, Sandman, en sept tomes plus un prequel, ouvre encore une nouvelle brèche dans la métaphysique de l’esthétique, en joignant aux schèmes désormais canoniques de la science-fiction une variation tirée des mythes, des déplacements et des connexions oniriques, faisant un usage absolument novateur et « délirant » (pour reprendre le mot de Jean-Clet Martin) des capacités graphiques d’une simple narration dessinée. Sans rien d’autre que de la couleur et du papier, l’auteur et les dessinateurs qui travaillent avec lui font éclater la limite physique du support qui relate l’histoire du sandman, le marchand de sable ou Morphée, Morpheus, etc. Son œuvre rappelle à bien des égards la singularité esthétique et narrative de Lovecraft.
- Jean-Clet Martin, op. cit., page 47.
- Jean-Clet Martin, Ibid., page 63.
- Sur le plan de l’expérience esthétique et philosophique, Viktor Chklovsky parlera de « défamiliarisation » dans un article de 1917 devenu absolument fondateur de toute une esthétique, L’art comme procédé, intégré à un corpus plus large réuni sous le titre Sur la théorie de la prose, 1929, traduit du russe par Guy Verret, éditions L’Âge d’Homme, 1973, Lausanne. L’article L’art comme procédé couvre les pages 9 à 28, et le développement du concept de défamiliarisation en propre commence page 20. Nous proposons, sur le plan radical du territoire, qui est un enjeu de la science-fiction
- À ce sujet, la note 17 de la page 142 : « […] Van Vogt s’inspire de Une carte n’est pas le territoire de Korzybski, créateur de la sémantique générale, et dont la lecture anti-aristotélicienne rivalise avec la Logique de Hegel. », Jean-Clet Martin, op. cit.
- Ibid, pp. 148-149.
- Ibid, page 123.
- Viktor Chklovsky, Sur la théorie de la prose, 1929, traduit du russe par Guy Verret, éditions L’Âge d’Homme, page 9, 1973, Lausanne.
- Il faudrait considérer à cet égard, outre l’explosion esthétique des genres de la science-fiction, la poétique du devenir dont les témoignages littéraires français, au moins, se multiplient depuis les années 2010.
- Jean-Clet Martin, op. cit., page 108.
- Ibid, page 73.
- Ibid, page 37.
- Ibid, page 75.
- Ibid, page 75.
- Ibid, pp. 87-88.
- Ibid, page 88.
- Il faut lire à ce titre l’évocation précieuse de la figure des cinq dimensions qu’est le cube en mouvement, le tesseract mis à l’honneur par le film Interstellar de Christopher Nolan, 2014, mais également par les Comics de Marvel, adaptés au cinéma depuis 2008, univers de fiction où le tesseract joue comme un fil rouge entre les différents héros et dont on découvre au fil des opus qu’il est une des pierres d’infinité qui sous-tendent l’énergie de l’univers. Jean-Clet Martin évoque explicitement le tesseract page 130, et y fait allusion plusieurs fois par la suite, dont ici.
- Ibid, pp. 300-301.
- Ibid, page 130. L’auteur cite ici un essai de Stirling publié en 1865, essai sur la pensée de Hegel et publié à Edinburgh. Nous noterons la grande proximité entre cette description et l’œuvre toute entière de Lovecraft.
- L’auteur utilise d’ailleurs l’expression de maelström pour évoquer l’infini comme désolation de l’existence et comme dissolution de l’Être sans paraître, sans empreinte : « Peut-on dans un tel maelström parier sur une essence ? Quels rapports l’être va-t-il entretenir avec l’idestité et la différence, ou encore avec l’indifférence qui annule, neutralise toute autre distinction ? », Ibid, page 140.
- Une intelligence de la science, comme il existe pour les théologiens une intelligence de la foi qui nécessite un enseignement et une méthode.
- Jean-Clet Martin, op. cit., pp. 93-96.
- Ibid, page 101.
- Ibid, page 94.
- Ibid, page 332.
- Ibid, pp. 334-335.








