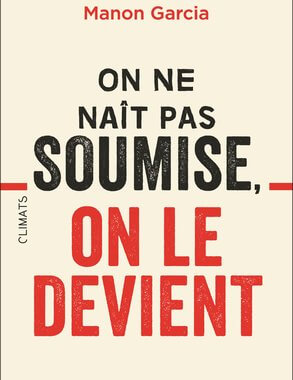Manon Garcia a fait paraître récemment, chez Flammarion (collection « Climats »), On ne naît pas soumise, on le devient[1], un ouvrage consacré à l’étude de « la soumission des femmes dans les rapports interindividuels entre hommes et femmes dans les sociétés occidentales » (p. 27). On y apprend, pêle-mêle, que « les femmes sont d’abord des objets » (p. 181), que les glandes mammaires n’ont pas d’intérêt pour elles (p. 167), que la puberté est une « aliénation » (p. 186) et que la femme ménopausée « coïncide avec elle-même » (p. 173). Manon Garcia explique en détail pourquoi les femmes blanches ne sont pas solidaires des femmes noires, pourquoi en général les femmes « n’ont pas […] même l’idée de s’exprimer » (p. 117) et quelle mystérieuse diablerie pousse « même les femmes les plus indépendantes et les plus féministes » à préférer parfois « des tâches ménagères […] à des activités essentiellement plus épanouissantes » (p. 11) !
Un neuroendocrinologue réputé, Jacques Balthazart, auteur de plus de 450 articles publiés dans les plus grandes revues scientifiques, écrit à juste titre : « on naît bien femme (en partie), on ne le devient pas ! ».[2] Depuis Beauvoir nous avons découvert des « différences morphologiques et physiologiques entre les cerveaux masculins et féminins qui sous-tendent les différences comportementales entre hommes et femmes », aux niveaux sexuels et cognitifs. Ces différences comportementales, induites par l’éducation, « se construisent sur la base biologique différenciée, organisée de façon irréversible à la naissance. […] La thèse de Simone de Beauvoir est donc partiellement correcte mais elle ignore complètement la dimension biologique de la féminité. »[3]

Pour exclure la soumission féminine du domaine de la simple soumission volontaire, Garcia apparente cette dernière au sadomasochisme, qu’elle associe ensuite à la théorie freudienne, disqualifiée en raison de son naturalisme essentialisant et de son discours normatif. L’auteur postule ainsi que les relations de domination les plus courantes sont « faites d’un mélange d’actions de domination et d’actions de soumission ». L’hypothèse d’une domination réciproque et simultanée, en forme par exemple d’échanges économico-sexuels, n’est à aucun moment sérieusement envisagée. Bientôt, la soumission n’est plus seulement action, mais « situation » (p. 34) ; et la résignation remplace soudainement la possibilité d’une volonté positive d’être soumis.[4] La soumission décrite par Manon Garcia, plus qu’ambiguë, semble inconcevable : choisie et non choisie, abdication et pouvoir, source de plaisir et destinée à l’échec, individuelle mais influencée par la société, tantôt délicieuse, tantôt trompeuse, elle implique une « active passivité » (p. 203). La soumission est attitude, comportement prescrits, vécu ou expérience subjective, mais aussi condition première de tout individu (p. 222) et possibilité prétracée par la société (p. 161), enfin « situation » des femmes qui ne résistent pas à leur propre domination (p. 34).
Les hommes sont évidemment les premières victimes de violence,[5] mais selon Garcia la soumission serait davantage expérimentée par les femmes que par les hommes ! En tout cas elle l’est davantage par les « opprimés » (p. 108). Une fois le naturalisme et l’essentialisme écartés, Garcia se sert du « constructivisme social total » – et totalement délirant – de Catharine MacKinnon (« il n’y a rien de naturel » et « tout est socialement construit ») à la façon d’un repoussoir, pour mieux présenter l’existentialisme (ou constructivisme modéré) de Beauvoir comme la meilleure solution au problème du rapport « entre la soumission, la féminité et la vie ordinaire des femmes » (p. 59). Derrière les structures et les normes sociales accusées d’être la source de la soumission des femmes, ce sont au fond des hommes, et non pas les femmes, qui sont tenus pour les premiers responsables, pour ne pas dire « coupables ».[6]
Le consentement des femmes à la soumission est selon Garcia le fruit d’un « calcul coût/bénéfices dans lequel les délices de la soumission pèsent lourd face aux risques de la liberté » (p. 210). Or dans la plupart des sociétés traditionnelles du monde, les relations amoureuses et sexuelles sont entremêlées avec des rétributions ; et la différence entre mariage et prostitution n’est peut-être que de degré et non de nature.[7] Cette transaction sexuelle pourrait s’expliquer par la compétition et la sélection sexuelles (cf. François de Smet, ibid.) et plus généralement par notre nature comptable et calculatrice. Agréable comme pouvoir sur l’homme, la soumission est selon Manon Garcia désagréable comme abdication devant lui : la femme n’y consent jamais « de gaité de cœur » (p. 205), mais toujours uniquement en raison de conditions économiques, sociales et politiques ! Même le pouvoir sur l’homme que la soumission confère aux femmes est réduit à un instrument au service de la domination masculine (p. 193). En réalité, les hommes sont attirés par les femmes belles non seulement parce que la beauté est un indice de bonne santé, de fertilité, mais aussi parce qu’elle est devenue pour cette raison un critère recherché en lui-même pour en avantager la progéniture (« attractivité de l’attractivité », au service de la sélection sexuelle)[8] ! La dynamique qui fait de la femme un trophée pour l’homme est certes un motif culturel, mais ce motif semble répondre aux attentes de la nature.
Soumission ou stratégie adaptative ?
Pour Manon Garcia, les femmes qui se maquillent disparaissent comme sujet (p. 193). Pourtant il faut bien voir qu’une femme prétendument dominée comme l’est la prostituée peut se définir comme actrice de l’échange économico-sexuel, comme sujet responsable et autonome.[9] Evidemment, la volonté de se distinguer par son apparence physique conduit la femme à vivre dans une dépendance sans fin vis-à-vis du regard des hommes (p. 193). Mais si domination il y a, elle est tellement intériorisée par les hommes et femmes « qu’elle ne leur est pas apparue comme telle durant la plus grande partie de l’histoire de l’humanité » (F. de Smet, ibid.). Beaucoup de femmes n’ont sans doute pas vécu leur domination comme une oppression ou une exploitation, faute de la boite à outils conceptuelle nécessaire (valeurs d’égalité entre hommes et femmes, légitimité du désir féminin, légitimité de l’autonomie financière des femmes). Parler comme Bourdieu d’intériorisation de la domination est anachronique : la domination des femmes a précédé l’élaboration du concept de domination. Pour expliquer la forte compétition du paraître chez les femmes, il suffit peut-être de savoir que la beauté féminine est d’abord la publicité extérieure d’une femme sur sa capacité reproductive (sa position dans sa période de fécondité).[10] L’avantage des femmes de ce point de vue est que le désir des hommes est très prévisible… La raison de leur dépendance vis-à-vis du regard masculin se trouve vraisemblablement dans une évolution à la fois culturelle et naturelle.[11]

La différence de taille des gamètes mâles et femelles implique déjà une forme d’exploitation de celles-ci par celles-là, qui s’est imposée, selon Richard Dawkins (Le Gène égoïste), comme stratégie évolutionnaire payante. Les sciences naturelles nous apprennent que les femmes ont exploité cette exploitation en développant des stratégies reproductives efficaces. La prétendue domination « est le fruit d’une transaction perpétuelle et millénaire, au sein de laquelle les femmes ont joué un rôle actif, et non une domination unilatérale d’un sexe sur l’autre » (François de Smet, ibid.). Jouant sur la loi de l’offre de la demande, les femmes raréfient ainsi l’accès à l’offre[12] : « elles acceptent dès lors que… l’accès à leur sexe, devienne monnayable ». A l’origine de la « domination » masculine se trouve probablement une sélection sexuelle dans laquelle les femmes opèrent activement des choix, si exigeants que les hommes se sont reproduits… deux fois moins que les femmes[13]. Mais pour Garcia, le « schéma selon lequel « l’homme propose, la femme dispose » [… ] est un schéma inégalitaire et sexiste » (p. 241). Pour séduire une femme, dit pourtant un proverbe chinois, un homme doit gravir une montagne ; pour séduire un homme, une femme doit seulement franchir une barrière de papier. « C’est nous qui avons le pouvoir, rappelle Brigitte Lahaie : on fait ce qu’on veut d’un homme ».[14] Les femmes semblent en outre traditionnellement attirées par les hommes pourvus d’ambition.[15] Pour les impressionner et les séduire, les hommes paraissent avoir tendance à adopter des comportements à risques.[16] Si la femme qui se maquille se nie en croyant s’affirmer, que dire alors des hommes, qui prennent de tels risques ?
Trop dominées pour ignorer qu’elles choisissent de se soumettre ?
Pour expliquer le mystère d’un « consentement qui n’est pas un choix », Garcia invoque des conditions politiques, sociales et économiques résultant de la domination masculine ; le plaisir pris à la soumission ; la mauvaise foi ; le calcul coût/bénéfices ; etc. Pourtant l’auteur continue de parler de « choix », jugeant même « que ce choix n’est pas objectivement bon pour [les femmes] » et qu’il est le résultat de la domination masculine, laquelle conduit « les femmes à adapter leurs préférences » à leur situation (p. 218). Cette vision des choses paraît accorder trop d’importance aux rapports de forces comme fruits d’une oppression délibérée et organisée. Comme Paola Tabet, Beauvoir semble considérer la subjectivité féminine « comme d’emblée écrasée par l’homme » et n’envisager les sentiments amoureux des femmes « que comme une marque de leur aliénation sexuelle vis-à-vis des hommes ».[17]
Pour Manon Garcia, « seul un « oui » exprimé et consentement » (p. 241) : pourtant les femmes ne semblent avoir jamais exprimé un oui enthousiaste face à la domination masculine ! Prétendre alors qu’elles consentent à leur soumission, n’est-ce pas une nouvelle façon de les dominer ? Le naturel déconstruit revenant vite au galop, l’auteur avoue finalement que la femme se soumet parce qu’elle « choisit de ne pas être libre pour pouvoir bénéficier des privilèges de la soumission », plutôt que par incapacité de se projeter vers la liberté[18]. Sa libération apparaît possible, mais elle n’exploite pas cette possibilité : par sa « soumission complice », la femme occidentale opère « une démission de liberté ». Faisant preuve de mauvaise foi, elle commet une faute morale ! Beauvoir semble au fond valider la figure traditionnelle de la femme soumise, dont la soumission, choisie, responsable, serait une « passivité consentante ».[19] Tantôt la soumission est décrite comme un choix actif (pp. 198 et 201 à 203), tantôt comme une acceptation purement passive, qui rapproche singulièrement la femme de l’animal domestique le plus docile[20] ! Consentir à la soumission suite à un calcul sur ses coûts et ses bénéfices exige d’analyser sa propre expérience avec une certaine lucidité, que l’auteur ne moque pas. Mais comment les femmes pourraient-elles faire ce calcul si elles ne sont pas toutes dans la position privilégiée de Beauvoir, si elles n’ont pas toutes lu Le Deuxième sexe, si le propre de l’oppression est d’empêcher les opprimés d’analyser leurs expériences et, enfin, si les femmes n’ont « pas la possibilité ni même l’idée de s’exprimer » (p. 117) ? Comment la plupart des femmes peuvent-elles à la fois être incapables d’analyser leur propre expérience et être convaincues d’avoir choisi « cette soumission qui est dans leur nature sans que les hommes n’aient à les dominer »[21] ? Garcia semble finalement identifier la soumission à la situation elle-même à laquelle la femme se soumet, mais aussi à un destin et non plus seulement à ce qui est vécu comme un destin.[22]
Guerre des sexes et paranoïa
Pour Garcia, « il n’y a pas de tension dialectique dans la relation entre les sexes. Les femmes échouent à demander la reconnaissance aux hommes », donc les hommes ont peu de chances d’être « frappés par la relativité de l’altérité des femmes » (p. 152). Pourtant « les stratégies de reproduction des mâles et des femelles, constate Pascal Picq, sont soumises à des intérêts et des investissements parfois très divergents ».[23] Ne peut-on pas y voir ce que F. de Smet (ibid.) appelle « une batailles des sexes très organisée » ? Surtout, les anciennes disputes au sujet des femmes, au Moyen-âge, trouvaient l’antagonisme sexuel tout naturel. Toutes les formes de mariage et d’activité courtisane reposaient sur la rivalité. C’est le féminisme moderne qui a voulu faire la paix entre les sexes, de sorte qu’hommes et femmes se considèrent égaux. Ces controverses admettaient une contradiction entre l’amour, fondé sur l’égalité sexuelle, et le mariage, institution hiérarchique qui met fin à l’égalité sexuelle et, partant, à l’égalité de l’amour. Ce que Christopher Lasch (ibid.) appelle « la dialectique médiévale de l’amour » avait pour « prémisse centrale » l’incompatibilité de l’amour avec le mariage. Dans la querelle des femmes, « le débat stylisé sublimait la guerre, tout comme l’amour courtois sublimait le désir sexuel ».[24]
L’ouvrage de Manon Garcia prête le flanc à l’accusation de complotisme et de paranoïa. La « domination », ruineusement confondue avec « l’oppression » ou l’exploitation durant tout l’ouvrage, est conçue comme permanente (p. 87), « absolue et statique » (p. 153), ainsi qu’imposée aux femmes « en tant que femmes » (p. 18), par les hommes uniquement.[25] La soumission engagerait un pouvoir qui « n’est pas directement politique » (p. 108), donc ses ordres ne laisseraient aucune trace ! L’expérience même que les femmes font de la soumission serait « prescrite par la structure de la société » (p. 109). Les femmes seraient destinées à la soumission par les hommes « dans toutes situations » (p. 136) et « Beauvoir situe systématiquement ses expériences comme le produit de la domination des femmes par les hommes ».[26] C’est en se fondant étrangement sur la Bible, le Coran et l’Emile de Rousseau, que Garcia croit parvenir à montrer que la soumission n’est pas naturelle aux femmes[27]. N’étant plus à une pétition de principe près, l’auteur soutient que c’est pour « justifier la hiérarchie sociale entre les hommes et les femmes » que la théologie, la philosophie et littérature classique font de la soumission la nature des femmes (p. 49–50). Du reste, aujourd’hui les « normes acceptées de tout type […] sont sans doute façonnées plus directement par le féminisme, comme l’écrit Christopher Lasch, que par le vieil idéal de soumission féminine » (ibid.). Selon Manon Garcia, les hommes situent les femmes entre la nature et le semblable, ou entre la chose et l’être pleinement conscient. La définition de la féminité que donne Beauvoir est manifestement à la fois descriptive et normative, ce qui ne milite pas en faveur de sa cohérence et de sa légitimité !
Le harcèlement précède l’essence
« La force de la phénoménologie beauvoirienne » se mesure, au moins en partie, au fait que ses descriptions, selon Manon Garcia, permettent de rendre compte de l’expérience du harcèlement de rue (p. 185). Les commentaires sexualisés sur le corps de la jeune fille font de la puberté l’expérience d’une « aliénation » (p. 186). Mais qu’en est-il de toutes les jeunes filles dont le corps, par ses défauts physiques par exemple, n’est pas ou peu objet de désir masculin ? Se sentent-elles, elles aussi, dépossédées de leur corps et perdent-elles prise sur lui, donc sur leur moyen d’être dans le monde ? Il semble exagéré d’affirmer que « pour la fillette sans ruse, écrit Beauvoir, [l’homme] n’a qu’indifférence et même hostilité » (Le Deuxième sexe, t. II). Et « qu’y-a-t-il de si traumatisant, demande Peggy Sastre, à admettre qu’on puisse être, à un moment donné, un objet de désir « brut » pour autrui ? ».[28] Sauf à sacraliser et sanctuariser le sexe, un jugement de nature sexuelle et son expression, en vue d’initier une interaction sexuelle, ne sont pas nécessairement plus oppressants que tous les autres types d’interactions et de « jugements plus ou moins verbalement exprimés ».[29] Pourquoi la sociosexualité haute[30] est-elle associée au risque de harcèlement sexuel Parce qu’elle est associée « au risque que soient pris certains signaux, à tort, pour des signaux sexuels ».[31] Ainsi, le harcèlement sexuel est une affaire de marché sexuel. Complimenter le corps d’une jeune femme, est-ce vraiment, comme le soutient Beauvoir, se l’approprier et le lui voler[32] ? Pour de nombreux scientifiques, l’objectif du harcèlement n’est pas la domination (sinon il ciblerait prioritairement des individus à la sociosexualité basse), il est de « vérifier s’il y a bien moyen de copuler avec des individus qui ont l’air plutôt d’être ouverts à la chose ».[33] « Les femmes à sociosexualité haute ont le plus de risques d’être harcelées », notamment parce qu’elles sont harcelées par d’autres femmes qui les envisagent comme des concurrentes. Garcia ne se prive d’ailleurs pas pour décréter aliénées les femmes qui « se vantent de n’avoir pas porté plainte ni dénoncé les actes de harcèlement ou d’agression dont elles avaient fait l’objet, et accusent les femmes qui dénoncent de tels actes de « se victimiser » » (p. 241) ! Le slutshaming a de beaux jours devant lui… Au demeurant, ce sont les femmes à sociosexualité basse qui sont plus à même de se sentir harcelées[34]. Il y a certes plus de harceleurs que de harceleuses, mais alors que l’initiatrice de #balancetonporc a été récemment condamnée pour diffamation, il n’est pas inutile de rappeler qu’hommes et femmes ont tous deux recours au harcèlement et à la coercition sexuelle.[35] La théorie évolutionnaire offre une explication plus satisfaisante du harcèlement que l’existentialisme de Beauvoir.[36] Par exemple « un non peut parfois signifier « essaie encore » », ce qui conduit certains hommes à « insister au point que certaines femmes jugeront leurs avances à la fois indésirables, hostiles et menaçantes ».[37]
Quant aux hommes battus, qu’ils soient avertis : dans le cas de « la tyrannie que la femme exerce parfois sur son mari », « le mari est opprimé, écrit Garcia, du fait de l’oppression qu’il exerce » (note 5, p. 258). Faut-il comprendre que le sexisme anti-homme n’existe pas et que les hommes ne font jamais l’objet d’une violence genrée, « sexospécifique » ? Ou que les hommes représentant la majorité des agresseurs, ils ne font que récolter la monnaie de leur pièce ?[38] Selon Adam Jones « la procédure standard chez les universitaires et les militants féministes stipule que […] les chiffres pouvant susciter de l’inquiétude et de la sympathie à l’égard des femmes […] doivent être soigneusement distingués et présentés isolément. Les données menaçant de contrebalancer ou de contextualiser ce tableau, peut-être au détriment de l’importance accordée aux victimes femmes, doivent être ignorées ou occultées ».[39] Maria Kouloglou, note que « les hommes sont en général perçus, à un degré ou à un autre, comme responsables de leur propre victimisation. […] la violence commise contre elles serait […] un crime plus grave ».[40] Evidemment qu’« il y a quelque chose de féminin dans la soumission » (p. 61) ; mais l’explication qu’en livre Manon Garcia, par ses aspects anti-scientifiques, militants, ethnocentrés, complotistes et simplificateurs, tombe malheureusement dans les travers courants du féminisme mainstream et, ce faisant, ne paraît pas servir les véritables intérêts des femmes.
Un point de vue marxiste sur la soumission
L’ouvrage ne démontre pas, mais postule d’emblée qu’« examiner la soumission des femmes aux hommes, c’est étudier la façon dont les hiérarchies de genre dans la société façonnent les expériences des femmes » (p. 12) ; ou encore que la domination masculine constitue un « phénomène global structurel » suscitant la complicité (p. 20). L’auteur ne cache pas le caractère féministe (donc nécessairement militant) de sa démarche.[41] Il suggère même que les femmes ne séduisent pas, ni ne jouissent, ni ne trompent[42]. Son enquête se limite aux rapports hétérosexuels, parce que les rares travaux sur la répartition des tâches domestiques dans les couples lesbiens laissent imaginer que « la dimension structurelle de la soumission » est davantage présente chez les hétéros (p. 27). « Le lieu par excellence de l’oppression des femmes par les hommes » n’est pas le harem oriental, ni la maison close, mais les rapports hétérosexuels (p. 28). N’écoutant que son courage, Manon Garcia choisit d’exclure les femmes orientales de son enquête, pour ne pas prendre le risque d’accréditer les « représentations culturalistes » de la femme totalement contrainte (la « prisonnière du patriarcat ») et de la femme qui adhère complètement aux normes qui l’oppressent (la « dupe du patriarcat ») ? Les Iraniennes apprécieront d’être réduites à des « images fantomatiques »… Subvertissant audacieusement les frontières qui séparent la philosophie du journal intime, Manon Garcia justifie de se concentrer sur la France et les États-Unis parce qu’il s’agit des deux pays dans lesquels elle vit (p. 28-29)… Car « il y a de la soumission dans le fait de s’affamer pour rentrer dans une taille 36 » (p. 26) : preuve que la soumission est bien universelle et banale. Musulmanes voilées, instagrameuses au régime : même combat !
A moins d’être esclave ou « racisé », comme dit la novlangue contemporaine, un homme sera semble-t-il toujours trop privilégié pour faire l’expérience de la soumission,[43] peu importe qu’il soit philosophes et quel que soit le nombre de pots de chambre que Xanthippe a pu vider sur la tête de ce pauvre Socrate ! La philosophie a été « faite exclusivement par des membres de l’élite sociale » (ou « destinée uniquement à ceux-ci », p. 94) ! Comme l’a bien vu Marx – bourgeois miraculeusement épargné par le biais qu’il dénonce – la domination n’a été étudiée que du point de vue des dominés, qui en ont fait le récit « qui sert leurs intérêts ». Faut-il en déduire que Manon Garcia elle-même ne fait aucunement partie d’une élite sociale ? Elle imputerait peut-être aux « normes sociales de genre qui prescrivent aux hommes l’indépendance, le courage » (p. 241), le fait que de nombreux philosophes (Socrate, Nietzsche, Wittgenstein, Alain, Reinach, Cavaillès, Hans Jonas, etc.) aient participé plus ou moins docilement à des guerres ; mais il faut croire que cette expérience masculine de la soumission – où l’objectification réduit le corps à de la chair à canon – est sans doute trop rare et limitée pour prétendre concurrencer l’expérience quotidienne des femmes occidentales, objectifiées par… des regards, ou victimes d’une terrible « charge mentale » ! Quand bien même les philosophes de la tradition ont pu être souvent pauvres, isolés, exilés, suicidés (Sénèque, Condorcet, Walter Benjamin, Auguste Comte, Gilles Deleuze, etc.), emprisonnés (Socrate), condamnés au bucher (Giordano Bruno), etc. – leurs privilèges de mâles suffisent, selon l’auteur, à expliquer que « la soumission n’a pas fait l’objet d’études philosophiques notables » (p. 94). Les logiciens, les épistémologues, les métaphysiciens spéculatifs, comme les philosophes des mathématiques ou de la religion seront étonnés d’apprendre qu’il n’y a « d’études philosophiques notables » que de ce qui fait l’objet d’une expérience quotidienne.
La façon dont « fonctionne la domination pour celui ou celle sur qui elle s’exerce » a fait l’objet selon Garcia d’un véritable « tabou philosophique » (p. 14). Où le Seinsverlassenheit semble détrôné, dans l’ordre des problèmes philosophiques majeurs, par un immémorial oubli de la soumission ! Hobbes, La Boétie et Foucault ne pensent la soumission que d’un point de vue politique ; Freud la naturalise ; Rousseau la prescrit au lieu de la décrire ; et Deleuze essentialise les opprimés. « La femme n’aurait pas le génie de la parure si elle n’avait pas l’instinct du second rôle », écrivait Nietzsche (Par-delà bien et mal, § 145), qui n’est pourtant évoqué à aucun moment. Le philosophe propose tout de même une pensée élaborée de la soumission, y compris la soumission ordinaire, individuelle et féminine, en tenant souvent compte du point de vue féminin sur la question, mais peut-être serait-il accusé, à tort, de naturaliser la soumission.[44]
La suite de la recension est consultable à cette adresse.
[1] Manon Garcia, On ne naît pas soumise, on le devient, Paris, Flammarion, coll. Climats, 2018.
[2] Jacques Balthazart, Quand le cerveau devient masculin, humenSciences, Paris, 2019, p. 228.
[3] https://ledrenche.ouest-france.fr/on-ne-nait-pas-femme-on-le-devient-6421/
[4] La soumission est alors « l’action ou la situation des femmes lorsqu’elles sont parties prenante d’un rapport de domination auquel elles ne résistent pas » (p. 34).
[5] https://www.lepoint.fr/debats/la-vie-d-un-homme-vaut-elle-moins-que-celle-d-une-femme-20-07-2019-2325708_2.php
[6] p. 235. Cf. p. 231 : « La situation des femmes résulte d’une construction historique, religieuse, théorique et mythique des hommes et non pas d’une nature soumise des femmes ». Mais not all men : les hommes aussi sont « contraints » par leur situation, la domination masculine mine également leur liberté.
[7] Ainsi pour l’anthropologue Paola Tabet (« Echange économico-sexuel et continuum »), tenante d’un féminisme matérialiste, l’humanité a toujours pratiqué de nombreux échanges, même en dehors du cadre prostitutionnel, entre ressources des hommes et mise à disposition sexuelle des femmes.
[8] Ce phénomène est renforcé chez l’Homo sapiens : « la beauté d’une femme valorise l’homme qu’elle accompagne par l’image qu’il a de lui-même et qu’il projette sur les rivaux » (F. de Smet, ibid.). Ce n’est pas que les hommes préfèrent les femmes belles, c’est qu’ils en sont véritablement accrocs (David Buss, The Evolution of Desire. Strategies of Humain Matting, New York, Basic Books, 1994, trad. fr. par Suzanne Falcone, Les Stratégies de l’amour, Paris, InterEditions, 1994) !
[9] La prostitution dépasse la prestation sexuelle : l’acte prostitutionnel est un service qui implique plus que la mise à disposition d’un corps, ce qui conduit à distinguer la prostitution libre de l’exploitation objectivante. Pour la dirigeante du comité italien pour les droits des prostituées, Pia Covre, le client a le droit à un service sexuel, mais pas à sa sexualité à elle. Il peut payer le service de l’autre, pas le plaisir de l’autre, donc la prostituée peut se servir du client à son insu, en s’affirmant comme sujet (« Comme ça, on roule [le client] deux fois, on lui prend les sous et la queue en prime », Pia Covre, citée par Paola Tabet, ibid.).
[10] Cf. Philippe Gouillou, Pourquoi les femmes des riches sont belles.
[11] Les femmes sont accoutumées à mettre en avant leurs atouts physiques notamment parce que leurs gènes leur commandent de mettre leur fertilité en vitrine. Les femmes paraissent naturellement complices de l’importance prise par la beauté comme critère servant à les discriminer. Le plaisir qu’elles prennent à s’apprêter et à paraître belles semble être un mécanisme de récompense associé à un comportement pertinent du point de vue évolutif, passé dans leurs gènes pour une fonction d’utilité.
[12] En vertu de la stratégie du « bonheur conjugal » (choisir le meilleur reproducteur possible), la femelle chez l’Homo sapiens est encouragée à faire la difficile, à jouer les timides ou la sainte-nitouche, à refuser a priori de se donner, comme le font la majorité des femelles dans l’ensemble du règne animale.
[13] En vertu de la stratégie du « mâle dominant », les femelles choisissent le mâle qui apportera le meilleur gène à sa future progéniture. Les mâles de grande taille sont plus dominants et les femelles vont préférer des mâles davantage susceptibles de les protéger. « Ce dimorphisme est vraisemblablement le signe d’un important passif de compétition spermatique et de polygynie (plusieurs femelles pour un seul mâles) » (F. de Smet, ibid.). Cf. Sastre, La domination masculine n’existe pas, Paris, Anne Carrière, 2015, p. 127. Chez l’Homo sapiens, les régimes de polygynie ont longtemps trusté le pool évolutif. Cf. C. Muller et P. Sastre, Sexe Machines, p. 199 : moins de 1% des ethnies sont polyandres (Aléoutes au Groenland, Nayar Toda en Inde, Nyinba au Népal et au Tibet). Cette polyandrie est très probablement liée à des conditions écologiques et économiques extrêmes (la présence de deux hommes est alors nécessaire à la subsistance de la famille). Cf. Buss, D. M., Shackelford, T.K. (1997), « Human aggression in evolutionary psychological perspective », Clinical Psychology Review, 17, p. 605-619 ; Wilder, J.A. et al. (2004), « Genetic evidence for unequal effective population siezs of humain females and males », Molecular Biology and Evolution, 21, 11, p. 2047-2057.
[14] Brigitte Lahaie, BFMTV, 10 janvier 2018, http://www.huffingtonpost.fr/2018/01/10/on-peut-jouir-lors-dun-viol-affirme-brigitte-lahaie-en-plein-debat-sur-les-violences-sexuelles_a_23330225/
[15] « Les collégiennes américaines déclarent ne s’intéresser délibérément qu’aux 30 % d’hommes les plus riches ; et le fait est que les hommes se mariant sont en moyenne plus riches que ceux qui ne se mariant pas » (David Buss, Les Stratégies de l’amour. « Les hommes nantis, dont la situation matérielle est excellente, trouvent des partenaires plus tôt, commencent à se reproduira plus jeunes, ont moins de risque de voir leurs partenaires inséminées par d’autres mâles, et plus de chances de féconder celle d’un autre » (R. Baker, La Guerre du sexe, Paris, JC Lattès, 1997, cité par Philippe Gouillou, in Pourquoi les femmes des riches sont belles). « Le statut professionnel de l’homme semble être le meilleur indicateur de la beauté de la femme qu’il épousera » (David Buss, Les Stratégies de l’amour).
[16] Les mâles, note François de Smet (ibid.), sont attirés par les comportements dangereux généralement durant « l’âge de recherche des partenaires (adolescents et jeunes adultes) », plus que par la suite : n’est-ce pas parce que les mâles qui jouent aux héros et survivent connaissent d’importants succès reproductifs ? Aujourd’hui encore, les hommes « sont surreprésentés dans les activités à risque, au point que « le sexe est le premier facteur prédictif des activités dite organiques ou traumatologiques », alors que les femmes sont globalement davantage rebutées par la prise de risques (social, physique ou financier) ». Peggy Sastre, ibid., p. 29.
[17] F. de Smet, ibid. L’amour ne serait qu’un « sentiment » produit par une « situation historique, économique et sociale », dont la conception reflèterait « la façon dont la différence sexuelle est codée dans une société » (Manon Garcia, ibid., p. 197). « L’amour, pour les femmes, est une forme particulièrement profonde de soumission » (p. 197). Il n’est que renoncement à soi dans la vénération de l’autre et plaisir de servir, ce qui réserve à la femme uniquement une attitude que Sartre attribuait à tout amant (le souhait spontané de cet amour est « être tout pour lui », Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe, t. II).
[18] p. 223 (c’est nous qui soulignons).
[19] (p. 38). Néanmoins, Beauvoir ne juge pas la femme coupable de sa soumission, mais seulement responsable.
[20] (pp. 205, 214, 222, 225 à 227, 230). Les femmes désirent la liberté, tout en la redoutant ; elles veulent se projeter dans le monde, mais sont tentées par l’abdication (p. 227–228) ; la soumission leur est prescrite comme un destin ; et la liberté leur est plus coûteuse qu’aux hommes.
[21] Il s’agit là, de l’aveu même de l’auteur, de la façon « la plus commune » de penser « le lien entre féminité et soumission » (p. 50, c’est nous qui soulignons).
[22] la femme soumise « n’agit pas […] ne cherche pas à conquérir une quelconque liberté contre la situation qui est la sienne, c’est-à-dire contre la soumission à laquelle elle est destinée » (p. 230) ; « la soumission est une destinée toujours déjà là pour la femme ».
[23] Il serait certes exagéré de parler, au sujet des animaux en général, de « guerre des sexes selon une mode qui vient des Etats-Unis : cela reviendrait à relayer « les malaises d’une société malade du harcèlement sexuel, du viol et du puritanisme corrélés avec le plus fort taux de grossesse des jeunes filles » (Pascal Picq, ibid., p. 36).
[24] Cette querelle « prit la forme d’un combat rituel au cours duquel chaque partie en litige […] soutenait une position indissociable de son rôle social ». Au XVIIè siècle, le « rituel d’échanges d’insultes agonistiques » reposait sur des souvenirs ancestraux de la rivalité qui fondait le mariage et l’activité courtisane (Christopher Lasch, ibid.).
[25] p. 87. Il s’agirait d’« un système structurel d’oppression patriarcale » dont témoigneraient « les inégalités de genre » (p. 18) et qui priverait les femmes de l’accès à la parole (p. 113).
[26] p. 140 (c’est nous qui soulignons). Les hommes, qui « conçoivent les femmes comme des objets » (p. 158), ont seuls créés « la représentation du monde comme le monde lui-même » et ils confondent leur point de vue « avec la vérité absolue » (Simone de Beauvoir, ibid.) !
[27] Si du moins on parvient à suivre un propos qui se fait ici particulièrement confus : « les représentations » et la culture classique présenteraient la soumission comme (voire autorisent à dire qu’elle est réellement ?) « une conduite que les hommes considèrent comme typiquement féminine, ou comme nécessaires à la vertu des femmes » (p. 43–44). « À la différence de ce qu’il se passait chez Freud, où la soumission était dans la nature de la femme elle-même, ici, la soumission n’est pas tant un résultat de la nature des femmes que d’un (sic.) point de vue sur les conditions nécessaires à une entente harmonieuse entre les sexes » (p. 48).
[28] « L’opinion d’une tierce personne sur la vôtre, de personne, ne dit absolument rien, n’a absolument rien à dire de ce que vous pouvez être. Arpenter l’espace public, c’est nécessairement susciter des jugements dans l’esprit des gens que vous pouvez y croiser », Peggy Sastre, « Harcèlement de dure : un concept qui me laisse perplexe » : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1271143-harcelement-de-rue-un-concept-qui-me-laisse-perplexe-pour-4-raisons.html
[29] Cf. Peggy Sastre, ibid. : la plupart des actes de harcèlements de rue « ne sont en aucun cas le prélude à des agressions sexuelles caractérisées ». Nos sociétés « n’ont jamais été aussi sûres [Cf. Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined], aussi pacifiées, [et] n’ont jamais aussi durement puni les crimes et les agressions sexuelles » (cf. Cf. Marcela Iacub et Patrice Maniglier, Antimanuel d’éducation sexuelle). « Si [les codes de séduction que manifeste le harcèlement de rue] sont « mauvais », c’est qu’ils ne correspondent pas, comme le soulignait à très juste titre l’article sur le « féminisme bourgeois » d’Alix van Buuren, aux logiques que privilégient en moyenne les femmes lors d’une interaction sexuelle […] se mettre en couple, à plus ou moins long terme, avec quelqu’un d’un statut (social, intellectuel) plus élevé que le sien » (hypergamie).
[30] Il s’agit de l’inclusion des préférences sexuelles dans la sphère sociale (les individus à sociosexualité haute sont ceux que le langage courant qualifie d’« obsédés », cf. P. Sastre, La domination masculine n’existe pas).
[31] Cf. Kennair, L.E.O. et al. (2012), « Sociosexuality as predictor of sexual harassment and coercion in female and male high scholl students », Evolution and Human Behavior, 33, 5, p. 479-490, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090513812000025?via%3Dihub
Haselton, M.G. (2003), « The sexual overperception bias : evidence of a systematic bias in men from a survey of naturally occiring events », Journal of Research in Personnality, 37, p. 34-47.
[32] Par ses compliments, « l’homme fait du corps de la jeune fille un corps pour lui et non plus un corps pour elle » (p. 187).
[33] Peggy Sastre, La domination masculine n’existe pas. Voir les travaux de N. Malamuth, K. Sakahuchi, T. Hasegawa , M.R. Yost, E.L. Zurbriggen, etc.
[34] Soit dit en passant, les femmes voient plus d’impolitesse chez les autres femmes que chez les hommes https://www.cnbc.com/2018/03/06/women-see-more-workplace-rudeness-from-other-women-than-from-men.html
[35] Cette « hostilité est corrélée à une sociosexualité élevée et notamment à une préférence pour les relations sexuelles à court terme », préférence qui se retrouve davantage chez les hommes (P. Sastre, ibid.). 41 % des femmes québécoises, par exemple, ont déjà essayé de contraindre un homme à avoir des relations sexuelles contre son gré https://www.researchgate.net/publication/323391794_La_coercition_sexuelle_et_les_violences_sexuelles_dans_la_population_generale_definition_donnees_disponibles_et_implications Quant au harcèlement scolaire féminin, c’est un phénomène bien réel et de mieux en mieux connu http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/depp_education_formation_sept18_genre_et_lutte_contre_le_harcelement_a_l_ecole.pdf
[36] Comme forme atténuée de coercition sexuelle, le harcèlement sexuel « peut se voir comme un moyen, parmi d’autres, d’accéder à un maximum de partenaires ». Enfin « des études montrent qu’une proportion significative de femmes […] utilisent sciemment [le] genre de tactique » consistant à dire « non » tout en pensant « oui », pour temporiser le consentement, « car elle a pu se révéler avantageuse pour leurs ancêtres et maximiser leurs gains reproductifs ». (Peggy Sastre, ibid., cf. D.M Buss, The Evolution of Desire. Strategies of Human Matting, Basic Books, 1994).
[37] Les avantages sont ici de tester la qualité du prétendant et de ne pas éveiller « la périlleuse suspicion d’un partenaire masculin potentiellement floué danses ses intérêts propres », les femmes ayant aussi été « sélectionnées pour faire les difficiles » (P. Sastre, ibid., cf. L. Mealey, « Alternative adaptive models of rape », Behavioral and Brain Sciences, 15, 1992, p. 397-398).
[38] Par exemple 90 % de victimes de meurtre dans la région de Ciudad Juárez (ville frontalière du Mexique) sont des hommes, mais « peu de gens semblent surpris, écrit Debbie Nathan, et encore moins outrés, par ce carnage d’hommes » (Debbie Nathan, Texas Observer (cité par le politologue Adam Jones, in « The Murdered Men of Ciudad Juárez, in Letras Libres (Mexico), avril 2004, http://adamjones.freeservers.com/juarez.htm).
[39] « Cette stratégie féministe reflète et tire profit de croyances culturelles au sujet des hommes quasiment universelles », comme l’idée que les hommes seraient des « victimes non innocentes » (Adam Jones, ibid.).
[40] https://www.lepoint.fr/debats/la-vie-d-un-homme-vaut-elle-moins-que-celle-d-une-femme-20-07-2019-2325708_2.php. D’après au moins une étude, les femmes sont pourtant plus disposées que les hommes à sacrifier des hommes (http://archive.is/t4tjP). Pour M. Kouloglou, c’est peut-être l’évolution qui a « poussé les hommes et les femmes à protéger les femmes, parce qu’un homme peut féconder plusieurs femmes, alors qu’une femme ne peut généralement avoir qu’un seul enfant à la fois. Il serait dès lors plus logique pour les sociétés de protéger les femmes pour qu’elles soient en mesure de se reproduire ».
[41] L’auteur situe ce caractère féministe notamment dans l’adoption du « point de vue des femmes elles-mêmes comme point de départ de l’analyse » (p. 21). Parler en effet de « domination » masculine au lieu de « soumission » féminine, fut-ce pour dénoncer cette domination, serait toujours en quelque façon sexiste, puisque cela perpétuerait l’usage « de toujours envisager le monde depuis le point de vue des hommes considérés comme point de vue neutre et objectif » (p. 22) !
[42] « ce sont les hommes qui dominent ou qui ne dominent pas, qui violent, qui séduisent, qui proposent, qui jouissent, qui trompent » (p. 21, c’est nous qui soulignons).
[43] Il est difficile de décrire la soumission, selon Garcia, parce qu’il est difficile de penser l’ordinaire et le pouvoir (p. 92). Hormis Epictète, tous les « philosophes de la tradition […] avaient une situation sociale tellement privilégiée que l’expérience de la soumission ne faisait pas partie de leur quotidien » (p. 94). Par leur position sociale, ils sont à l’abri de « la vie ordinaire » qui, par conséquent, leur « échappe souvent » (p. 118).
[44] Pour Nietzsche, ce sont les valeurs qui fixent la signification de la biologie. La question est alors de savoir si l’énoncé performatif « les hommes et les femmes sont égaux » effectue bien l’égalité et supprime effectivement les inégalités ; ou bien si, au contraire, un énoncé opposé peut performer de nouvelles hiérarchies et doit renverser les hiérarchies présentes…