Ancienne directrice de recherche au FNRS, actuelle titulaire de la chaire « Religion, histoire et société dans le monde grec antique » au Collège de France, Vinciane Pirenne-Delforge s’est fait connaître par ses remarquables travaux consacrés à la figure d’Aphrodite[1] avant d’enrichir notre connaissance de la mythologie grecque et d’interroger le sens même du polythéisme associé à cette dernière.
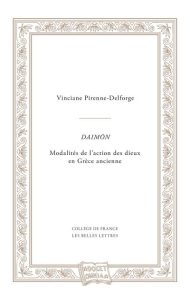 En 2025, elle a publié un ouvrage consacré à la question du daimôn[2] dont elle a cherché à rendre compte depuis des sources exclusivement littéraires et ce en excluant sciemment l’usage que les spéculations philosophiques – en particulier platoniciennes et néoplatoniciennes – avaient patiemment élaboré et que des historiens comme Dodds avaient eu à cœur d’explorer.
En 2025, elle a publié un ouvrage consacré à la question du daimôn[2] dont elle a cherché à rendre compte depuis des sources exclusivement littéraires et ce en excluant sciemment l’usage que les spéculations philosophiques – en particulier platoniciennes et néoplatoniciennes – avaient patiemment élaboré et que des historiens comme Dodds avaient eu à cœur d’explorer.
Issu de leçons dispensées au Collège de France, en particulier du cours de 2018-2019 consacré au Daimôn dans l’épopée homérique[3], ce livre fait le choix d’un matériau textuel original et fécond, et peut être lu en regard d’un ouvrage récent ayant emprunté la direction contraire, à savoir celui de David Vachon[4] recherchant dans le néoplatonisme de Proclus – et de Jamblique – les traces démoniques à partir d’une reconstruction de la théurgie.
A : Démarche générale de l’auteur
Le choix assumé par V. Pirenne-Delforge s’inscrit sans aucun doute dans la continuité de son approche générale de la mythologie grecque qui, loin d’être réduite à un Panthéon figé et statique, propose au contraire d’en restituer la vitalité, la mouvance et, plus encore, la dimension sociale, impliquant de ne pas plaquer des questions dogmatiques sur une série de pratiques avant tout cultuelles et même pragmatiques. C’est pourquoi, dans son enquête sur la notion de daimôn, on retrouve moins une investigation de la dimension étiologique des daimônes – que ce soit dans une optique cosmologique ou dans une optique plus métaphysique – qu’une description de la manière dont ils apparaissent, dont ils sont nommés et dont ils sont corrélés à des cultes précis et à des pratiques mises au jour par l’archéologie. Il convient de ne pas oublier que, dans sa Leçon inaugurale, V. Pirenne-Delforge avait insisté sur la nécessité pour l’historien des religions antiques de solliciter une diversité de matériaux, et de n’en pas rester à la seule approche textuelle :
« Quand il s’agit de religion grecque, les traces en question vont des œuvres les plus abouties des auteurs anciens jusqu’aux ossements d’animaux qui parlent de division sacrificielle, en passant par les règlements épigraphiques, les structures architecturales, les milliers de dédicaces et d’artéfacts de tous types[5]. »
 Ainsi, dès lors que le polythéisme apparaît pour l’historien comme un objet d’étude transversal, sollicitant toutes sortes de matériaux, il ne s’agit plus vraiment de comprendre le sens intellectuel de tel ou tel objet mais de restituer un fonctionnement global, variable dans le temps et saisi depuis une fonctionnalité que détermine chaque société. Dans le cas précis qui retient notre attention, il n’est donc plus question de comprendre quelle peut être sa place dans une économie philosophique cherchant à expliquer le monde ou l’âme mais, bien plutôt, « de saisir la notion de daimôn dans une tradition poétique qui n’interroge pas l’essence du monde ou de l’homme, mais rend compte des multiples aspects de leur existence et des puissances visibles et invisibles qui les traversent. C’est au sein de cette tradition que se font jour à nos yeux modernes les dieux du polythéisme hellénique et la manière dont les Grecs percevaient leur action. Dans la langue grecque, ces dieux sont des théoi, mais le pluriel daimônes peut également servir à les désigner, attestant que, d’emblée, le terme daimôn renvoie à quelque chose de divin[6]. »
Ainsi, dès lors que le polythéisme apparaît pour l’historien comme un objet d’étude transversal, sollicitant toutes sortes de matériaux, il ne s’agit plus vraiment de comprendre le sens intellectuel de tel ou tel objet mais de restituer un fonctionnement global, variable dans le temps et saisi depuis une fonctionnalité que détermine chaque société. Dans le cas précis qui retient notre attention, il n’est donc plus question de comprendre quelle peut être sa place dans une économie philosophique cherchant à expliquer le monde ou l’âme mais, bien plutôt, « de saisir la notion de daimôn dans une tradition poétique qui n’interroge pas l’essence du monde ou de l’homme, mais rend compte des multiples aspects de leur existence et des puissances visibles et invisibles qui les traversent. C’est au sein de cette tradition que se font jour à nos yeux modernes les dieux du polythéisme hellénique et la manière dont les Grecs percevaient leur action. Dans la langue grecque, ces dieux sont des théoi, mais le pluriel daimônes peut également servir à les désigner, attestant que, d’emblée, le terme daimôn renvoie à quelque chose de divin[6]. »
Un tel choix méthodologique présente une incidence immédiate, à savoir que le concept ne saurait fixer un sens unique du daimôn, ce qui ouvre ce dernier à une pluralité de sens qu’il s’agit d’abord d’établir selon les traditions littéraires, puis de corréler à des pratiques concrètes en s’aidant des découvertes archéologiques, lesquelles permettent aussi d’interroger des absences : si le daimôn semble n’avoir pas été représenté, ou très peu, quelle signification cela revêt-il et une telle absence peut-elle s’expliquer depuis les traditions littéraires connues ?
B : Le corpus retenu
Si l’on regarde les textes littéraires retenus par l’auteur, on constate que se trouvent convoqués Homère, qui utilise soixante fois le terme daimôn, Hésiode pour Les travaux et les jours, des textes relevant de la poésie mélique (poésie moins définie ici comme lyrique que comme « non épique ») où revient Hésiode à côté de Pindare, mais aussi des extraits de pièces de théâtre, qu’il s’agisse d’Electre, d’Œdipe roi ou de quelques autres. A cet égard, le corpus s’étend sur plusieurs siècles, couvre plusieurs genres, et offre un panorama très vaste du sujet, permettant d’étudier les variations de la notion selon une pluralité de facteurs.
Forte de ce corpus, V. Pirenne-Delforge se montre très attentive aux variations lexicales, aux différences entre le singulier et le pluriel, aux adjectifs voire à la forme adjectivale de daimôni, tout en tenant une ligne directrice assez claire consistant à se demander quel rapport le daimôn entretient avec le divin. Un cas paradigmatique apparaît par exemple dans la formule daimôni isos, « égal au daimôn », ou « semblable au daimôn », formule présente dans l’Iliade mais absente de l’Odyssée, dont il s’agit de se demander quel rapport au divin elle implique et, plus encore, quel effet concret elle désigne.
- L’approche homérique
Très vite se dessinent dans le corpus homérique plusieurs cas dont nous allons signaler une sélection : d’abord celui d’un humain, c’est-à-dire d’un « mortel », favorisé par un Dieu et qui, de ce fait, devient réceptacle d’une puissance supérieure à lui qui le rend plus puissant que ses semblables. Au regard de la pratique, il devient alors irrationnel pour un homme de s’en prendre au daimôn puisque cela revient à affronter plus puissant que lui. Celui qui est qualifié de daimôni isos ressemble à ce que l’auteur appelle un « homme augmenté » en vertu de la puissance divine qui l’anime, ce qui signifie à la fois que l’individu n’est plus acteur de lui-même et, en même temps, que se joue bien dans le démonique quelque chose de divin :
« Dans le scénario que traduit l’expression daimôni isos, le poète évoque une action divine qui travaille l’humain de l’intérieur et détermine un comportement qui fait éclater les limites attendues de l’action d’un mortel. L’humain alors augmenté ne se contente pas de paraître : il agit ou est agi de l’intérieur[7]. »
Un point intrigant tient au fait que, pour exprimer cette action divine dans l’homme, ne se trouve pas convoqué le terme de « théos », alors même que ce sont bien les dieux qui semblent agir en l’homme ainsi rendu égal au daimôn. L’auteur note, en examinant de près l’Odyssée, que cette situation d’un homme égal au daimôn est fréquente bien que le syntagme daimôni isos ne soit pas employé.
Un second aspect relevé chez Homère tient à l’obscurité du Dieu agissant en l’homme. Dans l’Odyssée, apparaît ainsi l’impossibilité d’identifier le dieu qui « agit l’homme », comme si l’obscurité de l’identité divine se faisait consubstantielle à l’action initiée en l’homme.
Un troisième aspect, lié au précédent, est également relevé : quelles que soient les nuances des textes, chez Homère, « la volonté des dieux et l’activité démonique sont indissolublement liées[8]. » Cela reçoit une assise particulièrement solide à partir d’une quasi-équivalence dans certains passages de l’Iliade – et non de l’Odyssée – entre theoi et daimônes, ces derniers pouvant désigner les dieux de façon collective.
- L’approche hésiodique
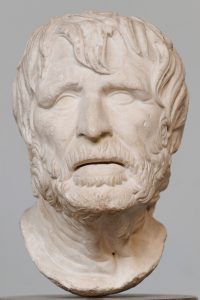 Le cas d’Hésiode est fort intéressant car il semble prolonger sur un point l’Odyssée – qui ne mentionne pas l’équivalence daimônes / théoi – et s’écarter de l’Iliade. Mais un élément semble plus essentiel encore, à savoir qu’un daimôn divin se trouve nommé, donc identifié en la figure de Phaéthon (fils d’Hélios). En outre, les daimônes sont référés quant à leur origine aux races originelles, la race d’or donnant lieu à des daimônes bienveillants, celle d’argent à des mortels bienheureux et celle de bronze semblant être enfouie dans l’Hadès.
Le cas d’Hésiode est fort intéressant car il semble prolonger sur un point l’Odyssée – qui ne mentionne pas l’équivalence daimônes / théoi – et s’écarter de l’Iliade. Mais un élément semble plus essentiel encore, à savoir qu’un daimôn divin se trouve nommé, donc identifié en la figure de Phaéthon (fils d’Hélios). En outre, les daimônes sont référés quant à leur origine aux races originelles, la race d’or donnant lieu à des daimônes bienveillants, celle d’argent à des mortels bienheureux et celle de bronze semblant être enfouie dans l’Hadès.
A cet égard, le daimôn change de manière radicale car, par le devenir de la race d’or, ce sont trente mille daimônes qui, sur terre, accompagnent et gardent les hommes en vue de les protéger et d’assurer certains principes de justice. Le lien avec le divin n’est pas rompu, le daimôn ne s’autonomise pas pour autant car ces trente mille daimônes, issus de la race d’or, s’avèrent subordonnés aux intentions de Zeus qu’ils cherchent à accomplir sur Terre :
« Au cœur des Travaux se situe l’exercice de la justice de Zeus au sein d’une communauté paysanne, dans le respect du bon accomplissement des tâches agricoles et des entreprises maritimes. L’œuvre ne présente pas d’intrigue mais déroule une leçon de justice et une exhortation au travail qui placent, l’une et l’autre, Zeus en position dominante : il est maître de justice et pourvoyeur de postérité parmi les humains[9]. »
Sous cet angle, une clarification s’opère : non seulement les daimônes se trouvent associés à un dieu précis, Zeus, mais en plus l’un des dieux (Phaéthon) se trouve lui-même présent sur Terre comme desservant dans le temple d’Aphrodite.
- La poésie mélique
Avec la poésie réapparaît un élément qui avait été aperçu chez Homère, à savoir le caractère obscur du dieu agissant à travers la force démonique. Si l’on trouvait dans les Travaux et les jours un dieu précisément nommé, donc identifié, il n’en est pas de même dans la poésie, y compris au sein de la Théogonie. Plus précisément, si Zeus peut parfois apparaître à l’origine d’un daimôn comme dans la Vème Pythique, il n’en demeure pas moins que l’indétermination de l’identité divine semble fréquente, à telle enseigne d’ailleurs que, dans la conclusion de l’ouvrage, ce point se trouve fortement souligné :
« Au sein de la paire theos/daimôn, ce dernier est le terme marqué, dans la mesure où il exprime une dimension spécifique de théos, à savoir sa capacité à agir, du point de vue limité des humains qui en subissent les effets. (…). Bien des occurrences de daimôn en poésie indiquent que quelque chose d’origine divine s’est passé ou est en train de se passer, sans possibilité d’en identifier l’agent. Une puissance divine agit parmi les hommes, et cette intervention, passée ou présente, peut être positive ou négative[10]. »
- L’usage théâtral du daimôn
Le chapitre consacré au théâtre met au jour une pluralité de situations dont il serait fastidieux d’établir la liste ; en revanche, un point nous semble essentiel, celui du destin. En effet, si le daimôn a à voir avec la manifestation d’une force supérieure à celle dont un mortel est normalement capable, ne faut-il pas y voir celle du destin et donc traduire ainsi le terme daimôn, notamment lorsqu’il est impossible de déterminer l’identité d’un dieu précis ? L’auteur discute la question de la traduction, en particulier pour Œdipe roi, 1297-1302, et montre de manière très convaincante que si la traduction par « destin » n’est pas dénuée d’arguments, elle est néanmoins trompeuse car elle substitue une forme de force aveugle et nécessaire à la médiation démonique d’une intention divine, en l’occurrence d’Apollon :
« La notion de « destin », sans être fausse, gomme une fois de plus l’action des dieux qui sous-tend l’alternance des biens et des maux, l’eudaimônia et la dusdaimônia, qui inscrivent l’existence humaine dans l’incertitude que chantait Pindare et dont l’Œdipe Roi nourrit sa conclusion[11]. »
Ainsi, certains choix de traduction peuvent substituer à la question de l’intervention divine médiatisée par l’action démonique l’idée d’une irruption de la force destinale, oblitérant le lien que cherchent à établir les dieux à l’endroit de la vie humaine. L’enjeu n’est ni mince ni simple car, montre l’auteur, en d’autres circonstances, la traduction de daimôn par « destin » est légitime ; tel est le cas de Médée, 1346-1350, où le daimôn revêt le sens générique du « sort ».
C : L’analyse réflexive du corpus
A partir du chapitre V, le propos évolue ; après avoir fixé le corpus et listé des significations fort différentes du daimon, l’analyse intervient enfin, ce qui n’est pas chose aisée au regard de l’éclatement de sens établi par les quatre premiers chapitres. C’est pourquoi, et comme cela pouvait s’anticiper, il est impossible de déterminer une approche unifiée du daimôn qui se refuse à la prise conceptuelle. D’une certaine manière, cela était inéluctable au regard de la méthodologie retenue, mais impose de ne jamais pouvoir dépasser la liste d’usages différenciés comme le prouve le passage suivant :
« Une action divine est en cours et ressentie comme telle, mais on ignore qui l’a provoquée et qui la porte. C’est normalement le cas dans les usages du terme en contexte homérique. En revanche, dans d’autres poèmes, l’identité du daimôn apparaît parfois comme évidente pour ceux qu’il frappe ou favorise, et non seulement pour le poète ou son auditoire qui surplombe l’intrigue. C’est alors la synonymie théos / daimôn qui prévaut. Dans d’autres cas, et singulièrement dans la tragédie, l’identification du dieu à l’origine de l’action en cours fait l’objet d’une conjecture plus ou moins assurée. C’est ce qui arrive quand Œdipe identifie, à la fin de l’Œdipe roi, Apollon comme celui des daimônes (… tis… daiimonon) qui l’a perdu ; le dieu commande au daimôn qui « a bondi du plus grand des bonds sur sa malheureuse part de vie ».[12] »
La conclusion, à rebours de la dissémination des sens parcourus, essaie pourtant de retrouver l’unité du daimôn en la reconstituant à partir d’une perspective polythéiste assumée comme telle :
« daimôn est avant tout la marque lexicale d’une action supra-humaine en train de s’accomplir, en laissant ceux qu’elle affecte dans l’ignorance de sa source. Une seule certitude s’impose alors : une puissance divine est à l’œuvre. Il s’agit d’un théos en action : « une puissance divine », « la puissance d’un dieu » ou « la manifestation d’une action divine », voire même « la volonté divine », sont autant de manières de rendre compte de ce type d’usage[13]. »
Autrement dit, dans une telle perspective, l’unité du daimôn tient au fait que l’action divine a pu se cristalliser en agent divin, un théos ayant envoyé un daimôn accomplir sa volonté ; en ce sens, le daimôn devient agent distributeur des biens et des maux, et est enfin conforme si l’on peut dire à sa fonction réelle de distributeur des pouvoirs divins que porte l’étymologie du terme. Il est ainsi clair que le daimôn est le nom par lequel est nommée la dimension agissante du divin ce par quoi, d’ailleurs, le daimôn n’est peut-être pas sans rapports avec la reprise chrétienne de la notion de Providence :
« Au sein de la paire theos/daimôn, ce dernier est le terme marqué, dans la mesure où il exprime une dimension spécifique de théos, à savoir sa capacité à agir, du point de vue limité des humains qui en subissent les effets. (…). Bien des occurrences de daimôn en poésie indiquent que quelque chose d’origine divine s’est passé ou est en train de se passer, sans possibilité d’en identifier l’agent. Une puissance divine agit parmi les hommes, et cette intervention, passée ou présente, peut être positive ou négative. Le terme lui-même reste neutre et justifie que l’expression du bonheur lui impose un préfixe quand l’adjectif apparaît pour la première fois à la fin des Travaux d’Hésiode : un homme heureux est eudaimôn[14]. »
Mais cette unité retrouvée ne doit pas masquer le fait que les usages du daimôn demeurent multiples, contradictoires, et imprévisibles : l’action peut être bénéfique comme nuisible, référée à un dieu précis ou énigmatique, nécessaire comme issue d’un arbitraire divin, et ainsi de suite. De là, du reste, les réactions très différenciées des hommes face à l’incertitude constitutive de l’intervention démonique :
« En tant que terme marqué du lexique divin, daimôn exprime la capacité des dieux à agir parmi les hommes, de façon imprévisible. Or, en cette matière, les maux qui s’abattent sur les mortels sont ressentis d’une manière particulièrement intense[15]. »
D : Les paradoxes du croisement des sources
L’un des paradoxes de l’ouvrage tient au fait que la volonté de croiser corpus littéraire et découvertes archéologiques, loin de faciliter la compréhension de ce que peut signifier daimôn, vient compliquer la donne. En effet, le terme de daimôn semble absent des inscriptions retrouvées au sein du monde grec. Daimôn n’est pas attesté dans les prescriptions rituelles ni dans les dédicaces épigraphiques en prose. Cela impose de spéculer sur les raisons d’une telle absence, et de rendre compatibles les textes analysés avec les pratiques quotidiennes, votives et cultuelles connues.
Une hypothèse, de nature quelque peu inductive, est alors proposée : puisqu’il a été possible, à partir des textes, de constater que le daimôn pouvait avoir à l’origine un dieu identifié avec la figure de Phaethon, alors peut-être est-il légitime de considérer que lorsque sont nommées des entités divines dans la pratique cultuelle, elles se trouvent à l’origine d’une action démonique :
« Dès lors, maints indices laissent entendre que des entités divines dénommées et chevillées à l’action des dieux de ce type jouent le rôle que la poésie attribue aux daimônes pour ceux qui en subissent les effets : c’est le cas d’Eros, d’Himeros, de Philotès ou d’Apatè dans la part d’Aphrodite émergeant des flots chez Hésiode ; c’est le cas d’Atè et d’Erinye qui sont « agis » par Zeus[16]. »
Ainsi se trouve défendue la thèse selon laquelle se nouent une étroite solidarité et des référents partagés entre chant poétique et pratique cultuelle ; que devient alors, dans l’exercice du culte, ce potentiel d’expression de la puissance divine que recèle le terme daimôn alors que le terme y est absent ? Pour des raisons liées à l’efficacité de l’obtention d’une faveur divine, le principe d’incertitude ou d’indétermination qui nourrit les intrigues poétiques n’a plus lieu d’être ; il convient de nommer le destinataire de la démarche cultuelle, si bien que le daimôn comme terme disparaît (à l’exception toutefois de l’ « Agathos daimôn »), la puissance divine étant directement nommée dans le cadre cultuel :
« Concernant les dieux aux larges compétences et dont la poésie place le siège sur l’Olympe, leur puissance se diffracte en fonction des lieux et des attentes de ceux qui leur rendent un culte. En langage poétique, cette distribution est susceptible de s’exprimer par la référence à un daimôn ou à des daimônes. Sur le plan cultuel, la nomination s’impose pour faire droit à la complexité du réseau de compétences qui détermine l’action divine parmi les hommes. Les stratégies de nomination sont autant d’outils mobilisés – épiclèses adjectivales, substantives, associations divines – pour garantir l’efficacité de la démarche rituelle. En tant que puissances divines, les destinataires de ces actes de culte forment autant de réseaux interconnectés, voire partiellement superposés, en des combinaisons censées augmenter la force de frappe des vœux et leur pertinence[17]. »
Conclusion
Pour le philosophe, un tel ouvrage se révèle fort instructif ; il permet d’abord de donner un arrière-plan à cette figure du daimôn, si fréquente dans les textes de tradition platonicienne, et qui ne cesse de rappeler que les dieux ne se mêlent pas directement au monde humain ; la nécessité d’un intermédiaire, d’un metaxu reliant les hommes aux dieux, est régulièrement rappelée par Platon, par exemple dans Banquet 202e. Mais l’indétermination même du sens du divin peut conduire, notamment en philosophie, à des situations complexes : on sait par exemple qu’Apulée avait publié un opuscule entier consacré au daimôn de Socrate, significativement intitulé en latin de deo Socratis, comme si le daimôn se résolvait in fine en un dieu.
Par ailleurs, une chose frappe à la lecture du livre de V. Pirenne-Delforge, à savoir que la pratique cultuelle n’est pas systématiquement corrélée à un niveau d’éducation donné ; or, pour qui a les thèses de Dodds en tête, ce point peut dérouter. Si celui-ci avait noté l’évolution de la notion de daimôn, il l’avait inscrite dans un processus de délégitimation relative à l’instruction, les catégories les plus cultivées s’étant progressivement détournées de l’idée de daimôn. Analysant les passions, l’historien avait montré que les Grecs avaient eu tendance à y voir initialement quelque chose de mystérieux, une force présente en l’homme mais non explicable par ce dernier ; mieux encore, le terme même de pathos associé aux passions impliquait par sa passivité l’idée d’une réception extérieure par laquelle quelque chose d’une puissance divine était reçu et subi ; mais en même temps, dans le public cultivé, une telle lecture des passions avait fini par s’estomper, la passion devenant un élément humain et purement humain, et non l’occasion de l’expression d’une force extérieure. « Le monde démonique s’est retiré, laissant l’homme seul avec ses passions[18]. » Rien de tel chez V. Pirenne-Delforge pour qui la question démonique est moins un problème de cas-limite pour la raison, impliquant une adhésion différenciée selon le degré d’instruction, qu’un fait textuel et cultuel dont il s’agit d’établir les variations et l’étendue et non la légitimité.
C’est là que, peut-être, émerge une certaine frustration ; en suspendant toute évaluation de la notion, en suspendant même toute explication de ce qui est évoqué au profit d’une portée essentiellement documentaire, le propos affecte une neutralité qui n’est pas sans risque. Prenons par exemple le cas de Phaéthon : d’où provient le privilège de son identification ? Pourquoi est-ce spécifiquement lui dont on retrouve le nom dans un texte d’Hésiode ? Tout de suite vient à l’esprit une question sur son nom lui-même : par son étymologie, Phatéhon évoque la « brillance » dont on peut se demander si elle est explicative de son identification en vertu de la lumière dont il est porteur. En outre, associé à la légende de la chute, il n’est plus véritablement membre du monde divin – Zeus le foudroie pour le punir d’avoir embouti le soleil et mis le feu à la Terre – et n’est pas non plus un homme ; certes, Hésiode en fait un desservant du temple d’Aphrodite mais son histoire particulière en fait un être particulier qui semble justifier son statut d’intermédiaire démonique.
De même, l’idée que la distinction entre le dieu et le daimôn s’inscrive dans la question de l’action rencontre certaines limites, notamment lorsque l’on sort du corpus littéraire et poétique ; la très célèbre anecdote de Porphyre au sujet de Plotin, quelle qu’en soit la motivation, impose de relativiser pareille distinction :
« Ainsi, il arriva qu’un prêtre égyptien (…) pria Plotin de venir voir l’évocation du daimôn familier qui était son compagnon. Plotin accepta volontiers et l’évocation eut lieu dans l’Iserion ; c’était là le seul endroit pur que l’Egyptien disait avoir trouvé à Rome. Appelé à apparaître, le daimôn vint ; c’était un dieu il ne faisait pas partie des daimônes[19]. »
Bien sûr, il appartient à l’auteur de circonscrire son matériau documentaire, et licence lui est faite de ne retenir que les textes poétiques et non-philosophiques ; il n’en demeure pas moins que, dans une visée où l’on souhaiterait comprendre ce que peut signifier conceptuellement le daimôn, le croisement avec la philosophie s’imposerait, tout comme deviendrait impérieux le questionnement sur les écarts significatifs entre les usages poétiques et philosophiques du terme.
De surcroît, à de très nombreux moments émerge une série de questions en matière politique : l’idée de daimôn exprime en effet ce sentiment sans doute prégnant d’une humanité ne se sentant ni véritablement maîtresse d’elle-même, ni véritablement autonome, ce que l’auteur suggère à de nombreuses reprises ; mais alors, au regard de la conceptualité grecque du politique, on est amené à se demander comment s’articulent éventuelle action démonique des divinités poliades sur la cité, autonomie du politique, et détermination de ce dernier comme sphère spécifiquement humaine de l’action. Le politique est-il, pour les Grecs, le domaine réservé de l’homme se dispensant de l’action démonique ? Mais pourquoi dans ce cas confier une cité à la protection d’une figure divine ? Et quelle différence se joue-t-elle entre les cités confiées à des divinités poliades et celles n’étant sous la tutelle « que » d’un daimôn ? Les prières et les apostrophes peuvent-elles être menées en matière politique ? Ce sont là des questions qui viennent immédiatement à l’esprit et qui invitent à poursuivre la réflexion sur la figure du daimôn bien au-delà de l’ouvrage.
Mais, nonobstant certaines frustrations liées à des passages se refusant à l’explication au profit d’une simple description de ce qui est disponible, l’ouvrage apporte de substantielles clarifications quant à la nature et aux usages différenciés du daimôn au sein du monde grec pris en ses multiples dimensions. Mieux encore, en suscitant l’interrogation au-delà de ce qu’évoque le livre, l’auteur éveille un intérêt durable pour la notion abordée et stimule la curiosité pour cette figure démonique dont elle a brillamment contribué à asseoir encore un peu plus la légitimité au sein du champ académique.
***
[1] Cf. Vinciane Pirenne-Delforge, L’Aphrodite grecque. Contribution à l’étude de ses cultes et de sa personnalité dans le panthéon archaïque et classique, Liège, Presses universitaires de Liège, 1994.
[2] Vinciane Pirenne-Delforge, Daimôn. Modalités de l’action des dieux en Grèce ancienne, Paris, Les Belles Lettres / Collège de France, 2025.
[3] On peut consulter ici l’argument du cours : https://www.college-de-france.fr/fr/agenda/cours/dieux-daimônes-heros-1/daimôn-dans-epopee-homerique
[4] David Vachon, La théurgie et la mystagogie dans la de Proclus, Paris, Paris, Vrin / Laval, Pul, Collection Zêtêtis / Vrin, 2024.
[5] Vinciane Pirenne-Delforge, Le polythéisme comme objet d’histoire, Paris, Fayard / Collège de France, 2018, p. 11.
[6] Daimôn., op. cit., p. 12.
[7] Ibid., p. 30.
[8] Ibid., p. 34.
[9] Ibid., p. 82.
[10] Ibid., p. 281.
[11] Ibid., p. 118.
[12] Ibid., p. 163.
[13] Ibid., p. 283.
[14] Daimôn., op. cit., p. 281.
[15] Ibid., p. 284.
[16] Ibid., p. 199.
[17] Ibid., p. 208.
[18] Eric Robertson Dodds, Les Grecs et l’irrationnel, Traduction Michael Gibbson, Paris, Flammarion, coll. Champs, 1977, p. 186.
[19] Porphyre, Vie de Plotin, 10, 18-23, traduction Luc Brisson et Jean-François Pradeau, in Plotin, Traités 51-54, Paris, GF, 2010, p. 290.







