La première partie de l’entretien est consultable à cette adresse.
B : L’héritage cartésien
AP : Une des subtilités particulièrement appréciables que vous défendez dans votre édition des textes de Leibniz où figure la thématique de la mathesis universalis tient au fait que vous distinguez le rôle de Descartes comme tel de celui de ses héritiers. Des Regulae, on peut dire qu’elles ont « joué un rôle négligeable dans la diffusion du thème de la mathesis universalis au XVIIè siècle[1] » Mais cela n’empêche pas de noter l’ambiguïté de la situation, que vous identifiez fort bien en ces termes :
« La thèse selon laquelle une œuvre comme le De Arte Combinatoria ne ferait que poursuivre le programme cartésien de mathesis universalis, lorsqu’elle se donne pour tâche de proposer une théorie mathématique permettant de traiter toutes sortes de questions allant de la Logique à la Métaphysique, est donc ambiguë : le jeune Leibniz reçoit indéniablement le programme d’une mathesis universalis « cartésienne », dont il s’inspire explicitement, mais ce programme ne correspond pas à celui de Descartes, exposé dans les Regulae, et même pas à celui de ses premiers disciples. S’il se donne pour tâche d’étendre cette mathesis dans le cadre général d’un ars combinatoria, qui pourrait être utile jusque dans les matières métaphysiques, c’est donc selon une autre inspiration[2] »
Quelles seraient donc les caractéristiques qui permettraient de définir une mathesis universalis qui ne soit pourtant pas identique au programme de Descartes ?
DR : Il y a deux aspects dans cette question : d’un côté, il y a le programme défendu par des « Cartésiens » sans être nécessairement celui de Descartes lui-même ; de l’autre, il existe aussi des traditions différentes de la tradition cartésienne auxquelles Leibniz a également eu accès.
Quant au premier point, nous avons vu que les choses sont assez claires : Franz Van Schooten, qui a fait ses études aux Pays-bas et a vraisemblablement eu accès au thème de la mathématique universelle indépendamment de Descartes, publie en 1651 une introduction à la Géométrie qu’il intitule « principes de mathesis universalis ». A partir de là, on va trouver un grand nombre de textes où la mathesis universalis est purement et simplement identifiée avec l’algèbre symbolique. Les auteurs parlent alors de la « mathesis universalis de Descartes » sans se référer du tout au projet des Regulae, qu’ils ne connaissent généralement pas. John Wallis, qui publie une Mathesis universalis en 1657, est exemplaire de ce point de vue. C’est selon ces canaux que Leibniz en a entendu parler à l’époque du De arte combinatoria (à cette époque, le titre de Van Schooten avait même été repris pour l’édition du second volume des commentaires latins à la Géométrie)
Quant au second point, il y a plusieurs sources que Leibniz cite dès avant son arrivée à Paris et qui témoignent d’une familiarité avec d’autres programmes de « mathématique universelle », que j’ai essayé d’exhumer dans mon travail. La plus importante est certainement celle qui provient d’Erhard Weigel, dont Leibniz suit brièvement les cours à Iéna en 1663. Mais je rappelle également que Leibniz était familier d’ouvrages, comme le cours de mathématiques de Vossius où le corpus afférant à la mathématique universelle avant Descartes (de Proclus à Pereira) était déjà exposé très clairement – permettant donc aux lecteurs de l’époque d’accéder à des sources que nos contemporains n’ont pu redécouvrir que par l’étude de Crapulli.
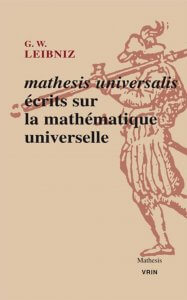
AP : Vous mentionnez un certain nombre d’auteurs, de Van Schooten à Tschirnhaus, en passant par John Wallis qui est d’ailleurs le premier à publier un ouvrage dont le titre mentionne explicitement la Mathesis universalis (1657). On voit à nouveau réapparaître la délicate question de la quantité, mais aussi le rôle des symboles et l’élaboration conséquente d’une algèbre symbolique. Il semble que Leibniz, au moins un temps, hérite des cartésiens l’usage d’une certaine symbolique porteuse de l’universalité en mathématique. Est-ce là ce que Leibniz aura de plus « cartésien » dans les années 1679-1685 et est-ce encore en lien direct avec la mathesis universalis ?
DR : Oui, les premières mentions de la mathesis universalis que l’on trouve chez Leibniz l’associent à un strict équivalent de l’algèbre, dont l’universalité proviendrait de sa nature symbolique. Mais il faut alors se rappeler que Leibniz n’est pas d’accord avec cette position : d’une part, il pense que la Symbolique a une universalité plus grande que l’algèbre ; c’est ce qu’il évoque dès le début des années 1670 au titre de la « Caracteristique » ; d’autre part, mais les deux traits ont liés, il considère que la mathesis cartésienne est encore trop focalisée sur la seule quantité (qu’il faudrait donc étendre, selon le vocabulaire de Leibniz à cette époque », à la « forme » ou à la « qualité »).
Au moment où Leibniz reçoit le programme « cartésien » d’une mathesis universalis comme algèbre symbolique, il s’en démarque donc en faisant valoir la possibilité de ce qu’il désignera, dans un texte célèbre des années 1680, comme les éléments d’une « nouvelle » mathesis universalis. Un trait frappant de ce texte-programme est que l’universalité n’y est justement pas portée par les symboles eux-mêmes, mais par ce qu’ils expriment. Ce qui fait l’universalité de cette science, d’après Leibniz, est alors sa capacité à traiter en mathématiques de la quantité et de la qualité, de la grandeur et de la forme, qui sont les objets de l’imagination. Il en résulte que ce qui fonde l’universalité de cette science, dans les termes de l’époque, est sa capacité à offrir une « logique de l’imagination » (logica imaginationis). Une autre surprise de l’étude du corpus est que Leibniz va ensuite revenir, au début des années 1690, à une conception apparemment plus étroite de la mathesis universalis, où elle s’identifie à nouveau à l’algèbre considérée comme science universelle de la seule quantité. Mais je suppose que nous aurons l’occasion de revenir sur cette chronologie.
AP : Que peut-on dire de l’ars inveniendi déjà présent chez les héritiers de Descartes, notamment Malebranche et Tschirnhaus ?
DR : On trouve chez Tschirnhaus et chez Malebranche une tendance assez nette à rapprocher la méthode du rôle que peut jouer l’algèbre symbolique dans les sciences. Cette identification est naturelle dans un contexte où l’héritage de Viète est encore très prégnant. L’argument de Viète, bien connu, est que la « nouvelle algèbre » est une mise au jour de techniques cachées par les Anciens au titre de l’analyse (c’est un thème que reprend d’ailleurs Descartes dans les Regulae lorsqu’il évoque la vera mathesis, soutien du projet d’une « analyse nouvelle »). Or, à la Renaissance, le thème de l’analyse a rejoint celui, plus général, de l’ars inveniendi hérité de la rhétorique quintilienne. Il est donc naturel d’associer l’analyse mathématique à une méthode plus générale qui fonde les raisonnements et s’apparente à une « logique de l’invention ».
Cela dit, si Leibniz hérite clairement de ce projet d’une « logique de l’invention », porté notamment par le courant « philippo-ramiste », il n’en vient pas moins d’une tradition mathématique différente. Ses premiers travaux, bien que peu avancés encore, sur l’art combinatoire, une discipline qui paraît plus « synthétique » qu’« analytique ». C’est pourquoi il n’a de cesse dès le milieu des années 1670 de se battre contre l’identification de l’ars inveniendi à l’analyse, et plus étroitement à l’algèbre. A ses yeux, il y a une partie de l’ars inveniendi qui est portée par l’approche combinatoire et qui se rapproche donc plus de la synthèse (comme on peut le voir dans ses travaux mathématiques par l’usage heuristique qu’il peut faire très tôt des tableaux ou des combinaisons symboliques « aveugles »). C’est un des motifs de son opposition aux programmes de Tschirnhaus et Malebranche, qu’il côtoie l’un et l’autre à Paris. Il y revient ensuite très souvent dans les textes méthodologiques et encyclopédiques des années 1680.
C : La périodisation de l’usage leibnizien de la mathesis universalis
AP : Rentrons à présent dans l’analyse interne des propos de Leibniz ; vous distinguez deux périodes dans la réflexion de ce dernier autour de la thématique qui retient votre attention, la première courant de 1679 à 1686-87 où s’élabore le projet d’une « logique de l’imagination » et une seconde à partir du milieu des années 1690 où se trouve visé le projet d’une logica mathematica, identifiée à l’algèbre. Ce sont là les périodes où Leibniz parle explicitement et longuement de la mathesis universalis ; mais on peut se souvenir que dès 1666, il parle « d’éléments de mathesis universalis » en se référant à l’édition de la Géométrie de Descartes. Vous mentionnez la question du rapport de la mathesis universalis à la géométrie cartésienne dans un article presque contemporain de votre édition des textes de Leibniz, et dites qu’au sujet du Leibniz de 1666, « on peut parler d’un premier projet de mathesis universalis, à condition de bien prendre garde que Leibniz n’utilise alors jamais ce terme en son nom propre[3]. » Pourriez-vous préciser quel serait le contenu de ce premier projet et comment expliquez-vous qu’à cette date Leibniz ne reprenne pas en son nom propre le nom qui pourtant semble s’imposer ?
DR : Comme il l’a raconté lui-même à plusieurs reprises, Leibniz n’avait qu’une connaissance très rudimentaire des mathématiques avant son arrivée à Paris, en 1672. En particulier, il ne connaissait les travaux de Descartes et de ses successeurs que de loin. C’est Huygens qui le forcera à entreprendre cette étude de manière poussée à partir de 1673. Dans le monde baroque où évolue le Leibniz de 1666, le nom de la discipline « universelle » n’est donc pas mathesis universalis, mais bien ars combinatoria. Par analogie, on peut donc dire que le premier projet de « mathématique universelle » chez Leibniz est porté par l’ars combinatoria et le fait qu’il cite l’édition de Van Schooten autorise une telle association. Comme il le redira au duc Jean-Frédéric en 1671, sa première ambition est de prolonger le projet « cartésien », centré sur l’analyse algébrique, sous la forme d’une combinatoire universelle. Mais il faut voir que cette association est néanmoins la source de tous les malentendus, car nombre de commentateurs, confondant ici le vocabulaire des acteurs et celui de l’observateur, considèrent que Leibniz identifiait donc les deux disciplines. Or ce n’est pas le cas et un trait remarquable du corpus est précisément de n’y voir cette identification jamais faite. Il « suffit » de lire les textes pour le constater. Même dans les projets les plus ambitieux de « nouvelle mathématique universelle », l’ars combinatoria garde une forme de prééminence sur la mathesis universalis (par différence avec la combinatoire mathématique au sens strict qui, elle, peut être intégrée à la « mathématique universelle »).
AP : Une des thèses récurrentes de votre travail consiste justement à prévenir l’identification ou la réduction de la mathesis universalis à l’ars combinatoria et à la characteristica universalis, réduction souvent appuyée sur un passage des Nouveaux essais sur l’entendement humain (NEEH, IV, 17, § 4). Je vous cite :
« Si Leibniz avance indéniablement à plusieurs reprises une subordination de la mathématique universelle à l’ars combinatoria, ce ne peut être que dans une acception différente de celle d’un « calcul universel » qu’on appliquerait à différents domaines (par spécification d’axiomes)[4]. »
En quelle acception faut-il alors l’entendre ?
DR : Comme l’a souligné joliment mon collègue Arnaud Peletier, le commentaire leibnizien a une fâcheuse tendance à fonctionner par anadiplose (comme dans la chanson : « chapeau de paille-paillasson-somnambule… »). De ce que Leibniz rapproche certaines notions, comme celles que vous avez citées, on conclut un peu rapidement que la dernière dans la liste équivaut à la première citée, sans se soucier du contexte dans lequel tel ou tel rapprochement a été fait. Comme nous l’a enseigné en France Michel Fichant, seule une étude fine de la chronologie permet alors d’échapper à la projection d’un grand « système » englobant qui, parce qu’incohérent, permet de faire dire à Leibniz à peu près tout et n’importe quoi.
Si donc il arrive à Leibniz – quoique bien plus rarement qu’on ne le croie – d’identifier combinatoire, caractéristique générale et calcul universel, il faut bien prendre conscience que c’est ou bien à titre d’un simple programme à la fin des années 1670, ou bien sur la base du calcul « des ingrédients » (ou de continente et contento) qu’il élabore au milieu des années 1680. Mais que constate-t-on alors ? Au lieu de se saisir de ce succès pour pousser plus avant son projet contemporain d’une « nouvelle » mathesis universalis, Leibniz l’abandonne purement et simplement ! Comme vous l’avez évoqué, il revient alors significativement à l’idée d’une mathématique universelle qui ne serait pas un calcul universel, mais un calcul purement algébrique, limité à la quantité et dont il faut exhiber la structure logique (ce qu’il appelle logica mathematica, qu’il faut donc entendre comme une logique interne au calcul algébrique, par différence avec un calcul logique général).
Comment expliquer cette évolution à rebours de ce que l’on aurait pu attendre ? Mon hypothèse est qu’elle est liée à certains aspects techniques qu’il ne faut pas minimiser. En particulier, Leibniz perçoit alors qu’un calcul logique des notions doit poser en axiome la loi d’idempotence (A + A = A). Or, comme il le note immédiatement, cette loi ne s’applique pas aux grandeurs (où A +A = 2A). Le calcul logique ne devient donc réellement universel au milieu des années 1680 (c’est-à-dire en capacité de traiter toutes les notions) qu’à ne plus pouvoir porter directement sur la partie des mathématiques qui traite de la quantité ! Et c’est précisément cette dernière, et non pas le calcul logique, qui va alors hériter du programme d’une « mathématique universelle ». L’inverse aurait pu être vrai, certes, mais l’histoire ne s’écrit pas, malgré qu’en ait certains commentateurs, au conditionnel, fût-il passé.
C’est pourquoi j’insiste beaucoup sur le fait que le texte des Nouveaux Essais – seul endroit où Leibniz envisage la mathématique universelle hors du domaine de la seule quantité après 1690 et la rapproche du calcul logique – doit être lu avec attention et prudence : Leibniz n’y avance que la logique est la mathesis universalis, mais qu’elle est « une espèce de Mathématique universelle ». Il ne s’agit pas d’une identification, mais d’une analogie – analogie qui s’explique très bien par ce que je viens de rappeler : les deux agissent en position de « calcul général », même si l’un porte sur les notions tandis que l’autre porte sur les quantités. C’est une erreur de ramener alors dans cette architecture le projet d’un « calcul universel » des années 1670, car Leibniz a lui-même expliqué très clairement à partir du milieu des années 1680 en quoi un calcul général des notions ne pouvait maintenir sa position d’universalité sur les mathématiques qu’en limitant les relations qu’il pouvait atteindre (typiquement les relations d’« ingrédience »).
AP : Nous parlions précédemment de l’ars inveniendi dont vous montrez fort bien pourquoi, chez Leibniz, il est d’une part intrinsèquement lié à l’analyse des notions et d’autre part pourquoi il constitue la source de la characteristica. Mais j’ai alors deux questions : lorsque s’estompe l’espoir d’une analyse complète des notions, y a-t-il une répercussion sur la portée de l’ars inveniendi ? Et peut-on dire par ailleurs que l’ars characteristica se révèle progressivement au fondement de l’algèbre ?
DR : Quant à la première question, cela ne fait pas de doute. Dès la fin des années parisiennes (1675-1676), Leibniz se rend compte que son premier programme de « caractéristique universelle », où il s’agissait de parvenir à un alphabet de notions simples primitives que l’on combinerait ensuite pour obtenir toutes les vérités, est utopique, voire impossible à réaliser (je donne dans le livre et ailleurs plusieurs indications sur le rôle qu’ont pu tenir les mathématiques dans ce constat). Il en résulte que l’ars inveniendi ne peut plus avoir pour tâche unique de trouver cet alphabet, mais doit plutôt se reconfigurer. De fait, dit Leibniz, un raisonnement peut être vrai s’il repose sur des « identiques » même si nous n’avons pas encore analysé complètement les notions qu’il implique. Je prépare actuellement un autre ouvrage qui sera entièrement consacré à cette question. De fait, on a tendance à amalgamer cette « réduction aux identiques » à la réduction au seul principe d’identité, alors qu’il s’agit en fait d’une stratégie plus générale d’analyse des concepts mathématiques jusqu’à des relations d’identité primitives. En ce sens, je prétends d’ailleurs que Leibniz a inventé une nouvelle manière de faire des mathématiques en mettant en avant ce rôle de l’analyse conceptuelle.
Quant à votre seconde question, ma réponse serait plutôt négative. A cause de son parcours singulier, Leibniz a très tôt l’idée qu’il y a quelque chose de plus dans la caractéristique que dans l’algèbre symbolique. Dès 1671, il présente son projet d’une combinatoire universelle comme une manière d’étendre les pouvoirs de l’algèbre et par la suite, il sera très explicite sur le fait que l’algèbre hérite de la caractéristique sa puissance d’universalité. Mais ces déclarations sont antérieures au moment où il semble se rendre compte du caractère utopique de son premier programme et ne peuvent donc pas en découler.
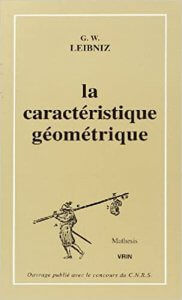
AP : Finalement, si vous aviez à caractériser de manière synthétique – quoiqu’intégrant les évolutions – les rapports de fondation entre ars combinatoria, ars characteristica, ars inveniendi et mathesis universalis, comment les formuleriez-vous ? Et serait-ce tout simplement possible de le faire ?
DR : J’aurais tendance à dire qu’on ne peut justement pas le faire. Il n’existe pas de « grande synthèse » où le rapport de ces différentes notions pourrait être décrit tout en intégrant les évolutions. Cela provient notamment du fait que la mathesis universalis est d’abord perçue par Leibniz comme devant s’étendre à la qualité et à la forme (dans les années 1680), alors qu’elle est ensuite pensée comme relevant de la seule quantité (à partir de 1690). Ces deux projets ne vont pas dans la même direction. En revanche, on peut proposer des synthèses correspondant à différentes époques, différents projets, différentes découvertes. C’est ce que j’ai essayé de faire autour de deux grandes idées : celle de logica imaginationis (typique des années 1680) et celle de logica mathematica (typique des années 1690-1700). On peut remarquer que dans tous ces tableaux, la caractéristique est toujours « au-dessus », ainsi que la « combinatoire » dans son sens le plus général (soit qu’elle s’identifie à la caractéristique, soit qu’elle se restreigne à l’étude des « formes »). On peut en dire de même de l’ars inveniendi qui reste dans tous les cas une méthodologie générale et dont Leibniz insiste à toutes les époques sur le fait que, même en mathématiques, elle ne peut se résorber dans la seule analyse algébrique. Ce qui, en revanche, n’est pas invariant dans les différents tableaux est précisément ce qui nous intéresse : le sens de la mathesis universalis. Bien plus, ces variations rétroagissent sur l’ensemble de la dérivation : par exemple, la combinatoire comme « science des formes » n’a pas le même statut quand la mathesis universalis traite également des formes (auquel cas cette combinatoire au sens étroit peut être subsumée par la mathématique universelle) et quand elle n’en traite plus. Le rapprochement avec la logique est également différent selon qu’existe un calcul méréologique général (« du contenant et du contenu ») ou non.
AP : Un des points également centraux de vos analyses vise à restituer l’importance de la ratio estimandi ; ma première question en la matière sera définitionnelle : que signifie exactement une science de l’estime ?
DR : Cette idée provient très clairement de Weigel et elle est sans mystère. Weigel voulait relancer le projet d’une forme de pythagorisme où les mathématiques seraient une science universelle au sens strict du terme (c’est-à-dire s’appliquant à toutes choses). Un tel projet demandait notamment que les mathématiques puissent s’appliquer à toutes les notions et jusqu’à des domaines pratiques, comme la morale ou la politique. L’idée de Weigel (en quoi il n’est justement pas vraiment pythagoricien !) est qu’une telle universalité ne repose pas sur le nombre et sur la quantification stricto sensu, mais sur le fait que les mathématiques s’occupent plus généralement de différentes manières d’estimer les choses. Ainsi, par exemple, Weigel ne partageait pas l’avis de nombre de ses contemporains qui voyaient une tension entre le modèle logique offert par la syllogistique aristotélicienne et celui offert par les démonstrations mathématiques euclidiennes. A ses yeux, la première était une forme d’analyse au même titre que la seconde, même si elles étaient assurément d’espèces différentes. De fait, elle est bien une forme de calcul qui ne repose pas sur la quantification numérique, mais sur la manière dont nous parvenons à isoler un fonctionnement opératoire des « notions » (c’est dans ce contexte qu’on voit d’ailleurs apparaître, notamment chez son élève Johann Christoph Sturm, les premières représentations des syllogismes au moyen de cercles). D’où l’idée qu’il faut élargir l’idée de mathématique pour qu’elle puisse rendre compte de ce type de « calcul » (en morale, cela donnera lieu aux premières idées d’un « calcul de l’utilité », sur lequel un autre élève célèbre de Weigel, Samuel Pufendorf, édifiera sa théorie du « droit naturel »). Au lieu de la traditionnelle quantitas, Weigel propose de relier ces différents aspects à la possibilité de déterminer des quanta dans différents domaines. D’où l’idée centrale qu’il s’agit d’estimer des aspects quantifiables, sans être directement quantitatifs ou mesurables stricto sensu – une idée que l’on trouve déjà au Moyen âge avec toutes les tentatives pour mathématiser des intensités ou des formes. Cette tradition weigelienne, que l’on commence seulement à redécouvrir aujourd’hui[5], fut décisive dans la pensée de Leibniz.
AP : L’idée weigelienne de la mathesis comme cognitio aestimativa est très étrangère à toute forme de cartésianisme !
DR : Absolument et, à nouveau, cela fut crucial pour Leibniz qui fut tout de suite réticent face à la tendance des Cartésiens à vouloir résorber les mathématiques dans le seul calcul algébrique et le traitement quantitatif stricto sensu. Mais, de manière intéressante, cette opposition a pris des formes assez différentes au cours du temps. Dans un premier temps, Leibniz a considéré que le principal défaut de la mathématique cartésienne était de n’avoir pas su s’ouvrir à différents aspects « qualitatifs » en mathématiques. Dans un second temps, il semble changer d’avis et réinvestit la définition traditionnelle des mathématiques comme science de la quantité, mais ouverte à un sens élargi de la quantité qui permettrait de rendre compte de la mathématisation de l’intensif. Ici l’anti-cartésianisme de Leibniz se marque également par sa volonté de réhabiliter la pensée scolastique de la « latitude des formes », qu’il trouve notamment chez Oresme et Swineshead et dont, comme l’a bien montré Alberto Ranea, il fait grand usage dans ses Dynamica.
AP : Leibniz hérite de l’idée d’une mathesis comme science estimative et relie donc l’universalité de la mathesis à la question de l’estimation, ce qui permettra de développer une logique générale dont l’algèbre n’apparaît plus que comme un cas particulier. Cette influence de Weigel a-t-elle été constante chez Leibniz ou a-t-elle varié en fonction des besoins inhérents à l’évolution de ses recherches ?
DR : L’influence de Weigel a été constante, mais elle n’a pas agi constamment de la même façon sur l’idée d’une mathesis universalis. Dans un premier temps, Leibniz s’appuie plutôt sur l’idée générale d’un calcul symbolique pour étendre le projet de mathématique universelle cartésienne. Son ambition est alors l’élargir le calcul à la « forme » et à la « qualité », un projet dont il trouve une première réalisation mathématique dans ses essais d’analysis situs. L’universalité est alors portée à la fois par le fonctionnement gnoséologique de l’imagination et par la puissance du symbolique. Dans ce cadre, Leibniz ne part pas du rôle de « l’estime » comme fondement de l’universalité. Les choses changent à la fin des années 1680. A partir de ce moment, Leibniz revient à l’idée que les mathématiques traitent de manière centrale de la quantité au sens strict, si bien que la mathématique universelle redevient une « science universelle de la quantité » (ou de la grandeur). C’est dans ce contexte qu’il met alors en avant la définition de Weigel et cela semble naturel : il lui faut, en effet, pouvoir insérer les aspects « qualitatifs », qu’il avait d’abord conçu comme extérieurs au régime du quantitatif, à l’intérieur de la science de la quantité (supposément « universelle »). Pour cela, il doit ouvrir la quantité à un sens large (ce que Weigel appelait quantum) ; c’est précisément ce que la notion d’aestimatio permet (par exemple, dit Leibniz, quand on estime une force par ses effets quantifiables). Le dernier texte de notre recueil déploie ces différents sens de la quantité à partir de question comme celles de « l’angle de contact » ou de « l’estime des forces ».
Conclusions méthodologiques
AP : Dans un article que je trouve remarquable, publié dans le premier collectif français consacré à Leibniz, vous dites que Leibniz ambitionne de concilier une mathématique universelle avec une métaphysique de l’individuation, mais que l’on a tendance à y voir des contradictions du fait même que l’on reconstruit artificiellement sa supposée pensée mathématique sans tenir compte des évolutions et des problèmes spécifiques que traite chaque période, ce que vous avez rappelé au cours de notre discussion[6]. Il est vrai qu’existe une certaine tendance à picorer et à juxtaposer des morceaux de pensée destinés à produire de manière très artificielle une pensée unifiée qui n’a sans doute jamais existé ; mais si l’on se fait l’avocat du diable, ne peut-on pas vous répondre qu’il doit bien exister au moins un fil directeur autorisant à parler de la pensée de Leibniz, ce sans quoi l’on risquerait de ne pouvoir justement qu’établir des successions divergentes dont on perdrait de vue l’intuition directrice ?
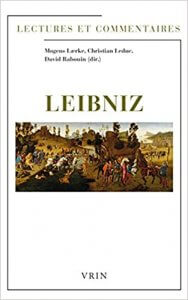
DR : Une précision tout d’abord : l’idée de caractériser la pensée de Leibniz comme mise en tension entre mathématique universelle et métaphysique de l’individuation n’est pas de moi. Elle vient de Husserl, puis, surtout, de son élève Dietrich Mahnke qui, en 1925, avait entrepris dans sa thèse de faire un panorama des interprétations existant à son époque et s’était rendu compte qu’elles étaient effectivement polarisées par ces deux thèmes. L’idée d’aller prélever de-ci de-là des morceaux dans l’œuvre gigantesque de Leibniz – dont la plupart était encore inédite à l’époque – avait précisément nourri une telle tension. Selon qu’on s’intéressait plutôt aux mathématiques qu’on redécouvrait alors (et dans les mathématiques plutôt à la logique ou plutôt au calcul différentiel ou à l’analysis situs) ou à la métaphysique (et, dans la métaphysique plutôt à la doctrine de la liberté ou à celle de la substance, etc.), on obtenait des vues très différentes du « système » de Leibniz. Mais je suis absolument convaincu, comme Mahnke d’ailleurs, qu’il existe sinon un, du moins quelques fils directeurs dans la pensée de Leibniz. Reste que pour les discerner, il ne faut pas fonctionner par simple fiat et se lier les mains en n’étudiant a priori que tel ou tel corpus. Cela suppose donc de saisir à bras le corps ce qu’on pourrait appeler le « problème de Mahnke », c’est-à-dire la réponse à la question : « comment s’articule mathématique universelle et métaphysique de l’individuation ? ». C’est l’objet de l’étude que je suis en train d’achever pour publication et qui a fait l’objet de mon mémoire d’habilitation.
AP : Dans l’article que je mentionnais précédemment, vous célébrez peut-être l’une des gloires de Leibniz, à savoir l’invention d’une mathématique « conceptuelle ». C’est là, dites-vous, « la plus évidente source de son inventivité sans mesure[7] ». Diriez-vous que cette mathématique conceptuelle est le produit d’une réflexion sur la nature même de la mathématique ou une astuce méthodologique extérieure à la nature de la mathématique ?
DR : L’idée de « mathématique conceptuelle » a été fortement mise en avant à la fin du XIXème siècle par un certain nombre d’auteurs, plutôt en contexte allemand, qui entendaient célébrer la puissance des idées contre le calcul. Sous ce point de vue, Leibniz, avec sa défense du calcul « aveugle », n’est pas l’auteur qu’on cite le plus souvent. J’essaye de montrer que ce n’est pas juste et qu’il peut même être crédité d’avoir inventé cette manière de faire des mathématiques où l’analyse des concepts est le moteur de l’invention. Elle provient bien d’une réflexion sur la nature même des mathématiques et, en particulier, de la stratégie que j’évoquais de « réduction aux identiques ». Mais le montrer requiert une étude fine des textes des années 1680, qui formera la trame de l’ouvrage que j’achève sur les rapports entre mathématiques et philosophie chez Leibniz.
[1] Leibniz, Mathesis universalis, Introduction, op. cit., p. 21.
[2] Ibid. p. 25.
[3] David Rabouin, « Sur la Mathesis universalis chez Leibniz », 2018, p. 42.
[4] Leibniz, Mathesis universalis, Introduction, op. cit., p. 17.
[5] Voir notamment la thèse de Mattia Brancato : « ErhardWeigel and His Influence on Leibniz’s Philosophy of Mathematics ». Dir : Professor Gianfranco Mormino. Thèse de doct. Università degli Studi di Milano, 2016.
[6] David Rabouin, « Mathématique et philosophie au fil de l’analyse des notions », in Mogens Laerke, Chistian Leduc, David Rabouin (dir.), Leibniz. Lectures et commentaires, Paris, Vrin, 2018.
[7] Ibid., p. 139.








