En guise de prolégomènes…
Actu-Philosophia : David Rabouin, vous avez dirigé il y a peu la traduction et la publication d’une série de textes de Leibniz tournant autour de la Mathesis universalis[1]. Avec une introduction aussi dense qu’érudite, sur laquelle nous reviendrons abondamment, vous poursuivez votre ambition qui était explicitée dès le début de votre célèbre ouvrage de 2009, Mathesis Universalis, où vous entrepreniez de considérer celle-ci non plus un programme mais un « problème »[2]. Traditionnellement, il est vrai que la mathesis universalis est plutôt vue comme une position par laquelle on établit pour la période moderne l’unité du savoir, et sa formulation dans une langue sinon universelle du moins commune. Mais, dans ce livre, vous pratiquiez une forme de décentrement au sens où vous montriez de manière très convaincante que la Mathesis universalis était moins le nom du fondement de la science moderne que celui d’un problème « consubstantiel au projet d’une métaphysique tout court (…)[3]. » Avant donc d’entrer dans le vif du sujet, j’aimerais vous demander de rappeler de quel problème il est question, et en quoi il concerne le projet général de la métaphysique.
David Rabouin : Le problème attaché à l’idée d’une « mathématique universelle » est simple : il s’agit de savoir s’il est possible de formuler en mathématiques une théorie « universelle », c’est-à-dire qui vaudrait pour tous les domaines d’objets. La difficulté est plutôt de déterminer en quoi un tel problème pourrait concerner la philosophie, voire la métaphysique. Pour le comprendre, j’ai essayé de montrer qu’il faut d’abord se replacer dans le cadre de la pensée grecque ancienne. Un trait frappant des grandes œuvres des mathématiciens grecs classiques – Euclide, Archimède et Apollonius – est, en effet, qu’elles traitent séparément deux domaines d’objets que nous avons tendance à mêler, voire à confondre : les « grandeurs » (objets de la « géométrie ») et les « nombres » (objets de « l’arithmétique »). Cela se manifeste par un fait remarquable : les démonstrations valant pour un des domaines ne sont pas considérées comme valables pour l’autre. Non moins surprenant pour nous : les manipulations opératoires sur ces objets sont formulées de manières séparées et indépendantes pour chaque domaine. On le voit bien au fait qu’Euclide formule deux « théories des proportions » (pour les grandeurs au livres V et pour les nombres au livre VII des Éléments). C’est là le cœur du problème de l’existence d’un éventuel point de vue « universel » en mathématiques.
Or ces faits sont mis en avant par Aristote, en particulier dans les Seconds Analytiques : on ne peut pas, avance-t-il, passer dans une démonstration « d’un genre à l’autre » (c’est le principe de « l’incommunicabilité des genres », dont l’exemple privilégié est précisément la distinction arithmétique/géométrie). Bien plus, le Stagirite y voit le motif d’une objection fondamentale au projet platonicien, tel qu’il se trouve exposé dans des dialogues comme La République. La « dialectique » y figure, en effet, comme « science de toutes choses » et prétend s’appuyer sur l’unité des mathématiques (dans le vocabulaire platonicien : « ce qu’elles ont en commun », leur koinômia). À l’inverse, Aristote défend l’idée qu’une science est toujours attachée à un genre d’objet. Tout savoir visant à une « universalité » complète, comme prétendent l’être la « dialectique » ou ce que lui-même nomme la « philosophie première », sera donc d’un type différent de ces sciences qu’on pourrait dire « positives » et que les Grecs appelaient les mathèmata (ce qui peut être enseigné). Elle devra précisément faire fond sur cette polysémie et cette équivocité de l’être.
Voir la « mathématique universelle » comme problème, c’est reconstituer ce débat occasionné en philosophie par les mathématiques. Cela permet alors de comprendre que les passages où Aristote mentionne une telle « mathématique universelle » (comme en Métaphysique E 1), ainsi que ceux où il évoque une démonstration « universelle » de certaines propriétés des proportions (comme en Anal. Post. I, 5), ne témoignent pas de l’existence d’une théorie mathématique autonome, mais cachée, qu’il reviendrait à l’historien de reconstituer (comme beaucoup s’y sont essayé !). Ils montrent plutôt un Aristote qui s’appuie sur le fait qu’une telle théorie n’est pas formulée de manière autonome et séparée pour faire valoir sa propre interprétation de ce que doit être une « science universelle » et en particulier de ce qui sera nommé après lui une « métaphysique ». On le voit bien en relisant les passages de Métaphysique M et N consacrés à la question de l’universel en mathématiques – passages qui sont rarement mentionnés dans ces discussions, alors qu’ils sont pourtant cruciaux. C’est en ce sens que je dis que le problème d’une mathématique universelle est lié au projet d’une « métaphysique » tout court. Il engage, à partir des mathématiques, une question plus générale sur la manière dont s’exprime l’unité du savoir et une décision « métaphysique » où le projet aristotélicien de « philosophie première » se sépare de l’héritage de son maître, Platon, et d’une certaine figure de la philosophie comme « science de toutes choses ».
AP : Un des points que vous mentionnez dans Mathesis universalis, et qui est sans doute décisif pour comprendre ce que vous direz de Descartes et Leibniz, concerne la Renaissance et l’inflexion qu’on y observe quant au sens du problème que vous avez mentionné ; ce n’est donc pas tant l’interrogation sur les passages d’Aristote de Métaphysique E1 et An. Post I, 5, ni même celle sur les Eléments d’Euclide qui change mais c’est le sens du questionnement qui est infléchi vers la question de la certitude des mathématiques ; ainsi, la question de la communauté et de l’universalité se trouve-t-elle subordonnée au problème de la certitude, et vous dites même que « c’est d’abord par contagion que le thème de la « mathématique commune » semble être parvenu au-devant de la scène à partir de la seconde moitié du XVIè siècle et ce qui explique son succès paraît d’abord la profondeur de la crise qui affecte alors la « certitude des mathématiques ».[4] » Comment rendre compte d’un tel changement ?
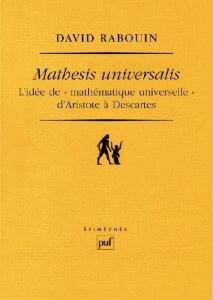
DR : Une des premières enquêtes proprement historiques qui ait été menée sur la mathématique universelle à la Renaissance a été le livre de Giovanni Crapulli paru en 1969[5]. Giovanni recherchait d’éventuelles sources à ce thème avant Descartes (sous des noms variés : « mathématique universelle », « mathesis générale », « science mathématique commune », etc.) et il a alors mis en évidence deux faits importants : d’une part, il existe un corpus assez vaste d’œuvres antérieures à Descartes, qui avaient été jusque-là négligées, sinon ignorées ; d’autre part, l’élément déclencheur du regain d’intérêt qu’on voit naître à la Renaissance est clairement la redécouverte du Commentaire au premier livre des Éléments d’Euclide du néoplatonicien Proclus (œuvre qui n’est pas connue, sinon indirectement, dans le Moyen-âge arabe et latin).
On le voit très bien chez Barocius (Francesco Barozzi) qui occupe la chaire mathématique à l’université de Padoue ; il y fait cours sur le Commentaire de Proclus, qu’il commente ligne à ligne et dont il publie d’ailleurs la première traduction latine « officielle » en 1560 (il existait une traduction cachée dans un traité antérieur de Giorgio Valla). De fait, il l’accompagne de deux petits discours : l’un sur la certitude des mathématiques (de certitudine mathematicarum), l’autre sur leur position médiane dans l’organisation du savoir (de medietate mathematicarum). Il s’agit là d’une réponse à un autre auteur, Alessandro Piccolomini, qui s’était appuyé en 1547 sur l’editio princeps du commentaire de Proclus (paru en 1533) pour mettre en cause la certitude des mathématiques et qui mentionnait déjà à ce titre l’idée d’une « mathématique universelle » (deux sujets pourtant apparemment sans rapport). Barozzi, qui entend défendre la certitude des mathématiques contre ces attaques, provoque à son tour des réponses du professeur de mathématiques au Collège Royal, Pierre de la Ramée, avec lequel dialogue Conrad Dasypodius à Strasbourg (un autre traducteur de Proclus). A Rome, le jésuite Benito Pereira se saisit à nouveau de cette question au milieu des années 1570. Or Pereira est la source citée par les deux seuls auteurs connus à ce jour ayant utilisé le terme précis de mathesis universalis avant Descartes : le mathématicien belge Adriaan Van Roomen et l’encyclopédiste d’Herborn Johann Heinrich Alsted. Le réseau des auteurs traitant de la mathématique universelle est donc clairement un sous-ensemble du débat, plus large, autour de la « certitude des mathématiques ».
Je ne peux pas entrer ici dans le détail de ce débat, mais l’élément important à avoir à l’esprit est que la quaestio de certitudine est une question technique qui interroge moins la certitude elle-même, que le degré de certitude des mathématiques – degré qui est censé pouvoir s’évaluer à partir de la nature causale ou non de leurs démonstrations. Or il est frappant de voir que c’est également un aspect que Descartes met en avant dans les Regulae ad directionem ingenii lorsqu’il introduit le thème de la mathesis universalis. Son point de départ est, en effet, le constat que les démonstrations mathématiques qu’il trouve dans les livres ne semblent montrer ni le pourquoi et le comment[6] – reprise quasi littérale du thème de la certitudo mathematicarum. Il va d’ailleurs concéder qu’à ce titre, il est normal que nombre de lecteurs se détournent des mathématiques, faute d’accéder à ce qu’elles peuvent receler de certain (et qui se trouve caché dans l’analyse des Anciens et sa reprise moderne par les algébristes).
AP : Vous notez en outre que la question de la mathesis universalis, avant Descartes, circule plutôt dans les cercles philosophiques que dans les cercles mathématiques, au point qu’il y aurait eu un « rendez-vous manqué avec l’algèbre[7] ». Comment expliquer cette rencontre manquée ?
DR : Certains des auteurs que j’ai mentionnés sont des professeurs de mathématiques, comme Barozzi, Ramus ou Dasypodius. Mais il est vrai qu’ils sont rarement des mathématiciens créateurs (Van Roomen faisant exception) et que leur enseignement est très philosophique. Le « rendez-vous manqué », dont je parle, concerne plus spécifiquement l’algèbre symbolique alors naissante et il est d’abord le fruit de nos propres attentes. En effet, nous nous attendons à ce que l’algèbre symbolique ait réglé le problème grec, si l’on peut l’appeler ainsi, en fournissant, une authentique théorie « universelle », c’est-à-dire une théorie purement opératoire où l’on manipulerait des symboles qui pourraient ensuite être interprétés soit comme des nombres, soit comme des grandeurs. Et de fait, il est clair que l’émergence de l’algèbre, dès les mathématiciens arabes, a coïncidé avec une redistribution des rapports entre arithmétique et géométrie. Pour autant, on est frappé de voir que cette redistribution s’opère plutôt sous la forme d’un choix, selon qu’on interprète l’algèbre comme étant d’abord de nature arithmétique ou de nature géométrique. Une même dichotomie se retrouve à la Renaissance dans les œuvres des créateurs de l’algèbre symbolique : Viète et Stevin. Si l’algèbre peut bien faire office de théorie générale, surtout pour le premier, c’est sur le modèle d’une « logique » (le parallèle est explicite), héritière à la fois de la syllogistique et de « l’analyse » des Anciens. Au niveau de ses objets, en revanche, ils doivent être, pour Viète, modelés sur ceux de la géométrie – tandis que que Stevin les modèle de son côté sur ceux de l’arithmétique. Mais le point le plus important est que l’on ne trouve ni chez l’un, ni chez l’autre mention d’une « mathématique universelle ».
La seule exception à cet état de fait est Adrian Van Roomen, qui a, de plus, la particularité d’hériter à la fois de Viète et de Stevin, et d’utiliser le mot précis de mathesis universalis. Certains commentateurs en ont conclu qu’il identifiait donc mathématique universelle et algèbre, identification dont hériterait à son tour Descartes. Mais j’ai montré qu’une lecture attentive ne permet pas une telle conclusion. Le fait est que Van Roomen maintient toujours la distinction entre ces deux disciplines, même s’il voit qu’elles doivent être liées l’une à l’autre. Son référent premier pour la première reste une « théorie des proportions » reformulée – assez maladroitement d’ailleurs – pour pouvoir fonctionner pour les nombres et les grandeurs : soit le candidat le plus ancien, déjà mis en avant par Proclus, pour exemplifier la possibilité d’une théorie universelle en mathématiques. C’est ce modèle qu’on retrouve d’ailleurs chez Descartes et auquel fait allusion le célèbre passage de la seconde partie du Discours de la méthode où il évoque son parcours mathématique[8]. Même lorsque la mathesis universalis et l’algèbre sont donc au plus proche, comme chez Van Roomen et Descartes, elles restent distinctes. Les choses changeront précisément après Descartes.
AP : On voit ainsi toute la complexité et toute l’inflexion problématique qu’a connues l’histoire de la mathesis universalis, qui incite à revoir peut-être sa place dans la pensée moderne. La longue introduction que vous consacrez aux écrits de Leibniz portant sur la Mathesis universalis commence par une sorte de prise de distance à l’endroit d’un topos de l’histoire de la philosophie qui se retrouve aussi bien dans l’approche néokantienne que dans les textes heideggériens et foucaldiens, à savoir que la Mathesis universalis serait le symbole de la modernité philosophique et scientifique et que, de surcroît, elle serait d’inspiration cartésienne ; vous convoquez ainsi, entre autres textes, la Logique des sciences de la culture de Cassirer, Qu’est-ce qu’une chose ? de Heidegger ou encore Les mots et les choses de Foucault. Et, analysant cette étrange convergence, vous écrivez :
« Cette présentation du « cosmos de la mathématique universelle » et de sa place dans l’émergence de la science moderne, bien qu’elle soit encore très répandue dans le commentaire, est doublement trompeuse : outre qu’elle méconnaît l’ancienneté de l’idée et fait jouer un rôle au traité de Descartes qu’il ne peut avoir eu, elle donne à croire que ce thème tient une place centrale dans le « rationalisme classique », aussi bien dans son rêve supposé d’une mathématisation du réel que dans sa foi supposée en la méthode géométrique (mos geometricus)[9]. »
J’aimerais vous poser une question sur les conséquences de cette erreur avant de creuser les raisons de cette dernière. Prenons par exemple Heidegger : il affirme dans Besinnung que « die mathesis universalis des Descartes [10]» fait partie des quatre grands concepts fondateurs de la métaphysique avec ceux d’Aristote, Platon et Kant. Tout votre propos vise à montrer que ce type d’affirmations repose sur une surdétermination du rôle de la Mathesis universalis ; mais quels sont les effets concrets d’une telle erreur ? Je veux dire par là, qu’est-ce que cette erreur amène à voir qui, pourtant, n’existe pas comme tel, et, inversement, qu’est-ce que cette erreur amène à manquer ?
DR : Un premier effet très concret de ce genre d’interprétation est qu’il existe aujourd’hui un grand nombre de discours sur la mathesis universalis, plus ou moins savants (mais souvent d’apparence très savante), qui n’ont tout simplement aucune idée de l’histoire de ce thème. Ils se contentent alors d’y projeter leurs propres fantasmes sur ce qui est censé avoir constitué notre « modernité » scientifique et philosophique. Si vous le faites remarquer, on vous objectera que vous vous perdez dans l’histoire « érudite », dans des détails qui vous font manquer le changement global de « cadre de pensée » qui s’effectuerait sous ce thème chez Descartes ou, plus généralement, dans notre « modernité ». Peu importe, sous ce point de vue, que des auteurs mineurs de la Renaissance en aient déjà parlé auparavant ! Tout aurait changé avec Descartes…
J’ai essayé d’aller plus loin que Crapulli sur ce point en montrant qu’il n’y a pas du tout de changement radical attaché à ce terme chez Descartes (ce n’était pas l’objet de Crapulli qui arrête son corpus avant). La célèbre Règle IV, où le terme de mathesis universalis est introduit, dit en effet très clairement que c’est un nom ancien et « reçu par l’usage », une discipline dont tout le monde connaît le nom et, surtout, dont tous « entendent ce dont elle se préoccupe », qui « surpassent en facilité les autres sciences », etc., etc. Toutes choses que confirme justement l’histoire érudite. Rien, surtout, qui puisse correspondre, dans les termes de Descartes lui-même, à un programme – et encore moins à un programme faisant rupture dans l’histoire de la pensée.
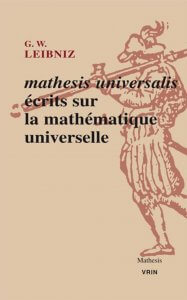
Au-delà des querelles d’interprétation, on peut faire remarquer que les partisans de ce que j’appelle avec Nietzsche « l’histoire monumentale » sont pris dans une contradiction pratique intéressante : ils ne mettent pas leur méthode à l’épreuve de leurs propres sources. Il est pourtant assez facile de voir que la mathesis universalis, dans le sens qu’ils lui donnent, appartient à un « cadre de pensée » très singulier qui est celui non pas de l’âge classique et de la « rupture cartésienne », mais du XIXème siècle et de la « rupture kantienne ». Dans ce contexte, on voit, en effet, les néokantiens sauter sur la redécouverte des Regulae ad directionem ingenii pour y discerner les contours du « bon » Descartes, celui qui se serait limité à l’élaboration d’une théorie de la connaissance accompagnant sa méthodologie scientifique (avant de s’égarer par la suite dans des questions « métaphysiques » concernant Dieu et l’immortalité de l’âme). À l’inverse, Heidegger entend montrer que le projet des Règles est déjà de part en part un projet « métaphysique » (c’est encore l’idée que défend Jean-Luc Marion qui y discerne une ontologie « grise »). Dans ce contexte, mathesis universalis devient un mot-slogan du début du XXème siècle censé arbitrer le débat post-kantien entre théorie de la connaissance et ontologie. Pourquoi pas ? Mais il faut au moins être conscient que ce sens n’a tout simplement rien à voir avec celui des acteurs du XVIIème siècle.
Remarquez qu’on peut faire exactement le même type de commentaires sur les usages de la mathesis universalis de Leibniz. Les positivistes logiques l’ont mise en avant à peu près au même moment pour faire valoir leurs propres conceptions de la supériorité de la logique dans l’analyse des problèmes philosophiques. Cette fois, mathesis universalis devenait plus ou moins synonyme de la « caractéristique universelle », elle-même assimilée au rêve d’un « calcul (logique) universel ». Et personne ne se soucie d’aller voir si Leibniz a fait ses identifications, qui persiste jusqu’à aujourd’hui dans le commentaire ! Or il ne les fait justement jamais. Mais nous y reviendrons par la suite, je suppose.
A : Descartes et la mathesis universalis
AP : Dans votre présentation des écrits de Leibniz, et fort de vos travaux antérieurs, vous pouvez montrer que la présence de la mathesis universalis chez Leibniz ne saurait être unilatéralement ramenée à l’héritage des Regulae, ne serait-ce que parce que Leibniz avait eu accès à cette notion bien avant qu’il ne prenne connaissance des Regulae (en 1676), puisque le thème joue un rôle dès le De Arte Combinatoria de 1666.
Cela pourrait nous inciter dans un premier temps à nous demander quel sens revêt la mathesis universalis chez Descartes. Je me permets à cet égard de rappeler une de vos distinctions que je trouve convaincante : si vous acceptez fort bien l’idée selon laquelle il y a un lien indiscutable entre mathesis universalis et méthode, et même que celle-là ait pu servir de fondement à celle-ci, il serait excessif d’en déduire que la mathesis universalis soit identique à la méthode. Où se joue alors la différence entre les deux ?
DR : Le sens dont hérite Leibniz avant qu’il prenne connaissance des Regulae est clairement issu du titre qu’avait donné l’éditeur de Descartes, Franz van Schooten à son introduction à la Géométrie : « principes de mathématique universelle »[11]. Dans ce contexte, il devient très courant dès l’époque d’identifier l’algèbre symbolique à la mathesis universalis, elle-même soutien de la réforme de la géométrie promue par Descartes en 1637. Mais ce sens n’est pas celui qui est mis en avant dans les Regulae (il n’y est jamais question du traitement des courbes géométriques alors que c’est le cœur du projet de la Géométrie). Bien plus, lorsque Descartes introduit le terme, il précise qu’il n’est nul besoin de lui donner un nom « barbare » (comme algèbre justement) et qu’il s’agit d’une discipline très ancienne. J’ai déjà rappelé que, plus généralement, la mathesis universalis n’est jamais présenté par Descartes comme un programme, comme on peut le croire en l’amalgamant à la « vraie mathesis » dont il est également question dans la Règle IV ou à l’« analyse nouvelle » qui apparaît dans la première partie de la règle et que le traité entendait promouvoir.
Cela se manifeste notamment au fait qu’elles ont des propriétés très différentes : la « vraie mathesis », comme la « nouvelle analyse », sont des disciplines dont Descartes dit qu’elles sont cachées, difficiles d’accès, qu’il faut adapter pour le lecteur néophyte. À l’inverse, la mathesis universalis est décrite comme une discipline bien connue de tous, très simple et dont personne ne se préoccupe tant elle semble élémentaire. Sous ce point de vue, c’est Descartes lui-même qui fait explicitement la différence entre méthode et mathesis universalis en rappelant à la fin de la Règle IV que « l’ordre dans la connaissance des choses » commande de s’occuper des choses les plus simples et que c’est la raison pour laquelle il s’est occupé de la mathesis universalis avant de s’occuper de sciences « plus relevées ».
Le fait que la mathesis universalis soit décrite comme « une science de l’ordre » (et de la mesure) et que la méthode soit définie comme capacité à « disposer en ordre » (les choses vers lesquelles doit se tourner la vue de l’esprit) a fait parfois confondre les deux (et corrélativement les deux types d’ordre : celui qui prévaut entre les objets et celui qu’il s’agit de suivre dans l’acquisition des connaissances). Mais le texte n’autorise pas un tel amalgame et j’ai essayé de faire valoir qu’un des buts important de Descartes dans les Règles est précisément de mettre en avant différents niveaux où opère la question de l’ordre.
Pour autant, Descartes dit bien qu’il a tiré de son étude de la mathesis universalis des réflexions méthodologiques et il est donc clair que les deux ne sont pas non plus sans lien. À mon sens, ce lien est exposé dans la Règle VI quand Descartes explique, à partir d’un exemple tiré de la théorie élémentaire des proportions, comment il est venu à la distinction entre ce qu’il appelle déduction « directe » et « indirecte ».

AP : Si l’on avait à situer Descartes dans l’histoire du « problème » tel que vous l’avez identifié, on voit assez vite que deux domaines peuvent être distingués. D’un côté, Descartes paraît assez classique dès lors qu’il est question de l’unité des domaines d’objets mathématiques, c’est-à-dire qu’il paraît classique dans sa manière de problématiser le thème. Sa singularité se situe donc ailleurs, vous l’identifiez dans une certaine manière de concevoir les rapports entre la simplicité et la déduction, sachant que la mathesis y est conçue comme le soutien du passage d’une deductio à l’autre : la simplicité, dites-vous, n’est pas antérieure à la déduction, le plus simple n’est pas un donné antérieur à la déduction. Et, de proche en proche, vous parvenez à l’interprétation suivante :
« Loin d’établir la position triomphante d’un sujet « maître et possesseur » de ses objets, et d’une mathesis universalis arraisonnant le réel dans les rets de ses déductions trop limpides, elles montrent comment le sujet en est réduit à « observer » la structure problématique des objets dans la résistance (dans les « difficultés ») qu’ils offrent à la construction[12]. »
Pourriez-vous ici expliciter ce que vous entendez par la résistance offerte par les objets à la construction qui en est faite ?
DR : Depuis l’Antiquité, il existe une tension entre deux manières différentes, mais complémentaires, d’approcher les mathématiques : par les « théorèmes » et par les « problèmes ». En contexte grec, cette distinction rejoint, sans s’y confondre, celle existant entre ce qu’ils nommaient la « synthèse » et « l’analyse ». Dans l’approche synthétique, il est naturel de voir les objets comme intégralement livrés à nos manipulations, et en particulier aux opérations que l’on peut faire agir sur eux. Mais ce type de synthèse, les Grecs en étaient très conscients, vient souvent après coup. Elle nous livre une figure du sujet qui maîtrise son savoir parce qu’il a d’abord dû passer par l’analyse et, en particulier, par la plus ou moins grande difficulté à résoudre tel ou tel problème. Or certaines difficultés résistent à l’analyse et elles se retranscrivent donc en régime synthétique par une résistance de certains problèmes.
Descartes, dans l’héritage de Viète mais aussi de Ramus et de ses disciples[13], est un grand défenseur de l’analyse et de l’approche par les problèmes, où il voit la seule vraie figure du savoir en acte. Comme il le redira à Hoguelande, la mathesis doit s’entendre au premier chef comme « habileté à résoudre des questions », le reste n’étant que de « l’histoire », mémorisation d’un savoir mort[14]. C’est là le fondement de sa première remarque méthodologique dans la Règle VI : lorsque l’on entend partir des « choses les plus simples », on ne doit pas se laisser avoir à la plus ou moins grande facilité à construire ces objets dans une synthèse. De fait, un objet facile à construire peut s’avérer très complexe à maîtriser du point de vue des problèmes qu’on lui adresse (pensons à la facilité que nous avons à définir les nombres entiers et aux difficultés à résoudre des questions parfois très simples portant sur eux, par exemple : « trouver deux cubes tels que leur somme soit un cube »).
Descartes illustre ce fait avec l’exemple des moyennes proportionnelles qu’on peut construire ad libitum, mais qui peuvent s’avérer très difficiles à trouver dès lors qu’il s’agit de les insérer entre des termes distants. Mais il fait alors une seconde remarque méthodologique importante : certains problèmes d’apparence complexe se réduisent à des problèmes plus simples. Il ne faut donc pas non plus se fier à la complexité/simplicité apparente des problèmes et savoir saisir, au cœur de la « méthode », un ordre des difficultés qui émerge du champ problématique lui-même. On ne prend d’ailleurs pas assez garde à ce que la seconde règle du Discours de la méthode ne demande pas à analyser des notions en leurs parties les plus simples, comme l’interprèteront tant de lecteurs dès l’époque (et jusqu’à aujourd’hui !), mais, « de diviser chacune des difficultés (…) en autant de parcelles qu’il se pourrait, et qu’il serait requis pour les mieux résoudre » (c’est moi qui souligne).
AP : Une question peut-être, concernant le texte même des Regulae dans son état éditorial. Est-ce que vos analyses de 2009 ont été modifiées au regard des révélations de Richard Serjeantson ? On sait que ce dernier a découvert à la bibliothèque de Cambridge ce qui s’apparente à une ébauche des Regulae, laquelle ne contient que les règles I à XVI, et ne contient pas la règle IV-B où se trouve développée la notion de mathématique universelle. Or, depuis les travaux de Jean-Paul Weber reconstituant les étapes supposées de la méthode[15], chacun considérait que le texte consacré à la mathesis universalis correspondait à une sorte de proto-pensée cartésienne qui, par la suite, se serait affinée avec la méthode générale. Mais le manuscrit de Cambridge ne comporte pas de développement sur la mathesis (ni d’ailleurs sur les natures simples). Cette découverte datant de 2012, a-t-elle un impact quant à vos travaux antérieurs ?
DR : Le fait que la mathesis universalis n’apparaisse pas dans la copie trouvée par Serjeantson confirme dans leur interprétation tous ceux qui, comme moi, soutenaient que la mathesis universalis a d’abord à voir avec les mathématiques et non avec la « méthode » (qui lui préexiste plutôt qu’elle n’en provient). Serjeantson a donné plusieurs éléments indiquant que la copie qu’il a retrouvée est une copie d’auteur (c’est-à-dire que les variantes y sont le fait de Descartes et non d’un copiste) et qu’elle est antérieure aux versions qu’on connaissait jusqu’à présent.
Dans la lecture de Weber, reprise par de nombreux commentateurs, « IV-B », la partie où apparaît la mathesis universalis, est censée être une version ancienne (remontant même d’après lui à 1619 !). Elle correspondrait à un projet que « IV-A » n’aurait fait que reformuler ensuite au titre de la « méthode » (c’est la même thèse que défend Jean-Luc Marion et qui conduit à identifier mathesis universalis et vera mathesis pour assurer un parallèle avec la « nouvelle analyse » présentée dans la première partie de la Règle). La nouvelle copie tend à montrer que c’est l’inverse qui s’est produit : IV-B semble être venue après, en même temps que les dernières règles exposant une première version (maladroite) de « calcul géométrique » (Règle XVI et suivante). Avec Frédéric De Buzon, qui défend une lecture comparable à la mienne sur la mathesis universalis, nous avons été sollicités par Serjeantson pour l’expertise des règles les plus mathématiques (à partir de la règle XIV). Nous avons donc eu accès à la retranscription complète du manuscrit. J’ai pu alors la parcourir intégralement et trouver une autre confirmation importante de mes vues : tout ce qui concerne la distinction entre déduction directe et indirecte, qui forme le cœur de la Règle VI dans les versions que nous connaissions, a été ajouté en même temps qu’apparaît la mathesis universalis et le projet d’un calcul géométrique permettant de traiter les questions simples (Règles XVI et suivantes).
AP : Je me permets d’insister sur un point méthodologique : dans vos écrits postérieurs à 2012, vous ne vous appuyez pas sur la découverte de R. Serjeantson ni sur les hypothèses qui en découlent pour accentuer le caractère improbable d’une responsabilité cartésienne dans la diffusion du thème de la mathesis universalis. Vous dites d’ailleurs dans un article consacré à la mathesis universalis chez Descartes que la copie découverte par Serjeantson, précisément parce qu’elle ne contient pas le passage de la Règle IV, n’apporte rien de directement signifiant quant à votre propos[16].
DR : L’article auquel vous vous référez est une étude interne des rapports entre mathesis universalis et algèbre et n’a de sens que pour les copies les plus développées des Regulae (puisqu’aucun de ces thèmes n’est développé dans la copie de Serjeantson). Cette interprétation reste inchangée qu’on considère que ces passages ont été insérés dans une trame existante ou non. En revanche, comme je l’ai indiqué dans ma réponse précédente, il est clair que la découverte de Serjeantson va dans le sens de mon interprétation globale sur la position de la mathesis universalis dans le traité et, plus généralement, dans l’œuvre de Descartes.
Cela ne change rien, en revanche, à la question de la circulation du thème. Le fait que les Règles n’aient pas joué le rôle qu’on leur fait jouer est moins une affaire d’interprétation, que d’étude historique de la réception de cet ouvrage. Cette étude a déjà été faite par Crapulli et elle a montré que la première réception, très limitée, se fait en hollandais en 1684, puis, surtout, en latin en 1701 (avec la publication des Opuscula Posthuma de Descartes à Amsterdam). Comme nous ne connaissons pas à ce jour de réception à la copie retrouvée par Serjeantson, ce constat reste en l’état : la réception des Regulae se fait soit par des auteurs qui ont eu accès directement à des copies manuscrites (Arnauld, Leibniz, Tschirnhaus, vraisemblablement Malebranche), soit essentiellement après 1701. Il est donc faux qu’on puisse lui attribuer une influence importante sur les conceptions développées à l’âge classique et ce d’autant que la plupart des auteurs qui ont accès aux manuscrits n’accordent pas une grande importance au thème de la mathesis universalis (qu’ils lisent déjà à travers le prisme de son usage par Van Schooten et donc de son identification à l’algèbre symbolique).
AP : Pour finir l’analyse des thèses cartésiennes, j’aimerais évoquer l’interprétation qu’a faite Frédéric de Buzon de la mathesis ; ce dernier a proposé une lecture très intéressante de la mathesis pura dans un ouvrage relativement récent[17] ; il y montre comment l’héritage ramiste du quadrivium se distribue en mathesis mixta et mathesis pura, Descartes n’innovant nullement quant à la mathesis universalis mais se singularisant à travers la question de la mathesis pura, notamment à travers la version latine de la Vème Méditation et l’article 64 de la Seconde partie des Principia. Or, selon l’interprétation très stimulante de F. de Buzon, la mathesis pura élimine la question du nombre et de l’arithmétique pour se concentrer sur la question du mouvement, ce qui tirerait la mathesis vers la question des lois de la nature, en instaurant donc une sorte de rupture considérable entre la mathesis universalis et la mathesis pura. A ma connaissance, la question de la mathesis pura ne retient que peu votre attention et je me demandais si vous jugiez féconde l’opposition entre mathesis universalis et mathesis pura.
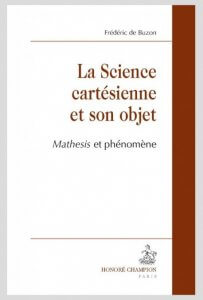
DR : Je partage tout à fait la lecture de Frédéric De Buzon, qui est d’ailleurs un des rares auteurs en France à avoir pris la mesure de ce que changeait le corpus exhibé par Crapulli dans la compréhension de la mathesis universalis. Dans mon ouvrage de 2009, je renvoie à cette interprétation (p. 345 et suivantes) et j’essaye d’expliquer ce qui me semble sous-jacent à la redéfinition de la mathesis pura. A mon sens, le projet d’une mathesis universalis échoue sur la question de l’unité du discret et du continu d’un point de vue à la fois technique (la solution esquissée dans les Regulae s’avérant non viable) et d’un point de vue métaphysique (Descartes se saisissant très clairement et explicitement de la question de l’infini au début des années 1630 et y faisant valoir un certain nombre de décisions). C’est pour cela que j’avançais dans le livre que « la vague d’une science universelle vient alors s’échouer contre ces ‘deux puissances incompréhensibles’ : l’infini véritable et la cause ».
[1] Leibniz, Mathesis universalis. Écrits sur la mathématique universelle, Textes introduits, traduits et annotés sous la direction de David Rabouin,Paris, Vrin, 2018.
[2] David Rabouin, Mathesis Universalis. L’idée de « mathématique universelle » d’Aristote à Descartes, Paris, PUF, coll. Épiméthée, 2009. Par exemple page 11 : « Il vaut comme le nom d’un programme, dont on fait justement reproche aux classiques de ne pas l’avoir considéré comme problématique. »
[3] Ibid., p. 25.
[4] Ibid., p. 226.
[5] G. Crapulli, Mathesis universalis. Genesi di una idea nel XVI secolo, Rome, edizioni dell’Ateneo, 1969.
[6] Règle IV, AT X, 375, l. 8-9 : quare ista ita se habeant, et quomodo invenirentur, menti ipsi non satis videbantur ostendere.
[7] Ibid., p. 237.
[8] « Mais je n’eus pas dessein, pour cela, de tâcher d’apprendre toutes ces sciences particulières, qu’on nomme communément mathématiques ; et voyant qu’encore que leurs objets soient différents, elles ne laissent pas de s’accorder toutes, en ce qu’elles n’y considèrent autre chose que les divers rapports ou proportions qui s’y trouvent, je pensai qu’il valait mieux que j’examinasse seulement ces proportions en général, et sans les supposer que dans les sujets qui serviraient à m’en rendre la connaissance plus aisée ». C’est sur ce fondement des « rapports ou proportions » qui assure l’unité des mathématiques que l’on peut ensuite les « supposer en des lignes » et les « expliquer par quelques chiffres », empruntant ainsi « tout le meilleur de l’analyse géométrique et de l’algèbre » en corrigeant « les défauts de l’une par l’autre » (AT VI, 19-20).
[9] David Rabouin, Introduction de Leibniz, mathesis universalis, op. cit., p. 8-9.
[10] Heidegger, GA 66, p. 343.
[11] Principia matheseos universalis : seu introductio ad geometriae methodum Renati Des Cartes, Leyde, Elsevier, 1651.
[12] David Rabouin, Mathesis universalis, op. cit., p. 278.
[13] Sur cette généalogie, voir le livre d’O. Dubouclez, Descartes et la voie de l’analyse, Paris, PUF, 2013.
[14] AT III, 722.
[15] Cf. Jean-Paul Weber, La constitution de du texte des Regulae, SEEP, 1964.
[16] Cf. David Rabouin, « Mathesis universalis et algèbre général dans les Regulae ad Directionem Ingenii de Descartes », in Revue d’histoire des sciences, tome 69, 2016/2, note 2, p. 260.
[17] Frédéric de Buzon, La science cartésienne et son objet. Mathesis et phénomène, Paris, Champion, 2013.








