Introduction
Fruit d’un travail collectif, Lectures de Sartre1 se présente de manière double : l’ouvrage constitue un socle fondamental de connaissances en soulignant les problématiques et les concepts essentiels du sartrisme, mais dégage également des perspectives plus approfondies de l’œuvre du pape de l’existentialisme. Ceux qui connaissent un peu le travail du Groupe d’études sartriennes, reconnaîtront des piliers de ce groupe, des « sartrophiles » convaincus : M. Cabestan, M. Cormann, M. Lecarme, Mme Simont ou encore M. Sicard pour n’en citer que quelques uns. Soulignons d’ailleurs la présence de ce dernier qui fut à l’origine, à la fin des années 70, d’un célèbre numéro d’Obliques consacré à Sartre.
D’emblée, ce recueil de quinze contributions s’ouvre sur un avant-propos de Philippe Cabestan qui donne le ton : l’auteur se demande qui de nos jours lit France, Barrès, Giraudoux ou Montherlant, pour mieux souligner la popularité dont Sartre bénéficie aujourd’hui encore. Jugement un peu précipité : si France n’est plus, Giraudoux est toujours étudié par les lycéens (bien souvent préféré à Sartre d’ailleurs) et la Reine morte de Montherlant n’est pas oubliée (Pierre Boutron a notamment réalisé une adaptation pour la télévision en 2009). Quant à Barrès, il fut davantage victime de sa position politique plutôt que de son talent d’écrivain. En vérité, une telle entrée en matière révèle une terrible injustice, qui tient moins au génie qu’à la visibilité de l’écrivain : Sartre, contrairement à ces auteurs, a bénéficié d’une couverture médiatique sans précédent en ayant su habilement l’utiliser.
Il fallait alors être pour ou contre Sartre, le suivre ou préférer l’atlantisme d’Aron. D’ailleurs, M. Cabestan rappelle que l’on a parfois du mal à saisir les engagements de Sartre : pour les comprendre, il faut lire les textes qui fondent ses engagements. Mais l’intérêt idéologique, comme le disait Sartre, est bien là : thèses et autre polissages d’amphithéâtre pourraient bien ne pas être suffisants.
Alors si survivance de Sartre il y a, d’où vient cet intérêt pour son l’œuvre ? De son extraordinaire prolixité mais aussi de son aspect singulier et protéiforme : philosophie, roman, théâtre, cinéma, esthétique, politique font (ou faisait) de Sartre une gloire nationale. Enfin, M. Cabestan souligne, en faisant référence à une contribution de l’ouvrage, que Sartre est avant tout le philosophe de la liberté sur laquelle une morale courageuse se fonde : le penseur de l’authenticité face à l’esprit de sérieux, le pourfendeur de la comédie bourgeoise. Cette morale serait l’inverse des « morales du devoir » qui se dissimuleraient la liberté dont elles procèdent : un coup à ce que Rauh ou Le Senne meurent une seconde fois, eux qui maintenaient fermement que le devoir procède de la rencontre entre l’obstacle et la liberté, qu’ils appelaient l’expérience de la contradiction.
L’œuvre de Sartre conserverait alors « une incontestable puissance de dévoilement », et cette somme collective tente d’en témoigner.
I. Sartre, la littérature et les arts
Le livre s’ouvre sur un texte efficace de Jacques Lecarme déjà publié dans les années 70. Pas de coup d’éclat dans la contribution de ce grand spécialiste, notamment, de l’autobiographie. Il s’agit d’une présentation synthétique de la production littéraire et critique de Sartre. L’auteur y souligne le style agressif et indépassable de la Nausée pour montrer comment Sartre est en rupture avec le roman français d’avant. Contrairement à Proust, l’auteur de la Nausée n’apprécie guère l’intériorité et les moments privilégiés. Se moquant d’un humanisme périmé, l’autodidacte est la caricature d’un modèle culturel que Sartre récuse. Dans les nouvelles constituant le Mur, M. Lecarme décèle des « images de l’aliénation mentale, de l’anomalie sexuelle et de la mauvaise foi » (20). Nous ne pouvons que suivre l’auteur lorsque celui-ci soutient que ces textes sont sans doute « les plus accomplis que Sartre ait jamais écrits » (20). Qu’on lise notamment « Intimité », une nouvelle qui brise le tabou de l’intimité charnelle : on y découvre par exemple Lulu se contentant du membre flasque de son mari impuissant. Difficilement supportables, il est vrai, certaines nouvelles du Mur révèlent une réelle nouveauté dans l’écriture. Dans le triptyque des Chemins de la liberté, inachevé, Sartre met ses personnages à l’épreuve de la liberté et emprunte, en termes de techniques d’écriture, aussi bien à Dos Passos (Le Sursis, 1945) qu’à Zola (La mort dans l’âme, 1949.)
Au théâtre, Sartre se situe dans le sillon de Giraudoux (Les Mouches) en réécrivant les mythes antiques et s’intéresse à la distanciation de Brecht (Les Séquestrés d’Altona, 1959). Les échecs de Morts sans sépultures (1946) et Nekrassov (1955) n’ont pas empêché Sartre de trouver un large succès auprès du public. On notera que Huis Clos et Les Mains sales firent recette : ces deux pièces, emblématiques du style sartrien dévoilent un théâtre qui met la liberté en situation. Cette dramaturgie à visée morale est encore tout à fait actuelle : là où le Bien et le Mal se valent, là où le héros des Séquestrés d’Altona tente de se laver de sa responsabilité, le spectateur est au rendez-vous.
Cette « liberté en situation » sera bien évidemment théorisée par Sartre, mais aussi décelée dans d’autres œuvres que sont celles sur Baudelaire, Flaubert, Mallarmé ou encore Jean Genet. Il écrit au début de son Saint Genet, comédien et martyr : « Pris la main dans le sac : quelqu’un est entré qui le regarde. Sous ce regard l’enfant revient à lui. Il n’était encore personne, il devient tout à coup Jean Genet. » (S G, p. 26, 1952 ; 1988) Si l’on met entre parenthèses la poétique un peu grossière de cette phrase, on ne manquera pas de souligner un objectif désormais courant chez Sartre : saisir chez l’écrivain son projet initial, son authenticité propre. Mais dans ces essais, note Lecarme, Sartre est souvent magistral et dialecticien : il n’y a que dans son Saint Genet que son auteur laisse libre cours à une plus grande liberté de ton.
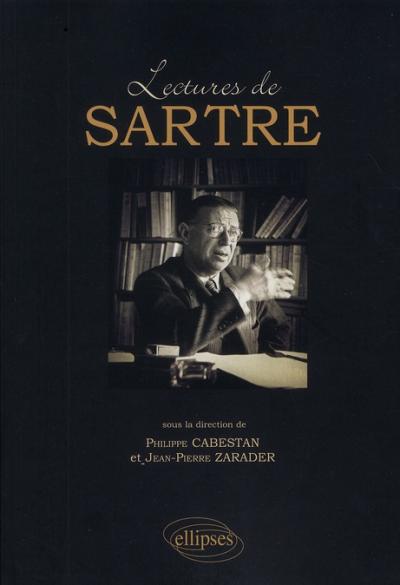
« Quelqu’un est entré qui le regarde » : ce syntagme n’est pas sans rappeler le fameux passage de l’Être et le Néant (1943) dans lequel la honte s’élève au rang de concept. C’est bien ce que l’on reprochera à Sartre : faire de la philosophie avec la littérature et inversement. Reproche simpliste, comme le souligne M. Chabot dans sa communication. L’enseignant va souligner la difficulté pour Sartre de vouloir être à la fois Stendhal et Spinoza. M. Chabot s’emploie donc à montrer qu’on ne peut réduire les romans de Sartre à de simples transpositions fictives de ses thèses philosophiques : s’il y a roman, nous dit l’auteur, c’est que Sartre l’a voulu avant tout. De plus, alors que les romans à thèse impliquent un discours transparent et assuré, les romans de Sartre naissent d’une volonté d’écrire ou de penser contre soi-même, de ne pas coïncider avec soi. Ecrire un roman, nous explique M. Chabot, c’est éviter la philosophie c’est-à-dire la non-ambigüité, en sachant manier les registres, les images, et les niveaux de langue. Le roman, travail du sens par le style, est donc la réunion de l’ambigüité et de l’équivoque dixit Blanchot. Il y a plus : Sartre renouerait avec l’essence même du roman ou le combat du relatif contre l’Absolu présent chez un Rabelais ou un Cervantès. D’ailleurs, dans La Nausée, Roquentin n’est-il pas l’inverse de l’autodidacte qui incarne la « psychologie stable » que Sartre déteste ?
Dès lors il la remplace par sa fameuse contingence. Roquentin devra trouver en lui-même son être authentique et se vouloir autre qu’un salaud, afin d’incarner cette instabilité existentielle qui fait l’homme sartrien : « Faire, et en faisant se faire » comme l’écrivait le philosophe dans l’Être et le Néant. C’est un peu, avant l’heure (Sartre n’est pas novateur sur ce sujet) le projet du personnage principal du premier cycle romanesque de Duhamel. Dans Journal de Salavin (1927), Duhamel présente Louis Salavin, homme faible et miséreux qui décide de devenir un saint et de tenir un journal. Or Salavin, contrairement à Roquentin, ne parviendra pas à s’affirmer comme il se veut : « Ah Dieu, si tu existes, fais-moi revivre, quelques jours dans la peau d’un homme courageux, courageux à la façon des bêtes, courageux d’instinct comme lâche me voici d’instinct. » (JS, « 15 octobre ») Roquentin et Salavin ont un point commun : ils cherchent non plus à être, mais à exister. Ce problème du « se faire » est une obsession dans l’œuvre de Sartre, au-delà même des différents genres ou domaines intellectuels. Si comme le montre M. Chabot, il ne faut pas réduire les écrits littéraires de Sartre à de simples transpositions de ses écrits philosophiques, on ne peut cependant pas nier leur promiscuité.
Cette étroite relation est soulignée par M. Zarader qui se demande si Les mots n’incarnent pas l’Être et le Néant. L’auteur nous montre, par exemple, que la distinction de l’en-soi et du pour-soi était déjà présente dans Les mots sous une forme particulière. L’être en lui-même, l’en-soi, c’est le grand-père Karl, aimant conserver la comédie familiale ainsi que la place qu’il occupe dans celle-ci. Quant au pour-soi, au néant, il prend vie en la personne de la grand-mère qui refuse la mascarade instituée. On peut alors se demander, avec M. Zarader, s’il n’y a pas de l’artificiel dans cette « fable dialectique », selon l’expression de Lejeune. Et l’auteur de prolonger : est-ce la vie qui a enfanté l’œuvre ou cette dernière qui a reconstruit la vie ? Cette question justifie la réaction de la mère de Sartre, Mme Mancy, à la lecture des premières pages des mots : « Poulou n’a rien compris à son enfance ». Or comme l’écrit M. Zarader, le livre de Sartre « récuse toute conception de l’autobiographie comme simple miroir et récit d’une vie » (65) Il s’agit davantage de retrouver l’élan initial, le moteur du « projet Sartre ». C’est parce que le petit Poulou à genoux sur le prie-Dieu est mort que Les Mots sont possibles. Le salaud est devenu écrivain. Et M. Zarader, commentant le fameux dessin de Levine qui figura longtemps sur la première de couverture de l’édition folio, montrera que le Sartre en imperméable signifie une chose simple : il est l’inspecteur faisant son travail d’enquête. Selon M. Zarader, les Mots reviennent à critiquer l’idéal hégélien d’une totalisation, d’une réconciliation, d’une synthèse du moi et du monde dans l’œuvre créée. Mais il n’y a pas que dans ce rapport entre l’Être et le Néant et Les Mots que M. Zarader trouve l’origine de certains concepts sartriens. Son archéologie, fort étonnante, fouille dans d’autres domaines et particulièrement le cinéma. Ce dernier fascine le jeune Sartre parce qu’il entre en contradiction avec le réel. L’auteur de l’Imaginaire aurait accédé à l’imagination par l’imaginaire du cinéma. Il y a plus : selon M. Zarader, qui s’appuie sur une déclaration du philosophe, montre que l’idée de contingence trouverait son origine dans l’opposition entre l’univers du cinéma (nécessité) et celui de la réalité (ordre de la contingence).
Ainsi chez Sartre, les arts donnent à penser et M. Sicard, spécialiste d’esthétique, le souligne avec vigueur. Dans une communication au titre pompeux « Là où le réel fulgure : matiérisme et immatérialité dans l’esthétique sartrienne », l’auteur revient sur la première philosophie de Sartre. Celle-ci est attachée à la question de l’image manœuvrée par l’intentionnalité : l’imagination n’est pas un a priori mais une opération réelle concrète. L’œuvre d’art est en ce sens un « irréel » : la conscience imageante en figure les traits et rend possible la contemplation car « l’image est au centre de l’œuvre d’art, et pleine de l’esprit que le sujet y place. » (74) Dans son étude, l’auteur nous explique en quoi certaines peintures constituèrent un régal pour une conscience telle que Sartre la décrivait. Ce dernier s’intéressa aux travaux de Calder, Wols ou encore Masson car ils opéraient, dans leurs esthétiques, un décentrement du sujet. Liés à la mobilité, à l’image en fuite (notamment chez Calder), ces artistes séduisent Sartre par leur imprévisibilité et leur irrégularité. M. Sicard note également l’intérêt du philosophe pour Tintoret, artiste de la renaissance italienne. Sartre voyait dans l’œuvre de ce peintre, l’incarnation du refus des codes de l’époque, du culte vénitien. Cette traîtrise lui plait car Tintoret se montre tout entier dans sa peinture, et les scénarios qu’il peint ne sont que des prétextes à cette monstration.
Enfin, à l’époque contemporaine, Giacometti occupe une place de choix chez Sartre car ce peintre est « le premier artiste qui se soit intéressé au vide », et le vide est la forme « esthétique du néant philosophique tel que décrit dans l’Être et le Néant. » (81). Masson, lui aussi, retient l’attention du philosophe. Dans Situations IV, Sartre disserte au sujet des lignes dynamiques de Masson en montrant qu’elles ne sont pas des contours ou des esquisses mais des indications, des trajets, des traits d’orientation. Ainsi la mobilité fascine Sartre, et la non-adhérence au monde le séduit comme dans l’esthétique de Wols pour qui le monde « se vide de toute nature » pour « apparaître comme un rêve » (88).
On trouvera enfin dans ce collectif, une étrange communication de génétique littéraire. Mme Simont se penche sur la bibliothèque de Sartre, et propose de prolonger l’inventaire des lectures de l’intellectuel entrepris par Mme Geneviève Idt. Parce que la drôle de guerre semble être une période intéressante à travailler pour comprendre la formation de la pensée sartrienne, Mme Simont s’intéresse aux écrits de guerre et précisément au Guillaume II d’Emil Ludwig sur lequel elle jette son dévolu. Selon l’auteur, la lecture de cet ouvrage apprend à Sartre que « dans un autre milieu, dans d’autres circonstances, un autre Guillaume eût été possible ». Aussi le philosophe s’emploie-t-il finalement à penser que l’être de Guillaume II, c’est la royauté. Ainsi, l’existence injustifiée trouve sa justification dans ce que l’on se donne à être.
II. La philosophie, la politique et anthropologie.
La première contribution proprement philosophique est celle de M. Cormann. Le spécialiste choisit de se pencher sur le « nouveau traité des passions » annoncé par Sartre au début de Situations I. Il faut partir de la notion centrale d’intentionnalité que Sartre met au centre de ses textes de psychologie phénoménologique. Ainsi notre monde, s’il est peuplé de choses, est aussi un monde de sentiments qui doit faire l’objet d’une description. Par exemple, l’amour n’est pas une réaction indépendante de l’objet sur lequel il porte : « si nous aimions une femme, écrit Sartre, c’est qu’elle est aimable ».
Sartre a une dette envers Descartes et souhaite concilier la phénoménologie avec le rationalisme des Passions de l’âme. Les émotions, proprement magiques, constituent le monde du commerce des consciences : Sartre écrivait en effet que l’homme est toujours un sorcier pour l’homme. Si Sartre cherche à saisir l’inscription concrète de l’homme dans le monde, il cherche surtout à penser un monde où les choses sont « chargées des significations humaines coulées dans les choses », ce qu’il appellera plus tard, dans la Critique de la raison dialectique (1960), le pratico-inerte.
M. Cormann rappelle alors qu’au sujet des émotions, il existe une parenté entre Sartre et Alain. Ce dernier indiquait que le « magique », propriété de la conscience émotionnelle, est « l’esprit traînant parmi les choses ». M. Cormann souligne que bien avant Sartre, Chartier aurait montré que « les explications magiques portant sur le monde physique ne sont que l’extension d’une « magie vraie » qui régit le monde humain ». Ainsi dans Les Idées et les Âges, Alain anticipe cette idée que l’émotion se définit comme le maintien, par la conscience, d’une attitude magique.
L’auteur montre enfin comment cet acquis de l’Esquisse d’une théorie des émotions, à savoir que « la connaissance de l’homme doit être totalitaire » conditionne le programme philosophique de Sartre : dans le texte de présentation des Temps modernes, Sartre écrit que « tel est l’homme que nous concevons : homme total. Totalement engagé et totalement libre. » Cette déclaration conduit Sartre à développer une herméneutique de l’existence. Celle-ci aurait pour but de « comprendre la manière dont une conscience assume et n’assume pas sa responsabilité, c’est-à-dire le choix qu’elle fait d’elle-même » (107) A la fin de son article, M. Cormann prolonge cette question de l’herméneutique de la facticité en nous invitant à comprendre dans quel contexte Sartre a pu composer, entre autres textes, La Transcendance de l’ego (1934). Il se penche alors longuement sur Vers le concret (1932) dans lequel Jean Wahl explique « que le déplacement, interne au mouvement des essences à la prise en compte de l’existence dans ses différentes dimensions facticielles » est le « symptôme » de la nouvelle préoccupation pour le concret : préoccupation qui sera celle aussi bien d’un Sartre que d’un Merleau-Ponty.
Dans l’étude de M. Mouillie, la notion de « concret » se lie au problème de la morale. Si une morale est possible, écrit Sartre, elle doit être « une morale en situation et donc concrète » (Cahiers pour une morale, 24). M. Mouillie rappelle d’abord que la base de la morale sartrienne est l’autodétermination de la liberté, et par extension l’accomplissement de soi dans l’authenticité : c’est-à-dire la saisie de sa propre liberté qui est une appropriation assumée. C’est ainsi que la valeur n’aiguille pas la liberté de l’extérieur : la liberté est « l’unique fondement des valeurs » en s’imposant à elle-même un idéal. L’existence devient alors « une structure de dévoilement » en laquelle liberté absolue et liberté finie coexistent, pour ainsi dire, sans contradiction : « l’idée de liberté éclaire la morale, sa possibilité et sa visée, mais c’est la morale qui éclaire l’apprentissage et les significations concrètes de la liberté » (295). Actif, en devenir, l’agent moral est en situation. Il y a plus : M. Mouillie note qu’il existe un « affect moral » puisque dans le milieu affectif « chacun, écrit Sartre, se détermine librement une sorte d’affect moral, à partir duquel il saisir les valeurs et conçoit ses progrès. » (265) Chacun éprouve sa liberté. Mais l’individu n’est jamais seul : la morale se revêt alors d’une dimension collective « impliquant la reconnaissance réciproque de libertés par des actes visant à supprimer des situations « inhumaines » s’oppression. » (308). Or cette réciprocité exigée se heurte à la rareté. En effet, dans la Critique de la raison dialectique, Sartre montre qu’il n’y en a pas assez pour tous : les hommes peuvent donc devenir oppresseurs les uns des autres. M. Mouillie répond astucieusement à ce problème en montrant que « penser la morale, c’est saisir l’immoralité que nous avons en partage, mettre en doute sa moralité […] » (309)
Cette rareté est encore traitée par M. Cabestan qui s’attache, dans une partie de son étude, à montrer le tragique de ce concept. Alors que dans l’Être et le Néant, Sartre traitait du besoin, celui-ci se radicalise dans la Critique de la raison dialectique : pour certaines populations « la faim comme besoin disparaît » (153) et cette urgence se structure socialement. On pourrait alors croire qu’un intervalle infranchissable sépare les analyses sur le besoin dans l’Être et le Néant du diagnostic développé dans la ‘Critique. En vérité, les analyses de la Critique prolongent celles de l’Être et le Néant qu’elles enrichissent, en insistant sur la corde matérialiste : il s’agit des deux versants d’un même problème, celui d’un sujet « hanté par le désir d’être ».
Le matérialisme n’apparaît pas ex nihilo dans la Critique : M. Kail en souligne déjà la possibilité dès la Transcendance de l’ego. L’auteur renvoie à l’assimilation de la phénoménologie au réalisme effectuée par Sartre dans cet ouvrage. Si l’idée de la liberté sartrienne fait couple avec le réel, elle fait aussi couple avec un anti-naturalisme qui pourrait s’énoncer ainsi : dès que l’homme s’arrête, il se transforme en chose car faire de l’être au monde une nature, c’est annuler la liberté.
Les questions de la rareté et du matérialisme nous renvoient donc à la Critique de la raison dialectique : quelques auteurs de ce collectif traitent abondamment de cet ouvrage, et l’on retrouve souvent la même obsession : l’hypothèse d’une continuité, malgré les divergences, entre les deux sommes sartriennes. C’est ce que se propose d’examiner M. Tomès lorsqu’il s’interroge sur le statut de la phénoménologie dans la Critique. Il nous apprend qu’il y a une continuité, un parallélisme (par exemple entre le pour-soi et le libre organisme pratique). Mais dans la Critique, Sartre prend ses distances avec la méthode utilisée dans l’Être et le Néant : sa réflexion sociale, sur les luttes, ne pourrait être pleinement satisfaite par seul usage de l’outil phénoménologique qui « néglige la matérialité ». Même si Sartre utilise encore la description phénoménologique dans sa dernière somme philosophique (notamment lorsqu’il s’agit de traiter la notion de série) celle-ci doit être complétée : le marxisme l’aidera en ce sens.
Le marxisme est examiné par M. Barot. Sartre écrivait dans Questions de méthode (1957) que le marxisme « est indépassable parce que les circonstances qui l’ont engendré ne sont pas encore dépassées. » (éd. 1986, p. 35-36) Les circonstances sont d’autant plus indépassables au moment de l’écriture de la Critique, qu’elles exigent un tel « moment dialectique ». La combat, la violence, la révolte produisent et engagent, à la suite de Marx, la dialectique déployée dans l’ouvrage de Sartre.
Cette dialectique est plus amplement étudiée par M. Rizk, dans le but d’examiner au plus près le concept de totalisation au cœur de la Critique. Si comme l’écrivait Sartre, chaque homme est un être total, ces totalités peuvent-elles être à leur tour totalisées ? La totalisation, chez Sartre, est l’action de rassembler une multiplicité en vue d’une finalité, d’un projet. Il s’agit alors pour M. Rizk d’élargir au maximum la notion de totalisation afin de la pousser dans ses retranchements : s’il faut un totalisateur (lié à la praxis) à la source de toute totalisation, l’Histoire (qui n’est que par les luttes) peut-elle être totalisatrice alors qu’elle n’est pas un organisme pratique ? L’auteur répond que « les luttes sont intelligibles parce que les déchirures elles-mêmes sont totalisantes : chaque lutte singulière totalise l’ensemble de toutes les luttes » (196) En effet, dans le second volume de la Critique de la raison dialectique (1985), Sartre développe l’idée qu’il existerait une autre forme de totalisation, qu’il nomme « totalisation d’enveloppement » : celle-ci dépasserait l’action synthétique décrite dans le premier volume de la Critique. Cette autre forme de totalisation est bien produite par les praxis individuelles mais en même temps, elle les dépasse : par exemple, si chaque lutte se donne un but, une visée, elle produit aussi une déviation c’est-à-dire un ensemble de conséquences imprévues. On notera que le problème majeur que pose cette idée, et que Sartre ne résout pas (le second volume de la Critique est inachevé), est le suivant : qu’en est-il des sociétés sans luttes, sans révoltes de masse ?
Ces luttes nous conduisent à envisager l’action politique, comme le fait M. Bourgault. Dans Questions de méthode, il s’agit pour Sartre de « fonder existentiellement le marxisme » (205). Et c’est en idéologue qu’il le fera, c’est-à-dire comme celui qui entreprend « d’aménager les systèmes ou de conquérir par de nouvelles méthodes des terres encore mal connues. » (Questions de méthode, 22) L’idéologie de Sartre ira au-delà de l’affrontement des choses, des concepts abstraits pour mieux réintégrer dans le champ politique des actes ou actions trop infimes – et peut-être méprisables – aux yeux d’un marxisme qui s’attache à ne manipuler que de grandes formes abstraites : il faut réintroduire la liberté au cœur du combat politique. Un acteur politique, souligne M. Bourgault, « demeure pourtant toujours engagé dans un rôle qu’il doit soutenir et auquel il doit croire. » (224) Sartre lui-même, dans son combat, n’a jamais négligé cette exigence : il a conservé sa place d’intellectuel classique, de technicien des savoirs pratiques, en oubliant jamais qu’il était un bourgeois pensant contre la bourgeoisie. Ainsi, l’action politique ne peut se faire sans être pleinement éprouvée.
L’étude du domaine politique chez Sartre se prolonge dans la contribution de M. Oulc’hen sur le colonialisme. Celui-ci est un système qui, pour Sartre, ne peut être légitimé d’aucune sorte. En reprenant « Le colonialisme est système » dans Situations V, l’auteur montre que le colonialisme comme totalisation ne peut plus se sauver. En effet, les libertés sont déviées de manière à ce que la liberté de l’un soit rendue exploitable par l’autre. Sur ce problème du colonialisme, souligne M. Oulc’hen, Sartre reste très radical : d’un côté les oppresseurs, et de l’autre les opprimés. Ainsi Sartre opposerait « à une violence systématique oppressive et sérielle une contre-violence révolutionnaire de groupe. » (248) Et M. Oulc’hen de sauver Sartre, en se demandant si cette conception tranchée n’est pas solidaire d’une exigence de révision, de remise en question propre à Sartre.
Nous noterons enfin la présence d’un travail de M. Flajoliet qui met en rapport l’Idiot de la famille (1971-1972) et une démarche d’anthropologie existentielle développée par le philosophe. En effet, comment concilier la biographie avec une telle anthropologie sans voir, à la place de Gustave, Sartre tout entier ? En réalité, selon M. Flajoliet, il faut distinguer la liberté telle qu’elle est introduite dans l’Idiot de la famille du concept de choix original présent dans l’Être et le néant : par exemple, la liberté de Gustave est aliénée par sa famille mais ne constitue en rien un destin. Il y a plus : lire l’Idiot de la famille du strict point de vue de la psychanalyse existentielle serait nier toute l’évolution de la pensée de sartrienne depuis l’Être et le Néant. Car c’est notamment avec le Saint Genet puis la ‘Critique que Sartre complète et complexifie sa manière de penser l’individu. Et M. Flajoliet de constater que dans l’Idiot, tout se passe comme si Sartre avait rassemblé sous son propre regard la totalité de ses acquis théoriques : « L’intégration à l’anthropologie de l’étude dialectique de la socialité et de son histoire a permis de penser l’individu, non plus seulement comme totalisation de sa propre vie, mais aussi comme détotalisation de cette vie dans l’histoire. » (286)
En conclusion, il conviendra d’indiquer l’extrême densité de ce collectif : le lecteur peut enfin, en dehors des publications internes au Groupe d’études sartriennes, avoir plus facilement accès aux recherches incessantes et variées menées par les spécialistes de Sartre. La nouveauté qu’offre ce volume est l’attention portée à la Critique de la raison dialectique, moins lue et commentée que l’Être et le Néant. Cette appétence pour la dernière somme philosophique de Sartre est stimulante car elle permet d’envisager l’évolution complète de sa philosophie. Si nous trouvons, çà et là, quelques coquetteries dans ce volume, l’ensemble des contributeurs souhaite montrer la cohérence de l’œuvre sartrienne : il ne fait pas de doute que le lecteur retrouvera dans cet ouvrage l’atmosphère de la pensée de Sartre qui, malgré ses multiples aspects, aspire à l’unité.








