Ce recueil d’études1 se veut un guide de lecture de l’œuvre majeure de Bergson. L’ordre des contributions s’ordonne selon les quatre chapitres de l’Evolution créatrice, alternant études détaillées -de véritables commentaires linéaires- et articles thématiques plus courts, qui serrent d’aussi près que possible la pensée de Bergson et ses références sous-jacentes.
L’apport le plus précieux de cet ouvrage est d’ordre méthodique, à deux points de vue qui renvoient l’un à l’autre : ces textes mettent en oeuvre les méthodes contemporaines d’étude de Bergson, et ils éclairent de ce fait la logique suivie par Bergson. De même que ce dernier ne procède pas systématiquement (en partant d’un principe pour en déduire les conséquences) mais en suivant des lignes de faits pour se replacer dans une durée et la suivre par intuition, les commentateurs s’attachent à tracer de telles lignes d’analyses au sein de l’œuvre bergsonienne.2 Leur approche est ainsi en adéquation avec la façon de procéder de l’auteur.
Je ne proposerai que des aperçus superficiels des contributions, qui n’ont de toute façon de sens que si elles sont lues en regard du texte de Bergson lui-même.
La logique du vivant
L’introduction d’Arnaud François montre quelle réflexion circulaire structure toute l’Evolution créatrice : un va-et-vient permanent entre théorie de la vie et théorie de la connaissance. Bergson doit réformer la métaphysique afin de la sortir de son incompréhension naturelle de la vie, et simultanément, en déblayant les obstacles posés par l’intelligence, accéder à une compréhension plus profonde de la vie, grâce à une métaphysique rénovée. Bergson constate en effet que la science biologique n’a pas encore reçu son complément indispensable, une métaphysique qui parviendrait à penser ce que l’évolution révèle : la créativité de la vie, en même temps que son absence de finalité.
La logique d’ensemble du livre est commandée par la nécessité de refondre la notion de causalité. Bergson critique simultanément les deux formes principales de causalité : la causalité comme enchaînement mécanique et la causalité comme avancée vers un but ; plus profondément, Bergson établit que cause et effet ne sont pas extérieurs l’un à l’autre. Refuser la séparation entre des ensembles de phénomènes dont l’enchaînement relèverait de la logique, est une étape préalable à la découverte de la durée. Issue de la logique de la matérialité, la causalité se trouve réformée par ce qu’on pourrait appeler, avec François Jacob, une logique du vivant : logique mise à l’œuvre par le vivant lui-même pour s’affronter à la matière, et logique philosophique nouvelle indispensable pour saisir le vivant.
Arnaud François commente également le premier chapitre du livre. L’explication, qui suit de très près le texte, son vocabulaire, ses inflexions et ses références implicites, reconstitue magistralement la construction d’ensemble et le cheminement de cette ouverture du livre.
Si la durée est changement perpétuel, c’est qu’elle produit en permanence de la nouveauté. Mais si tout change en permanence, n’est-ce pas un retour perpétuel du même ? Si tout change, rien ne change. C’est là une résistance que notre entendement oppose à la vision du nouveau : toujours nous le ramenons à de l’ancien. Bergson doit donc ajouter que la nouveauté est aussi imprévisibilité. Elle n’est pas réarrangement de parties mais bien « refonte radicale du tout ». En cela, elle est originalité. La méthode analogique suivie par Bergson va montrer que ce caractère de la durée, valable pour notre conscience, peut s’appliquer à l’existence en général.
Le monde n’est que tendances, ; il n’est pas un ensemble de choses douées d’une nature immuable, il n’y a par conséquent en lui aucune finalité organisé, ni un pur et simple mécanisme aveugle.
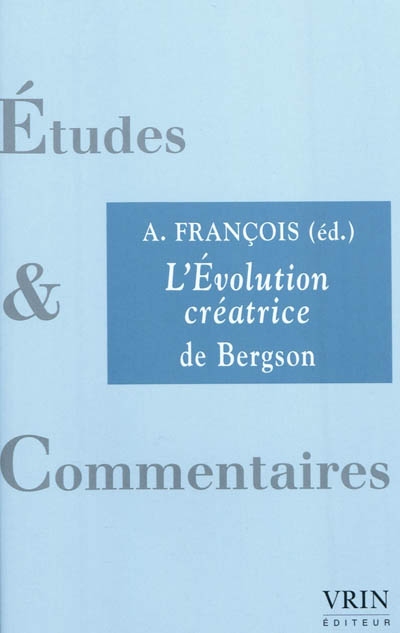
Penser un monde de tendances suppose de suivre celles-ci chronologiquement dans leur développement. Bergson est donc amené à discuter de la causalité propre au vivant, sans rompre le lien avec les sciences, c’est à dire en ne postulant pas deux causalités hétérogènes, une pour le vivant, une pour la matière, ou même une absence de causalité chez le vivant. Bergson cherche à penser le tout, et à le penser dans le temps. Or, la théorie mécaniste a ce double défaut de ne considérer que des parties artificiellement recomposées et d’ignorer le temps véritable en son écoulement. Le mécanisme nie l’imprévisibilité, en posant qu’une intelligence divine pourrait, dans l’absolu, tout prévoir du déroulement des causes et des effets. La nouveauté ne serait alors qu’un effet des limites de nos facultés. Le finalisme tombe dans la même illusion, en posant une fin donnée d’avance.
Face à ces deux thèses adverses, Bergson va introduire sa propre conception du vivant, dont il faudra montrer à la fois qu’il est animé d’impulsions qui ne se réduisent pas à des phénomènes physico-chimiques, et qu’il est un ensemble de tendances qui n’ont pas de finalité. 3 Le changement n’est pas accidentel, il n’est pas dû au hasard -mais il n’est pas dû non plus progression vers un but posé d’avance. Il n’est pas mouvement vers une fin possible qu’il faut réaliser.
Une notion cruciale dans ce chapitre est celle d’impulsion : Bergson la conçoit comme vis a tergo, c’est à dire comme force qui propulse le vivant par derrière, par opposition à à la volonté consciente d’un but en avant d’elle. [L’impulsion est l’un des thèmes-clefs du livre d’Arnaud François, Bergson, Schopenhauer, Nietzsche. Volonté et réalité. Lire sur ce site [le compte-rendu de ce livre.[/efn_note]
Il est à noter que Bergson, en quelque sorte, rejoue par son écriture l’effort de la vie même, qui doit parvenir à s’insinuer dans la matière pour la tourner à son profit : le philosophe doit introduire sa propre pensée du mouvant entre deux théories qui éliminent le changement réel.
La vie ne cherche ainsi pas l’adaptation pour elle-même mais pour mieux se réaliser (critique de Darwin), en ce qu’il y a en elle des tendances, des directions à l’évolution. Il y avait donc des virtualités qui allaient dans le sens de leur plein développement, comme la vue ou la mobilité -que la vie n’aurait pas eu besoin de créer si elle ne cherchait qu’à produire le minimum d’effort pour s’adapter à la matière. La vie cherche au contraire à s’assurer de plus en plus de pouvoir d’action, en créant une marge d’indétermination, donc de liberté, par rapport aux contraintes du milieu.
Le commentaire proposé par Arnaud François est vraiment limpide et les références scientifiques érudites. Que demander de plus ?
Osamu Kanamori montre en quoi Bergson appuie sa philosophie de la vie sur le néo-lamarckiste. Son article s’interroge alors sur le statut d’extra-scientificité du discours bergsonien : discours non-scientifique qui s’appuie pourtant sur des faits. L’intelligence scientifique demande à être complétée et prolongée par l’intuition, qui ne subsiste en nous que comme frange vague, indéfinie. Le néo-lamarckisme maintient contre le darwinisme l’idée d’une intentionnalité à l’oeuvre dans le vivant, que Bergson comprend comme une liberté en acte. La métaphysique de la vie s’appuie de ce fait sur des intuitions qui, virtuellement, débordent l’activité de l’intelligence scientifique, et demandent à être explorées, approfondis par la philosophie. C’est pourquoi Bergson se propose d’écrire la philosophie appelée par les théories de l’évolution.
Causalité et finalité
L’étude de Camille Riquier, « Les directions de l’évolution », étudie le second chapitre de l’ouvrage. Selon Bergson, la métaphysique a gardé les mêmes fondements d’Aristote à Spencer, et n’a pas su penser la vie comme liberté. Kant aussi bien que Plotin ne peuvent garantir la liberté humaine qu’en la plaçant dans un domaine séparé de celui du déterminisme (monde sensible chez l’un, phénomènes chez l’autre). La liberté se trouve ainsi placée au-dessus de la nature, comme dans un sanctuaire. Il en découle l’illusion, dont Spencer ne s’est pas dépris, qu’il y a une supériorité de la liberté sur la nature, du moral sur le biologique. Bergson entend revenir sur cette partition dualiste et trouver, au sein même du devenir vivant, cet effort de la liberté pour tourner la nécessité à son profit. Ce sont les rapports très complexes du vivant et de la matière que Camille Riquier décrit finement, reconstituant la « philosophie de la vie » bergsonienne. Si la matière est un ensemble de forces, la vie est en face d’elle très faible, surtout au début : la vie sera ainsi une ruse pour utiliser les forces matérielles à son profit. Toute la force de la vie lui vient en revanche de la matière. Ainsi, sans la matière, ou dans un monde fait d’une matière moins rétive, la vie serait restée bien plus évanescente. Elle n’aurait pas à eu à développer autant de force pour vaincre l’inertie du milieu.
Après avoir établi, dans l’Essai sur les données immédiates de la conscience, l’existence de la liberté, Bergson reprend et amplifie donc son questionnement, en retrouvant cette fois la liberté à l’œuvre au sein de l’évolution du vivant.
L’argument central de la compréhension de la vie comme élan est, comme le dit le premier chapitre, l’existence de directions de l’évolution (vie végétative, mobile et consciente : plantes, animaux et hommes).
La vie, élan donc dynamisme, est à elle-même sa propre cause, cause qui est elle-même dynamique. Aussi, l’élan vital ne fait-il pas que s’intensifier en s’approchant de sa finalité. La fin resterait un point fixe à l’approche duquel l’élan s’accroîtrait, et cette fin serait extérieure à l’élan. La fin elle-même est plutôt dans ce dynamisme : la vie s’intensifie en pliant de mieux en mieux la matière à son avantage, en s’exprimant de plus en plus à travers elle. La vie retrouve ainsi la simplicité de sa poussée originelle à mesure qu’elle parvient, par des voies multiples et complexes, à traverser la matière. C’est ainsi que la conscience parvient à ressurgir au sein de l’inerte. La fin, comme but, est donc aussi bien la source.
L’intelligence, qui est faculté d’action sur la matière, produit des outils, dont l’effet sera de libérer une conscience. Si la vie est ruse là où la matière est force, on serait presque tenté de parler d’une « ruse de la conscience » : l’intelligence, qui s’en tient à l’action sur la matière, libère, de surcroît, par son effort, une conscience endormie. Comme le dit Camille Riquier, la prise de conscience, effet de la fabrication, est plutôt la cause de sa cause (l’intelligence travaillait sans le savoir pour la conscience). Causalité circulaire et dynamique, causalité créatrice.
Cependant, il me semble qu’une objection ici s’impose : c’est une chose de dire que la conscience se réveille à l’occasion de la confrontation avec la matière (dans la technique, le travail). C’en est une autre de dire, à la manière de Hegel, que sans le savoir, la matière devait préparer le réveil de la conscience -que la conscience devait en passer par cette épreuve pour en ressortir plus forte. N’est-ce pas réintroduire une finalité ? Si le travail, l’effort, sont causes occasionnels de l’émergence de la conscience, n’y avait-il pas un dessein providentiel qui a voulu cette confrontation de la vie et de la matière ? Faut-il alors rapprocher Bergson de Hegel, parce qu’ils auraient tous deux pensé une fin nécessaire qui ne peut parvenir à elle-même que dans « l’épreuve de la contingence » ? 4
Dernier point que je souhaite mettre en valeur : si la vie est multiplicité, ce n’est que du fait de son éparpillement dans la matière. La vie a trouvé de nombreuses solutions pour contourner la résistance matérielle mais elle ne cherchait pas au départ cette multiplication exubérante des formes. Contre la lecture de Deleuze [Camille Riquier m’a indiqué, au sujet de son livre Archéologie de Bergson, qu’il avait souvent dû s’efforcer de se déprendre de la lecture deleuzienne de Bergson, pour en surmonter les insuffisances. Lire sur ce site [le compte-rendu de ce livre.[/efn_note] C. Riquier établit que la vie ne vise pas la complexification : au contraire, l’élan tend à revenir à la simplicité –idée qui se prolongera pour Bergson dans son analyse du mystique, homme d’une conscience supérieure capable d’en revenir à la simplicité originelle de tout élan de vie (voir Les deux sources de la morale et de la religion, chapitre III).
A la lecture de cet article s’impose enfin cette question : comment la conscience a-t-elle pu être cet élan qui s’est lancé à travers la matière ? D’où lui venait sa force si, à l’origine, elle n’est en rien matérielle ? Il faudrait alors poser une origine divine à l’élan vital, admettre que la conscience découle d’une supra-conscience, au principe non seulement de la matière mais de la vie. Bergson admet toutefois le premier que, d’une telle réalité mystique, nous ne pouvons presque rien affirmer de certain. Il n’en reste pas moins que cette conviction spiritualiste est l’un des moteurs de la philosophie de Bergson.
Alain Prochiantz s’interroge sur la théorie de la finalité du vivant chez Bergson. Il montre pourquoi les positions spiritualistes de Bergson ne sont pas en désaccord complet avec l’esprit scientifique. Même un matérialiste conséquent -ce que se doit d’être un scientifique aujourd’hui – ne peut pas s’en tenir à la réduction du vivant au mécanique. Bergson, en réintroduisant une finalité dans la nature, n’est pas pour autant du côté des théories « créationnistes » de l’Intelligent Design (théorie selon laquelle la création manifeste l’intention divine). Il faut donc reconnaître à l’auteur de l’Evolution créatrice une « compréhension très aiguë du caractère historique de l’évolution, et plus largement des sciences du vivant, ce qui rend difficile leur rabattement total sur des théories importées de la physique ou de la chimie. »
Le sens de la vie et de la nature
Le troisième chapitre est connu pour être le sommet du livre et sans doute de toute l’oeuvre de Bergson, le moment où le philosophe passe de la psychologie à la cosmologie, et même à la cosmogonie, nous rejouant rien moins que la naissance de l’univers !
Il revient à Paul-Antoine Miquel d’expliquer en détail ce chapitre. D’emblée son commentaire se présente comme très critique. Il adresse une suite d’objections, appuyées à la fois sur les théories scientifiques contemporaines et sur la phénoménologie. L’ambition de Bergson est dans un premier temps clairement définie : faire la genèse de nos facultés à partir du mouvement même de la vie et de sa dégradation en matière, autrement dit de faire la genèse de nos facultés à partir de l’élan et de sa retombée. M. Miquel montre que cette genèse suppose une réforme de l’intuition, qui n’est plus seulement réflexion sur un ensemble de faits collectés par l’intelligence : elle devient faculté d’engendrement des catégories. Ces deux ambitions conjointes définissent proprement ce que l’article nomme « une philosophie évolutionniste ».
Ce point de vue critique n’empêche nullement l’auteur de suivre de près le texte dans ses problèmes essentiels. De longs développements scientifiques resteront par contre difficile d’accès au profane, dont je suis. (Les critiques adressées à Bergson m’ayant paru, pour certaines, contestables, pour d’autres plus pertinentes, j’en discute quelques-unes, en annexe de cet article.)
Frédéric Worms répond à une objection cruciale adressée à Bergson : celle de ne pouvoir penser le néant, c’est à dire -théoriquement- la négativité et -pratiquement- le nihilisme. Bergson critique longuement l’idée de néant, comme un pseudo-concept, tout en opérant la genèse de cette illusion métaphysique selon laquelle l’être aurait à exister par-dessus le non-être. Là serait en fait la faiblesse de Bergson, à la fois de ne pas penser le mouvement dialectique, qui en passe nécessairement par le négatif, et d’ignorer le tragique. La pensée du néant manquerait donc à Bergson. Il est avéré que les passages des Deux sources de la morale et de la religion consacrés à la religion dynamique font peu de cas de la théologie négative, et de toute expérience de « nuit obscure », image pourtant obsédante et centrale chez les grands mystiques. La pensée de la plénitude de la vie serait ainsi son défaut central. F. Worms montre, assez rapidement toutefois, que le vitalisme bergsonien, loin d’ignorer le négatif (sous ces trois figures que sont le néant, le désespoir et le mal) permet de le comprendre, au double sens d’en avoir une intelligence et de le contenir en le dépassant.
C’est sur cette question que l’on peut jauger ce qui rapproche et ce qui sépare Bergson de la « patience du concept » hégélien, qui doit en passer par le déchirement absolu d’avec soi-même pour accéder à une réconciliation plus haute. Cette question interroge aussi la critique implicite effectuée par Heidegger dans Qu’est-ce que la métaphysique ?, où la mise en évidence du néant est en fait une tentative de dépassement de Bergson [Comme l’a montré Yvon Bélaval, dans Les philosophes et leur langage.[/efn_note]. Peut-on penser le réel dans sa plénitude, sans y adjoindre l’idée de néant ? Reconnaître un néant absolu, n’est-ce pas toujours un manque, donc une tristesse ? En abordant brièvement ces problèmes, en signalant qu’ils ne sont résolues que par le mystique, et de façon ineffable, F. Worms nous laisse sur notre faim. 5
L’oubli de la durée
L’article de Florence Caeymaex s’insère dans la continuité du propos de Bergson. Elle y commente la critique des pseudo-concepts de désordre et de néant, pour en montrer la portée essentiellement métaphysique. Bergson considère comme une fausse question l’angoissant « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? ». Cette question ne peut être posé que sur fond de l’illusion que l’être aurait à exister par-dessus le néant.Cette illusion est celle de l’intelligence, qui néglige naturellement la réalité en tant qu’elle change et s’écoule. Cette critique des faux problèmes s’articule ainsi avec l’histoire des systèmes proposée au chapitre IV, pour former un envers de la pensée de Bergson : l’ensemble des conceptions qui travaillent dans ce que F. Caeymaex appelle -paraphrasant l’oubli de l’être chez Heidegger- « l’oubli de la durée ».
Cette étude offre une explication détaillée de la genèse de cette illusion. Pour détruire ce concept de néant, Bergson s’emploie à remonter du contenu énoncé (il y a du néant) à l’énoncé pensé (je ne trouve pas dans le réel ce que j’y cherchais), puis à remonter du langage à l’état psychologique qu’il indique, celui du reproche fait en fonction d’une attente déçue (je n’obtiens pas ce que je désire). F. Caeymaex s’appuie sur l’étude, faite par Bergson et d’autres auteurs qui l’ont inspiré, de l’analyse des jugements négatifs. Que signifie juger qu’une chose n’existe pas, ou pas comme je voudrais ? La confusion psychologique demande de ce fait une explication par la logique.
L’idée d’inexistence est un flatus vocis produit par l’intelligence. La logique est alors à son tour expliquée par le besoin d’agir, qui est à l’origine de ces illusions théoriques. J’ai besoin d’obtenir un objet, donc j’en suis privé, donc le monde n’est pas conforme à ce que je désire, donc il manque quelque chose au monde. L’idée de néant est donc une hypostase de mon libre pouvoir de désirer. La négativité affirmée est ainsi l’indice de la positivité du désir tout autant que de ma finitude.
Etre de désir, l’homme, pour penser la durée réelle qui crée et nous fait désirer, doit se défaire de l’intelligence. « La critique bergsonienne aura montré ce qu’il en coûte à la philosophie de réifier les conventions du langage et les catégories mobilisées par l’action qui se réfléchit ». 6
Les deux études de F. Worms et F. Caeymaex renvoient finalement à ce double fait : l’homme est finitude et surtout l’élan vital n’est pas actuellement infini. Ne peut-on alors dire qu’il manque à être ce qu’il pourrait être ? La question est bien de savoir si le manque relatif (donc en particulier la souffrance, le découragement…) est ou non l’indice d’un néant absolu, d’un véritable défaut dans l’être, d’un mal métaphysique.
Bergson et la philosophie
Le rapport de Bergson à Plotin est des plus essentiels. C’est le sujet de l’article de Sylvain Roux, qui montre le rapport entre bergsonisme et néo-platonisme. Plotin est en quelque sorte le métaphysicien par excellence, car il a exprimé mieux que personne la pente naturelle de l’intelligence, qui voit dans la création une dégradation de l’élan créateur et dans le mouvement un dégradé de l’immobile. Or, Bergson ne cherche-t-il pas à montrer que la création ne fait pas que s’épuiser à créer mais qu’elle se renforce dans sa confrontation même avec la matière ?
Chez Bergson, le questionnement métaphysique en revient fondamentalement à un questionnement sur la mobilité et sur notre incapacité naturelle à la comprendre. Il semble que pour Bergson, les faux problèmes et les confusions dans les différences (de degré ou de nature) viennent en dernier recours de cette incapacité première de l’intelligence. Aussi l’étude chez Bergson de la métaphysique, « coupable » au premier chef de reconduire ce travers, est-elle cruciale. « C’est pourquoi, parce qu’il veut achever un mouvement que le néoplatonisme a laissé incomplet et inachevé, le bergsonisme peut se présenter autant comme une critique de celui-ci que comme un de ses prolongements possibles. »
S’intéressant à l’histoire des modernes, Jean-Christophe Goddard établit, dans un article passionnant, comment Bergson a voulu prolonger Descartes et a pu critiquer à partir de lui les systèmes des successeurs cartésiens. L’auteur des Passions de l’âme n’a -volontairement- pas développé un système. Il en est resté à une hésitation assumée entre déterminisme et liberté. Il a de ce fait su conserver une pensée nuancée, au contraire de Spinoza et Leibniz qui ont rigidifié sa pensée pour la faire entrer dans leur système. La force de Descartes est de n’avoir pas tranché entre la causalité naturelle et le libre-arbitre, d’avoir cherché à tenir ces deux positions ensemble. 7. Descartes a donc su conserver la simultanéité – mot-clef de cet article- des deux vues, qui est celle d’une « coexistence contradictoire de la durée et de l’éternité, de la création et de la donation, du mouvement et de la paralysie ». A partir de Descartes, Bergson trouve à prolonger cette hésitation et même l’accroître jusqu’à atteindre un point critique : « être radicalement cartésien et pousser à l’extrême la polarisation de l’intelligence et de l’intuition pour voir la première naître de la seconde et saisir la continuité qui va de l’une à l’autre par un mouvement de renversement du même en son contraire ». Cette approche du rapport Descartes-Bergson est pour ainsi dire hégélienne : le mouvement dialectique ne va-t-il pas au bout de la détermination d’un concept pour tirer de lui son contraire ?
Se plaçant à un point de vue plus général, la dernière étude, proposée par Matthias Vollet, cherche « comment l’histoire de la philosophie s’insère dans le travail philosophique systématique de Bergson ». Ce bref parcours dans les cours de Bergson, auteur tout autant que professeur, éclaire la présentation de l’histoire de la pensée dans le quatrième chapitre. Quand Bergson étudie une doctrine, il en cherche toujours le « point unifiant », l’intuition fondamentale qui dirige tout le système 8. A plus forte raison lorsqu’il veut comprendre la métaphysique dans son ensemble, Bergson cherchera-t-il quelques formules directrices, « des centres de force », pour unifier entre eux les systèmes. Le rapport aux grands penseurs permet de s’installer -comme eux l’ont fait – dans l’intuition, quitte à voir à quel moment eux en sortent, pour tenter de prolonger leur élan plus loin qu’eux.
L’histoire de la philosophie serait donc, comme le dit aussi M. Vollet, l’histoire de « l’oubli de la durée », au profit de la spatialité, qui est l’objet propre de l’intelligence. Cette histoire est ainsi vue comme une « préhistoire » de la pensée de Bergson. Ce qui n’a de sens que rétrospectivement : l’histoire de la philosophie n’attendait pas en secret d’accoucher du bergsonisme. Celui-ci, en effet, n’est héritier qu’en tant qu’il marque une rupture. A tel point que pour Bergson, si la modernité est une suite de rencontres ratées avec la durée, la métaphysique antique est profondément erronée, car elle n’a vu dans le durable qu’une dégradation de l’éternel. Bergson se demande ainsi à quel point chaque penseur a su ou non penser implicitement sub specie durationis. Reste alors une ambigüité, dont l’explicitation termine l’article : l’histoire de la philosophie est-elle donc un progrès vers la durée ? Y a-t-il une évolution en philosophie ?…
La métaphysique de la création
Ce recueil est donc un guide de lecture très précieux, version développée et prolongement de l’édition critique de L’évolution créatrice. Les lignes tracées par ces commentaire permettent d’aboutir aux questions les plus passionnantes posées par la philosophie de Bergson. Il faut d’ailleurs souligner la cohérence et la continuité de ces études, qui se répondent et s’appellent mutuellement. Il ne faut néanmoins pas cacher que le propos est dense, ce qui tient à la fois à la façon dont Bergson va contre nos habitudes de pensée, et au fait que nous avons dans ce recueil la recherche universitaire la plus « pointue » sur cet auteur.
Je dirais que l’exploration de ce livre est difficile, mais promet de belles découvertes à qui va creuser -par exemple, comme je l’ai suggéré sur la proximité de Bergson et de Hegel. Ce recueil, en exposant toute la complexité des textes, permet d’en revenir aux intuitions simples et aux problèmes fondamentaux du bergsonisme, qui sont ceux de la philosophie même : y a-t-il du néant ? Peut-on penser la vie ? L’existence a-t-elle un sens ?…

ADDENDUM : BERGSON ET LE STATUT DE LA SCIENCE
Comme annoncé plus haut, je discute les critiques que Paul-Antoine Miquel adresse à Bergson, dans son commentaire du troisième chapitre.
La physique et la géométrie
Selon Bergson, la faculté propre de l’intelligence est de spatialiser la durée pour nous permettre d’agir. Ainsi, toutes les sciences, issues de l’intelligence, travaillent selon cette tendance.
En s’appuyant sur Poincaré, M. Miquel fait valoir que « l’induction physique fait intervenir des théories qui ne sont pas de simples théories géométriques. » Par parti pris philosophique, Bergson aurait au contraire voulu que la géométrie soit la métaphysique naturelle de l’esprit et que la physique reste donc sous sa dépendance. Toutefois, comme le rappelle l’article, Bergson ne confond pas matière et espace : l’espace n’est que la limite de la matière, si elle allait au bout de la tendance à la désorganisation. Le physique ne se réduit donc pas au géométrique.
Ainsi la matière reste bien, pour Bergson, mélange de quantitatif et de qualitatif, d’extension et d’intensité. C’est pourquoi la physique est bien guidée par l’expérience, comme le veut Poincaré (Bergson ne le nierait pas) ; néanmoins, en tant qu’elle formule des lois et des constantes, elle travaille bien à spatialiser l’expérience. Elle le fait, consciemment ou non, parce qu’elle s’appuie sur des outils mathématiques, auxquels Bergson assigne une origine pragmatique. La physique a besoin des schèmes du nombre et de l’espace, elle est lestée de géométrie en tant qu’elle est le produit de l’intelligence fabricatrice.
C’est pourquoi il y a bien, pour Bergson, deux voies et non pas une pour se placer dans l’absolu. La première façon est la plus connue : nous touchons à l’absolu en ressaisissant dans notre conscience la durée pure, par intuition, là où l’intelligence ne prend que des clichés sur le mouvement. La science reste alors relative par rapport à la métaphysique, sur le plan spéculatif. En revanche, en tant que l’intelligence prépare l’action et que vivre c’est agir, par l’intelligence nous touchons pratiquement à l’absolu (cette double capacité à dépasser le relatif se trouve incarné dans la figure du mystique accompli, qui atteint quelque chose de divin par sa pensée et par son action dans le monde.) C’est cette critique de l’épistémologie de Bergson (pour qui la science n’offre qu’une connaissance relative) qui est le nerf de l’argumentation de M. Miquel.
Compréhension et explication
M. Miquel cite cette phrase de La pensée et le mouvant (« La position des problèmes ») sur l’intuition : « C’est la vision directe de l’esprit par l’esprit. Plus rien d’interposé ; point de réfraction à travers le prisme dont une face est espace et dont l’autre est langage ». L’intuition serait compréhension intérieure, durée vécue, contact par sympathie avec son objet, là où l’intelligence expliquerait des phénomènes hors de nous. Comment l’intuition pourrait-elle donc sympathiser avec un dehors si elle est tout intérieure ? Dans tout son article, M. Miquel entend en fait affronter plusieurs apories bergsoniennes, réformer ce dernier pour mieux le dépasser. Sur ce problème de la relation de l’intuition au dehors, il écrit ainsi : « Voici notre interprétation, c’est de l’intelligence que naît alors l’intuition et non l’inverse. L’intuition naît de l’effort à travers lequel l’intelligence tente de penser le discontinu. »
Bergson le contesterait-il ? En fait, que veut dire « l’intuition naît de l’intelligence » ? Bergson est le premier à dire qu’un vivant évolue parce qu’il rencontre un obstacle sous forme d’un problème, dont la solution est à inventer et sera ainsi une création originale. L’intuition répond bien aux problèmes que l’intelligence rencontre sans pouvoir les résoudre, ni même les poser clairement. L’intuition n’est un prolongement de l’intelligence que pour autant que l’intuition subsistait comme une virtualité presque complètement « éteinte ». En ce sens là, l’intuition est bien, comme le dit l’article, « un surplus de force » pour l’intelligence. Cependant, ce surplus, l’intelligence ne sait qu’en faire, elle ne peut pas d’elle-même le dépenser.
Disons donc que les obstacles rencontrés par l’intelligence, seule l’intuition peut les résoudre, parce qu’elle seule comprend que ces obstacles ont leur origine dans l’intelligence elle-même. Autrement dit, les échecs de l’intelligence dans son effort d’explication sont autant d’occasions pour l’intuition de se réveiller. Il est par contre bien clair que pour Bergson l’intelligence doit travailler la première. C’est par la science que le philosophe connaît les faits. La science est travail d’extériorisation de la conscience dans la spatialité, avant la ressaisie de cette dernière comme durée, création.
Durée et substance
Pour M. Miquel, si je comprends bien, Bergson aurait tiré de la science un énergétisme, celui de l’élan vital, érigeant en principe métaphysique une simple notion scientifique. Tout ne serait qu’énergie (élan, conscience) et dégradation de cette énergie (matière, spatialité). Il faudrait dégager le sens de cet énergétime. M. Miquel le fait plus loin dans l’article, en affirmant que, à la limite, pour Bergson la durée n’est rien de substantiel -ou du moins, faudrait-il aller jusque là, malgré Bergson. Ce dernier aurait ainsi travailler à montrer que la matière n’est pas le tout du réel, grâce à cette notion d’énergie. Cette énergie est un l’accroissement qui est à lui-même sa propre fin. Dynamis sans telos donc, ou encore processus qui à chaque instant est aussi puissant qu’il peut l’être –conatus ou volonté de puissance.
M. Miquel prétend élargir le bergsonisme en allant plus loin que lui : « il faut dé-substantialiser la durée ». Quelle est au juste l’ambition d’un tel programme ? Bergson a-t-il eu besoin d’assimiler la durée à une substance ? N’a-t-il pas déjà évité de faire de la durée une substance ? La durée chez Bergson est aussi bien devenir que substance -mais ces deux termes appartiennent au langage de l’entendement, ils désignent deux vues insuffisantes sur une réalité indivisible. La durée change et ce changement est l’étoffe du réel. Que le changement soit substantiel, Bergson l’accorde, mais c’est pour dire qu’il ne se confond pas avec le fleuve héraclitéen : la durée a bien une consistance, une viscosité pourrait-on dire. Bergson n’accepte d’employer le lexique de la substance que pour soustraire celle-ci à toute immobilité.9
La vie et la matière
M. Miquel présente alors son objection la plus intéressante, la plus maline, contre Bergson. Il aborde un des questions les plus difficiles de tout le bergsonisme, celle de la genèse de la matière. Question qui oblige Bergson à bouleverser la métaphysique telle que léguée par Aristote, en revenant sur la distinction entre substances et accidents. « Il s’agit de passer d’une conception à l’intérieur de laquelle il n’y a qu’un ordre et un seul, l’ordre vital dont l’ordre mathématique serait la suppression, à l’idée que l’ordre mathématique n’est pas un néant ».
Voici l’objection : comment l’arrêt de l’élan peut-il être une négation réelle, pas un simple prédicat, sans être un néant absolu (notion explicitement critiquée par Bergson) ? Pour Bergson, on le sait, il n’y a pas de manque dans le réel. Quand je dis qu’il n’y a pas quelque chose, quand j’introduis verbalement du négatif, ce n’est que parce que je substitue à ce qui existe quelque chose d’autre, que j’imagine mais ne rencontre pas. Si je dis que l’immeuble qu’on m’a indiqué n’est pas là, c’est que je m’attendais à le trouver. Mais le réel ne manque de rien. S’il n’y a pas l’immeuble cherché, il y a autre chose, mais qui ne m’intéresse pas (un square, un carrefour…). Dès lors, s’il y a de la matière, note l’article, elle ne peut être un manque par rapport à la vie, elle ne peut être une négation de la vie -sans quoi Bergson se contredirait. La matière est autre chose. Il faudrait alors conclure que « l’ordre géométrique n’est une suppression, que du point de vue de l’ordre vital, et non en soi ». Il n’y aurait alors plus de raison de voir dans l’immobile du mobile dégradé. La matière ne serait plus inférieure au spirituel, elle ne serait pas sa négation. Elle n’apparaîtrait telle que pour un vivant, qui ne peut concevoir l’inerte que comme du non-vivant.
Comment Bergson peut-il alors affirmer que la matière est bien une interruption et une inversion réelle, pas seulement pour la conscience, mais en soi ? La solution proposée dans l’article est ingénieuse : la durée ne serait ni la vie ni la matière, mais « ce au sujet de quoi il y a vie et matière ». L’unité des deux tendances de l’élan, dont l’une n’est alors plus simplement la dégradation de l’autre, se trouverait dans la durée. Tout vécu de conscience serait toujours déjà spatialisé. Unité de la substance, dualité des tendances. Autrement dit encore : vie et matière sont deux prédicats de la durée. « C’est-à-dire que cette structure ontologique duelle du réel n’est pas un absolu dans lequel la pensée métaphysique s’installe d’emblée, mais plutôt un évènement qui surgit sur le terrain de l’analyse scientifique des systèmes et de l’ontologie équivoque et finitiste que cette analyse dégage ! »
Il faudrait en fait corriger Bergson dans un sens qui est somme toute spinoziste : matière et vie sont deux expressions différentes d’une même substance. Et cette substance, la durée, n’est pas un être mais un acte pur. Par là, M. Miquel plaide manifestement pour la science, contre sa dévaluation par les métaphysiciens. A quoi Bergson répliquerait certainement que ce parallélisme entre vie et matière est précisément une tendance inhérente à l’intelligence, exprimée le plus clairement par le système de Spinoza, et reprise sans critique par les philosophes et les scientifiques. Tendance à laquelle résiste Bergson, en affirmant qu’il y a plus dans l’esprit que dans la matière étendue.
Un bergsonisme matérialiste ?
En fait, que la pensée de la dualité soit découverte sur le terrain de l’expérience, Bergson ne dit pas le contraire, et son tour de force a toujours été de retrouver des intuitions spirituelles à partir de l’étude empirique. L’expérience est l’occasion de l’intuition, non son origine. C’est bien au contact des faits que la conscience se réveille, que l’esprit s’affermit, Bergson ne le nie pas. Quand il demande un effort pour revenir en nous, il entend revenir à des données immédiates fournies par la conscience à elle-même. Cependant, ce retour à l’immédiat est enrichi de toute la médiation apportée par l’étude des faits. L’étude de la science est le moment où il faut engranger des faits, élargir notre horizon et remettre en question nos préjugés. C’est aussi le moment où l’intelligence trouve ses limites, où les sciences finissent par dévoiler la métaphysique inconsciente grâce à laquelle elles travaillent. En ce sens, le plus métaphysicien, c’est le scientifique, qui opère des choix non-justifiés et extra-scientifiques sur le statut de son objet.
M. Miquel entraîne donc Bergson sur un terrain où il ne voudrait sans doute pas aller et nous montre ainsi que la science est désormais incompatible avec toute forme de spiritualisme. Le reproche adressé à Bergson est finalement de défendre une rentrée en soi, ce retrait dans l’intériorité, face à quoi M. Miquel plaide pour une attention aux choses. Contre la genèse bergsonienne de l’intelligence, il faut retrouver celles-ci par « l’analyse du mouvement de matérialité dans les choses. » C’est plaider pour un monisme de la matière et de la vie, pour une science qui serait capable d’avoir une vision complète de ses présupposés métaphysiques, et donc de les surmonter. Or (pour prendre un exemple) peut-on faire de la science sans chose ? Peut-on assigner le mouvement à la matière, là où elle était immobilisation pour Bergson ? En un sens, ce serait réduire le dualisme central de l’Evolution créatrice, installer le dualisme de la vie et de son arrêt dans l’unité de l’expérience. Il n’y aurait ainsi plus de différence de nature, seulement de degré, entre science et philosophie. Il n’y aurait plus une seule, mais plusieurs épistémologies, définies au contact de l’expérience, au contraire de l’épistémologie de Bergson, qui reposerait sur une position de principe (une vision spiritualiste de la nature).
L’intuition du tout
Le rapport de Bergson aux sciences tenait en fait sur le fil du rasoir : il lui fallait simultanément montrer la continuité et la rupture entre l’intelligence et l’intuition, sans les considérer comme des symétriques, sans quoi ces deux facultés auraient été équivalentes, car leurs domaines propres auraient été deux moyens d’expression d’une même réalité.
Et pour cela, il fallait prouver que l’intuition pouvait vraiment comprendre l’intelligence car elle en reconstituait la genèse, tandis que l’inverse n’était pas vrai (l’intelligence néglige naturellement l’intuition, elle la renvoie du côté du vague, de l’irrationnel, de l’instinctif). Bergson devait donc montrer comment l’intuition sort de l’intelligence (au double sens où elle en provient et s’en sépare). Si de fait, l’intuition ne demeure qu’à l’état de résidus et reste sous la coupe de l’intelligence, elle doit, de droit, pouvoir s’en distinguer. Contre cette supériorité, M. Miquel entend montrer que la hiérarchisation des méthodes de traitement des phénomènes est contingente, que c’est nous qui faisons varier les ontologies. Autant Bergson apprécierait sans doute cette liberté de variation, qu’il utilise lui-même souvent avec la métaphore du kaléidoscope, autant cette contingence des structures de connaissance ne serait pour lui qu’un faux-fuyant. C’est pourquoi Bergson maintenant bien un absolu, dans lequel nous pouvons nous placer en revenant à la durée.
Ce terme d’absolu, la science contemporaine le refuse, pour ses relents théologiques, parce qu’il assigne d’avance une direction au travail du scientifique.
Par ailleurs, il ne semble pas que l’effort d’intuition demandé par Bergson soit un repli sur soi, bien au contraire. L’intuition s’accroît en s’étendant, elle approfondit les couches de durée en pénétrant de plus en plus largement dans le réel. L’effort de retour vers les données de la conscience est un préalable, peut-être à la manière du doute cartésien ou de l’épochè husserlienne. Nous suspendons notre attitude habituelle face au monde, pas pour trouver la vérité en nous, mais pour nous ouvrir différemment au monde, pour sympathiser avec lui. L’intuition, en même temps qu’elle culmine dans une mystique de la vie, est également cosmique. L’homme de science, à partir de sa discipline particulière, n’est-il pas lui aussi à la recherche d’une vision du tout en tant que mouvant ? Le prix à payer pour cela serait ultimement de renoncer à une illusion commode, celle qu’il existe des objets stables.
La science peut-elle se passer des choses et, positivement, parvenir à intégrer l’efficacité du temps comme effort perpétuel de création ? A quel point les sciences peuvent-elles constituer ce que Bergson nomme l’expérience intégrale ? Cette question passerait sûrement par une comparaison entre recherche de l’unité de l’expérience et recherche philosophique de la simplicité.
L’épistémologie de Bergson
Au fond ce que pointe M.Miquel, c’est ceci : en critiquant certains présupposés propres à l’intelligence et aux sciences, Bergson ne le faisait-il pas au nom de préjugés aussi forts, ceux d’un « spiritualisme » d’essence religieuse ? Ce qui continue à heurter, agacer le scientifique, c’est ce recours à un absolu que la science serait incapable d’atteindre, puisqu’elle ne serait qu’une expression conventionnelle du réel.
Dans Sagesse et illusions de la philosophie, Jean Piaget affirmait que la position de Bergson n’était jamais que l’expression plus nuancée et polie du thomisme dogmatique de Jacques Maritain : la science se meut dans le relatif et le contingent, la métaphysique seule atteint l’absolu.
Bergson est pourtant plus fin, ou retors comme on voudra, que Jacques Maritain. Il a voulu un spiritualisme qui ne soit pas pour autant une dévaluation de la science, ni une manière de faire de celle-ci un auxiliaire de la philosophie.
En voici au moins trois raisons : Bergson accorde que la science touche -indirectement il est vrai- à l’absolu en tant qu’elle sert l’action. De plus, le travail de l’intelligence est indispensable pour faire rejaillir dans un second temps l’intuition. Enfin, dans Les deux sources de la morale et de la religion, Bergson ne tranche jamais clairement sur le caractère divin ou non de l’élan vital. Il y a donc de la place pour une étude strictement immanente de la durée, indifférente à la transcendance.
Mais le scientifique peut-il accepter d’être un (noble) ouvrier de l’intelligence, et de laisser au philosophie cette région inexpugnable qu’est la spéculation sur l’absolu ? C’est bien ce partage des tâches qui constitue le point névralgique de l’épistémologie de Bergson. A vrai dire, rarement philosophie aura été autant en sympathie avec les sciences de son temps, ce qui explique sûrement que Bergson continue de séduire aujourd’hui.
- Arnaud François (dir.), L’évolution créatrice de Bergson, Vrin, 2010
- La méthode consistant à suivre des lignes de faits et à les recouper est exposée dans la conférence « La conscience et la vie », in l’Energie spirituelle.
- On peut à ce sujet penser à la conclusion d’André Pichot, dans son Histoire de la notion de vie, pour qui le vivant se définit comme écart par rapport à l’inerte. Vivre, c’est maintenir cette tension, tandis que la mort est retour complet au milieu.
- Je pense au livre de Bernard Mabille, Hegel : l’épreuve de la contingence, qui traite de la confrontation de l’Esprit avec ce qui lui est le plus extérieur : le sensible dénué de nécessité.
- F. Worms signale toutefois que la lecture de cet article appelle en complément celui qu’il a écrit pour le recueil Bergson et la religion : « Terrible réalité ou faux problème, le mal selon Bergson ». Lire [le compte-rendu de ce livre.
- L’idée de néant trouve son origine dans une projection de la conscience, qui peut librement choisir dans le tout de la réalité ce qu’elle désire et ce qu’elle rejette. Cette thèse a sans doute inspiré le Sartre de l’Etre et le Néant : c’est la conscience qui néantise, qui apporte le néant dans le monde.
- Voir à ce sujet le livre de Vincent Carraud, Pascal et la philosophie : tout comme Descartes, Pascal n’a pas produit un système achevé, il s’en est tenu fermement au point de vue subjectif et à sa dualité, entre liberté et nature.
- Comme le note justement M. Vollet, cette méthode de la recherche de l’unité simple est valable chez Bergson à plusieurs niveaux : en philosophie (le système et son intuition), en poésie (l’élan simple exprimé par le texte) et même pour la réalité tout entière, qui est engendrée à partir d’un mouvement simple. Toujours Bergson retrouve la création sous l’état de fait, et la simplicité sous la complexité créée.
- Gérard Lebrun présente une objection similaire : Bergson n’aurait fait que changer la topique de l’Être, en remplaçant la substance par la durée. Là où Hegel, après Zénon, conçoit le mouvement comme le contradictoire en soi, Bergson aurait esquivé la difficulté en montrant que la contradiction s’évanouit au contact de la durée. Par ce refus de la contradiction, Bergson serait donc lui aussi tombé dans les travers de la métaphysique. cf. La patience du concept, page 240.








