Les discussions contemporaines autour du sens de la « démocratie » aboutissent parfois à des conceptions singulièrement opposées, voire radicalement incompatibles. Pour illustrer notre propos, mentionnons deux d’entre elles : une conception formelle, ou procédurale, et une conception substantielle, que nous pouvons également qualifier de maximale.
Les tenants de la démocratie comme procédure cherchent à s’accorder sur une définition minimale. Selon eux, la démocratie est avant tout une méthode, comprenant un certain nombre de règles aptes à produire des décisions collectives, sur la base du consensus le plus large possible, et requérant le minimum de violence pour être appliquées. Elle est donc un moyen de résolution pacifique des conflits qui implique la participation du plus grand nombre. Leur problème est moins celui du sujet politique (qui gouverne ?) que celui du mode de gouvernement (comment gouverner ?). Hans Kelsen ou Norberto Bobbio figurent parmi les défenseurs de cette conception.
Pour les partisans de la conception substantielle, au contraire, confondre la démocratie avec un certain mode de domination, même encadré par des règles spécifiques, est une absurdité. À la rigueur peut-on parler d’Etat de droit, mais certainement pas de démocratie. La démocratie est portée par des communautés éphémères rassemblées dans le but de contester un ordre social inégalitaire. L’ordre est toujours fondé sur la distinction de ceux qui ont un titre à gouverner et ceux qui n’en ont pas, ceux qui sont compétents et ceux qui ne le sont pas. Cela se traduit par des discriminations spatiales très concrètes : les sans-titres ne peuvent occuper certains lieux. Tout va bien, le film de Jean-Luc Godard de 1972, qui raconte la séquestration d’un patron et l’occupation d’une usine par des ouvriers, illustre très bien cette conception, portée en philosophie par Jacques Rancière. Le problème principal que posent ces penseurs est moins celui du mode de gouvernement que celui du sujet qui gouverne, ou plus exactement, du sujet qui vient bouleverser le mode ordinaire de gouvernement.
Où est le peuple ? À cette question, les partisans des conceptions minimales et maximales répondent de façon totalement opposée. Le peuple, diront les premiers, apparaît au terme d’une procédure – le vote – initiée à l’intérieur de l’ordre constitutionnel. Il n’est rien de plus que la somme de tous les individus qui se sont rendus aux urnes. Le peuple, diront les seconds, émerge dans la contestation de cet ordre juridique, dans ses marges. Il est cette part de ceux qui sont en excès, de ceux qui n’y trouvent pas leur place, et qui pourtant, sur la base de la commune intelligence humaine, revendiquent leur appartenance à cette communauté, en exigeant qu’elle se transforme pour les accueillir, et non l’inverse.
Peut-on sortir cette opposition ? Ne pouvons-nous pas, tout en conservant ce que ces conceptions ont de pertinent, offrir un dépassement aux limites qu’elles rencontrent ?
La première qualité du livre de Catherine Colliot-Thélène, La démocratie sans « demos »1, est justement de proposer une issue à cette opposition. D’emblée, remarquons que le titre, certes percutant, est également trompeur. Sommes-nous face à un énième appel à retrouver le peuple, à une énième dénonciation des élites qui gouvernent sans le consentement du peuple ? C’est de tout autre chose qu’il s’agit. Si nous avons autant de difficultés à nous entendre sur le sens de la démocratie, nous dit Catherine Colliot-Thélène, c’est parce que le peuple que nous recherchons désespérément est un mythe. Ce mythe s’est enraciné en nous par l’intermédiaire d’un concept, la souveraineté populaire, qui, bien que faux depuis toujours, a connu une fortune extraordinaire du fait de sa remarquable efficacité passée. Aujourd’hui encore, la charge émotionnelle qui l’accompagne témoigne de son histoire glorieuse. Malheureusement, dans le contexte de la mondialisation, le décalage entre ce récit et les faits devient, pour la Raison, proprement inacceptable : le peuple souverain n’a jamais été aussi impuissant. Faut-il, alors, écouter les âmes chagrines qui nous annoncent la fin prochaine de la démocratie et l’avènement de nouveaux totalitarismes plus ou moins soft ? La force de La démocratie sans « demos » est justement de soutenir une thèse tout autre, nettement plus profonde, plus originale, et donc plus difficile à entendre : nous pouvons penser la « démocratie » sans la souveraineté populaire.
Le concept de souveraineté populaire repose, selon Catherine Colliot-Thélène, sur « la notion classique d’un demos conçu comme une communauté unie dont la volonté présumée conditionne la légitimité du pouvoir »2. Dans les termes de Rousseau, la souveraineté populaire renvoie au corps politique né du contrat social, possédant un pouvoir absolu sur ses membres, et guidé par la volonté générale. L’idée d’un peuple uni dans une même volonté autorise, selon une opinion commune, l’extension du principe d’autonomie de l’individu à la collectivité. Le critère de l’autonomie permet ensuite de distinguer le régime démocratique des autres formes de gouvernement. Il est nommé autolégislation, et se définit par la participation des individus à la formation des lois auxquelles ils obéissent. Dans cette acception idéale de la démocratie, la domination doit s’évanouir, puisqu’il est aussi illogique de forcer les individus à faire ce qu’ils font naturellement que de les contraindre à obéir aux lois qu’ils se donnent. Or, la domination étant loin d’avoir disparu des Etats dits démocratiques, on invoque une multiplicité de facteurs pour expliquer cette contradiction : du côté des gouvernants, la trahison des idéaux démocratiques, la tendance des élites à préférer leurs intérêts personnels à l’intérêt général, la puissance corruptrice des lobbys et de l’argent, et, du côté du peuple, la perte du lien social, la tendance à la massification et au conformisme, ou encore la concurrence effrénée des intérêts privés et les désirs de consommation.
Il existe une littérature considérable consacrée à l’explication, dans le meilleur des cas, ou à la déploration, dans le pire, du décalage entre théorie et pratique démocratiques. La démocratie sans « demos » ne viendra pas s’ajouter à cette liste. Face au principe de l’autolégislation, qui semble si mal rendre compte de la vie des démocraties, Catherine Colliot-Thélène pose cette question : avons-nous bien compris Rousseau ? En effet, parce que « le peuple soumis aux lois doit en être l’auteur »3, nous avons vu en Rousseau le héraut de l’autogouvernement. Du principe d’indivisibilité de la souveraineté4, nous avons conclu à l’homogénéité du peuple chez Rousseau, voire au caractère nécessairement identitaire de la démocratie. De son exigence de « l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté »5, nous avons cru que Rousseau niait, comme Hobbes, la possibilité de l’abus de pouvoir, voire anticipait la Terreur et les Totalitarismes.
Tout cela relève, selon Catherine Colliot-Thélène, d’une « lecture extrêmement tronquée »6 du Contrat social. Le second chapitre (La démocratie) de La démocratie sans « demos » offre à ce titre une relecture serrée de Rousseau, et parvient à des conclusions radicalement opposées aux précédentes. Tout d’abord, l’autonomie politique ne signifie nullement, chez Rousseau, que le peuple est lui-même législateur7, mais bien plutôt que la loi doit être générale, impersonnelle 8, c’est-à-dire égale pour tous : « la loi doit être telle que tout individu, pour peu qu’il veuille l’union de la société, doive nécessairement l’accepter »9 explique Catherine Colliot-Thélène. Ensuite, notons que ce n’est pas l’homogénéité, mais bien l’hétérogénéité du peuple que présuppose Rousseau. Unir la multiplicité des volontés particulières et contradictoires n’exige qu’une seule condition : non pas de niveler ou d’abolir les différences, mais de reconnaître une volonté commune, la volonté d’accord elle-même, identique chez tous les contractants. Enfin, et c’est peut-être la méprise la plus grave, Rousseau n’a jamais cherché à penser l’anéantissement du sujet au profit du citoyen, ou la soumission illimitée de l’individu à la communauté, mais bien les conditions d’une constitution politique la plus favorable possible aux libertés individuelles. La communauté à laquelle l’individu aliène ses droits n’est pas le peuple réel ou la multitude, mais le peuple politique, tenu par des lois qui ne statuent jamais sur le particulier (ce qui interdit la répression ciblée d’un individu ou d’une minorité) mais toujours sur le général. Le but de cette association est non seulement de préserver chacun dans la jouissance de ses biens, mais en plus d’assurer une sécurité à cette jouissance. De plus, cette communauté démocratique n’exerce pas elle-même le pouvoir, c’est le gouvernement qui s’en charge. De là, lorsque l’intérêt général est détourné au profit d’intérêts privés, la possibilité des abus de pouvoir, que Rousseau souhaite congédier dans sa réflexion sur les meilleures formes de la domination10. Cette réflexion le conduira, comme le rappelle Catherine Colliot-Thélène, à préférer l’aristocratie élective à la monarchie et, surtout, à la démocratie.
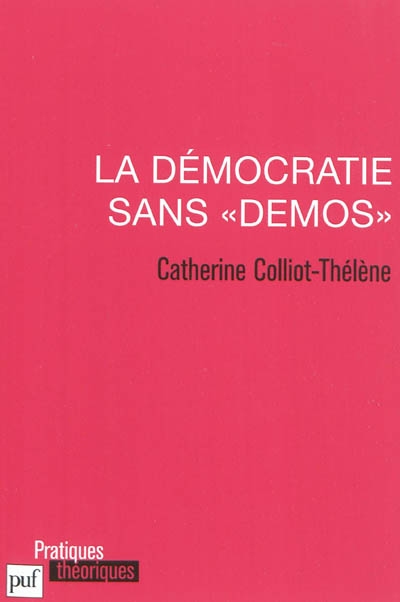
C’est donc Rousseau lui-même qui, contre toute attente, nous aide à nous défaire de la conception classique du demos, en nous libérant de la « fiction »11 de l’autolégislation. Mais ce biais qui déforme notre compréhension de la démocratie moderne n’atteint pas uniquement Rousseau. Notre représentation des rapports entre les divers penseurs de la modernité est parfois tout aussi biaisée. Ainsi, on oppose fréquemment Kant à Rousseau, et Hegel à Kant : Rousseau serait un démocrate, Kant un républicain, et Hegel un conservateur. Pourtant, tous partagent une analyse assez semblable de la nature cet Etat moderne que nous nommons « démocratie » : selon eux, par opposition à l’Etat féodal dont il est issu, l’Etat moderne se caractérise par l’abolition des différences statutaires et du pluralisme juridique. Sa tâche est de monopoliser le pouvoir juridique afin d’instaurer, à l’intérieur d’un territoire délimité, l’égalité de la loi. L’épopée des codifications illustre parfaitement ce processus, dont la figure centrale, le sujet de droit, est à la fois la cause et l’effet, l’initiateur et le produit. Pour cette raison, le véritable objet de La démocratie sans « demos » est moins le peuple que le sujet de droit.
Pourquoi, dans la pensée politique contemporaine, avons-nous perdu de vue la problématique du sujet ? Le premier chapitre de La démocratie sans « demos », intitulé « Les droits subjectifs », s’efforce d’y répondre. Les droits subjectifs sont traditionnellement définis comme l’effet d’un ordre juridique qui autorise un individu à créer des normes individuelles (en déclenchant un processus de défense de ses intérêts, et en exigeant la mise en œuvre de sanctions) ou des normes générales (en donnant la possibilité, par le vote et l’élection de représentants, de participer à la production des lois). Tous les régimes politiques ne garantissent pas aux sujets des droits subjectifs. D’après Catherine Colliot-Thélène, les droits subjectifs, associés aux droits naturels, ont été, comme eux, rangés dans la catégorie de la fiction juridique. En s’en tenant à cette analyse, on manque l’intuition fondamentale que recouvre cette association : « la « naturalisation » des droits ne faisait que traduire l’individualisation du sujet juridique »12. Le sujet politique médiéval était lui-même ses propres droits, il les emportait partout avec lui. La nature de ses droits, conçus comme des privilèges, conditionnait son statut, son existence dans « l’ordre cosmo-social objectif »13. À l’opposé de cette conception, la modernité, avec Kant, proclame que « le sujet de droit est pensable indépendamment des droits qu’il possède »14. Le seul droit inné que reconnaît Kant est le droit à l’égale liberté, à partir duquel nous pouvons déduire tous les droits concrets. Ces remarques permettent à Catherine Colliot-Thélène de conclure que Kant est bien celui qui a poussé le plus loin cette subjectivation en séparant « la figure du sujet de droit de toute appartenance présupposée à un collectif quel qu’il soit »15.
Ainsi, la modernité ne proclame pas l’autonomie de la communauté, mais l’autonomie du sujet. Au contraire, fonder la démocratie moderne sur le principe de l’autolégislation implique que la communauté démocratique prenne le pas sur le sujet de droit. Elle devient elle-même cette individualité fondamentale, dont le sujet n’est plus qu’une composante. Lorsque l’individu est déterminé par son appartenance communautaire, le tout prime sur les parties. Cette configuration a été renversée par « la révolution politique moderne »16 qui a défendu l’inaliénabilité du droit de la partie de se séparer de n’importe quel tout (la famille, la classe, la nation). Il ne faut donc plus rechercher le fondement du droit des sujets politiques dans un ordre social objectif quel qu’il soit, mais dans la relation du sujet à lui-même, dans l’autoréférence du sujet, dont Catherine Colliot-Thélène nous dit qu’il a « la propriété paradoxale de permettre l’inclusion sociale d’un individu qui est délié de toute appartenance à des collectifs déterminés »17.
Des analyses précédentes, nous pouvons tirer les conclusions suivantes : tout d’abord, il nous faut renoncer à la croyance, rattachée au mythe de l’autolégislation, d’une fin possible de la domination. La démocratie n’a rien à voir avec l’extinction progressive de l’Etat, chère aux marxistes ; elle est le mode de domination caractérisée par le sujet politique moderne sur lequel il s’exerce : le sujet de droit. Néanmoins, cette thèse, loin de se contenter de ruiner certaines illusions, a des vertus salutaires, notamment celle de « nous délivrer radicalement de toute interprétation communautaire de l’identité du peuple démocratique »18. Or, dans la période que nous traversons, quel moyen plus efficace de déjouer les ambitions des populismes qui prétendent pouvoir ressusciter des communautés authentiques fondées sur une identité ou des caractères éthiques partagés ?
Mais cette conception de la démocratie pose également un problème très pressant. En effet, les droits subjectifs ont été portés par un Etat centralisateur qui a, de cette manière, nationalisé la citoyenneté. L’unification de la collectivité présente sur le territoire sous la forme du demos a été le moyen de l’Etat moderne pour institutionnaliser les droits subjectifs. Devons-nous considérer ces derniers comme indissolublement liés à l’Etat-nation ? Si oui, qui va garantir la défense de ces droits à notre époque d’affaissement de la souveraineté étatique ? Si non, comment penser la citoyenneté en dehors du cadre national ? Doit-on rechercher à la raccrocher à de nouvelles appartenances communautaires (religieuse, ethnique, linguistique, civilisationnelle, etc.), et perdre de nouveau le sujet de droit ? Ou bien doit-on maintenir la primauté du sujet de droit en approfondissant encore la critique de la notion de demos ?
Le troisième chapitre de La démocratie sans « demos » décrit ainsi le processus d’assimilation de la citoyenneté à la nationalité, et s’interroge sur la nouvelle statutorisation des droits subjectifs – en d’autres termes, la tendance à faire dépendre la jouissance des droits de l’homme de l’appartenance à un collectif. Faire dépendre la citoyenneté de la nationalité pose un premier problème : que faire des non-citoyens, les étrangers ? La statutorisation des droits subjectifs, que l’on a cru déceler à travers l’apparition des droits sociaux, pose un second problème : la logique des droits subjectifs, qui s’appuie sur l’indépendance radicale du sujet politique, ne s’est-elle pas épuisée au profit d’un retour aux anciennes relations d’interdépendance entre individus à l’intérieur de la collectivité ?
À l’égard du second problème, nous pouvons indiquer quelques pistes tirées de La démocratie sans « demos ». L’apparition des droits sociaux – qui illustrent bien, rappelons-le, la capacité intégrative des droits de l’homme – a, en réintégrant l’individu à la communauté, redonné vie à l’idée de privilège du demos. De là cet apparent rabattement des droits subjectifs sur le statut des individus : la jouissance des droits sociaux présupposerait l’intégration dans un collectif qui nous procurerait ces bienfaits, et imposerait en retour des droits et des devoirs spécifiques à chaque membre. Nous pouvons donc préciser le problème posé par les droits sociaux : ont-ils remis en cause l’autoréférence du sujet politique en lui attribuant une dette envers la communauté dont il serait, en quelque sorte, impossible de s’acquitter ?
Nous pouvons, d’après Catherine Colliot-Thélène, réfuter complètement cette hypothèse. Tout d’abord, souvenons-nous que « les solidarités communautaires traditionnelles étaient toujours attachées à des relations spécifiques entre les individus qui jouaient des rôles distincts »19. Autrement dit, bien que des relations de réciprocité aient obligé les individus les uns envers les autres, il a toujours existé une dissymétrie complète entre les droits et les devoirs de chacun. Les droits sociaux n’impliquent aucunement un retour à cette dissymétrie, au contraire : ils sont le produit de luttes pour l’égalité des droits, menées par des sujets autonomes qui se sont à chaque fois librement associés. L’agrégation de ces revendications par les partis politiques, qui ont permis ensuite leur institutionnalisation et donc leur transformation en droits, permet à Catherine Colliot-Thélène de conclure que « l’imputation à l’individu de la charge de faire valoir ses droits demeurait un moyen extraordinairement économique, apparemment le seul imaginable, de réaliser les politiques sociales des gouvernements dans le cadre de société où la différentiation fonctionnelle a atteint un point de non-retour »20. Loin de constituer une régression vers la société de privilèges, les droits sociaux représentent l’aboutissement de la logique impliquée par l’émergence du sujet de droit.
Quant au problème du rapport entre citoyenneté et nationalité, parmi les nombreuses analyses que nous offre La démocratie sans « demos », retenons la suivante : pendant la période révolutionnaire, la citoyenneté était associée à la garantie des droits naturels ou civils (libertés d’opinion, de presse, interdiction de la torture, droit à un procès équitable ou encore droit de propriété), c’est-à-dire la protection contre les abus de pouvoir, et non avec la possession des droits politiques (droit de vote, droit d’assumer des charges politiques). Aujourd’hui, au contraire, un étranger disposant d’un titre de séjour dans un Etat démocratique bénéficiera des droits civils et d’une grande partie des droits sociaux, si bien que les droits politiques apparaissent comme l’essentiel de la citoyenneté.
Néanmoins, si nous persistons à penser la citoyenneté comme déterminée par la nationalité, l’exclusion croissante des non-citoyens, les étrangers, semble inévitable. En effet, avec l’affaiblissement des souverainetés nationales, et la multiplication des instances supra ou transnationales – instances qui produisent des règles échappant au contrôle des citoyens, et qui sont, pourtant, contraignantes –, renaît le désir de lier la démocratie à l’appartenance, la protection efficace des citoyens à la communauté. La logique de l’appartenance risque alors de reprendre le dessus sur la force émancipatrice des droits subjectifs, et la communauté se refermera sur elle-même. La célèbre analyse d’Hannah Arendt21 sur la situation des « sans-droits » apparaît toujours aussi pertinente : les non-citoyens, ainsi que les minorités qui ne sont « sans-patrie qu’à demi »22 – que l’on pense aux Roms aujourd’hui en Europe – en sont réduits à revendiquer un « droit à avoir des droits », un droit à être inclus dans une communauté au nom de leur appartenance à la communauté humaine. Or, nous pouvons constater, avec Hannah Arendt, que l’humanité ne joue pas ce rôle, et qu’il est peu probable qu’elle l’assume un jour. Comment sortir de cette impasse ?
Deux solutions sont généralement retenues : soit, comme le défend Seyla Benhabib23, nous pouvons compter sur l’inclusion progressive des étrangers grâce à la réinterprétation permamente, par la communauté démocratique nationale, de ses principes et valeurs; soit, comme le soutient Hauke Brunkhorst24, une communauté démocratique mondiale, structurée autour d’instances juridiques internationales, prendra en charge l’intégration des non-citoyens. Selon Catherine Colliot-Thélène, aucune de ces deux solutions n’est satisfaisante. Des arguments qu’elle leur oppose, nous retiendrons en particulier celui qui sous-tend toute l’analyse de La démocratie sans « demos » : ces deux thèses continuent de comprendre la démocratie en termes d’appartenance, notamment à cause du mythe persistant de l’autolégislation, et se trouvent de ce fait condamnées à produire de l’exclusion.
Le quatrième chapitre de La démocratie sans « demos » propose de résoudre la difficulté révélée par la situation des « sans-droits ». Faut-il, pour les défendre efficacement, invoquer cette ultime appartenance à l’humanité ? Catherine Colliot-Thélène conclut, à la suite de Kant, que l’humanité n’est pas un concept politique. En effet, si l’homme a bien l’humanité en partage, cela ne signifie pas qu’il appartient à l’humanité comme le sujet prémoderne appartenait à sa famille, sa seigneurie ou sa principauté. Nous ne devons pas considérer que les droits subjectifs sont octroyés par l’humanité à l’individu, pas plus que par aucune autre communauté. À ce titre, se contenter, comme l’a fait André Gorz, d’Adieux au prolétariat25 est insuffisant, il faut prononcer un « Adieu à tous les communautarismes »26. Évidemment, cela ne signifie pas que le sujet de droit abolisse tout sujet collectif, comme la nation ou la classe, dont les rôles, pour comprendre la démocratie, sont infiniment plus utiles que le « théorème de l’autolégislation »27. Néanmoins, il nous faut admettre que ces sujets collectifs ne peuvent peut-être pas se conserver, suite à leur institutionnalisation, avec la charge émotive qui les a fait naître.
C’est que les luttes politiques donnent naissance à des communautés qui semblent résoudre, chaque fois, le problème de la domination et des droits. Les révolutions populaires, par exemple, analysées à l’aide de concepts wébériens, ont, outre leur dimension antiéconomique, un caractère charismatique. Elles sont portées par des communautés émotionnelles, organisées autour de chefs dont les actes individuels sont fondamentaux. Toutefois, l’histoire nous enseigne que toute communauté charismatique, lorsqu’elle perdure, finit par s’organiser selon des « structures durables de l’action collective ». Inévitablement, alors, « le charisme est soumis à un processus de quotidianisation »28. Cette impossibilité, pour les communautés, nées de luttes pour l’égalité des droits, de survivre à la quotidianisation, c’est-à-dire à la fixation dans les formes nécessairement inégalitaires de la société, a été particulièrement bien analysée par Jacques Rancière. Mais ce dernier, selon Catherine Colliot-Thélène, comment une erreur en renvoyant le droit du côté de la pure logique de domination exercée par les experts. Ce faisant, il perd en effet la figure du sujet de droit, qui reste la clé nous permettant de comprendre la formation de ces collectifs en lutte.
Les collectifs qui, au moyen des luttes, font progresser les droits, ne le font pas sur la base d’appartenances initiales indépassables. Au contraire, ils produisent, à chaque fois, par leur association libre, des appartenances originales, qui se dissolvent plus ou moins vite une fois satisfaite leur revendication de droits. Si les révolutionnaires ont eu recours à l’Etat national pour instituer la citoyenneté démocratique, s’ils ont favorisé cette monopolisation du droit sur un territoire délimité qui a eu pour effet de contrôler le séjour des étrangers, c’était pour des raisons conjoncturelles, et non intrinsèques. Il s’agissait de mettre fin aux ordres, d’abattre la société médiévale dans laquelle les droits des individus dépendaient de leurs multiples appartenances. L’Etat-nation a donc toujours été un moyen, et non une fin. « C’est en tant que communautés territoriales que les Etats (ou l’Union européenne) excluent, et non pour des raisons inscrites dans le concept moderne de la démocratie »29, nous explique Catherine Colliot-Thélène. Il faut donc renoncer à associer la démocratie à la nation, ou même au peuple. La démocratie est « l’exigence d’égalité des droits » 30 portée par le sujet politique moderne.
Cette conception, fortement individualiste, ne doit pas être confondue avec la défense de l’individu souverain des théories économiques libérales. Ces dernières pensent l’individu comme un agent rationnel, occupé à maximiser ses bénéfices et minimiser les coûts qu’ils impliquent, dans une concurrence permanente avec les autres, de telle manière que tout collectif doit pouvoir se dissoudre devant la puissance de sa richesse personnelle. Si le sujet de droit, de son côté, est bien l’individu dont la caractéristique est de pouvoir se désolidariser de tout collectif préexistant, il est aussi celui qui peut s’associer librement à d’autres sujets afin de produire de nouveaux collectifs porteurs de revendications de droits. Ces collectifs sont caractérisés, comme nous l’avons vu, par leur anti-économisme. Ces droits, comme l’histoire des luttes sociales nous le montre, peuvent très bien avoir trait à la répartition des richesses, et remettre en cause la sacralité du droit de propriété. Le cinquième chapitre et dernier chapitre de La démocratie sans « demos » affirme que ce droit à revendiquer des droits est « un droit préjuridique qui n’est pas de nature, mais n’a de réalité que par l’action des individus, lesquels ne deviennent sujets qu’en s’affranchissant des tutelles »31. Il s’agit de l’essence même du sujet de droit, qui, en ultime instance, constitue la seule garantie contre les abus de pouvoir, qu’ils soient politiques ou économiques.
Fonder la démocratie sur le sujet de droit, remarque Catherine Colliot-Thélène, s’oppose également à la vision républicaine de la démocratie, qui, en France notamment, résiste fortement à l’idée d’un affranchissement total du communautarisme. Priver le Républicanisme de toute référence à la communauté revient, en effet, à faire fond sur son paternalisme intrinsèque, que l’on observe bien chez un auteur comme Durkheim. Les Leçons de sociologie de 1922 nous montre le sociologue bien moins occupé à « empêcher que l’Etat opprime l’individu » qu’à « affranchir l’Etat de l’individu »32. Afin de protéger l’autonomie de l’individu contre l’Etat, Catherine Colliot-Thélène nous rappelle l’utilité de distinguer la cohésion sociale du lien social. Le premier présuppose l’existence d’un Tout dont l’individu n’est qu’une partie, et dans lequel il doit s’intégrer. Le second, à l’inverse, « ne préjuge […] pas nécessairement l’existence d’un collectif délimité »33, et laisse donc une place pour la transformation de la communauté en fonction des aspirations des individus.
L’attraction que la conception républicaine de la démocratie exerce sur les individus est liée aux transformations planétaires à l’œuvre aujourd’hui. À l’heure de la mondialisation, le sujet de droit se retrouve de plus en plus contraint de composer avec de nouvelles formes et de nouveaux lieux de pouvoir, qui s’étendent bien au-delà du cadre rassurant de la nation. C’est en opposition avec la tentation de renouer avec ce cadre que s’inscrit La démocratie sans « demos ». Pour illustrer concrètement son propos, Catherine Colliot-Thélène choisit, dans ce dernier chapitre, de s’appuyer sur les analyses que James Holston34 a consacrées à la constitution de la citoyenneté démocratique au Brésil. Au cours des années 1980, les populations des quartiers populaires de plusieurs grandes villes brésiliennes, luttant pour améliorer leurs conditions de vie, ont décidé, au lieu de se tourner vers les responsables politiques, d’en appeler à la justice et aux tribunaux pour faire reconnaître des droits qui restaient, alors, à inventer. Avec l’aide de juristes, ils ont développé des connaissances juridiques, et sont devenus « des acteurs à part entière de la sphère publique en redéfinissant en même temps les contours de cette sphère »35. En effet, la citoyenneté brésilienne était fondée sur l’inégale répartition des droits. Se réclamer d’une quelconque appartenance à la nation aurait été absolument contreproductif. Les habitants des favelas ont réussi à faire valoir leur « droit à avoir des droits » en écartant le principe de l’appartenance au profit d’un réinvestissement du « langage des droits de l’homme »36. Voici une nouvelle illustration du fait que les sujets de droit ne peuvent compter que sur eux pour faire naître une citoyenneté basée sur l’égal accès aux droits.
Ainsi, bien que l’Etat ou la Nation soient des formes contingentes, la citoyenneté démocratique reste, quant à elle, essentielle. Elle implique l’existence d’un sujet en dialogue constant avec les pouvoirs pour faire progresser les revendications de droits, ou encore l’exigence d’égalité. À l’heure où les lieux de pouvoir se multiplient, et remettent en cause le cadre national, il faut s’interroger, d’après Catherine Colliot-Thélène, sur « les chances encore ouvertes aujourd’hui à la citoyenneté démocratique »37. Doit-on compter sur l’émergence d’une société civile mondiale pour la porter ? Selon l’auteur, cela constituerait une régression vers « une compréhension territoriale de la structuration de la politique »38. Doit-on alors parler d’un « monde fragmenté » dont il s’agirait de recomposer l’assise afin de placer efficacement les droits sous sa protection ? Mais le monde n’est pas un « puzzle »39 dont un expert pourrait nous dévoiler le sens préétabli.
Parvenu à ce point, La démocratie sans « demos » se conclut sur un certain nombre de résultats particulièrement éclairants sur l’état de notre monde et ce que nous pouvons en attendre. Tout d’abord, retenons que ce monde n’est pas une « totalité cohérente », même fragmentée, mais bien plutôt un enchevêtrement « de multiples réseaux qui se juxtaposent et se chevauchent à la fois »40 – réseaux économiques, politiques, culturels, citoyens, élitistes, scientifiques, légaux ou illégaux, locaux, nationaux ou transnationaux. L’image du réseau possède de nombreux avantages : dépourvu de centre, réticulaire, hétérogène, il est sans limites précises parce qu’il peut indéfiniment se connecter à d’autres réseaux. Mais cette image nous révèle autre chose : il est improbable que, dans les mailles de ces réseaux, des ensembles structurés et unifiés comparables à des Etats réapparaissent. Il faut donc faire le deuil de l’Etat tel que nous l’avons connu. Le peuple souverain, cette fiction devenue réalité par la volonté de l’Etat moderne, a également peu de chance, « du moins si les pouvoirs qui donnent forme à notre monde doivent demeurer éclatés »41, de retrouver une « consistance »42. Cette inconsistance frappe également, de façon remarquable, « le concept de droit »43. En effet, une des caractéristiques de la mondialisation est d’avoir séparée, notamment dans la sphère marchande, l’ordre étatique de l’ordre juridique, soustrayant par là même les normes produites à tout contrôle des citoyens. Il convient, alors, de revenir à la définition wébérienne du droit – tout ordre que des individus, regroupés en communauté, considèrent subjectivement comme valide, et qui détermine de fait leurs comportements – car elle nous libère du poids intellectuel du droit étatique.
Catherine Colliot-Thélène, s’appuyant encore sur Weber, propose également de réactiver sa définition du droit subjectif : « toute possibilité garantie que possède un individu « d’exiger pour ses intérêts (idéaux et matériels) l’appui d’un « appareil de coercition » constitué à cet effet »44, en ajoutant que cet appareil de coercition peut être celui d’un pouvoir autre que politique et que les moyens de coercition eux-mêmes ne sont pas nécessairement violents »45. Dans un monde où l’État ne monopolise plus la capacité de contraindre, et où le sujet de droit doit conserver son rôle émancipateur, cette définition permet d’inclure ces multiples instances vers lesquelles les citoyens doivent se tourner pour faire entendre leurs exigences d’égalité.
L’inflation des instances de pouvoir nous interroge, en dernier lieu, sur la pertinence du concept de légitimité. Des règles de plus en plus nombreuses, et effectivement contraignantes, sont produites par des entités auxquelles les États ont transféré, délibérément, une partie de leur souveraineté. Ces pouvoirs ne se réclament d’aucune légitimité particulière, « ils ne sont ni légitimes ni illégitimes, ils existent, tout simplement »46. Quelle marge de manœuvre reste-t-il au sujet de droit ? Au milieu de cette complexité croissante, il est rendu à sa figure originelle de sujet autonome, autoréférent, c’est-à-dire responsable de se libérer par lui-même des tutelles. C’est à lui qu’incombe la tâche de contraindre les pouvoirs à reconnaître l’égalité des droits. Et Catherine Colliot-Thélène de conclure : « Cette possibilité est certes assez faible, mais elle n’est pas inexistante, et elle est en tout état de cause ce dont dépend l’avenir de la démocratie »47.
La démocratie sans « demos » est donc un livre passionnant, relativement bref par rapport à l’ampleur de la tradition politique qu’il revisite, et riche d’enseignements sur la situation contemporaine. L’exigence que ce texte traduit de se placer dans une veine réaliste, objective, conduit inévitablement à désenchanter un certain nombre de nos représentations. Mais, en renouvelant la question du sujet politique, il présente aussi l’avantage de redonner vie à un paradigme qui, tout en fournissant un modèle de compréhension de la démocratie à l’âge de la mondialisation, laisse ouvertes des perspectives crédibles d’émancipation.
- Catherine Colliot-Thélène, La démocratie sans « demos », PUF, 2011
- La démocratie sans « demos », Paris, PUF, « Pratiques théoriques », 2011, p. 8.
- Du contrat social, Livre II, Chap. IV.
- Ibid., Livre II, Chap. II.
- Ibid., Livre I, Chap. IV.
- La démocratie sans « demos », p. 43.
- cf.Du contrat social, Livre II, chapitre VII, « Du législateur ».
- Ibid., Livre II, Chap. VI.
- La démocratie sans « demos », p. 73.
- Du contrat social, Livre III.
- La démocratie sans « demos », p. 8.
- Ibid., p. 28.
- Ibid., p. 45.
- Ibid., p. 36.
- Ibid.
- Ibid., p. 45.
- Ibid., p. 45.
- Ibid., p. 92.
- Ibid., p. 111.
- Ibid., p. 112.
- L’Impérialisme (1968), T.II de Les origines du totalitarismes, chap. V, II, Paris, Fayard, 1982.
- Ibid., chap. V, I, p. 252.
- The Right of Others, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
- « Menschenrecht und Solidarität – ein Dilemma ? », in H. Brunkhorst, W. R. Köhler, M. Lutz-Bachman (eds.), Recht auf Menschenrechte, Berlin, Suhrkamp, 2002.
- Adieux au prolétariat, Au-delà du socialisme, Paris, Seuil, 1980.
- La démocratie sans « demos », p. 157.
- Ibid., p. 139.
- Ibid., p. 153.
- Ibid., p. 161.
- Ibid., p. 162.
- Ibid., p. 173.
- Ibid., p. 171.
- Ibid., p. 171.
- Insurgent Citizenship, Princeton, Princeton University Press, 2008.
- La démocratie sans « demos », p. 184.
- Ibid.
- Ibid., p. 186.
- Ibid.
- Ibid., p. 187.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid., p. 188.
- Weber, Sociologie du droit, Paris, PUF, 1986, pp. 326-328.
- La démocratie sans « demos », p. 189.
- Ibid., p.193.
- Ibid.








