La première partie de l’entretien est consultable ici.
Le second chapitre de cette partie, « La dynamique de la possibilisation », complète ces analyses en étudiant le possible de l’existence dans son rapport à l’histoire, puis à la temporalité, et enfin la transcendance. La démarche allant de l’historicité à la temporalité peut surprendre, dans la mesure où elle n’est pas celle de Sein und Zeit, mais elle est justifiée par la démarche régressive de l’auteur vers ce qui rend possible le possible, et c’est bien la temporalité qui est le fondement de l’historicité. Comme le montre finement Claudia Serban, le devancement dans la mort ne va pas sans l’historicité propre, car les possibles existentiels qu’elle nous ouvre sont tirés de l’être-jeté vers lequel le Dasein résolu fait retour pour l’assumer. En effet, le devancement ne consiste pas à créer ces possibilités, puisque le Dasein est jeté en elles, mais à se les approprier, en tant qu’elles constituent un héritage, puisqu’elles ont déjà été choisies avant nous par les Dasein qui ont existé avant nous. C’est pourquoi la décision du Dasein résolu pour une possibilité est la répétition d’une possibilité traditionnelle. Comme le remarque avec justesse Claudia Serban, « la Wiederholung n’est pas « répétition » à proprement parler : elle n’est pas une reprise à l’identique, mais bien au contraire altération du passé en vue de son appropriation » (p. 150). Nous aimerions ajouter que cette Wiederholung est fortement influencée par la Gjentagelse kierkegaardienne, qu’on a longtemps traduit par « répétition » mais qu’on traduit maintenant pas « reprise », précisément parce que cette Gjentagelse a déjà le sens d’une appropriation. Comme l’explique encore l’auteur de manière pertinente, il s’agit pour Heidegger de réconcilier la phénoménologie avec l’histoire que Husserl excluait.au profit de la recherche de l’eidos anhistorique. Dans la mesure où l’histoire est d’abord une science du fait, nous pouvons retrouver ici le problème consistant à penser l’effectivité propre au Dasein. En effet, Claudia Serban écrit :
« la factualité sur laquelle porte l’histoire ne peut être que cette factualité excédentaire du Dasein qui se nomme facticité » (p. 152).
Nous retrouvons là cette hypothèse de lecture d’après laquelle l’effectivité du Dasein serait bien la factualité mais toujours dépassée par un ensemble de possibilités factices. La formulation de l’auteur semble dire que la facticité est un certain type de factualité, à savoir une factualité excédentaire, ce qui nous semble problématique dans la mesure où Heidegger semble bien exclure la factualité et la facticité quand il les thématise, au § 29 de Sein und Zeit, au lieu de chercher à les articuler. Il écrit : « Le « qu’il est et a à être » ouvert dans l’affection du Dasein n’est pas ce « que » qui exprime de manière ontologico-catégoriale la factualité propre à la subsistance. […] La facticité n’est pas la factualité du factum brutum d’un subsistant, mais un caractère d’être du Dasein » (SZ, p. 135). Et au § 57 : « la facticité du Dasein se distingue essentiellement de la factualité d’un subsistant. » (SZ, p. 276). On le voit, la factualité est ici massivement reconduite au subsistant et exclue de l’existant. Claudia Serban semble parfois défendre aussi une telle exclusion, puisqu’elle écrit qu’« il n’y a de « fait » du Dasein que comme facticité » (p. 152), donc pas comme factualité, et plus loin que « le Dasein historique n’est pas un fait au sens de la Tatsache, de « l’état de chose » » (ibid.). Si le Dasein n’est pas un fait au sens de la Tatsache, il ne saurait donc avoir de factualité (Tatsächlichkeit). Pourtant Claudia Serban veut pouvoir rendre compte de l’effectivité historique du Dasein, et se trouve alors à réaffirmer de nouveau une factualité du Dasein, puisqu’elle écrit que « le factuel lui-même n’apparaît qu’en tant que corrélat du possible » (p. 153), car « s’il y a donc quelque chose comme des « faits » historiques, ils ne sont que des sédiments, pour ainsi dire, d’une facticité transie par des possibilités d’existence » (ibid.). En somme, le possible factice, passant à l’effectivité, deviendrait fait au sens de la factualité, de sorte qu’il y a bien une factualité du Dasein, mais nous avons vu que Heidegger semble bien l’exclure quand il thématise la factualité. Par ailleurs, Claudia Serban, à propos de ce passage à l’effectivité, évoque « un possible lui-même facticiel, concret et, en tant que tel, appelé à entrer dans l’existence » ((ibid.). Mais comment une entrée dans l’existence, au sens de l’Existenz, serait-elle pensable, si ce n’est comme naissance ? L’Existenz, c’est le projet, c’est l’être-possible. Donc cette entrée dans l’existence du possible ne peut que signifie l’existence au sens non-heideggerien et traditionnel de l’existentia, dont Heidegger écrit : « existentia signifie ontologiquement autant que subsistance, un mode d’être qui est essentiellement étranger à l’étant qui a le caractère du Dasein » (SZ, p. 42). On le voit une fois de plus, l’effectivité semble être comprise par Heidegger comme subsistance, radicalement étrangère au Dasein, ce qui rend hautement aporétique la pensée du passage à l’effectivité du possible existentiel. L’interprétation de Claudia Serban est hésitante car l’hésitation est chez Heidegger lui-même, puisqu’il lui arrive d’écrire que « la factualité propre au fait du Dasein, ce mode en lequel tout Dasein est à chaque fois, nous l’appelons sa facticité. » (SZ, p. 56). Ici, la facticité semble être un mode de la factualité, de sorte qu’il y aurait bien une factualité propre au Dasein, ce qui semble rejoindre l’affirmation de Claudia Serban d’après laquelle la facticité serait une factualité excédentaire. Pourtant, elle semble encore hésiter, puisque quand elle décrit l’effectivité propre du Dasein, elle évacue la factualité pour ne plus parler que de facticité : « S’il n’y a du « fait » du Dasein que comme facticité et si cette dernière est traversée de part en part par le pouvoir-être, dès lors la tâche de l’histoire ne peut être que la mise au jour de cette facticité transie de possibilité qui constitue l’effectivité propre au Dasein » (p. 152). Mais l’idée d’une facticité transie de possibilité, traversée de part en part de pouvoir-être, nous semble problématique, non seulement parce que Heidegger ne définit jamais la facticité en ces termes, mais surtout parce qu’elle semble faire une différence entre la possibilité et la facticité, ce qui nous semble impossible, car pour Heidegger, c’est la possibilité elle-même qui est factice. Ce que le Dasein est facticement, c’est son pouvoir-être, et rien d’autre, de sorte que la facticité n’est pas transie de possibilité, elle est la possibilité elle-même, et la possibilité est toute entière la facticité du Dasein. Puisque Claudia Serban parle d’une factualité excédentaire, il nous semble que c’est cette factualité qui est transie de possibilité et traversée de part en part par le pouvoir-être. Nous le voyons, c’est un problème d’interprétation très complexe, car il trouve son fondement dans une aporie de la phénoménologie de la possibilité heideggerienne, qui ne semble pas capable de rendre compte de l’effectivité du Dasein tant elle place sa possibilité « plus haut ». L’unique passage de Sein und Zeit où Heidegger parle de l’effectivité du Dasein est celui-ci : « Mais qu’est-ce que cela veut dire : le Dasein est « factuel » ? Si le Dasein n’est « à proprement parler/proprement (eigentlich)» effectif (wirklich) que dans l’existence, alors sa « factualité » se constitue justement dans le se-projeter résolu vers un pouvoir-être choisi. » (SZ, p. 394). On remarque que « factualité » est mis ici entre guillemets, ce qui semble vouloir dire que ce terme n’est pas approprié pour décrire l’effectivité du Dasein. Par ailleurs, l’effectivité du Dasein est identifiée à l’existence, c’est-à-dire au projet vers la possibilité. Dès lors, l’effectivité du Dasein semble être identique à sa possibilité, et on ne voit plus comment serait pensable un passage du possible à l’effectif.
Claudia Serban entend ensuite montrer comment la possibilité existentiale est liée à la temporalité du Dasein. Elle montre de manière précise que le Möglichsein et le Zeitlichsein apparaissent ensemble pour être intimement liés dans les cours de Heidegger précédents Sein und Zeit à partir de 1923, puis dans Le concept de temps et Les conférences de Cassel. L’hypothèse de lecture est ici qu’être-possible et temporalité sont au même plan et se recouvrent. Mais l’auteur remarque bien qu’il y a un infléchissement à partir de Sein und Zeit, où c’est la temporalité qui rend possible, qui possibilise, toutes les possibilités existentiales du Dasein, de sorte que la temporalité devient condition de possibilité et fondation de l’être-possible, et donc de tous les existentiaux, et de l’être du Dasein comme tel : « la temporalité est une condition de possibilité au sens fort – une source de possibilisation – et en cela le dernier mot de l’ontologie fondamentale » (p. 160). Pourtant, Claudia Serban entend contester cette évolution dans l’articulation entre être-possible et temporalité en montrant que la position antérieure à Sein und Zeit et celle de Sein und Zeit se complètent, évoquant « la circularité (que nous lirions bien plutôt comme une fondation réciproque) qui existe entre l’être-possible et l’être-temporel » (p. 162). L’hypothèse est originale, mais elle ne nous convainc pas. Elle semble reposer entièrement sur l’interprétation d’un passage fondamental des Problèmes fondamentaux de la phénoménologie de 1927, le cours qui suit la parution de Sein und Zeit, et qui affirme :
« Dans la mesure où le temps est ce qui possibilise originairement, où il est l’origine de la possibilité elle-même, le temps se temporalise lui-même comme le prius absolu. Le temps précède toute priorité possible de quelque nature qu’elle soit, parce qu’il est la condition fondamentale de la priorité en général. Et dans la mesure où le temps comme source de possibilisation (possibilités) est le prius absolu, toutes les possibilités comme telles, dans leur fonction de possibilisation, sont caractérisées par la priorité, autrement dit elles sont a priori » (Ga 24, p. 462) (cité en note 1 p. 163).
L’auteur voit ici la confirmation que « la priorité du temps est la priorité du possible lui-même » (ibid.), de sorte que l’être-possible et l’être-temporel seraient pensés encore au même niveau comme ils l’étaient dans les cours marbourgeois, de sorte qu’il y aurait bien fondation réciproque et circularité. Nous ne sommes pas convaincus, nous pensons que Heidegger abandonne bien sa position des cours marbourgeois dans Sein und Zeit et aussi en Ga 24, car nous ne lisons pas cet extrait de la même façon. Il nous semble que ce que veut dire Heidegger ici, c’est que les possibilités existentiales, donc l’être-possible, sont a priori, mais que ce qui fonde cette priorité du possible est le temps qui, lui, n’est pas a priori puisqu’il rend possible tout a priori, et c’est ce que signifie le fait qu’il soit dit, non pas a priori, mais le prius absolu. Ce passage nous semble donc bien confirmer la position de Sein und Zeit, à savoir une fondation de la possibilité dans la temporalité, et donc interdire toute interprétation en termes de circularité et de fondation réciproque.
Dans un dernier moment, Claudia Serban entend montrer le rapport entre la possibilité, la transcendance et la liberté dans les textes de la fin des années trente relevant du projet éphémère d’une métaphysique du Dasein. Le lecteur non-germanophone y trouvera des indications précieuses sur ces cours importants, mais non traduits en français que sont Ga 26 et Ga 27. Nous nous contenterons de discuter certaines interprétations. Tout d’abord, l’auteur demande comment il faut comprendre l’articulation de la transcendance et de la temporalité, et demande laquelle des deux est le phénomène originaire. A nos yeux, il n’y a pas véritablement là de problème d’interprétation, la réponse est clairement donnée par Heidegger dans De l’essence du fondement lorsqu’il affirme que « la transcendance a sa racine dans l’essence du temps, ce qui veut dire dans sa constitution ekstatique-horizontale » (Ga 9, p. 166. Q I et II, p. 146). C’est l’ekstaticité de la temporalité comme être hors de soi qui rend possible la transcendance, et c’est son horizontalité qui rend possible le monde, pour autant que le monde est ce vers quoi la transcendance transcende l’étant, de sorte que l’unité de la transcendance et du monde au sein de l’être-au-monde est rendue possible par la temporalité ekstatico-horizontale. Claudia Serban explicite avec justesse la transcendance comme liberté, mais elle l’identifie avec le devancement et la liberté pour la mort, ce que nous contestons. Il faudrait distinguer un sens existential de la liberté, l’être-possible lui-même, le projet, neutre à l’égard de la différence entre l’existence propre et l’existence impropre, et un sens existentiel de la liberté, qui est l’existence propre comme résolution devançante, donc liberté pour la mort. Or, il nous semble que la transcendance est le nom de la liberté ontologique, donc du pouvoir-être en tant que tel, car que le Dasein existe proprement ou improprement, dans tous les cas il est transcendance vers le monde, car il est être-au-monde. De même, nous n’interprétons pas de la même façon le passage de Ga 26 sur le désespoir où Heidegger écrit que le désespéré voit l’impossibilité du possible, et par là-même témoigne encore en faveur du possible pour autant qu’il en désespère. Claudia Serban commente :
« Le désespoir (…) ne revient donc pas à une forclusion du possible qui marquerait son retournement en un ne-plus-pouvoir » (note 1, p. 165).
Il nous semble au contraire que le désespoir revient bien à une forclusion du possible qui marque son retournement en un ne-plus-pouvoir, mais que ce que veut dire Heidegger est qu’un tel retournement n’est possible que pour un étant qui est sur le mode de l’être-possible, du pouvoir-être, donc ce retournement témoigne négativement en faveur du possible, comme l’être-seul est un mode de l’être-avec. L’auteur cite aussi un autre passage de Ga 26 où Heidegger affirme de la transcendance qu’elle est le comprendre originaire (Urverstehen), le projet originaire (Urentwurf), pour en conclure que « la liberté apparaît ainsi comme plus originaire que la transcendance elle-même originaire (Urtranszendenz) ! » (p. 166), ce que nous contestons. La liberté est la transcendance originaire elle-même, à savoir le comprendre originaire, donc le projet originaire, qui n’est autre que le projet du monde. Plus loin, l’auteur entend montrer que la liberté comme transcendance n’est pas à comprendre exclusivement comme projet de soi, mais aussi comme projet du monde. Il nous semble que tout le propos de Heidegger est de ne pas les distinguer : projeter le monde, pour le Dasein, c’est projeter l’horizon de ses possibilités à partir desquelles il dévoile l’étant intramondain. Par conséquent, nous ne sommes pas convaincus lorsque l’auteur écrit qu’« il faut certes distinguer l’In-der-Welt-sein du monde lui-même, le premier étant un caractère inscrit dans le mode d’être du Dasein » (p. 170), car le monde est bel et bien un existential pour Heidegger, donc un caractère inscrit dans le mode d’être du Dasein, et il est même un moment structurel de cette constitution fondamentale qu’est l’être-au-monde, d’après Sein und Zeit, et il ne nous semble pas que les textes de la métaphysique du Dasein infléchissent cette position encore transcendantale qui ne sera surmontée qu’avec la Kehre. Nous avons montré plus haut en quoi les possibles existentiels du Dasein sont aussi les possibles de l’étant intramondain. Claudia Serban voit là un problème car « affirmer que la possibilité de l’étant intramondain s’origine dans le Dasein (…) contredit ouvertement le fait que l’étant intramondain ne partage pas – et Heidegger ne cesse de le répéter – le mode d’être du Dasein » (p. 172). Nous ne voyons pas là de problème.
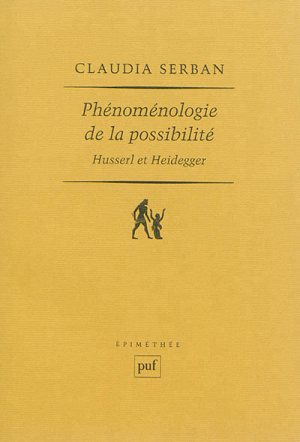
De la même façon que dire que le sens de l’objet intentionnel chez Husserl s’origine dans les acte donateurs de sens de la conscience transcendantale ne contredit en rien la différence entre l’être comme chose et l’être comme conscience, affirmer que la possibilité de l’étant intramondain s’origine dans le Dasein ne contredit pas le fait que l’étant intramondain ne partage pas le mode d’être du Dasein, c’est même le signe que le Dasein est encore pensé à cette époque comme un reliquat de sujet transcendantal. D’ailleurs, Heidegger dit explicitement dans Sein und Zeit que l’être de l’étant intramondain s’origine dans l’être du Dasein, puisque c’est à l’être du Dasein qu’appartient la compréhension de l’être, donc aussi de l’être de l’étant intramondain, ce qui n’est nullement contradictoire avec le fait que l’étant intramondain ne partage pas le mode d’être du Dasein. Le chapitre s’achève sur une lecture de la toute fin des Concepts fondamentaux de la métaphysique (Ga 29/30, pp. 128-131) qui n’avait jusqu’alors guère suscité l’intérêt des commentateurs où Heidegger semble se confronter enfin au problème de l’effectuation du possible existentiel, non plus en terme de factualité ni de facticité, mais de Verwirklichung, effectuation, et de mögliche Wirkliche, effectif possible. Mais force est de constater que ces passages sont obscurs et on ne peut les interpréter qu’avec modestie. Claudia Serban montre que le projet vers la possibilité est réinterprété comme une mise en suspens dans le possible qui peut faire penser à l’épochè husserlienne, ce qui ne nous paraît pas tout à fait évident, car le projet est l’être même du Dasein, pas quelque chose qu’il pourrait librement accomplir ou pas, alors que l’épochè est un acte qu’on peut librement accomplir ou pas. Toujours est-il que cette mise en suspens dans le possible n’éloigne pas de l’effectif vers des possibilités librement imaginées, mais relie le possible et l’effectif dans la mesure où le possible en question est toujours un effectif possible, est toujours l’esquisse d’une effectuation. Le projet nous lie à ce que cet effectif possible exige pour que le possible soit effectué. Nous ne sommes pas convaincus qu’il s’agisse là véritablement d’« un sens remanié de l’Entwurf » (p. 173), dans la mesure où le projet tel qu’il était thématisé dans Sein und Zeit n’était déjà pas un arrachement vers une libre possibilité imaginaire sans rapport à la situation concrète du Dasein, mais était toujours une possibilité factice, donc quelque chose qu’il peut véritablement choisir d’être dans la situation qui est la sienne, idée qu’on trouvait déjà de manière proche chez Husserl sous la figure de la possibilité motivée, ou réale.
D : Heidegger et le dépassement de la métaphysique du possible
La première section de la deuxième partie, « Le dépassement de la métaphysique du possible », a pour objet d’enquêter sur l’évolution de la possibilité dans la philosophie de Heidegger postérieure à la Kehre, dans les textes des années trente et quarante, dans la mesure où le possible n’y est plus simplement le possible de l’existence, mais bien le possible de l’être lui-même. A partir des années trente, la pensée de Heidegger devient de plus en plus une histoire de la métaphysique, parce qu’elle est aussi une histoire de l’être, et du même coup une pensée du dépassement de la métaphysique dans la pensée de l’être. Dès lors, le premier chapitre, « Méta-métaphysique des modalités », analyse l’examen heideggerien du statut du possible dans la métaphysique, et le second, « Du possible aimant au possible avenant », montre comment la pensée non-métaphysique de l’être implique une transformation du possible. Ces recherches sont tout à fait novatrices et donnent à découvrir des extraits de volumes essentiels de la Gesamtausgabe, les fameux traités non-publiés, qui ne sont pas encore traduits en français (Ga 66, 67, 69,70, 71, 73.1, 73.2), ou pas correctement (Ga 65, Contributions à la philosophie (De l’Ereignis)1).
Claudia Serban ne précise pas ce qu’elle entend au juste par cette « méta-métaphysique ». Nous pensons qu’il s’agit d’effectuer ce que Heidegger a appelé le pas en retrait (Schritt zurück) qui sort de la métaphysique pour la mettre à distance, et ainsi pouvoir considérer sa constitution fondamentale. Or, si la métaphysique a été très tôt caractérisée par Heidegger comme une métaphysique de l’effectivité, de la présence, en cela qu’elle est, comme le dit encore le Heidegger des années 20, une ontologie de la Vorhandenheit, de la subsistance, qui occulte tout autre sens de l’être, et d’abord celui du Dasein comme existence, Claudia Serban entend montrer, de manière plus originale, qu’elle est en fait une métaphysique des modalités en général, et pas seulement de l’effectivité, donc aussi une métaphysique de la possibilité que doit dépasser la phénoménologie heideggerienne de la possibilité. C’est pourquoi l’exposé de l’auteur trouve son point de départ dans la caractérisation du primat métaphysique de l’effectivité, dont le commencement est sans doute le primat aristotélicien de l’acte sur la puissance étudié par Heidegger dans son cours de l’été 1931 (Ga 33), et qui culmine avec Hegel : « c’est le primat de l’effectivité qui fait son entrée dans la métaphysique et ouvre un nouveau chapitre de l’histoire de l’être » (p. 190). L’effectif étant pensé comme effectuation d’une puissance par une volonté, ce primat est reconduit à un vouloir qui est la volonté de puissance, raison pour laquelle la pensée de Nietzsche est l’achèvement et l’accomplissement de la métaphysique. Il y a bien alors une pensée de la possibilité, mais d’une possibilité toute tendue vers son effectuation, d’un possible qui est puissance. Cette pensée implique aussi une confrontation avec la philosophie transcendantale kantienne où l’être est pensé selon les modalités, donc aussi bien comme possible, effectif et nécessaire. L’idée de Heidegger est que la triplicité des modalités est en fait secrètement dominée par le primat de l’effectivité, donc de la présence et du présent, car la possibilité est toujours tenue pour un niveau inférieur de l’effectivité. Ces modalités ne font que signer l’oubli de l’être dans la mesure où ce n’est en elle que la possibilité, l’effectivité et la nécessité de l’étant qui sont pensées. Contre cette pensée du possible pensé seulement comme exigence d’effectivité, l’autre pensée non-métaphysique devra penser le possible sans l’effectivité, comme retrait à l’égard de la présence d’un étant présent effectif, donc comme foncièrement à venir. Dès le milieu des années trente émerge chez Heidegger cette idée que la technique est liée à l’essence de la métaphysique, est une certaine manière d’appréhender tout étant dans l’horizon de l’efficience, ce qu’il appelle à l’époque Machenschaft. Le possible métaphysique est ainsi le possible technique, « le possible vu dans l’optique de sa réalisation (…) le possible planifié, calculé, privé de toute dimension d’imprévu ou d’événement – donc un possible déjà présent, qui n’est plus véritablement à venir » (p. 197). Claudia Serban cite, traduit et commente un passage essentiel de Ga 67 qui oppose au possible de la Machenschaft un autre possible qui est celui de l’être lui-même, et qui n’est plus subordonné à l’effectif. Le chapitre s’achève sur une analyse du possible de la technique dans sa différence avec le possible de l’existence2.
L’homme se laisse prescrire ses possibilités par les objets techniques, mais, remarque Claudia Serban, il semble que la mort soit le seul possible qui ne puisse être objectivé et inscrite dans le réseau de la machination, la seule possibilité qui lui revient en propre, raison pour laquelle Heidegger ne nomme plus l’homme « Dasein », mais le mortel. Pour notre part, il ne nous semble pas que ce soit véritablement là une avancée par rapport à Sein und Zeit dans la mesure où le fait de se laisser prescrire ses possibilités, et donc son être, par le monde, par l’étant intramondain, était déjà dans ce livre la caractéristique essentielle de l’avenir inauthentique comme s’attendre, et du comprendre impropre qui consiste à se comprendre à partir de l’objet de sa préoccupation quotidienne. Dès l’Hauptwerk, c’était déjà la mort qui était l’unique possibilité sans relation (unbezüglich) avec l’étant intramondain, rendant possible au Dasein de se comprendre proprement, c’est-à-dire comme mortel. Claudia Serban écrit :
« Le Dasein est celui dont l’existence est de part en part transie de possibilités, alors que pour le mortel, le pouvoir-mourir semble être la seule possibilité qui lui revienne encore en propre » (p. 201).
Nous ne voyons pas là non plus de différence foncière, dans la mesure où la mort comme possibilité était déjà en 1927 la seule possibilité que l’on ne peut déléguer, la seule possibilité que l’on ne peut prendre à quelqu’un, qui ne tolère aucun partage, en laquelle nous sommes impliqués en tant qu’uniques. Il nous semble que la nouveauté de la pensée de la mortalité de l’homme, telle qu’elle se déploie dans les conférences de Brême de 1949, consiste justement à montrer que la technique peut aller jusqu’à déposséder l’homme de son mourir, et que c’est ce qui est advenu dans les camps d’extermination. Toujours est-il que Claudia Serban fournit une interprétation tout à fait éclairante de l’affirmation heideggerienne selon laquelle la mort, en tant qu’écrin du néant, est l’abri de l’être. Pour autant que l’être n’est rien d’étant, le rapport à la mort est rapport à l’être qui veille sur lui en le mettant à l’abri de la violence de la technique.
Dès lors, le possible prend un autre sens que le possible de la technique, à savoir un possible qui est l’être lui-même comme possible aimant et avenant. Un possible soustrait à l’exigence d’effectuation, donc pensé comme retrait à l’égard de l’étant, voilà qui permet de penser l’être dans sa différence d’avec l’étant, l’être comme ce qui se retire, comme le plus inapparent. C’est l’occasion pour Claudia Serban de citer et d’expliquer les fragments 157 et 267 des Beiträge où se produit cette transformation. Contre le primat métaphysique de l’effectivité qui détermine encore le possible comme tendant vers son effectuation, Heidegger affirme ici explicitement que l’être doit être pensé sous la figure du possible dans la pensée de l’autre commencement. Dire que l’être est possibilité, c’est une manière de le penser dans sa différence avec l’étant, et comme « une possibilité soustraite à la téléologie de l’effectuation, une possibilité appelée à demeurer possibilité » (pp. 208-209). Même si l’auteur ne le dit pas ici, il nous semble que l’on peut voir là une confirmation du fait que la mort est l’abri de l’être, puisque dans Sein und Zeit, c’est bien la mort qui était ce possible pensé sans rapport à la moindre effectuation dans le devancement. Simplement, nous nous demandons si la pensée heideggerienne du possible ne se trouve pas confrontée de nouveau à la même aporie. Nous avons montré que penser la mort sans rapport à son effectivité rendait problématique son statut de possibilité. Car comment penser une possibilité pure, une possibilité qui ne soit la possibilité d’aucune effectivité ? Une possibilité de rien est-elle encore une possibilité ? On peut poser la même question à propos de la caractérisation de l’être comme possibilité, en demandant de quoi l’être est la possibilité, puisqu’il n’est pas la possibilité de l’étant effectif, et si on peut encore le caractériser comme un possible sans qu’il soit la possibilité de quelque chose. Toujours est-il que le possible est un outil pour penser l’être comme retrait, comme ce qui se refuse. Mais comme le remarque Claudia Serban, la détermination de l’être comme possibilité, à partir des années 40, et tout particulièrement dans la Lettre sur l’humanisme, ne vise plus tant à penser l’être comme retrait, mais comme amour désirant (Mögen) qui résonne dans l’allemand Möglichkeit là où le latin possibilitas renvoie plutôt au pouvoir (posse). Si l’auteur affirme que « ces deux régimes d’expérience ne sont sans doute pas à opposer de façon trop tranchée, car il se peut que l’amour désirant ne soit que le revers du retrait et sa manifestation » (p. 210), il nous semble que cela mériterait un éclaircissement, car nous avons pour notre part du mal à voir comment le fait que l’être se refuse à nous et nous abandonne, trait caractéristique de la détresse de l’époque de l’accomplissement de la métaphysique dans le nihilisme, pourrait être le revers de l’amour bienveillant de l’être, à moins qu’il ne pratique l’amour vache.
Mais Claudia Serban montre que l’amour en question est compris par Heidegger comme le don de l’essence, qui fait se déployer quelque chose, donc qui laisse être en aimant, qui rend possible. Si l’amour laisse être, alors peut être en effet cet amour peut être le revers du retrait de l’être, dans la mesure où se retirer, pour l’être, c’est aussi laisser être l’étant, ce dernier n’entrant en présence que dans le retrait de l’être. Mais ici, il s’agit moins de laisser être l’étant en tant que tel, que d’aimer et laisser être l’essence de l’homme, à savoir la pensée, la relation de l’homme à l’être, et de garder l’homme dans cette essence. L’être possible/aimant dispense l’essence de l’homme et la préserve. Ce possible aimant est aussi à comprendre comme un possible avenant, d’après Claudia Serban, en cela qu’il est lié à la nouvelle détermination de l’être comme Ereignis, qu’elle traduit par « événement appropriant » pour insister sur cette dimension de venue et d’événement. La possibilité permet alors de « penser la dimension événementiale (ou avenante) de l’être » (p. 215). Le Mögen de l’être envers l’essence de l’homme pourrait bien être en définitive un nom pour cet appropriement de l’être à l’homme et de l’homme à l’être que Heidegger appelle Ereignis. Si l’être comme possible signifie ultimement l’événement appropriant, alors l’auteur estime pouvoir en conclure que « Heidegger a fini par réconcilier le possible et l’événement » (p. 220), renvoyant en note à l’article de Claude Romano, « Le possible et l’événement »3 où ce dernier entendait montrer que Heidegger avait pensé le possible propre à l’homme dans l’analytique existentiale mais avait raté l’événement en un sens qui soit à la mesure de l’homme, à savoir au sens événemential. Cependant, nous ne sommes pas convaincu que l’articulation entre le possible et l’Ereignis exposée par Claudia Serban remette fondamentalement en cause les conclusions de cet article, car « événement » ne nous semble pas avoir le même sens. L’événement thématisé par l’herméneutique événementiale est multiple, qu’il s’agisse de la naissance, de la mort, où des multiples événements d’une vie qui bouleversent notre monde en réarticulant nos possibles, alors que l’Ereignis heideggerien est l’unique par excellence. Et l’événement au sens événemential semble bien être soit passé soit à venir, même si on ne peut en être le contemporain, alors que l’Ereignis est un appropriement qui a constamment eu lieu avec l’histoire de l’être sans pour autant être révolu. Penser l’être comme possible et comme événement, ce n’est donc pas véritablement penser l’événementialité de la naissance, de la mort ou d’une rencontre.
A cette approche de la signification renouvelée du possible dans les textes heideggeriens des années 30 et 40, nous aimerions demander pourquoi elle ne prolonge pas son enquête vers les textes du dernier Heidegger, ceux des années 50 et 60, surtout s’il s’agit de dire que le possible en question est l’Ereignis, puisque c’est dans ces années que culmine cette pensée. Une réponse que nous aimerions apporter nous même est que dans ces derniers textes, il n’est plus question de penser l’être et l’Ereignis à partir du possible. Tout d’abord, l’assimilation de l’Ereignis à un événement nous semble finalement contestable. Penser l’être comme possible, c’est ne plus le penser à partir du présent, et du coup le penser à partir de l’avenir, donc « comme événement (à venir) » (p. 220). Mais l’Ereignis est-il fondamentalement à venir ? Il a pourtant lieu tout au long de l’histoire de l’être, dans chaque dispensation de l’être à l’homme, de sorte qu’il est tout autant passé. Claudia Serban cite d’ailleurs un passage de Ga 70 très important à ce propos : « Qu’est-ce qui advient dans l’histoire de l’être ? […] Rien n’advient : das Ereignis ereignet » (cité en note 4 p. 219). On voit ici que l’appropriement approprie tout au long de l’histoire de l’être, et qu’il n’y a pas histoire de l’être sans cet appropriement de l’être à l’homme, de sorte que l’Ereignis n’est pas spécialement à venir sans pour autant être révolu. Cela nous semble confirmé par la conférence Temps et être de 1962 où l’Ereignis est pensé comme le « ça » qui donne dans « ça donne temps », mais le temps en question articule passé, présent et avenir sans qu’il y ait de primat accordé à l’avenir, de sorte que l’Ereignis ne semble pas être lui-même à venir, ni même passé ni présent, puisqu’il est l’offrande (das Reichen) des dimensions du temps les unes par les autres. Du coup, il nous semble que l’Ereignis n’est pas même un événement. Dans cette citation, Heidegger semble bien dire que rien n’advient, donc que l’Ereignis lui-même n’advient pas, que son approprier n’est pas un advenir, donc n’est pas du tout un événement, de sorte que nous ne sommes pas convaincus que le possible heideggerien ait un sens événemential, ni que la possibilité serve à Heidegger pour penser la dimension événementiale de l’être. Enfin, Claudia Serban affirme que « le dernier nom de l’être est bien (comme nous avons tâché de le montrer) le possible » (p. 220), l’être étant arraché à la métaphysique de l’effectivité, de la présence, du présent, pour être pensé dans son rapport à l’avenir, « l’avenir événemential de l’être » (p. 221). Nous ne pensons pas qu’il s’agisse là du dernier nom de l’être, car dans la conférence Temps et être, le dernier nom de l’être est bien, in fine, Anwesenheit, présence, et non possibilité, et l’être n’est plus pensé foncièrement comme avenant, ou à venir, car ce sont les trois dimensions du temps qui sont des modes de l’Anwesen, et non uniquement l’avenir. L’idée avancée dans les Beiträge selon laquelle « c’est sous la figure du possible que l’être doit d’abord être pensé dans la pensée de l’autre commencement » (cité p. 221) pourrait bien n’avoir été qu’une étape sur le chemin de pensée de Heidegger.
E : Husserl, l’ontologie phénoménologique du possible
Comme le remarque avec justesse Claudia Serban, la pensée du possible chez le second Heidegger se caractérise par son retrait, c’est-à-dire par « une raréfaction de la teneur expérientielle et phénoménale du possible » (p. 225). Ce possible extrême qu’est l’être est caractérisé par un retrait essentiel. C’est ce qui justifie le retour à Husserl qui, à l’inverse, entend examiner les multiples manières qu’a le possible d’être donné dans l’expérience, c’est-à-dire ses modes de donation.
Le premier chapitre, « Vers une nouvelle ontologie des modalités », entend montrer que le possible phénoménologique est une donnée intuitive, non un concept formel, c’est-à-dire comment le possible est déterminé à l’aide de critères extra-logiques, à savoir son mode de donation dans l’expérience. Le célèbre § 24 des Ideen I présente le principe des principes de la phénoménologie, à savoir qu’il faut s’en tenir à ce qui se donne dans l’intuition originaire. Ce principe doit aussi valoir pour une phénoménologie de la possibilité, de sorte qu’il doit y avoir une intuitivité du possible, là où la métaphysique réduisait le possible au pensable, donc au concept, à la notable exception de Kant. Il ne s’agit pas seulement dire qu’il y a une intuition du possible, mais plus encore que toute intuition est une source donatrice de possibilités à l’égard de l’intuitionné. La possibilité est déterminée dès la 6ème Recherche logique par son exigence de remplissement : une signification visée est possible si elle peut faire l’objet d’un remplissement intuitif, qu’il relève de la perception, ou même de l’imagination, car le possible va au-delà du perçu, ce qui fait dire à Claudia Serban que « la proposition : est possible ce qui peut être donné dans une intuition, se laisse alors reformuler : est possible ce qui peut être donné dans l’imagination » (p. 230). Les Recherches logiques mettent au jour une gradation du possible qui va de la possibilité syntaxique pré-logique à la possibilité objective matérielle, réale, phénoménologique, attestée dans l’intuition, en passant pas la possibilité logique qu’est la non-contradiction formelle. La possibilité phénoménologique est d’abord liée à l’idéalité. La possibilité réale est motivée par le contexte de l’expérience, alors que la possibilité idéale est seulement inscrite dans l’eidos de la conscience ou de l’objet d’expérience sans être motivée. Ces possibilités, comme une réflexion qui embrasserait tout le champ d’inactualité de la conscience ou bien la perception adéquate et intégrale d’un objet qui est donné par esquisse, ne sont pas effectuables mais font office d’Idées régulatrices pour l’expérience interne ou externe. La possibilité idéale n’est pas la possibilité réale, mais elle n’est pas non plus une possibilité vide, purement fictive, puisqu’elle est impliquée par l’eidos. Du même coup, la phénoménologie eidétique est une phénoménologie de la possibilité idéale. Mais cette phénoménologie ne trouve son véritable accomplissement que dans la phénoménologie du possible réal, lié à la mise au jour de l’a priori matériel qui fait l’objet de l’ontologie matérielle : « avec l’a priori matériel, nous retrouvons donc le niveau proprement phénoménologique de la possibilité réale par-delà celui de l’idéalité » (p. 240).
Le second chapitre, « Les expériences de la prégnance du possible », entend montrer concrètement dans quelles expériences le possible est donné afin d’en conclure à chaque fois que « le sol d’expérience ainsi conquis fait apparaître le possible et l’effectif dans leur indivision originaire ou dans leur entrelacement et co-engendrement dynamique, permettant ainsi de déplacer la distinction modale au profit de l’intermodalité » (p. 248). A priori, il semble que l’imagination soit le terrain le plus propice à l’expérience du possible, quand la perception serait plutôt le champ de l’effectif. Il en est tout autre pour Husserl : le possible est toujours déjà inscrit dans la perception, qu’elle soit interne ou externe. En effet, c’est, dans Expérience et jugement, à partir de la perception qu’il recherche l’origine expérientielle des modalités, où le possible surgit dans la modalisation. C’est d’abord dans l’expérience d’un empêchement, d’un conflit, de la discordance dans le cours normal de l’expérience perceptive que surgit le possible, car cette discordance altère la croyance en l’effectivité du perçu (la doxa originaire en l’existence de la chose perçue), qui apparaît alors douteux, seulement possible, en un sens du possible qui est anté-prédicatif, donc nullement réductible au possible logique au sens du non-contradictoire. Ces possibilités qui surgissent du conflit sont des possibilités problématiques, ou présomptives, c’est-à-dire les possibilités alternatives par rapport à l’effectivité jusqu’alors tenue pour valable mais qui a perdu cette validité. Ces possibilités sont elles mêmes plus ou moins probables, c’est-à-dire jouissent d’un poids plus ou moins important, poids qui correspond à la motivation d’expérience que Claudia Serban a éclairée dans sa première partie. A cette modalisation issue du conflit s’oppose une autre modalisation, la modalisation ouverte, qui fait jaillir les possibilités ouvertes dont toute expérience est transie, même là où la croyance originaire en l’existence du perçu n’est pas altérée. Ce sont les pré-figurations intentionnelles de l’horizon, comme ces faces d’un cube que je ne perçois pas encore, qui tiennent au caractère ouvert du processus perceptif. Le rapport entre les possibilités n’est plus le même que dans le cas des possibilités problématiques, car ces possibilités ouvertes n’ont pas de poids et il n’y a pas entre elles d’alternative. La possibilité ouverte correspond donc à ce que la première partie de l’ouvrage avait dégagé comme étant la structure d’horizon de toute perception. Il s’agit là pour Claudia Serban, plus que d’une modalisation, comme le dit Husserl, d’une intermodalité, par quoi elle entend l’entrelacement du possible et l’effectif, dans la mesure où, dans le cas de la possibilité ouverte, la possibilité ne surgit pas après l’effectivité, quand cette dernière est mise en doute, mais en même temps. Un troisième cas est la modalisation active, où c’est par une opération du « Je », une décision, qu’il y a surgissement du possible à partir de l’effectif, et la réduction phénoménologique en constitue le meilleur exemple. Cette modalisation peut encore intervenir après le surgissement des possibilités problématiques pour trancher leur conflit dans un jugement et rétablir la cohésion de l’expérience perceptive qui avait été dérangée. La modalisation perceptive fournit une illustration de l’origine première de l’expérience du possible, mais cette dernière ne se réduit pas à elle, car l’imagination est aussi une source essentielle de la donation du possible. Claudia Serban s’appuie, pour élucider la théorie husserlienne de l’imagination, essentiellement sur les Ideen I et Phantasia, conscience d’image, souvenir. On connait d’abord le rôle essentiel que Husserl accorde à l’imagination dans la variation eidétique, qui doit permettre d’obtenir l’intuition eidétique : elle permet de faire varier les possibilités là où la perception est assignée à l’effectivité, afin de dégager un invariant. Elle peut aussi tourner en quelque façon le dos à l’expérience pour se réfugier dans le monde du comme-si, c’est-à-dire transgresser le registre des possibilités de l’expérience dont il était question avec la perception pour imaginer de pures possibilités qui ne sont jamais motivées par le déroulement cohérent de la perception et qui expriment le libre jeu de l’imagination. Il s’agit là, non plus de l’expérience proprement dite, réservée à la perception, mais d’une quasi-expérience de la pure possibilité donnée en présentification. Quasi-expérience, car il y a une certaine concordance au moins minimale, mais quasi-expérience seulement car elle est arbitraire, et non pas motivée. Le possible imaginé comporte en lui une certaine indétermination, là où seule la possibilité réale, la possibilité d’expérience, peut et doit être déterminée jusqu’à la singularité, ce qui fait dire à Claudia Serban : « l’imagination a donc une ouverture inversement proportionnelle à son pouvoir d’individuation » (p. 257). Il y a bien indétermination au niveau de l’expérience puisque son cours est un processus ouvert, mais le possible est toujours déterminable dans la perception alors que le possible imaginé laisse toujours ouvert une marge d’indétermination.
On le voit, les possibilités réales impliquées dans toute perception restent toujours liées un monde existant, quand les possibilités imaginatives s’en affranchissent librement. Si les possibilités réales sont toujours entrelacées avec l’effectivité, les possibilités de l’imagination s’affranchissent de cet entrelacement pour être de pures possibilités, pures, car pures de lien avec l’effectif. Une autre différence est que la conscience de possibilités réales est toujours positionnelle, car on peut librement actualiser ces possibilités en tournant la tête ou en se déplaçant, alors que l’imagination est caractérisée par la neutralité positionnelle, dans la mesure où on ne peut que se représenter la possibilité sans la réaliser : « l’imagination ne « fait » rien, elle n’« agit » pas » (p. 265). Mais comme le souligne Claudia Serban, l’imagination demeure toujours néanmoins, à titre de « comme-si », une quasi-expérience, une quasi-constitution, donc aussi une quasi-effectivité, de sorte que l’imagination se nourrit encore d’une référence à l’effectivité, et on retrouve au niveau de l’imagination l’idée déjà mise au jour dans la perception d’un entrelacement de l’effectivité et de la possibilité. De ce point de vue, possibilité réale et possibilité imaginative seraient comme des gradations dans le possible ouvert, la première étant motivée par l’expérience, la seconde étant arbitraire. La modification qui permet de passer de l’une à l’autre est la neutralisation par l’imagination de la position d’existence caractéristique de la perception. De ce point de vue, puisque l’épochè est elle-même une neutralisation de la position de l’existence du monde, elle constitue elle aussi un passage de l’effectif au possible : « la conscience de possibilité qui surgit par la neutralisation semble dès lors désigner la véritable vigilance phénoménologique » (p. 273). Claudia Serban achève ce second parcourt de Husserl en montrant comment l’effectivité se laisse repenser à l’aune de cette phénoménologie de la possibilité dans son entrelacement avec le possible, dès lors que la hiérarchie entre possibilité et effectivité se trouve infléchie. De ce point de vue, la phénoménologie husserlienne constitue déjà, avant Heidegger, une critique de la métaphysique comme doctrine de l’effectivité qui réduit ce qui est à l’étant effectif. L’attitude naturelle est caractérisée par une adhésion naïve et spontanée à l’effectivité du monde, et l’épochè consiste bien à la remettre en question au profit de l’effectivité comme donation en personne dans la perception qui fait l’objet d’une certitude, mais effectivité comme idée régulatrice dans la mesure où la donation en esquisses n’est jamais achevée, ce qui montre qu’il n’y a pas d’effectivité pure, mais toujours entrelacement de l’effectif et du possible. L’effectivité se redouble elle-même en effectivité seulement présomptive du monde, et effectivité absolument indubitable, apodictique, de la conscience, la première étant relative à la seconde. La section s’achève sur un rapprochement entre le possible ouvert de l’expérience selon Husserl et le possible eschatologique de l’être, rapprochement qui ne nous convainc pas tout à fait, dans la mesure où le possible ouvert reste toujours possible de l’étant, alors que chez Heidegger, c’est l’être lui-même comme rien d’étant qui est le possible, et dans la mesure aussi où le possible ouvert peut être réalisé, alors que ce possible qu’est l’être est irréductiblement caractérisé par le retrait, et enfin parce que les possibilités ouvertes dont parle Husserl sont toujours multiples, quand ce possible aimant qu’est l’être chez Heidegger est l’unique par excellence. De ce point de vue, l’idée d’intermodalité, c’est-à-dire que « le réel n’est pas l’effectif, mais l’entrelacement de l’effectif et du possible ouvert » (p. 287), nous semble uniquement husserlienne. Nous ne pensons donc pas que « cette ouverture foncière et irréductible que Heidegger pense, dans les années trente et quarante, à l’échelle de la Seinsgeschichte, sous les espèces d’un possible avenant et eschatologique synonyme du Mögen de l’être, la phénoménologie husserlienne de la modalisation (et de l’intermodalité) l’accomplit déjà, dès la fin des années vingt, à l’échelle de sa théorie de l’expérience » (pp. 288-289).
F : Conclusion
Claudia Serban rappelle en conclusion ce qu’a voulu montrer sa thèse à propos du rapport entre Husserl et Heidegger, à savoir qu’il est faux de dire que le premier pense l’effectif quand le second se tourne vers le possible. L’un comme l’autre font de la phénoménologie une manière d’appréhender les choses « sub specie possibilitatis » (p. 291). L’un comme l’autre pensent une prééminence du possible par rapport à l’effectif, et l’ego ou le Dasein comme une projection de possibilités orientée vers l’avenir et enracinée dans le passé de la motivation ou de l’être-jeté. Dans les deux cas, l’auteur retrouve l’idée du possible comme prégnance du réel, c’est-à-dire comme présence excédentaire, comme auto-excédence. Il est alors possible de se demander ce qu’il en est dans la phénoménologie française post-husserlienne et post-heideggerienne, ce qui sera sans doute l’objet des recherches futures de l’auteur qu’elle esquisse ici. La pensée de Sartre prolonge la phénoménologie de la possibilité du côté de l’imagination (en dialogue avec Husserl) et de la liberté (en dialogue avec Heidegger). Merleau-Ponty prolonge et radicalise la pensée husserlienne du possible en définissant la chair du monde comme prégnance de possibles et en reconfigurant le « Je peux » husserlien à partir de la motricité corporelle. Claudia Serban voit à l’inverse chez Michel Henry une transformation de la phénoménologie de la possibilité en phénoménologie de l’impossibilité, donc de l’expérience du « je ne peux pas »4. La pensée de Levinas, de son côté, relève d’un au-delà du possible, et nous aimerions ici suggérer qu’un tel projet est aussi à l’œuvre chez Blanchot, où il s’agit plus d’un en-deçà du possible qui est le mourir, comme renversement du possible en impossible. Il serait sans doute aussi intéressant de voir ce qu’il en est chez des penseurs aussi différents que Derrida, Richir, Maldiney, Marion ou Romano. Signalons, pour conclure cette recension, que les prolongements à cette recherche sur la phénoménologie de la possibilité et son dépassement dans la phénoménologie française ont commencé à paraître dans divers articles en revues ou en volumes collectifs5.
- cf. notre recension : https://www.actu-philosophia.com/spip.php?article515 et https://www.actu-philosophia.com/spip.php?article516
- Signalons ici deux coquilles. D’abord p. 201, la troisième ligne est étrangement écrite sans espaces : « avecl’effectif,maisbienàdonnerl’illusionquetoutestpossible ». Ensuite p. 202, « l’affrmation » au lieu de « l’affirmation ».
- C. Romano, « Le possible et l’événement », in Il y a, Paris, PUF, 2003.
- Signalons une coquille page 300 : « défni » au lieu de « défini ».
- Sur Michel Henry, voir « Les modalités de la vie : actualité, potentialité, impossibilité », in La vie et les vivants. (Re-)lire Michel Henry, Presses universitaire de Louvain, 2013. Sur Jean-Luc Marion, voir « L’impossible et la phénoménologie, à partir de Certitudes négatives », in Jean-Luc Marion : Cartésianisme – phénoménologie – théologie, Archives Karéline, 2012. Sur Henri Maldiney, voir « Du possible au transpossible », Philosophie, n° 130, 2016.








