En marge de l’entretien qu’il m’avait accordé en mai 2009, Clément Rosset m’avait confié son intention de ne bientôt plus écrire de livres. Vient un âge, disait-il en substance, où il faut savoir s’arrêter… C’est avec plaisir que ses lecteurs constateront qu’il a de nouveau cédé au démon de l’écriture : en trois ans, l’auteur a publié pas moins de quatre livres, dont deux simultanément en octobre dernier : L’invisible et Récit d’un noyé 1.
Le premier poursuit les recherches de l’auteur sur l’appréhension du réel, par une étude des perceptions illusoires ; le second est un récit de cauchemars faits pendant une convalescence à Majorque. Les deux livres forment un diptyque sur les hallucinations, ces perceptions de choses qui n’existent en réalité nulle part. Ils sont une bonne porte d’entrée dans l’oeuvre de l’auteur, qui n’a cessé de traquer les illusions depuis ses premiers livres. L’étude des hallucinations poursuit cette interrogation : comment se peut-il que l’esprit parvienne à se détourner du réel et à lui préférer toutes sortes de doubles inexistants ?… Rosset n’a cessé d’analyser ce refus de la réalité, aussi bien par l’analyse conceptuelle que par la fiction. Philosophique pour sa plus grande part, son oeuvre se dédouble en effet d’une oeuvre proprement littéraire, frayant avec le fantastique, qui n’a jusqu’ici guère suscité d’intérêt. Je pense notamment à Route de nuit 2, Le monde perdu 3 ou encore Impressions fugitives et Fantasmagories4, qui se situeraient à la frontière des deux genres.
A les lire, on découvrira que ces livres ne sont pas moins métaphysiques que les autres, peut-être même plus -ce qui irait dans le sens de l’assertion de Borgès selon laquelle la métaphysique est une branche de la littérature fantastique. Est-il plus « métaphysique » de raconter, comme Maupassant, sa perte dans une nuit infinie 5, ou d’analyser l’angoisse ?
Le fantastique a cette vertu de nous montrer un double effrayant du monde, mais un double d’un genre singulier : il atteste de la réalité au lieu de la masquer, parce qu’il l’exprime en accusant ses traits les plus insolites. C’est en ce sens qu’il soutient l’entreprise philosophique. Cette orientation à la fois littéraire et philosophique, entre discours et récit, permet deux approches complémentaires des rapports entre le réel et ses doubles.
Je m’intéresserai surtout à Récit d’un noyé, avant de montrer en quoi la littérature est chez Clément Rosset le pendant de la philosophie -en quoi les deux versants de l’oeuvre sont indispensables pour comprendre le problème principal qui, me semble-t-il, parcourt tous ses livres. En quoi, autrement dit, deux moyens valent mieux qu’un pour mener la chasse aux illusions.
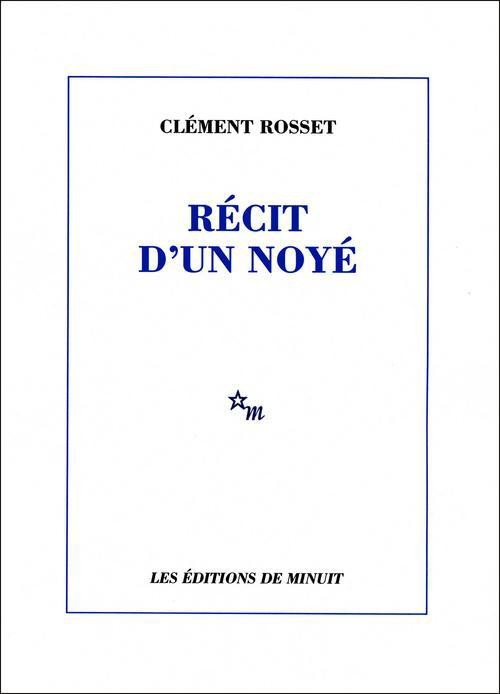
I°/ Le fantastique chez Clément Rosset
Récit d’un noyé nous raconte les mésaventures d’un personnage appelé Clément Rosset qui, après avoir échappé à la noyade, se retrouve dans un état comateux et suit une convalescence dans un hôpital de Majorque. Écrit à la première personne, le récit a tous les airs d’une autofiction, quoiqu’il soit dénué de nombrilisme et très drôle, à l’inverse de bien des oeuvres du genre.
Le récit commence quand le héros est conduit sur un brancard dans un hôpital qui ressemble fort à un camp militaire. Ligoté, harcelé par des infirmiers sadiques, le malheureux découvre un lieu oppressant, qui pourrait être la colonie pénitentiaire de Kafka ou un hôpital psychiatrique sorti des hallucinations de William Burroughs. Pour une raison qui échappe au héros, l’administration a décidé de l’humilier et, s’il ne se tient pas sage, de l’éliminer physiquement. Rivé à son lit, les deux bras entravés, Clément Rosset se sent comme ces personnages de Beckett réduits à leur condition matérielle la plus triviale (ensablés, prisonniers d’une poubelle…). Détail particulièrement cocasse, pour employer un qualificatif que l’auteur affectionne, le patient se voit interdit de boire la moindre goutte d’eau. Voilà donc notre noyé condamné au supplice de la soif.
Chaque chapitre raconte une saynète à mi-chemin de la comédie et du cauchemar, où l’on rencontrera des terroristes « néo-mexicains », Cicéron à dix-huit ans, ou encore les escrocs du lac Léman 6. A chaque fois que le héros parvient à s’endormir, il part dans un nouveau délire (bien qu’on ne sache pas, en réalité, si ce qu’il nous raconte a lieu quand il dort ou entre deux sommes). On est quelque part entre Alice aux pays des merveilles et les songes de Little Nemo.
Chaque scène commence in media res et s’arrête tout aussi brusquement, comme il en va vraiment quand nous rêvons. De plus, ces délires hallucinatoires paraissent aussi crédibles et aussi nets que la réalité. L’auteur s’est efforcé de brouiller la distinction entre les deux, en nous faisant passer de l’un à l’autre sans toujours prévenir.
Le héros ne cesse de subir toutes sortes de situations abracadabrantes : il ignore comment il est arrivé là, mais il n’a de doutes sur aucun détail de ce qui l’entoure. Une belle mise en pratique de la devise de Samuel Butler, que C. Rosset a en quelque sorte fait sienne : « I do not mind lying, but I hate inaccuracy ». Mentir ne me gêne pas, mais je déteste l’inexactitude -ce qui est en somme la devise de tout bon romancier.
La perception et son double
Le héros, comme le K. de Kafka, semble avoir peu de velléités de révoltes contre l’autorité. Il semble même assez disposé à complaire à ses gardiens. Hélas, cela ne fait qu’empirer la situation :
« LUI – Vous êtes Clément Rosset ?
MOI – Oui.
LUI – Vous savez que vous êtes fou ?
MOI – Oui.
LUI – Vous savez que la place des fous est à l’hôpital psychiatrique de Palma.
MOI – Oui.
LUI – On va donc vous y conduire. Attendez un instant.
MOI – Vous savez, ce n’est qu’une petite folie, je voulais seulement boire vos bouteilles » 7.
Le héros ne veut de mal à personne… Il est juste en situation d’extrême fragilité et ses soignants s’empressent d’abuser de son infériorité. On lui en veut et au moindre faux pas, on lui fera subir toutes sortes de supplices.
« Il s’acharnera longtemps sur moi, me poursuivant même de manière quasi diabolique puisque je le retrouverai souvent dans d’autres lieux et d’autres circonstances. Il veut ma peau, m’a-t-il expliqué, et il l’aura » 8.
A la noyade physique du héros succède une noyade dans les tourments de son inconscient : le voilà plongé dans une suite de scènes extravagantes et bizarres, dont il ignore quand il ressortira.
Tout ceci n’est bien sûr qu’une vision délirante de ce séjour dans l’hôpital de Majorque ; mais à quel moment dérape-t-on de la perception lucide à l’hallucination ? Quand la perception se brouille-t-elle pour laisser place aux fantasmes de persécution ? Il suffit d’un léger décalage par rapport au réel pour nous faire plonger dans cet univers oppressant, qui est certainement celui de la psychose maniaco-dépressive (trouble bipolaire), ou de ce qu’on appelait traditionnellement la mélancolie. Le monde y apparaît faux, repoussant, hostile ; le sujet ne parvient même plus à croire que son interlocuteur est un être vivant. C’est comme s’il était déjà au pays des morts :
« Ce qui me trouble ainsi n’est pas la chaleur ambiante mais l’expression bizarre et inquiétante de la personne qui m’héberge. Ce n’est d’ailleurs pas tant son expression qui me gêne que le fait qu’elle n’ait justement aucune expression. Son visage est figé, jamais remué d’une ride, ses yeux sont à la fois perçants et comme morts, semblant regarder dans le vide. De plus elle reste silencieuse la plupart du temps, parfois pendant des heures entières » 9.
L’auteur a le don de mêler à ces descriptions inquiétantes une dose indéniable de comique. Il est très finalement assez drôle de voir ces gens qui ont un comportement sadique juste par plaisir, sans justifications, comme s’ils étaient des pantins remontés pour ça. L’auteur s’amuse aussi de ce héros assez pitoyable, qui se croit persécuté, comme s’il était le centre du monde. Au gré de ses pérégrinations, il vit toutes sortes de mésaventures burlesques : « Un large chapeau de paille vient parachever l’oeuvre que l’artiste, maintenant tout à fait satisfait, signe enfin d’un coup de pinceau sur ma joue. Vous pouvez y aller, me dit-il. Vous valez désormais 50000 euros » 10.
Ces brèves séquences narratives nous emmènent dans des lieux d’où sont absents toute joie et tout espoir, un monde quasi-identique au nôtre, mais clôs et oppressant, c’est-à-dire à peu de chose près l’enfer.
La noyade
Plus qu’à une convalescence après un accident, les épreuves du héros ressemblent à la traversée d’une phase de dépression profonde. Incapable de se défendre, malmené, ballotté à droite et à gauche, le héros n’est plus que l’ombre de lui-même. « Car c’est depuis une position de déchet (pas loin du décès), du fond de la bouche d’ombre, que parle le sujet rossetien » [Voir [la critique du livre par Eric Houser sur Sitaudis.fr[/efn_note].
Déjà Route de nuit était un récit de cauchemars, dont le héros pouvait à la fois attester avec certitude qu’il était le sujet, mais dans lesquels il ne se reconnaissait plus du tout. Il était devenu étranger à soi-même et au monde. Rosset y décrivait une suite d’épisodes de dépression où apparaissait son double monstrueux, cousin du Horla de Maupassant.
On reconnaît là ce que Freud a nommé l’inquiétante étrangeté : le plus commun devient tout à coup inconnu, et peut provoquer un sentiment de véritable horreur. Ces passages mélancoliques ont une autre dimension, décrite plus précisément dans Le monde perdu : le sentiment de ne plus appartenir à ce monde. Mon esprit se détourne de ce qui m’est proche pour essayer de retrouver quelque chose qui est lointain, et que j’ai le sentiment d’avoir perdu. C’est une situation de deuil impossible -impossible car inexprimable. J’ai perdu quelque chose qui faisait mon bonheur naguère, mais je ne saurais dire quoi ; je ne peux donc en accepter la perte et la surmonter.
En proie à ce trouble, le sujet perd son attachement à la vie. Il ne s’évade pas réellement dans un autre monde, où il pourrait trouver une consolation à ses malheurs, il ne fait que refuser cette réalité qui l’oppresse.
A la racine de tous ces graves troubles mis en scène par l’auteur, il y a un phénomène des plus paradoxaux -et c’est là que nous retrouvons le lien avec la philosophie proprement dite : c’est le phénomène de l’hallucination, ou plus largement de l’illusion. Ces perceptions sont fausses car elles n’ont pas d’objet. L’existence même de cette perception est douteuse. Or, comment peut-il se produire une perception de rien ?… Je suis le jouet d’illusions, qui me font prêter de l’existence à des fantômes et développent chez moi des sentiments dénués de raisons. Par exemple, je me sens persécuté, mais je ne sais pas bien dire qui m’en veut ni pourquoi. A l’analyse, l’objet de la peur apparaît inconsistant. Or, cette peur recouvre partiellement un sentiment plus profond, celui de la fuite devant le vide : c’est l’angoisse. Je m’angoisse, mais ce devant quoi je m’angoisse n’est rien 11. L’image la plus forte que Rosset donne de cette perception morbide des choses, se trouve dans un chapitre où le héros visite une exposition de peintures :
« Quant aux toiles elles-mêmes, de facture avant-gardiste selon le catalogue de l’exposition, elles me semblent d’une platitude propre à susciter un certain malaise : on dirait le plus souvent des imitations de tableaux de maîtres du passé, effectuées de manière précise mais si mécaniques que ces tableaux paraissent dénués de tout éclat et de toute vivacité. Ce ne sont pas des natures mortes, ce seraient plutôt des peintures mortes » 12.
Non seulement les personnages « réels » mais aussi les images des choses prennent un aspect effrayant : des peintures mortes. La vie n’apparaît par contraste avec l’inerte que par un léger éclat, presque invisible en tant que tel, mais dont l’absence se fait sentir immédiatement. Sans cet éclat, même les oeuvres d’art perdent tout attrait, toute originalité. D’attrayantes, elles deviennent effrayantes. L’art mort imite un monde sans vie. C’est à cette perception délirante d’un univers peuplé de spectres et de fantômes que se résume peut-être toute folie. La vie n’y ressemble plus qu’à une mélancolique marche vers la mort : « And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death » 13.
Le héros n’est pas noyé parce qu’il a failli couler dans la baie de Majorque mais parce qu’il risque de ne jamais ressortir de ces hallucinations. La folie est bien analogue à une noyade, en ce sens qu’elle est provoquée par l’absorption d’une quantité de réalité supérieure à ce que j’en peux supporter. Je ne parviens plus à l’avaler, il faudrait que je la recrache mais je n’y arrive pas.
Après cette traversée du tunnel, la guérison finit par arriver, et marque la fin des épisodes de cauchemars. On accepte même de donner à boire au patient !
L’épreuve de la noyade s’est avérée critique et même cathartique.
« J’ai brusquement faim et envie de dire, comme Scapin à la fin de ses Fourberies : “Et moi qu’on me porte au bout de la table [du festin], en attendant que je meure” » 14. La faim (on peut même ici parler de fringale) marque le retour à la vie, qui est retour au désir, à l’appétit pour les choses, à l’appétit tout court. Quant à l’image du festin, elle rappelle le conseil de Lucrèce : sache jouir de la vie comme d’un banquet mais sache aussi t’en retirer le moment venu. La guérison débouche sur un épicurisme, qui se manifeste par le sentiment de revenir à la lumière (« Un joli soleil automnal commence à briller sur le port, la baie de Palma et l’île de Cabrera » 15), une véritable renaissance.
Même s’il ne nous restait plus rien, même si la vie apparaissait, comme mise à nue, dans son caractère éphémère et mortel, semble dire Clément Rosset, il nous resterait toujours Épicure et le sentiment printanier d’appartenir, malgré tout, à ce monde –d’être de ce monde. « C’est moi le printemps », disait Céline.
L’écriture elle-même atteste de cette victoire de la volupté sur la mélancolie : un dépressif complet n’aurait pas eu la force de tirer un livre de cette expérience.
Récit d’un noyé est l’oeuvre la plus nettement romanesque de l’auteur. C’est à regretter que Clément Rosset ne s’y soit pas mis plus tôt, tant il s’avère doué pour nous entraîner dans ces aventures tragi-comiques où la précision de l’imaginaire permet de jouer avec les illusions, et d’exprimer combien elles n’étaient que les manifestations du dégoût de vivre.

Jean Rochefort dans Lost in la Mancha, documentaire de 2003 de Terry Gilliam, sur l’échec de son projet d’adapter Don Quichotte au cinéma.
II°/ La philosophie comme chasse aux idées folles
Le matérialisme comme thérapie
Il est courant, quoique généralement stérile, que l’on veuille décrire une philosophie par son objet (philosophie de l’histoire, de la nature) ou sa tonalité dominante (sceptique, idéaliste, pessimiste…). Dans le cas de Clément Rosset, il est tentant de parler de philosophie tragique, ou philosophie de la joie ou encore philosophie du réel. Ses oeuvres de jeunesse tourneraient davantage autour du thème du tragique, puis, à partir de Le réel et son double, l’auteur entrerait véritablement en possession de son vocabulaire. Il est commode à partir de là parler par termes paradoxaux, d’anti-ontologie, de métaphysique négative etc. En réalité, je crois que la clef de compréhension de son oeuvre nous est donnée dans En ce temps-là 16, dans un passage qui résume sa conception de la philosophie, définie non pas comme entreprise de créations d’idées sagaces, mais comme chasse aux idées folles. S’il y a bien une volonté qui se manifeste dans tous les livres de l’auteur (déjà dans son essai de jeunesse La philosophie tragique 17), c’est bien la dénonciation des diverses pseudo-idées qui nous empêchent d’appréhender la réalité, parce qu’elles la remplacent par des doubles obsédants mais dépourvus de substance. La défense d’une anti-ontologie, ou métaphysique par concepts négatifs, ne se justifie que comme arme à opposer aux discours insensés.
C’est ainsi que Loin de moi critique l’idée d’identité personnelle, non pour le plaisir du paradoxe, mais pour combattre l’obsession pour la reconnaissance de soi par soi. L’hystérique, obsédé par son identité, ne guérira pas le jour où il découvrira qui il est, mais le jour où il acceptera d’abandonner cette question, parce qu’il aura compris que l’identité personnelle est une illusion. En ce domaine, la « guérison » ne s’obtient que le jour où je renonce à me croire atteint d’une pathologie : je n’ai pas de troubles d’identités, car il n’y a pas d’identité personnelle du tout.
A la suite de Wittgenstein, Rosset défend une fonction critique et thérapeutique de la philosophie : chasser les représentations confuses qui brouillent notre appréhension des choses. Wittgenstein se concentre surtout sur les confusions engendrées par un mauvais usage du langage, Clément Rosset plutôt sur la description des mécanismes psychologiques de refus. Les deux approches sont de toute façon solidaires, puisque si c’est mal vu, ce sera mal dit. Et si c’est mal dit, ce sera mal vu… 18
La thérapie est autant traque aux illusions que tentative d’exprimer leurs origines et leur mécanisme, dans une vision que l’on peut, par commodité, qualifier de matérialiste, si on l’entend au sens restrictif d’Althusser : le matérialisme, c’est ne plus se raconter d’histoires 19.
On peut ajouter que, malheureusement, bien des matérialistes en viennent malgré tout à se raconter des histoires, notamment lorsqu’ils croient remplacer une vision idéaliste des choses par une métaphysique plus juste, appuyée (par exemples) sur la matière, le corps ou le sensible. Or, c’est ici véritablement se laisser prendre au piège dans lequel est tombé l’adversaire, qui croyait voir à l’oeuvre dans ce monde-ci des entités surnaturelles. Contre cette illusion si tenace qu’elle atteint même ceux qui se croient le plus dénués de superstitions, il faut dire qu’à la limite, il n’y a pas de philosophie matérialiste, il n’y a qu’une critique de la vision idéaliste du monde.
C’est dire qu’une fois l’erreur dissipée, il n’y a rien à mettre à la place. Il n’est pas besoin de proposer autre chose pour compenser la perte de croyance en un au-delà. Montrer l’inconsistance de ces idées suffit. Il suffit par exemple qu’on puisse expliquer de manière cohérente et satisfaisante la nature par les atomes et le vide, sans avoir besoin de croire à leur existence 20. Il suffit que cette théorie nous dispense de recourir à l’intervention des dieux dans la nature. Si l’on fait plus, on n’aura fait que défendre une représentation affligeante plutôt qu’une autre ; on aura ravivé la superstition que l’on voulait chasser. Donner le primat à la matière contre l’esprit, ou au corps contre l’âme, ne change fondamentalement rien : la permutation des termes du dualisme laisse intacte la croyance.
C’est pourquoi l’originalité de Clément Rosset ne tient pas à l’invention d’une ontologie plus vraie que les autres, mais au refus de l’ontologie comme telle et ce, non pour des raisons théoriques, mais parce que ce qu’on nomme « ontologie » n’est bien souvent que le support de fantasmes, d’idéologies tyranniques, de délires malsains, qu’on leur donne le nom de « Nature », d' »Idée », d' »Etat » ou d' »Histoire » et qui sont autant d’idoles, c’est-à-dire des réalités (l’État, l’histoire…) auxquelles on surajoute -par peur, par incompréhension… – une dimension suprasensible et « morale ».
Le don-quichottisme
Contre ces tristes désirs de trouver dans la réalité plus qu’il ne s’y trouve, Clément Rosset a proposé plusieurs contre-modèles, dont beaucoup sont empruntés à la culture espagnole. L’Espagne apparaît chez lui comme la culture de l’acceptation heureuse de l’existence. Les textes sur le pays de Cervantès abondent et nous montrent combien la puissance de l’imaginaire fait paradoxalement obstacle aux chimères. L’imaginaire se coule heureusement dans l’existence, là où l’illusion ne produit que des doubles fantomatiques. Don Quichotte a l’air de voir des géants à la place des moulins à vent, mais, souligne Clément Rosset, jamais ces représentations fausses ne provoquent chez lui de dommages psychologiques. Le chevalier sait toujours retomber sur le réel, comme le chat retombe sur ses pattes, et même mieux que le soi-disant « matérialiste » Sancho Pança : ce dernier, derrière ses airs terre-à-terre, est bien souvent maladroit, perdu quand son maître n’est pas là. Il se prétend homme de bon sens mais il a manifestement des difficultés à voir clair dans les choses : à preuve, son incapacité répétée à rapporter des faits de manière cohérente. Il s’empêtre dans son récit quand il veut à son tour raconter une histoire. Don Quichotte, lui, n’a pas son pareil comme conteur ; il s’y laisse prendre sérieusement, mais sans se faire piéger. Le chevalier à la triste figure rit de bon coeur de lui-même et s’amuse de ce qu’il vit, au point qu’il paraît mieux armé pour faire face à la vie que Sancho, étouffé dans le carcan de son « réalisme ».
En somme, Don Quichotte apparaît comme le modèle de tout artiste : tout le monde le croit fou, alors qu’il est très lucide et très heureux comme il est, à jouer librement avec la réalité et ses rêves.
L’artiste fait bon accueil à la vie comme suite d’apparences provisoires, changeantes, mais toujours séduisantes. C’est pourquoi Sancho, malgré les réticences qu’il affiche, a bien raison de suivre son maître dans des aventures apparemment folles. Elles sont le seul moyen pour lui de se réconcilier avec la réalité. Seul celui qui assume les fantaisies de ses désirs et sait leur frayer un chemin jusqu’au réel, peut jouir d’une santé mentale robuste. Sans cela, la vie quotidienne devient un fardeau, une besogne usante et répétitive. C’est pourquoi la réalité, dit Freud en une formule saisissante, est destinée à ceux qui ne peuvent supporter le rêve 21.
Autre figure valorisée par Clément Rosset, celle du compositeur Manuel de Falla, dont le très beau portrait dans un chapitre de Fantasmagories, nous en apporterait la confirmation : n’est pas fou celui qui crée, mais celui qui n’y arrive pas, celui dont l’imaginaire ne trouve pas à s’insinuer dans le réalité. Les illusions se jouent de nous, alors que par l’imaginaire, nous jouons avec le rêve et l’ivresse que le rêve provoque 22.
La chasse aux idées folles
Le rapprochement des textes philosophiques et littéraires fait apparaître une indéniable unité dans toute l’oeuvre de Rosset. Ce dernier décrit la racine de toute folie, en-deçà des divers troubles que la psychanalyse ou la psychiatrie peuvent avoir à prendre en charge. Cela ne signifie pas que la philosophie pourrait mieux soigner schizophrénies ou psychoses parce qu’elle aurait mieux saisi leur origine, ni que la littérature puisse si bien sublimer nos troubles qu’elle nous en guérirait. En réalité, Clément Rosset ne cesse de montrer que le refus du réel est quelque chose de très banal, de très pernicieux pour cette raison, et que le domaine du double est bien large que celui des pathologies cliniques [« Le thème du double est souvent associé à une pathologie – schizophrénie, paranoïa – et autres confins de la normalité. Il n’en est rien. Le thème du double concerne un espace culturel bien plus vaste ! Notamment celui de l’illusion religieuse, ou de la philosophie idéaliste, qui substituent au réel un « autre monde », forcément meilleur…». Voir cet [entretien en ligne.[/efn_note]. On peut espérer guérir un malade clinique, mais celui qui s’obstine à nier la réalité sans manifester un trouble médicalement défini, celui-là est vraiment incurable.
Le rôle de la philosophie et de la littérature ne peut être que de cerner cette fragilité constitutive de la faculté perceptive, toujours susceptible de faire barrage à l’acceptation de la réalité. Ce qui est en jeu n’est pas la formulation d’une ontologie plus sagace que les autres. La question est moins celle de la nature de l’être, que celle de son acceptation ou de son refus. En deçà du travail de la sensibilité et de l’entendement est à l’oeuvre une affectivité qui, en dernier ressort, soutient ou non le goût de vivre. « Pour moy donc, j’ayme la vie » 23 : le « donc » employé par Montaigne n’indique pas la conclusion d’un raisonnement mais le bilan d’une vie. Ce ne sont pas des raisons qui décident de notre appréciation de l’existence.
Au lieu d’y chercher une nouvelle métaphysique, plus paradoxale ou plus excitante que les autres, il serait plus fructueux de lire l’ensemble des livres de Clément Rosset, que ce soient les textes littéraires ou philosophiques, comme cette vaste entreprise de chasse aux idées folles, c’est-à-dire en fait de défense d’une personnalité saine et heureuse. L’expression littéraire n’est pas un à-côté secondaire de la philosophie mais le pendant vécu de ce que l’analyse donne à comprendre. Cette dualité du mode d’expression contribue, paradoxalement, à déjouer les pièges du double.
- L’invisible et Récit d’un noyé, éditions de Minuit, octobre 2012.
- Route de nuit. Épisodes cliniques, Gallimard, L’Infini, 1999.
- Le monde perdu, Fata Morgana, 2009.
- Impressions fugitives : l’ombre, le reflet, l’écho et Fantasmagories, Minuit, 2004 et 2006.
- Voir la nouvelle de Maupassant, La nuit.
- Au passage, si l’on voulait donner dans le lacanisme, on entendrait « lac Léman » comme « la Clément », et on pourrait en tirer tout un monde de significations…
- Pages 37-38
- Page 17.
- Page 72.
- Page 76.
- C’était bien sûr déjà la thèse de Heidegger dans Qu’est-ce que la métaphysique ? Contrairement à la peur, l’angoisse n’a pas d’objet : elle m’expose directement au néant.
- Page 50.
- Shakespeare, Macbeth, acte 5, scène 5
- Page 89.
- Page 89.
- En ce temps-là, Minuit, 1992
- La philosophie tragique, PUF, 1961.
- Voir Le choix des mots, Minuit, 1995, pour le commentaire du « mal vu, mal dit » de Beckett.
- Voir En ce temps-là. Notes sur Louis Althusser, Minuit, 1992.
- cf. Montaigne, Essais, II, 12 : « Je ne me persuade pas aysement, qu’Epicurus, Platon, et Pythagoras nous ayent donné pour argent contant leurs Atomes, leurs Idées, et leurs Nombres. Ils estoyent trop sages pour establir leurs articles de foy, de chose si incertaine, et si debattable ».
- Pour un commentaire de cette idée, tirée de L’interprétation des rêves, voir Slavoj Zizek, La parallaxe, Fayard, 2008, Introduction, pages 9-14.
- Voir l’opuscule de jeunesse de Nietzsche, La vision dionysiaque du monde, Allia, 2004.
- Essais, III, 13.








