Les Leçons sur l’éthique et la théorie de la valeur qui paraissent cette année aux PUF sont la traduction du texte principal du volume XXVII des Husserliana publié vingt et un ans plus tôt – en 1988 – par Ullrich Melle. Il s’agit des cours professés par Husserl pendant le semestre d’hiver 1908/1909 et les semestres d’été 1911 et 1914. Les trois parties de l’ouvrage – respectivement notées A, B et C – présentent ces cours dans un ordre inverse à l’ordre chronologique, les traducteurs Philippe Ducat, Patrick Lang et Carlos Lobo adoptant en cela le choix de l’éditeur allemand, pleinement justifié puisque le cours de 1914 reprend de façon plus aboutie et plus explicite les éléments des cours de 1911 et 1908/1909 concernant le projet général de ces leçons, ainsi que le développement original de 1911 sur le rapport entre sommation et production de valeur. La troisième section du cours de 1914 propose en outre une « phénoménologie de la volonté » qui va plus loin que les acquis des cours précédents. Plus abouti, plus explicite, plus complet, il était tout à fait pertinent de placer en tête de l’ouvrage ce cours de 1914, mais l’édition de certains éléments des cours de 1911 (partie B) et de 1908/1909 (partie C) se justifient à son tour pleinement dans la mesure où cela concerne des aspects que ne reprend pas le cours de 1914 et qui sont essentiels à l’intelligence du propos de Husserl sur la valeur: la prise en compte des « faits » éthique (B) et les rapports entre raison théorique et raison pratique qui appliquent, au niveaux des actes affectifs, l’argumentation de la Cinquième Recherche logique à propos de la fondation des actes.
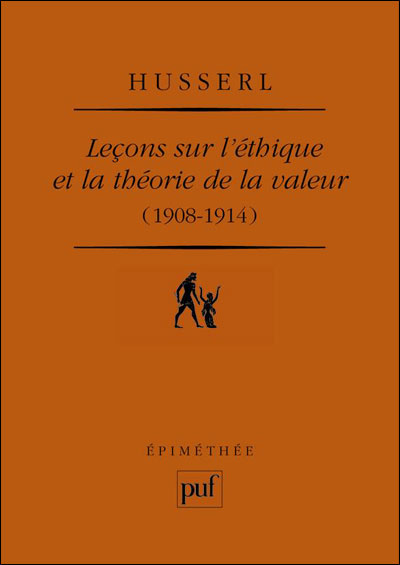
Ces leçons participent d’un champ de réflexion qui fait l’objet d’un souci constant de la part de Husserl avant et après ces leçons, comme en témoignent les cours des années 1891-1893 et1895 relatifs aux « Problèmes fondamentaux de l’éthique » et les leçons de 1897 intitulées « Ethique et philosophie du droit », les cinq articles publiés entre 1922/1923 sur le « renouveau » comme problème d’éthique individuelle et collective et le cours d’introduction des semestres d’été 1920 et 1924. Les recherches passent ainsi de l’ébauche de constitution d’une éthique formelle au développement d’une éthique de l’accomplissement de soi « où l’obéissance au devoir absolu prend la forme du consentement à une vocation intime et réfléchie » (introduction des traducteurs, p. 60). Les Leçons de 1908-1914, qui s’attachent à la constitution d’une éthique et d’une axiologie formelles et qui se donnent comme le volet formel des investigations phénoménologiques sur l’affectivité et la volonté (encore inédites, bien qu’annoncées depuis 1988) apparaissent comme un moment essentiel de la réflexion husserlienne sur la question de la valeur. Peut-on cependant les cantonner à un rôle propédeutique qui ne prendrait sens que rétrospectivement – les prémisses de la pensée de Husserl sur la valeur – ou bien la démarche elle-même mérite-t-elle qu’on s’y arrête? L’intérêt de ces leçons s’épuise-t-il dans le rôle qu’elles jouent dans une réflexion plus vaste sur la question éthique ou bien certains développements caractéristiques doivent-ils être pris en compte pour eux-mêmes? Le critère doit-il être ce que l’on estime être une « véritable phénoménologie de la pratique » 1, ce que l’on estime être pertinent pour que « le (?) » philosophe assume son rôle de « stratège dans le combat contre la déraison » 2, ou bien, de façon sans doute moins séduisante un léger déplacement dans ce que l’on estime précisément évident, dans ce que l’on estime être l’éthique et la valeur? A cet égard les textes introductifs semblent étouffer cette « autre » pertinence du propos, rabattu sur sa cohérence interne (préface), affaibli dans son insertion au sein d' »une » pensée husserlienne de la valeur (introduction).
1. Le sérieux de l’édition
Avant de traiter cette question, il importe de souligner la qualité de la présente édition qui repose sur le sérieux d’une traduction qui justifie ses choix et ses partis pris, sur l’adjonction d’un glossaire et de deux très bons textes introductifs qui mettent respectivement l’accent sur la cohérence du projet pour la préface – insistant sur les section I; II et IV de la partie A – et sur l’importance de la fondation des actes pour l’introduction – s’attachant à rendre compte des parties B et surtout C, ainsi que de la section III de la partie A. Les trois traducteurs se sont répartis le texte mais l’ensemble de la traduction a fait l’objet d’une double relecture qui assure la cohérence et la fluidité du texte 3. Le choix de traduction retenu 4 est la « lisibilité » et l' »accessibilité », ce qui amène les traducteurs à éviter les termes trop techniques quand cela n’est pas absolument nécessaire. « Objectal » est écarté au profit d' »objectif » dans l’ensemble du texte, au motif que les termes gegenständlich et objektiv sont la plupart du temps strictement synonymes dans le texte allemand (C, §.5 notamment). De même, « matériel » est utilisé de préférence à « matérial ». A l’inverse, les traducteurs ont parfois utilisé des termes français différents pour rendre compte d’un même terme allemand, afin de souligner et d’expliciter les nuances de sens effectivement présentes dans le texte. Enfin, la traduction des termes de la phénoménologie et de l’éthique ont fait l’objet d’une réflexion de fond dont il est fait état en tête du glossaire. On notera que les traducteurs rompent avec l’usage traditionnel qui conduisait à traduire, depuis P. Ricoeur Meinen et ses composés par « viser » et ses dérivés. S’appuyant sur une précision de Husserl lui-même qui déclare 5 « ne pas [penser] à l’intention ni à une quelconque visée délibérée ou à quelque chose qui serait ainsi visé », les traducteurs « [remettent] en flux la terminologie philosophique française, afin de ne pas réduire l’intentionnalité à une téléologie, à une lecture purement référentielle, voire à une métaphore balistique, mais de lui préserver son moment essentiel, qui est le mode d’appréhension ou de donnée » 6. C’est le terme « avis » qui est donc choisi, de préférence à « opinion » adopté par Suzanne Bachelard pour la traduction de Logique formelle et logique transcendantale, « avis » auquel correspond le verbe « aviser ». On regrettera cependant l’absence de cohérence, assumé 7, entre ces choix et le texte de la préface qui non seulement « maintient l’usage du terme visée », mais appuie son argumentation sur des distinctions fines entre « objectivité » et « objectalité » et emploie presque toujours le terme « material ». Mais peut-être peut-on considérer ce double discours comme une manière d’introduire progressivement le lecteur familier de la terminologie française des lectures husserliennes à l’intelligence d’un nouveau texte dans la préface avant qu’il n’accède au texte lui-même traduit selon des choix nouveaux. C’est à ce projet que nous devons à présent nous intéresser.
2. Le projet lui-même, sa cohérence, sa spécificité.
2. 1. le projet de constitution d’une éthique et d’une axiologie formelles
« Si l’on suit les parallèles entre la logique et l’éthique, ou encore le parallèle entre les types d’actes et les types de raison auxquels se rapportent essentiellement ces disciplines – à savoir la raison judicative d’une part, et la raison pratique d’autre part -, la pensée s’impose alors qu’à la logique, au sens précisément et étroitement délimité d’une logique formelle, doit aussi correspondre en parallèle une pratique formelle et également apriorique en un sens analogique. Il en va à peu près de même pour le parallèle avec la raison évaluative, évaluante au sens le plus large et non pas simplement évaluante esthétiquement, par exemple. Cela conduit à l’Idée d’une axiologie formelle en tant que discipline formelle apriorique des valeurs, ou encore de contenus de valeur ou de significations de valeur – discipline qui, pour des raisons essentielles, est intimement entrelacée à celle de la pratique formelle. Délimiter ces Idées de nouvelles disciplines formelles, que la tradition philosophique a toujours ignorées, et en réaliser effectivement des échantillons, tel est le thème principal de ces leçons. […] A la logique formelle correspond un système de structures fondamentales de la conscience-de-croyance (de la conscience doxique comme j’ai coutume de dire), et par suite une phénoménologie et une théorie de la connaissance formelle; il en va de même pour l’axiologie et la pratique formelles eu égard à la discipline phénoménologique qui leur est principalement associée, c’est-à-dire la théorie de l’évaluation et la théorie de la volonté (termes qu’il faut entendre ici en un sens analogue à celui de l’expression « théorie de la connaissance »). (A.1.§. 1, p. [4], c’est moi qui souligne).
C’est ainsi qu’Husserl annonce son projet dès la première section du cours de 1914: constituer une éthique et une axiologie formelles, un projet qui repose sur une analogie entre ces disciplines et la logique formelle. Comme le précise Dominique Pradelle dans une excellente préface, à la fois précise, synthétique et stimulante, « l’objet de ces cours sur l’éthique et l’axiologie ne réside pas dans l’analyse intentionnelle de la conscience irréfléchie qu’il s’agirait de surprendre sur le fait, dans la trame concrète de ses actes pratiques et évaluateurs […] ». Bien au contraire, il s’agit de « légitimer l’Idée programmatique de disciplines formelles non existantes (pratique et axiologie) » 8. En d’autres termes, il s’agit de légitimer la transposition de la notion d’analycité – l’idée, la méthode, le concept de loi analytique-formelle – en éthique et en axiologie. La question de la « légitimité » se pose en effet dans la mesure où le projet s’avère largement paradoxal: on comprend mal d’une part comment des disciplines déterminées par l’importance et le primat du pôle hylétique et noétique pourraient être traitées de la même manière que des disciplines théoriques sans y perdre leur spécificité ou sans exiger une refonte des concepts méthodologiques. On comprend mal également comment la méthode analogique – par définition médiate – trouve sa place dans la phénoménologie. Plus précisément, une telle méthode ne semble légitime que si l’on admet un primat de la raison théorique qui serait le paradigme de la rationalité, justifiant ainsi le parallélisme logico-éthique et l’usage d’une méthode analogique, mais il n’en demeure pas moins que les questions éthiques et axiologiques y perdent encore une fois leur spécificité. Les leçons de 1914 – la partie A de l’ouvrage – peuvent être comprises comme une explicitation de la cohérence interne du projet qui vaut comme légitimation de cette démarche analogique et réduit les paradoxes que l’on vient de mentionner.
La première section de ces leçons de 1914 est particulièrement intéressante dans la mesure où elle met au jour les rapprochements possibles entre logique et éthique à partir d’une analyse de trois composantes éidétiques de la logique formelle – aprioricité, résistibilité au scepticisme, formalisme – ce qui légitime la méthode analogique caractéristique du projet de constitution d’une éthique et d’une axiologie formelles. Pour chacun de ces aspects, Husserl s’attache à souligner le parallélisme qu’il est effectivement possible d’établir entre logique et éthique. Dans son apparition historique, l’éthique est, comme la logique, une discipline à la fois normative et pratique dont les règles font référence à une certaine anthropologie. Pourtant, la logique – la technologie de la pensée correcte – se fonde sur un ensemble de principes logiques purs. En éthique, l’aprioricité a le même sens (§. 1), ce qui justifie le parallélisme entre les disciplines et légitime l’usage d’une méthode analogique. Deuxièmement (§§. 2-4), de même que la logique permet de lutter contre le scepticisme et le relativisme, une éthique et une axiologie formelles assument le même rôle, la notion de « contresens pratique » assurant cette fois la légitimité d’un usage analogique entre logique et éthique. Enfin, Husserl montre qu’il est tout à fait possible de mettre en œuvre la méthode de formalisation en éthique et en axiologie (§. 5), autrement dit qu’il est possible d’y faire abstraction de toute référence à des sphères de choses déterminées, que l’on peut déterminer des lois formelles régissant la compatibilité, l’implication…en demeurant au niveau de la seule forme-valeur sans prendre en compte son contenu, et qu’il existe des analoga pratique et axiologique de l’ontologie formelle.
Pourtant, si l’on peut admettre que la logique formelle devienne un « fil conducteur pour la découverte des structures parallèles dans la sphère de l’affectivité » (A, §. 8), si l’on peut comprendre que la pratique soit susceptible d’un traitement formel (§. 5), on ne comprend pas en quoi le formalisme peut être pertinent à l’égard des disciplines pratiques. Si la méthode analogique n’est pas une tentative illégitime, en revanche, on ne comprend pas en quoi elle peut-être féconde et pertinente. C’est à quoi vont s’attacher les sections II et IV (notamment §§. 18-19) en montrant d’une part en quoi consiste le formalisme en question et surtout quelle est sa place dans l’économie des disciplines pratiques. Or, la cohérence manifeste du propos est sidérante dans la mesure où les limites du formalisme n’ont rien d’une objection externe, imputable à la spécificité de l’objet éthique. En effet, la double limite inhérente au formalisme s’applique aussi bien dans le champ théorique que dans le champ pratique, ce qui laisse intact le parallélisme logico-éthique qui se trouve renforcé. La première limite consiste à prendre acte du fait que la formalisation est un instrument – et non le but ultime – et sa priorité dans l’ordre de la stratification des disciplines et des relations de conditionnalité est l’envers de sa secondarité au plan téléologique. La seconde limite réside dans son impossibilité à exister de façon autonome. Les cas du « choix rationnel » (§. 18) et de l' »impératif catégorique » (§. 19) illustrent ces deux aspects, tandis que la partie B se caractérise par une prise en compte du factuel et du contentuel caractéristique d’un projet éthique d’envergure qui ne se limite pas à la formalisation. « La généralisation de l’idée de formalité en axiologie et à l’éthique n’implique donc nul glissement vers une position purement formaliste. La méthode analogique qui prend la logique formelle comme fil conducteur pour déterminer la possibilité d’une axiologie et d’une pratique formelle […] ne signifie ni que cette sphère nomologique-formelle soit le dernier mot de l’éthique, ni qu’elle ait une validité autonome et inconditionnée. Au contraire, le formalisme implique son dépassement vers une éthique matériale, en laquelle il trouve à la fois sa finalité ultime et sa condition de possibilité » 9.
En ce sens l’Idée programmatique d’une éthique et d’une axiologie formelles est doublement légitime, dans la mesure où le rapport analogique logico-éthique est pleinement justifié et où le formalisme s’inscrit dans un projet plus vaste dont il n’est qu’un moment.
2. 2. La « fondation des actes », comprise dans son opposition à la thèse brentanienne, est le sous-bassement de l’ensemble du projet et permet de comprendre en quoi Husserl se distingue d’une pensée néo-kantienne de la valeur.
Pourtant il y a plus: le parallélisme logico-éthique qui fonde le projet de constitution d’une éthique et d’une axiologie formelles ne repose pas sur le simple constat d’un fonctionnement similaire entre disciplines théoriques et disciplines pratiques. D’une part l’analogie fonctionnelle est moins de l’ordre du repérage que de l’intervention conceptuelle – Husserl produisant conceptuellement la notion de contresens pratique, par exemple, qui explicite et légitime à la fois l’analogie logico-pratique. D’autre part, ce parallélisme entre disciplines se trouve lui-même fondé sur un certain rapport entre les types d’actes, les actes de jugements et les actes affectifs, autrement dit entre raison théorique et raison pratique, ce qui fait de la « fondation des actes » le niveau ultime qui rend compte de l’ensemble du projet – le parallélisme logico-éthique d’une part et la constitution d’une éthique et d’une axiologie formelles qui prend la logique comme fil directeur analogique de leur constitution en tant que disciplines formelles.
On retrouve au niveau des actes affectifs les objections que Husserl adressait à Brentano dans la Cinquième Recherche logique à propos des actes de jugement, une prise de position qui reste très lisible dans les §. 2-4 de la partie A. La fondation des actes met en jeu des différences dans les modes de la référence de l’acte à son « quoi », différences qui sont selon notre auteur irréductibles à des différences de représentations – une thèse brentanienne considérée par Husserl comme une « construction ». Chaque fondation d’acte suppose des modifications de la référence elle-même, du Meinung – la visée que les traducteurs rendent ici par « avis » – qui n’est ni nécessairement doxique, ni nécessairement positionnel, mais le lieu d’une multiplicité de modifications secondaires. Husserl refuse donc de rapporter la différence entre actes de jugement et actes affectifs tout aussi bien que leur « intentionnalité » à des représentations fondatrices qui les expliqueraient. Les enjeux ne sont pas minces puisqu’une nouvelle pensée de la valeur s’y fait jour.
Avant d’aborder ce point notons qu’il devient dès lors possible de rendre compte du rapport qu’entretiennent raison théorique et raison pratique. L’idée d’un fil directeur analogique assumé par la logique pouvait laisser penser que la raison théorique assumait un rôle paradigmatique laissant les spécificités de la raison pratique de côté, mais restreignant également la dimension phénoménologique à la simple prise en compte, extrinsèque, du factuel, ce que pourrait laisser croire une lecture de la partie B si elle n’est pas rapporté au projet général de ces leçons. Au contraire, le débat relatif à la fondation des actes permet d’établir un type de rapport singulier entre les types d’actes et entre les types de raison qui établit ainsi une divergence essentielle et profonde entre le travail de Husserl et les recherches néo-kantiennes sur la valeur. Pour reprendre encore une fois une formule heureuse de Dominique Pradelle « ce n’est pas par généralisation, mais par formalisation que la raison théorétique subsume les autres formes de raison: si chaque sphère ontologique conserve son mode d’évidence spécifique, en revanche toute évidence s’avère convertible en évidence doxique, positionnelle, théorique, consacrant ainsi l’universalité de la raison théorétique »10.
La théorie husserlienne de la valeur apparaît donc comme le fruit d’une analyse de la fondation des actes (C), le fruit d’une phénoménologie de la volonté (A. III). La valeur se donne en effet comme le corrélat ou le noème d’un acte affectif qui, en tant que tel ne vise pas – je garde le terme traditionnellement admis – la valeur en tant qu’objet mais l’éprouve et la constitue ensuite selon le mode de l’affectivité en jeu. L’acte d’évaluation – autrement dit tout acte affectif – est une « tenue-de-valeur » (Werthaltung) 11 qui ne se réduit pas au « jugement de valeur » (Werturteil) qui implique pour sa part une objectivation de la valeur. Un élargissement significatif de la notion de valeur en découle puisque est « valeur » aussi ce qui est digne d’être réalisé, voulu, souhaité selon diverses lignes de modification et de modalisation, et pas seulement ce qui est digne d’être réalisé pratiquement ou ce qui est digne d’être aimé. Nous avons affaire à une perspective différente prise sur la question qui, en donnant le primat à l’acte d’évaluation sur l’objet valeur constitué, défait l’assimilation du principe et de la valeur en rendant celle-ci à sa dynamique d’une part et à sa richesse de l’autre.
3. Quand le formalisme travaille une phénoménologie qui devient critique et politiquement incorrecte
C’est dans ce versant – idéaliste et formaliste – que réside paradoxalement la pertinence stratégique du propos et on ne peut que se réjouir d’avoir aujourd’hui accès, grâce à la présente édition, à ces textes-là de Husserl et pas seulement aux textes plus récents que l’on considère généralement – et sans doute à raison – comme la véritable pensée de Husserl à propos de l’éthique et de l’axiologie. C’est en effet dans ce moment extrêmement théorique, où la dimension phénoménologique même est parfois mise en crise – comme le souligne D. Pradelle 12 – que réside une dimension critique non négligeable et qui me semble insuffisamment mise au jour par les textes introductifs, soucieux d’insister sur la cohérence et l’intelligibilité du propos d’une part, et, de l’autre, sur le statut partiel du formalisme qui fait de ces leçons consacrées essentiellement au formalisme, un moment de la pensée husserlienne sur la valeur. L’une 13 et l’autre 14 perspective, en essayant à tout prix d’acclimater le propos pour une pensée contemporaine peu friande d’idéalisme, réussit certes à le rendre acceptable et compréhensible, mais au prix d’un affaiblissement de sa portée à force de domestication. Le rendre acceptable, cela signifie inscrire les éléments idéalistes dans un procès d’ensemble, sans envisager ses éventuelles implications propres; c’est en outre rappeler le rôle concret du philosophe dans l’actualité dans les termes séduisants du combat et de la stratégie. Le philosophe « ne [saurait] se cantonner dans ce rôle d’architecte dessinant les lignes fondamentales d’une logique philosophique, d’une logique transcendantale » (introduction, p. 69); il doit endosser – pour reprendre les termes mêmes de Husserl, la fonction de « stratège dans le combat contre la déraison »(p. [202]). Pourtant, non seulement l’éthique husserlienne « proprement dite », « véritable » insistant sur l’historicité et le factuel n’est, réciproquement, qu’un des deux versants et ne se comprend pleinement que dans son rapport avec le formalisme; mais surtout, ne peut-on comprendre l’importance précisément « stratégique » de ce projet hautement théorique? Lectio difficilior, il est vrai. Doit-on cantonner la pertinence stratégique dans l’effectuation de tel ou tel acte pratique et conjoncturel ? Il ne s’agit pas de considérer cette entreprise et ce projet comme « la » réponse ou du moins comme la « bonne » manière de traiter la question éthique; il ne s’agit nullement d’envisager une autonomie pour ce formalisme, ce qui serait non seulement un contresens, mais surtout un contresens stérile. Il ne s’agit pas enfin d’en faire, au rebours de toutes les analyses, la « véritable » pensée de Husserl sur la question.
Il s’agit en revanche d’évaluer simplement la portée et les enjeux de cette tentative quand bien même n’est-elle qu’un volet, quand bien même ce dyptique n’est-il qu’un moment, quand bien même les réflexions ultérieures de Husserl s’attachent-elle à des problèmes plus concrets d’origine et d’historicité. L’explicitation du propos, la mise au jour de sa cohérence interne et de sa pertinence dans une réflexion plus vaste sont bien entendu légitimes et nécessaires. En revanche, peut-être peut-on également envisager les enjeux de telles réflexions indépendamment de tous ces rattachements: « qu’est-ce que cela fait », au début du XXe siècle de poser la question de la valeur autrement que tout le monde ?
Notons avant tout que c’est à cette entreprise hautement théorique que Husserl assigne le rôle très important de répondre au scepticisme, ce qui n’a rien d’une « fausse » question téléphonée de Sirius, mais qui apparaît à Husserl comme une véritable urgence. La pertinence stratégique réside ici dans une production conceptuelle – le fameux « contresens pratique » – qui vient légitimer l’usage analogique de la logique formelle et lutter contre le relativisme au niveau pratique de même que la logique pure menait ce combat dans le champ de la connaissance. Husserl ne construit pas tant une thèse; il montre plutôt en quoi le contresens peut avoir une réalité théorique et en quoi, précisément, le scepticisme est résistible.
Ce sont encore les spéculations idéalistes qui développent des pistes jusqu’alors inédites, quand bien même Husserl ne les poursuivrait-t-il pas. L’aprioricité réussit par exemple à penser une éthique normative sans l’homme ou plutôt en se passant de la référence à une humanité de fait, en négligeant de recourir à des caractéristiques anthropologiques données. N’est-ce pas, de la part de Husserl, rompre par anticipation avec le courant humaniste qui se réclamera plus tard de lui, refuser toute confusion entre l’intentionnalité et la multiplicité des actes de visée d’une part et l’anthropos de l’autre? C’est moins la rigidité du formalisme que son anti-humanisme qui risque de déranger.
C’est cette réflexion hautement abstruse qui donne lieu à une pensée de la valeur qui rompt avec les interrogations éthiques et axiologiques en vigueur. En effet, ce n’est pas « l’objectivité » des valeurs qui intéresse Husserl, contrairement à Rickert ou à Windelband à qui il s’oppose 15. Il s’attache au contraire à élucider le statut non objectif de la valeur, ce qui rompt avec la majeure partie des réflexions contemporaines – contemporaine des Leçons et de leur présente édition. Husserl échappe de ce fait – dans la mesure où son projet s’appuie sur une réflexion concernant la fondation des actes qui débouche sur un parallélisme – aux clivages admis entre une morale de l’entendement et une morale du sentiment. En d’autres termes, il déplace les clivages conceptuels familiers et admis. C’est davantage dans son projet ultra-idéaliste que dans le retour ultérieur au problème de l’origine et de l’historicité que Husserl rompt avec une certaine manière d’interroger la valeur, alors que ses dernières recherches tendraient à retrouver une perspective plus traditionnelle. Il ne s’agit pas de dire que cette perspective formaliste nous semble la « bonne » manière pour poser la question de la valeur. Peu importe notre « avis » et peu importe que ce soit une bonne ou une mauvaise manière.
L’essentiel est de comprendre que ce projet hautement paradoxal est une manière de rendre plurivoque l’interrogation sur l’évaluation et les valeurs. Les travaux en axiologie et les réflexions éthiques ne cessent d’aborder le thème des valeurs dans des termes toujours identiques. Or, le déplacement pertinent en la matière, qui réintroduit de la pensée dans le débat, ne consiste pas à proposer une nouvelle hiérarchie, à faire surgir d’autres questions empruntant le même faisceau de représentations évidentes, mais tout simplement de montrer – de fait – qu’il est possible de prendre une autre perspective sur le sujet. Ce faisant, c’est la notion de valeur elle-même qui perd de son évidence, aussi bien que le rapport de l’évalué à l’évaluation, la réflexion portant au moins autant sur l’acte d’évaluation que sur ce qui est devenu « valeur ».
Or, en 1908/1909, en ce début de XXe siècle, en Allemagne, sans doute n’était-il pas anodin de destituer le thème éthique de son évidence et plus particulièrement de mettre en question la préséance de la valeur sur l’évaluer et de mettre au jour la richesse des actes affectifs. A cet égard, la section III du cours de 1914 est tout simplement fascinante. N’est-ce pas une manière de faire échec aux pouvoirs incitatifs du terme de valeur et des thèmes « tenus pour » des valeurs? L’intérêt du texte réside moins dans la « position éthique » qu’il adopte, il ne tire pas sa pertinence – du moins celle qui nous intéresse – de son pendant contentuel et hylétique caractéristique des recherches ultérieures.
Or, en 2008/2009, en ce début de XXIe siècle, en France, peut-être n’est-il pas non plus anodin de rappeler que le champ axiologique est susceptible d’autres approches que celle qui consiste à hiérarchiser des principes, à produire de nouveaux principes plus séduisants. Peut-être la difficulté du texte, son hétérogénéité par rapport à la manière dont nous traitons aujourd’hui la question au point de voir dans l’éthique et l’axiologie un champ paradoxalement suranné et à la fois absolument « fashion »? Comment la valeur se donne-t-elle aujourd’hui ?
Les procédures de revendications diverses et variées, aussi bien que l’inflation du terme et de la notion de « valeur » dans le discours politique et publicitaire ne doivent-elles pas nous inviter à un peu de circonspection? L’appropriation par chacun du pouvoir d’évaluer à son aune ne débouche peut-être pas que sur l’épouvantail « relativiste ». Mieux, si le « relativisme » est un épouvantail, n’est-ce pas l’indice de la place stratégiquement centrale que joue l’évaluation au point de se demander si la revendication n’est pas une manière de combattre – comme s’il s’agissait de son salut – pour sa servitude. Où la phénoménologie – en décrivant hors d’une perspective « naturelle », mais surtout dans ma mesure où elle est travaillée par le formalisme – devient une véritable machine de guerre.








