L’éclatement de la raison
En 2000 est publié un hommage à Bernard Bourgeois sous la direction de François Dagognet et Pierre Osmo 1. B. Bourgeois, à la suite de Jean Wahl, A. Kojève et Jean Hyppolite, commentateurs émérites de Hegel, est ainsi salué par ses amis et ses collègues. Mais il fut également un professeur, spécialiste de Hegel et plus généralement de l’idéalisme allemand, et en cela, pour paraphraser Platon à propos du jeu dialectique, a semé dans l’âme de ceux qui ont suivi ses cours des discours donnant eux-mêmes naissance à d’autres discours 2. En 2007, Emmanuel Cattin et Franck Fischbach réitèrent donc l’hommage en publiant des articles très divers écrits par ses élèves. L’hommage n’est pas seulement le signe d’une admiration respectueuse, il témoigne à la fois d’une reconnaissance et d’une origine intellectuelle, de ce qui a marqué ces élèves dans leur formation philosophique. Certains semblent s’être davantage affranchis du maître, d’autres moins, ne serait-ce que parce qu’écrire sur Hegel sous l’obédience de Bourgeois implique de savoir se détacher et de l’un et de l’autre, sauf à prendre le risque du jargon et de l’obscurité. L’héritage lui-même désigne bien un patrimoine, ou plus généralement, ce qui est transmis par succession. Mais le patrimoine est à double tranchant : il peut être étouffant ou sclérosant, il peut pousser à profiter de l’héritage et empêcher la véritable création ; il peut également être ce sur quoi l’on greffe un nouvel empire, développant le patrimoine en le transformant et en le rendant parfois méconnaissable par rapport à ce qu’il était au départ. Or tous ces élèves héritent de la raison, du discours philosophique qui, par excellence, fait usage de la raison, et d’un discours qui lui-même s’interroge sur ce que peut bien être la nature ou l’essence de cette raison. L’unité de l’ouvrage ne va cependant pas tout à fait de soi. Premièrement, s’il s’agit bien de traiter de la raison, il s’agit d’une raison éminemment éclatée : raison tantôt théorique, tantôt pratique, tantôt morale, tantôt politique, tantôt historique, s’identifiant parfois directement à l’esprit hégélien et s’en démarquant parfois radicalement. Deuxièmement, le fil directeur de l’ouvrage éclate au profit d’une multiplicité d’auteurs commentés : Hobbes, Montesquieu, Kant, Herder, Fichte, Hegel, Schopenhauer, Binswanger sont abordés selon un ordre purement chronologique. Les quinze articles regroupés ici sont souvent précis, concernent un aspect particulier d’une doctrine, voire un chapitre : c’est pourquoi ils ne s’adressent pas véritablement au débutant. Ils permettent de remettre en question quelques a priori : par exemple celui d’un Kant douanier qui tracerait implacablement des limites à la raison ou encore celui d’un Fichte qui serait une simple transition entre l’idéalisme transcendantal kantien et l’idéalisme absolu hégélien. Ils abordent parfois des auteurs un peu oubliés par les philosophes, je pense par exemple à Binswanger, même si Michel Foucault a particulièrement contribué à sa postérité 4 ; certains se veulent critiques, en particulier envers Hegel, ce qui est évidemment très enthousiasmant puisque l’aspect systématique de la pensée hégélienne en rend la critique d’autant plus difficile et exige une véritable dextérité, mais la critique ne fonctionne pas toujours jusqu’au bout ou reste peu convaincante 5. D’autres enfin, et c’est là beaucoup plus dommageable, sont d’une désagréable obscurité parce que trop jargonnant. Commenter Hegel exige de ne pas le parodier, de ne pas en adopter invariablement le langage, sauf à risquer le psittacisme et surtout à rater l’exigence de clarté dont tout commentateur doit se faire une devise.
Philosophie et histoire de la philosophie s’entrelacent continuellement. « En Bernard Bourgeois, ainsi, [ses élèves] ont rencontré le philosophe, la philosophie et son histoire », soulignent Emmanuel Cattin et Franck Fischbach à l’orée de l’ouvrage. Si l’on rencontre bien « la philosophie et son histoire » dans l’ouvrage, on y rencontre moins « le philosophe ». Que la pudeur l’exige, qu’il faille éviter le sentimentalisme, est fort compréhensible, mais là où le lecteur actuel peut toujours avoir accès aux ouvrages de Bourgeois, le professeur qu’il fut éveille la curiosité. Seul Jérôme Lèbre évoque l’homme et le professeur qui affirmait : « Il est bien difficile d’être et de rester hégélien ! » 6 Non sans humour, on apprend donc qu’être un des plus grands commentateurs de Hegel 7 n’empêche pas d’entretenir de la distance avec celui-ci. Ce n’est pas seulement parce qu’Hegel n’a pas très bien saisi l’essence de la folie que J. Lèbre évoque cette phrase de Bourgeois, c’est également parce que toute pensée systématique est à la fois fascinante et écrasante et qu’il faut apprendre à s’en libérer.
Résumer quinze articles serait inutile et fastidieux. Dans la mesure où le problème de ce type d’ouvrage réside dans le manque (relatif) d’unité et dans l’inégalité de la qualité des articles, je me contenterai donc d’en choisir quelques-uns et de privilégier quelques points ou quelques figures.
A. L’usage de la raison en politique
Deux questions se posent dans cet ouvrage à propos de la raison dans le domaine politique : a) comment rationaliser l’action politique ? Autrement dit, doit-on faire usage d’un conseiller en politique et de quel type de conseil est-on capable ? b) En quoi le politique est-il la raison ou le fondement de la communauté ?
a. Un usage pragmatique de la raison : le joueur de paume et le bibliothécaire-voyageur
Deux articles abordent ainsi la question de la rationalité possible en politique : celui de Jean Terrel qui, en commentateur des théoriciens du contrat social, revient ici sur Hobbes ; et celui de Robert Damien qui aborde la question du conseiller chez Montesquieu. On sait que l’action politique est soumise à la contingence. Pour autant une connaissance du corps politique et de l’histoire d’un Etat pourrait permettre d’orienter l’action politique. Mais quel serait le type de conseiller politique adéquat ? Jean Terrel, dans « Hobbes : le rôle politique de la raison », propose un conseiller ne possédant pas une science à proprement parler, mais un art similaire à celui que possèdent les joueurs de « jeu de paume », un conseiller susceptible de bien jouer. Robert Damien, dans le chapitre II 8, à partir de Montesquieu et en poussant plus loin ses conclusions, propose un « bibliothécaire », maître de la lecture et des voyages.
Détaillons davantage. Après avoir rappelé le calcul rationnel permettant de passer de l’état de nature à l’Etat-Léviathan, du droit naturel aux lois naturelles, Jean Terrel montre qu’Hobbes critique la distinction de Grotius entre droit et politique et entend faire une réelle étude du droit politique. Mais pour saisir les principes du droit politique, pour saisir quels sont les droits et les devoirs du souverain et du sujet, il faut d’abord saisir ce qu’est un « corps politique ». L’intérêt de cet article réside dans le commentaire que fait Jean Terrel de l’« anthropologie politique » hobbesienne, aspect qui aurait, selon lui, été négligé, et dans l’importance qu’il donne au chapitre 22 du Léviathan qui représenterait un tournant dans l’ouvrage puisque l’Etat devient un véritable organisme et non plus une simple forme juridique : « La république a pour matière une pluralité d’individus naturels, le corps politique suppose davantage que la forme juridique (l’union de tous en une personne), il est un organisme dont les parties doivent être produites et assemblées. » 9 L’Etat est un automaton spirituale. Or, là où l’homme naturel est décrit en partant du corps et en s’élevant ensuite aux processus cognitifs, il faut procéder à l’inverse en ce qui concerne le corps politique qui est constitué de « systèmes » visant chacun à produire des effets. Dans le corps politique, il y a à la fois un « mouvement vital » qui équivaut à l’alimentation et à la procréation de la république et un « discours mental de la république » qui réside dans le conseil. 10 L’âme du corps politique régule les différents systèmes qui composent le corps, la république n’étant qu’un système de systèmes. « L’âme artificielle (…) anime de façon différente ses diverses composantes : animation directe, quand des hommes et des systèmes parlent et agissent directement au nom du souverain, contrôle et régulation en ce qui concerne la propriété, le travail, les échanges, la monnaie, art de gouverner quand il s’agit pour le souverain de choisir, de disposer et d’utiliser les hommes et les organes qui constituent sa mémoire et son discours mental. » L’anthropologie politique se distingue ainsi à la fois d’une « géométrie politique » (puisqu’on ne peut pas seulement faire des déductions à partir de principes tirés de l’expérience), et d’une « physique de l’Etat », puisqu’il ne s’agit pas d’expliquer génétiquement la constitution des Etats actuels en se référant au passé. L’anthropologie politique s’intéresse d’abord au futur, aux réformes possibles dans un Etat imparfait, et doit donc faire avec la contingence. Mais « le projet [de Hobbes] ne revient pas à distinguer une science du droit politique et un art de gouverner de part en part empirique et, à la limite, étranger à la raison. Pour une part, l’art de gouverner est scientifique et ce qui en lui excède la science est de plein droit rationnel. » 11 Une science politique, dans la mesure où toute science est science du général, ne pourrait aider à faire de la politique pratique. Mais un art n’est pas forcément non rationnel. De la même manière que l’histoire et l’exégèse sont des « connaissances rigoureuses », un conseiller politique est susceptible de raisonnements rigoureux et solides : « le bon conseiller allie l’expérience et le jugement : il faut en chaque circonstance consulter à part le conseiller approprié, dans une relation non-rhétorique où l’on peut soumettre chaque raisonnement à la critique. La politique pratique n’est pas une science, elle s’apparente au jeu de paume plus qu’à l’arithmétique, et il y a cependant une bonne et une mauvaise manière de jouer à la balle. » 12 J. Terrel conclut ainsi l’article : le rôle politique des raisonnements est « essentiel et pourtant doublement limité, du côté des fins dont les raisonnements sont seulement les serviteurs efficaces, et du côté des résultats du calcul : des règles démontrées et des inférences rationnelles qui laissent une place à l’arbitraire de la décision. » 13 La raison, effectivement, n’est qu’un calcul, calcul des moyens ordonnés aux fins. Comme le domaine à laquelle elle s’applique est contingent, ce calcul n’est pas de l’ordre de la nécessité, mais de la probabilité. Il ne peut valoir que pour une situation donnée et il ne peut valoir que pour l’ordonnancement des moyens. Lorsqu’une décision doit être prise pour atteindre un résultat particulier, il y a intervention de l’arbitraire. J. Terrel affirme que la raison a un « rôle essentiel », et précise que ce rôle est pourtant limité parce que les raisonnements ne sont que « des serviteurs efficaces » et qu’il y a « arbitraire de la décision » (p. 34). Mais si l’on renverse le problème et que l’on considère que l’essentiel, c’est d’abord de déterminer des fins et non en premier lieu des moyens, on peut considérer, à l’inverse de Terrel, que la raison a, en quelque sorte, un rôle subordonné. Une raison réduite au calcul est certes rationnelle, mais peu raisonnable.
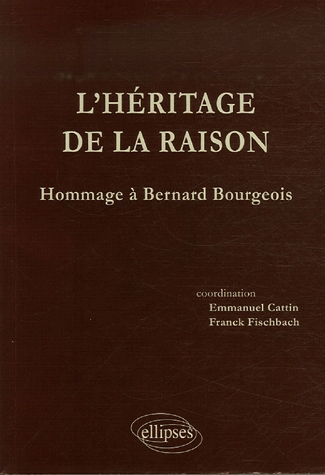
Ce qui rapproche alors l’article de J. Terrel de celui de R. Damien est l’idée selon laquelle les décisions politiques sont issues de raisonnements qui, pour n’être pas scientifiques, n’en sont pas moins rigoureux si les connaissances empiriques sont collectées. Mais la collecte d’éléments empiriques permettant de juger devrait elle-même être de l’ordre de la raison. La simple agrégation ou la plate énumération devrait alors faire place à un véritable classement. Là où J. Terrel faisait en particulier usage du chapitre 22 du Léviathan, R. Damien va s’attacher à un texte peu connu de Montesquieu : les Réflexions sur la monarchie universelle en Europe (1727). Il faut oublier les conseillers politiques tels que le prêtre ou le noble. Il n’y a pas d’ordre divin, il n’y a pas de hiérarchies naturelles qui permettraient d’atteindre le souverain bien. Le risque majeur est alors de sombrer dans le scepticisme. Redéfinir la raison devient donc nécessaire. Montesquieu critique à la fois la monarchie universelle qui, alliée à la religion, s’appuie sur l’idéal de la Cité de Dieu et la philosophie du droit naturel. Il critique le despotisme et n’envisage le pouvoir que comme borné. Mais si la rationalité n’est pas directement visible lorsqu’on saisit les hiérarchies divines et naturelles, si elle n’est pas directement visible lorsqu’on interroge sa propre raison, si l’homme est séparé de Dieu et de lui-même, comment faire de la politique ? Entre une raison qui coïnciderait avec celle de Dieu et un scepticisme désabusé, y a-t-il une autre possibilité ? La contingence et le scepticisme risquent de rendre le conseil politique inutile. La position de Montesquieu est ambiguë. D’où la « tentation contrariée » de R. Damien. Il faut acquérir une « perception synoptique et ordonnatrice », mais en même temps, ne pas participer « aux multiples tentatives politiques qui visent à restaurer le droit et le devoir du conseil pour rééquilibrer l’ordre acquis. » 14 Le scepticisme de Montesquieu empêche d’en revenir au « conseil théopolitique de la chrétienté », mais en même temps, il n’abandonne pas l’idée d’une « rationalité politique » 15 Or connaître, c’est avant tout saisir des causes. Ainsi, s’il y a bien contingence, il n’y a pas pour autant totale irrationalité. Il ne s’agit pas de mathématiser, mais de trouver des ordonnancements, des classements, des régularités. Bref, il s’agit de constituer une « science politique ». La raison n’est pas transcendante, mais doit ordonnancer le réel dans toutes ses variétés et singularités sans réduire celles-ci. « Celui qui saura concevoir, rassembler, exposer les liaisons comme les lésions de cet ensemble complexe [qu’est l’Etat] pourra bien revendiquer de conseiller les politiques. » 16 Le conseiller serait celui qui saisit les liens, le tout et la partie, ce qui convient à « l’esprit général », celui qui recueille patiemment tout ce qui concerne le politique et le social, à savoir les législations, les coutumes, etc. La collecte d’informations s’étend à la fois dans le temps et dans l’espace : il faut s’intéresser aux Romains, aux Goths, à l’Europe, à l’Afrique, à la Chine. La lecture et le voyage permettent l’accumulation des données. Mais s’arrêter à cette espèce d’inventaire désordonné et indéfini serait inutile : il faut ensuite classer afin de saisir les liens entre les choses. Comme le dit Montesquieu, « plus on réfléchira sur les détails, plus on sentira la certitude des principes » (De l’esprit des lois). L’ordonnancement présuppose de ne pas confondre lois humaines et lois religieuses, monde humain et monde divin. Ce n’est plus le prêtre qui conseille, c’est « un philosophe classificateur et synthétiseur qui voyage selon un catalogue des matières. » « Le problème épistémologique du conseil politique selon Montesquieu est, mutatis mutandis, un problème de bibliothécaire. » 17 La bibliothèque constituée, on pourra avoir une vue synoptique, une lecture synthétique de l’ensemble. Le conseiller se doit de saisir la complexité du réel et la décision et l’action devront s’appuyer sur ce savoir quasi-encyclopédique. Le point de vue n’est pas divin, mais il donne de la hauteur. Il permet de saisir où se situent les équilibres, mais aussi, et c’est plus important, où se situent les déséquilibres qui permettent la vie des Etats (que ce soit dans la monarchie ou dans la démocratie). Montesquieu saisit ainsi une dynamique qui, bien comprise, pourrait permettre le conseil philosophique adéquat. Saisir les « touts » qui forment le « tout » permet d’intervenir en connaissant avec précision ce sur quoi l’on intervient.
Il reste une contingence irréductible, il reste de l’indéterminé, mais l’action politique est possible. « L’action politique est un savoir-faire combinatoire qui travaille homéopathiquement une multi-causalité dont la composition n’est plus systématiquement additive ou cumulative, un agrégat alphabétique, mais une synthèse mobile, dynamique. » 18 Il s’agit donc de s’insérer au cœur du conflit et des déséquilibres. Ce conseiller « voyageur-bibliothécaire » n’a pas été véritablement thématisé par Montesquieu, mais il ouvre cette possibilité d’un conseil politique véritable et distinct de la tradition ecclésiastique.
b. Politique hégélienne : au-delà de la rationalité antique et de la rationalité libérale
Un article de Charles-Eric de Saint-Germain est consacré à la question de la politique chez Hegel et en particulier au problème de l’individualisme propre à la modernité. Le propos est relativement classique et peu original pour le lecteur des écrits de Bernard Bourgeois consacrés à la politique hégélienne. L’auteur s’y réfère d’ailleurs régulièrement 19. L’article interroge la question du libéralisme économique. Hegel, lecteur attentif des économistes anglais, admirateur de l’idéal de la Cité antique et de Rousseau, impose l’idée selon laquelle le monde moderne ne peut prendre exemple sur l’Antiquité. Pour autant, l’homme, en tant qu’il a pour vocation l’universalité et non la simple satisfaction animale de ses besoins, ne peut se contenter de l’Etat libéral d’un Adam Smith ou d’un Benjamin Constant. C.-E. de Saint-Germain insiste particulièrement sur le moment « libéral » de Hegel, et revient sur la distinction entre société civile et Etat. Cela lui permet d’une part de critiquer les théoriciens du contrat social, l’abstraction de leur droit et de leur conception de la personne réduite à la personne juridique, et de critiquer d’autre part la « belle totalité grecque » et l’abstraction révolutionnaire (à l’aide notamment de Benjamin Constant et de la distinction entre privé et public). La société civile n’est que le moment du besoin, le moment où les individus, égoïstes, nouent des liens économiques entre eux afin de satisfaire leurs intérêts. L’Etat promu par le contrat social est ainsi un Etat qui ne consiste qu’à garantir la liberté personnelle et la propriété privée, c’est-à-dire les droits du bourgeois. L’action étatique est donc extrêmement réduite : « La société civile bourgeoise tend ainsi à être un espace économique et social dépolitisé, susceptible d’une organisation et de régulations indépendantes : croyant s’acheminer vers la finalité du capitalisme de libre entreprise, elle exige de l’Etat qu’il se retire au-delà du monde social et se borne à en maintenir les conditions extérieures de fonctionnement. » 20 Mais s’il n’est plus possible, comme dans l’idéal antique, de dissoudre les volontés particulières dans la volonté générale puisque l’on risque la Terreur révolutionnaire, il n’est pas non plus possible de « faire de l’Etat un médiocre prolongement de la société civile et une institution de nécessité, et non de liberté. » 21 Constant a raison de saisir le social dans son autonomie, mais il a tort de concevoir l’Etat extérieurement, comme exclusivement fondé sur le besoin. C’est pourquoi de Saint Germain rappelle la nécessité des médiations entre la société civile et l’Etat et l’inscription nécessaire d’un peuple dans une culture. Un individu n’est pas qu’un propriétaire ou un bourgeois, c’est également un citoyen en tant qu’il participe à la vie éthique d’un peuple et éprouve donc une « disposition éthique ». L’individu est censé avoir accès à l’universalité de la citoyenneté et non être simplement un père dans sa famille ou un bourgeois dans la société civile. Le « sentiment patriotique », et l’épreuve de la guerre en particulier, permet ainsi de saisir l’attachement de l’individu à l’Etat, quittant ainsi des simples buts finis. Mais l’individu n’est pas soumis immédiatement à l’Etat. De Saint-Germain rappelle le rôle des médiations et notamment des corporations. La dernière partie, s’intitulant « La critique hégélienne de l’individualisme moral : l’absorption de la moralité subjective dans la vie éthique », reprend la distinction entre moralité et éthicité. Si la subjectivité des individus doit bien s’objectiver dans l’Etat, « l’Etat est cependant d’autant plus fort qu’il s’enracine profondément dans la conscience des individus – où il se donne un reflet, subjectif, de lui-même – et est reconnu par eux comme l’objectivation de leur vouloir raisonnable. » 22 L’Etat crée un lien social entre les individus analogique au lien religieux, mais au niveau terrestre. Par le patriotisme, les individus témoignent de leur croyance véritable, en tant qu’elle a un contenu et non en tant que pure abstraction, en l’Etat. « Cette refondation religieuse du politique, qui libère le fondé de son fondement divin, constitue assurément l’une des originalités de l’hégélianisme, en ce qu’elle autorise un sens chrétien de la laïcité » 23. Le privé est bien subordonné au public, mais il n’y a pas de retour à la Cité grecque puisque place est faite au principe chrétien de la subjectivité. La Cité grecque ne pouvait pas ne pas condamner Socrate à mort, à moins de se détruire dans sa propre essence. C’est Kant qui montre en particulier le « droit de la liberté subjective » grâce à une « morale (…) qui reconnaît à l’homme un prix et une dignité infinie. » 24 A chaque personne est dû le respect en tant qu’elle est une personne morale et raisonnable (au moins en droit) et en tant qu’elle peut elle-même poser la loi morale à partir de la raison pure pratique. C’est donc dans la notion d’autonomie que réside l’intérêt de Hegel pour la morale kantienne. L’individu peut examiner ce qui est son devoir, ce qui est bien et ce qui est mal. Mais le devoir reste alors purement formel. « La seule conviction subjective de l’individu est un critère insuffisant pour déterminer objectivement le contenu de mon devoir, il ne peut qu’aboutir à consacrer la particularité contingente et l’arbitraire subjectif de l’individu et l’arbitraire subjectif de l’individu, et à renverser la moralité dans son contraire. » 25 « Ainsi, là où la conviction subjective demeure le seul fondement du devoir, la moralité subjective se renverse nécessairement en subjectivisme moral. (…) C’est cette absorption de la subjectivité que se propose d’extirper radicalement Hegel. D’où la nécessité de subordonner la volonté subjective de l’individu à un bien transcendant, déterminé au niveau de la vie éthique d’un peuple, car c’est seulement la substance éthique du peuple constitué en Etat, et non l’individu, qui peut légiférer sur ce qui doit être reconnu objectivement et universellement comme bien. » 26 L’universalisation de la maxime, en tant qu’elle n’est qu’un critère logique, est insuffisante parce qu’on peut très bien décider d’universaliser une maxime immorale ce qui entraînerait une démultiplication des actions immorales. Le critère de l’universalisation ne peut garantir le contenu : on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas universaliser l’idée selon laquelle tout le monde devrait mentir au détriment de la maxime selon laquelle personne ne devrait mentir. Il devient donc arbitraire qu’un individu se détermine en faveur d’une maxime ou d’une autre. Or les impératifs éthiques chez Hegel sont intériorisés par l’intermédiaire de la « disposition éthique » et ce en leur contenu également. L’individu intériorise les normes sociales et les considère comme éthiques, même si leur origine peut ne pas être morale. Hegel refuse donc à la fois l’absolutisation de l’individu (propre au christianisme et à Kant ici) et l’absolutisation de l’Etat (comme ce serait le cas dans la Cité grecque). L’Etat est ce qui permet à la subjectivité de s’objectiver et d’abandonner le formalisme. Il s’agit de ne pas considérer les individus comme des atomes, mais comme des êtres sociaux et politiques, pris dans un tissu de relations familiales, économiques et politiques. Cela évite alors la violence étatique puisque les médiations permettent un enracinement qui évite d’adhérer immédiatement aux idéologies du pouvoir. Ni libéralisme, ni totalitarisme, l’hégélianisme permet de faire place à un individu libre subjectivement tout en étant enraciné dans une communauté politique.
B. Raison théorique et raison pratique chez Kant : le modèle du funambule
Trois articles sont exclusivement consacrés à Kant. Ils déterminent les points d’implosion du système kantien 27, remettent en cause quelques préjugés, insistent sur les tensions du système en trouvant parfois des solutions. Celui de Bruno Barthelmé, intitulé « La raison kantienne. Penser (à) la limite du savoir », traite de la raison théorique ; celui d’Alexandre Delamarre, « De l’arbitre à la maxime. Réflexions sur la finitude pratique dans l’œuvre de Kant. », traite de la raison pratique. Deux occasions de s’interroger sur la finitude humaine, deux occasions de s’interroger sur ce funambule qu’est l’être humain, déambulant entre sensible et suprasensible, entre animalité et divinité.
Dans son usage théorique, la raison kantienne, distincte de l’entendement, cherche à atteindre l’inconditionné et produit des idées métaphysiques qui transcendent le sol de l’expérience, donnant ainsi naissance à une « logique de l’apparence », à des contradictions insolubles entre dogmatiques et empiriques. Or cette guerre engagée au sein même de la raison peut être pacifiée. B. Barthelmé défend l’idée selon laquelle la paix est en réalité toujours déjà présente si l’on évite la confusion entre borne et limite, si l’on n’oublie pas que la limite n’est elle-même jamais donnée dans l’expérience, et si l’on instaure un véritable langage qui permet de penser à la limite, retrouvant ainsi, dans une perspective plus classique, la distinction entre penser et connaître et le « als ob » kantien. Les (mauvaises) habitudes poussent souvent à représenter Kant comme un poseur de limites, voire une sorte de douanier. La sensibilité, l’entendement et la raison ont leur lieu propre. A chaque faculté son type de connaissance. Or B. Barthelmé propose de s’installer sur les limites mêmes afin de mieux saisir le propos kantien, afin également d’initier une pensée à la limite, en repensant la Critique de la raison pure à partir des Prolégomènes. Deux sens de la limite s’esquissent. 1) La limite « enclôt, restreint, interdit en somme l’illimité, l’extension abusive » 28, bref elle sépare et distingue (l’entendement pense et les sens intuitionnent). 2) Mais une limite se distingue d’une borne : la borne fixe arbitrairement un territoire qu’on ne peut dépasser, elle détermine seulement un espace du dedans en rejetant le dehors ; la limite présuppose un territoire au-delà du territoire qu’elle institue : « La limite est comme la ligne de crête qui conjoint les deux versants d’une montagne ; au lieu de séparer, d’enfermer, elle indique un intervalle, à la manière du chemin du limes qui chemine entre deux bords qui ne peuvent jamais se toucher. La limite est cette zone franche, cet espace neutre qui articule l’un à l’autre sans les joindre deux territoires. » 29 En fixant à la raison des limites, Kant ne veut donc pas seulement dire qu’un usage spéculatif de la raison est inapproprié, il montre également que la raison peut « « penser » ses limites ». « Penser à la limite, c’est bien aller au-delà de ce qu’elle enferme, au-delà de cet espace intérieur qu’est l’expérience, toute la connaissance possible pour nous, sans pour autant se risquer dans l’espace extérieur, vide pour nous, qu’est la connaissance suprasensible. » C’est donc le modèle du « funambule » qui s’impose puisque la raison ne se satisfait pas de l’expérience, mais tend toujours à la dépasser. Les deux sens de la limite se complètent puisque la raison doit à la fois être bornée par l’expérience et en même temps « ces « bornes » n’interdisent nullement à la raison de penser au-delà, à la « limite » de notre savoir » 30. Penser les limites permet alors de saisir en quel sens Kant parle d’un « usage régulateur des Idées transcendantales ». Mais penser ne peut aller sans trouver un langage pour énoncer la pensée à la limite. B. Barthelmé convoque alors la distinction entre la « supposition relative » et la « supposition absolue » et la notion d’analogie. L’existence de Dieu ne peut être supposée de manière absolue parce qu’à cette idée manque une réalité objective, mais elle peut être supposée de manière relative au monde dans lequel nous vivons. Ainsi nous pouvons parler de Dieu selon un « anthropomorphisme symbolique » et non « dogmatique », en lui attribuant des propriétés qui sont en rapport avec le monde, sans pour autant lui donner ces propriétés en soi. « Une pensée à la limite est donc d’abord un langage. » 31 Il s’agit bien d’articuler le monde phénoménal et le monde nouménal. La limite devient donc un lieu propre, un « lieu neutre » 32. Le lieu neutre du domaine métaphysique rejoint alors celui de l’utopie dans le domaine politique. De belles pages sont consacrées à l’utopie kantienne. Kant, dans Le Conflit des facultés en trois sections, évoque Platon, Thomas More, Harrington, Allais. Mais ici le « lieu neutre » devient un « non-lieu », une u-topie. Le « nulle part », le lieu en tant qu’idée, et non en tant que chose, s’impose. A l’inverse d’une utopie, le pays de l’entendement kantien constitue une « contre-utopie » 33 puisque ce pays est le seul que nous connaissons et qui nous fournisse la vérité dont nous sommes capables. Mais les aspirations nous poussent vers l’utopie. Ainsi, la raison est invitation au voyage, « tâche, effort », elle est « voyage en utopie » 34, B. Barthelmé insistant sur la dimension dynamique de ce voyage davantage que sur la découverte d’un nouveau lieu. La raison fournit moins un « port » d’attache qu’un « projet, celui de nous faire parvenir sur cette limite où se dessine l’horizon du pays que nous habitons. » 35 « L’utopie n’est donc pas réductrice à la seule quête d’un « ailleurs » introuvable parce que l’« ailleurs » n’est tel que par la position d’un « ici » dont le voyageur ne s’écarte que pour mieux y revenir. Le voyage exige le retour chez soi, son sens n’étant pas l’évasion, la fuite dans le mauvais infini du désir, mais celui d’une meilleure et plus entière appropriation du pays que nous habitons. » 36 Le voyage permet la paix aussi bien en métaphysique qu’en politique car il nous permet de déterminer ce qui est véritablement chez soi. La limite, en tant qu’elle est un miroir, le mode du als ob, permet ainsi de fixer les limites du chez soi. On ne peut donc pas assigner un lieu propre à la raison, on ne peut pas lui donner des bornes, parce qu’elle est essentiellement un acte issu d’un besoin de transcender l’expérience, ne peut être assignée ni au monde phénoménal ni au monde nouménal que nous ne connaissons pas. Elle se place à la limite du connu et de l’inconnu. Faire usage de sa raison théorique, ce n’est donc pas entrer dans le pays du nouménal, c’est penser entre le phénoménal et le nouménal. C’est pourquoi la raison est, à proprement parler, nulle part. Deux préjugés sont donc à remettre en cause : 1) la limite kantienne n’est pas une interdiction, il n’y a pas de catégories fixées définitivement qui diraient ce qu’on peut penser et ce qu’on ne peut pas penser, puisqu’au fond on ne sait pas où se situe exactement cette limite dont nous n’avons pas d’expérience. C’est pourquoi l’on pourrait encore penser les sciences aujourd’hui en kantien. La limite n’est pas donnée a priori. 2) Lorsqu’on pense la limite et qu’on pense à la limite, on va au-delà de la borne et on permet donc le progrès. Ce n’est pas par l’expérience elle-même que l’on peut saisir la limite de l’expérience. Barthelmé pacifie alors les rapports entre dogmatiques et empiriques au niveau métaphysique. L’état de guerre ne vient que si l’on oublie que penser à la limite où penser sur la limite est un « langage du comme si » 37 qui lui-même est un langage imagé. Nous utilisons donc les Idées pour penser au-delà du connaître. « Le concept kantien de limite introduit la possibilité pour la raison de penser. Penser n’est pas connaître, cette distinction connue du kantisme donne toute la mesure d’une raison qui refuse obstinément de devenir une puissance de connaissance, de se nourrir du « sol de l’expérience » autant que de s’envoler dans l’espace suprasensible inconnu de nous pour se nourrir de fausses connaissances. Penser à la (sur la) limite du savoir, parce que la limite est proprement un « nulle part », ne peut que rendre la raison foncièrement apatride. C’est à cette seule condition que le langage de la raison peut échapper au langage dogmatique des choses. » 38
Dans son usage pratique, la raison permet de fonder la loi morale qui se doit d’être universelle. Alexandre Delamarre, dans le chapitre V, entend élucider la diversité des figures de la finitude kantienne. D’un point de vue théorique, l’homme ne peut connaître par intuition, il est affecté par les objets et reste donc soumis à la sensibilité. L’entendement doit prendre en compte ce qui lui est donné dans l’expérience. En cela, l’homme se distingue de Dieu qui est susceptible d’une intuition totalement spontanée. D’un point de vue pratique, l’homme est fini en ce qu’il dépend du monde sensible. En cela il se rapproche de l’animal, mais il s’en distingue dans la mesure où il fait un certain usage pratique de sa raison. L’usage pratique de la raison est double. Il renvoie d’une part à la recherche du bonheur, même s’il s’agit davantage d’un usage pragmatique que purement pratique. Cet usage est tout de même propre à l’être humain en tant qu’être raisonnable, et non simplement en tant qu’être sensible : il faut bien, comme le montrent les Fondements de la métaphysique des mœurs, user de sa raison puisque l’instinct fait défaut chez l’homme. L’usage de la raison renvoie d’autre part à la moralité et en cela il s’agit d’un usage pur pratique qui nous distingue radicalement des animaux. D’où : « Il s’agit moins alors de découvrir la raison purement pratique que de déterminer la hiérarchie des usages pratiques de la raison, dans un prélude à la constitution de l’idéal du souverain bien. » 39 A. Delamarre fait alors référence à l’utilisation que fait Kant du terme d’« arbitre » et plus particulièrement d’arbitrium sensitivum, « c’est-à-dire affecté par des stimuli. Là est le principe d’une pathologie de l’arbitre. Dépendance et affectibilité, telles sont donc les deux expressions pour une même figure que nous pouvons désigner par le terme général de sensibilité, et qui fait pendant à la finitude théorique examinée plus haut. » 40 Mais en ce qui concerne la moralité intervient également la notion de liberté. Or, en l’homme la moralité reste contingente puisque la volonté a des difficultés à se conformer pleinement et spontanément à ce que lui dicte la raison. D’où la distinction entre la maxime en tant que « principe subjectif d’action » et la loi. Pour l’homme, la loi se présente sous la forme d’un impératif et donc d’un devoir. L’homme peut donc très bien se donner des maximes qui seraient opposées à la loi morale. « C’est parce que notre arbitre est pathologiquement affecté qu’il comporte des maximes du bien-être qui peuvent s’opposer à la loi, et parce qu’il est capable de telles maximes que la loi nous commande en tant qu’impératif. L’impératif moral est donc tout autre chose que la maxime : celle-ci énonce le principe subjectif d’après lequel j’agis, celui-là dit comment je dois agir. Mais les deux, impératif et maxime (en tant que séparée de la loi) renvoient bien à la même finitude. » 41 L’Etre suprême, à la différence de l’homme, est doublement infini : parce qu’il s’auto-suffit, il n’éprouve pas le besoin ; parce que sa volonté est fondamentalement sainte, il ne connaît pas d’opposition entre maxime et loi. Nous sommes donc finis d’un point de vue pratique en deux sens : parce que nous sommes dépendants du monde sensible (ce qui nous pousse à réfléchir sur ce qui pourrait bien nous être utile pour être heureux) et parce que nous pouvons suivre le mal plutôt que le bien. Ainsi la sainteté appartient à un être infini pour lequel la distinction même entre maxime et loi est un non-sens : nous ne considérons que la maxime et la loi coïncident chez le saint que parce que nous le comparons à nous. A l’opposé, l’homme est celui dont la finitude est marquée par l’exercice de la vertu et le respect de la loi, respect qui n’est que la manière dont nous ressentons, en tant qu’être sensibles, la loi. Le saint n’a pas de devoir en tant que tel puisque ce qu’il est coïncide avec ce qu’il doit être, puisque ce qu’il doit faire coïncide avec ce qu’il fait effectivement. Le saint n’est donc que le terme idéal vers lequel l’homme tend, à savoir l’indistinction de la maxime et de la loi dont l’opposition ne se manifeste que pour l’être fini. Le but d’A. Delamarre est alors de montrer les « tensions conceptuelles » qui surgissent à partir de ces deux figures de la finitude pratique, à savoir la présence de l’arbitre en tant qu’il dérive de l’être-affecté et la disjonction entre maxime et loi. Comment l’arbitre se distingue-t-il de la volonté ? La volonté s’identifie à la raison pratique. A l’inverse « l’arbitre pur et simple n’est pas essentiellement libre, et […] il n’est donc pas lié à la possession de la raison. » 42 Les animaux peuvent également le posséder. Jusqu’ici rien de très original. En revanche plus intéressante est la distinction que rappelle M. Delamarre entre spontanéité « absolue » et spontanéité « relative » : l’une correspond à la spontanéité de la liberté transcendantale, tandis que l’autre peut s’accorder avec le mécanisme de la nature. Aussi l’âne est-il attiré par le foin de lui-même, mais cette spontanéité correspond à la vie elle-même. Le vivant, à la différence de l’inerte, est donc caractérisé par le besoin qui est au principe des actions qu’il mène. Mais alors toute action peut être rapportée à une action antérieure et la distinction entre interne et externe ne change rien au mécanisme puisqu’une représentation (interne) peut très bien en engendrer mécaniquement une autre. En cela, il ne faut pas être illusionné par l’intériorité de la représentation : la liberté n’est alors que psychologique ou comparative. L’automate peut très bien être matériel ou spirituel et l’animal n’est qu’un automaton spirituale puisque des représentations, et non simplement des mouvements, peuvent très bien s’enchaîner mécaniquement. Du moment qu’il y a succession temporelle, il y a mécanisme et non liberté transcendantale. Qu’est-ce qui spécifie alors l’arbitre humain ? A. Delamarre propose une « typologie » 43 des formes d’arbitre. Il faut d’abord rappeler la différence anthropologique, non plus en distinguant l’arbitre de la volonté morale, mais en distinguant les arbitres entre eux. « L’arbitre humain s’oppose à l’arbitre animal comme un arbitrium liberum à un arbitrium brutum. » 44 Il s’agit de deux formes d’un seul et même arbitre : « l’arbitrium sensitivum ». Le sensitivum renvoie au fait d’être affecté et donc de recevoir des stimuli. Or pour l’homme, le stimulus n’est pas nécessitant de manière absolue : autrement dit, la puissance du stimulus peut être atténuée, ce qui permet une première forme de liberté négative. Le stimulus nous incite, mais ne nous nécessite pas. L’homme n’est donc pas tout à fait affecté comme l’animal.
Seulement la typologie de l’arbitre est complétée dans les Reflexionen et les Vorlesungen. L’arbitre peut être soit sensitivum soit intellectuale. L’arbitrium intellectuale serait déterminé par des motifs, sans aucun stimulus. Il est bien évident que cet arbitre est l’arbitre divin. L’homme possède un arbitre entre celui de l’animal et celui de la divinité. Or là se situe la difficulté. « L’homme est […] le lieu d’une double négation inverse : limitation de la puissance des stimuli d’un côté, et en même temps négation par l’affectibilité de la pureté des motifs de l’autre. » 45 L’homme n’étant ni Dieu ni bête, la liberté positive et intellectuelle de l’homme ne se sépare pas de sa liberté négative. « L’arbitre intellectuel […] limite la force du stimulus. Mais, inversement, le stimulus et l’affect nous éloignent de la pureté de l’arbitre intellectuel. » 46 L’arbitre intellectuel peut certes limiter la puissance du stimulus, mais comment peut-il ne pas être pur ? En fait, il ne s’agit pas d’opposer le motif et le stimulus, puisque, pour céder à un stimulus, il faut déjà un motif pour le faire. Le motif se retrouve donc au cœur même du stimulus. L’arbitre humain est cependant profondément équivoque et penser la liberté humaine nous mène à l’aporie : comment en effet « concevoir qu’une liberté et donc une spontanéité absolue puissent exister en un être intrinsèquement dépendant » 47 ? L’animal et le dieu sont parfaitement déterminés : l’un passivement par sa nature sensible et l’autre activement par sa nature divine qui implique une coïncidence parfaite entre volonté et loi (ce qui est déjà une manière trop humaine de parler). Le saint est nécessité à agir droitement, mais cela ne limite pas sa liberté qui est parfaite en soi. Ce n’est pas la nécessité qui détruit la liberté, mais le fait d’être affecté passivement. Comme Dieu n’est pas affecté, mais seulement nécessité, il est libre. Il devient alors très complexe de penser l’arbitre humain qui est une contradiction dans les termes, être à la fois passif et actif, et surtout parfaitement indéterminé. Kant aurait pu faire résider la liberté humaine dans cette indétermination à suivre ou à ne pas suivre la loi. Mais « Kant a toujours récusé pareille identification de la liberté à la contingence de la moralité en l’homme ou à une quelconque forme d’indifférence entre le bien et le mal. Ce serait penser la liberté moins comme pouvoir que comme impuissance. » 48 La liberté, comme on le voit bien avec le saint, n’est pas une question de choix, ou en tout cas, ne peut pas être un choix qui aille à l’encontre de la raison. Toute référence à l’expérience ne peut donc permettre de saisir la liberté en son « essence ». Mais la présence de la maxime et l’expérience montrent bien que l’homme peut choisir contre la loi. « La distinction de la maxime et de la loi ou l’indétermination de l’arbitre sont déjà la possibilité du mal : ici la question est moins celle du fait que celle de la liberté comme simple possibilité de choisir contre la loi, même si cette possibilité est moins pouvoir qu’impuissance. » 49 C’est pourquoi « toute la question est alors de savoir si la liberté se pense à partir de son concept seulement, la finitude n’étant alors qu’une marque empirique ou un fait, ou s’il n’y a pas lieu de poser un véritable concept original de la liberté finie comme telle, même s’il doit contenir la négation et l’impuissance parmi ses caractères. » 50 A. Delamarre propose une solution qui est la thèse fondamentale de son article : « De l’arbitre procèdent essentiellement les maximes, et la liberté de l’arbitre se définit alors comme la liberté des maximes. Certes, Kant affirme que cette liberté ne consiste pas dans la faculté de choisir pour le mal et ne se définit pas par elle (ce qui serait liberté d’indifférence), mais il reste que l’homme n’est mauvais moralement que parce que ses maximes sont mauvaises, et qu’il ne peut être mauvais moralement que de son fait. Même mauvaises, les maximes naissent donc de la liberté de notre arbitre, puisque autrement elles ne pourraient être dites mauvaises moralement. » 51 Choisir une maxime est donc différent du fait de suivre la loi ou d’être autonome, c’est un « acte original de l’arbitre ». « En fait, il nous semble que Kant est partagé et comme tiraillé entre deux exigences contraires : d’une part, il lui faut, contre l’indifférence, réaffirmer la vérité conceptuelle et essentielle de la pure liberté (laquelle, en un être originairement saint, ne connaît même pas l’existence de la maxime), d’autre part, il lui faut donner sens à une figure également originale de la liberté, même si elle ne s’actualise que dans la finitude : tel est le choix de la maxime par le libre arbitre. » 52 Ainsi on peut se donner des maximes qui sont moralement mauvaises, qui permettraient notre accès au bonheur (par exemple user des autres comme moyens sans les considérer comme des fins pour s’élever socialement), et il est possible que ces maximes ne soient pas en accord avec la loi morale. On pourrait même se donner des maximes sans qu’il existe la moindre loi morale. Mais la maxime est toujours une marque de la volonté : je me donne d’abord une maxime (bonne ou mauvaise) et j’agis ensuite en fonction de cette maxime. C’est alors le motif qui permet de déterminer ce qui est bien et ce qui mal et qui nous déterminerait à agir. Mais déterminer le bon et le mauvais implique une réflexion. On peut en fait faire un double usage de la raison : soit déterminer ce qui est bien absolument et donc faire usage de la raison pratique dans sa pureté en désignant ce que doit être la loi ; soit déterminer les moyens qui permettent d’atteindre une fin arbitraire (comme c’est le cas par exemple pour l’impératif technique, mais aussi, dans une certaine mesure, pour l’impératif pragmatique). Mais ce que la raison détermine pour parvenir au bonheur est aussi le signe que l’impératif catégorique est une destinée plus élevée pour l’homme. Ainsi « il n’y a pas alors opposition entre la liberté négative et la liberté positive, mais entre deux formes de la liberté positive elle-même, celle où le positif se manifeste comme réflexion rationnelle à propos de l’utile, et celle où il se manifeste comme commandement de la raison pure pratique. » 53 L’arbitre permet de ne pas réagir immédiatement au stimulus, de laisser passer du temps. Mais la raison n’est pas utilisée alors dans son sens le plus élevé parce que différer l’immédiateté peut n’être qu’un calcul et doit donc se distinguer de la moralité en elle-même. Quant à la maxime, elle permet certes à l’homme de se détacher de l’immédiateté, mais on peut déterminer une maxime en dehors de tout stimulus. « Car une maxime, même selon les exemples les plus simples, consiste essentiellement en une règle d’action que l’arbitre se fixe pour plus d’un cas, ou pour tous les cas possibles qui se présenteront. » 54 Il ne s’agit pas de différer par rapport au présent, mais de sortir du temps lui-même pour passer au « toujours ». « La maxime marque donc un virage dans la conception de la raison pratique et de la liberté : il ne s’agit plus de nier l’immédiateté seulement par la résistance au stimulus, mais de nier la singularité dans la détermination de l’arbitre, en manifestant dans la liberté un pouvoir de décider pour l’universalité des cas. » 55 C’est cette universalité qui permet de lier la maxime et de montrer le passage à la loi puisque « la raison pure pratique ne fait qu’étendre l’universalité de tous les cas à tous les êtres raisonnables. La loi morale n’est alors que le plein accomplissement de la vocation d’universalité déjà présente en toute maxime. » 56
C. La raison envahissant le réel : Hegel et la Philosophie de l’esprit
L’idéalisme absolu donne un nouveau sens à la raison qui s’identifie avec l’effectif dans le mouvement dialectique de l’Esprit absolu. Quelques articles abordent certains aspects du système hégélien. Commençons par le début de la Philosophie de l’esprit, l’anthropologie.
J. Lèbre, dans « Avons-nous changé ? Ethique et anthropologie chez Hegel et Schopenhauer », rend explicitement hommage à son professeur en évoquant les cours de B. Bourgeois sur Hegel, mais également sur Kant et Schopenhauer. Cet article s’interroge sur l’anthropologie chez Hegel, sur la possibilité d’un traitement de la folie, sur les rapports entre folie et raison, sur la possibilité de changer. L’anthropologie est ce moment où l’être fini que nous sommes n’est pas encore reconnu (comme c’est le cas dans le procès phénoménologique), c’est le moment de l’âme, un moment presque infra-humain, celui de la « vie éthique, seconde nature, ou ethos » 57. J. Lèbre rappelle que Bernard Bourgeois « a développé le thème anthropologique en comparant Hegel à Rousseau, puis Hegel à Kant. » La comparaison entre l’anthropologie kantienne et l’anthropologie hégélienne est particulièrement pertinente. La distinction kantienne entre la raison pratique et l’être empirique de l’homme est radicale. C’est pourquoi Kant ne réussit à parler de l’homme « que sous la forme non rationnelle d’un discours pragmatique. Ce discours procède alors à l’exclusion de ce qu’il tente d’énoncer. L’animalité de l’homme échoue à faire sens, et tout ce qui la touche (le mécanisme corporel de l’habitude, le dérèglement spirituel de la folie) devient, non seulement immoral, mais aussi intangible. Hegel en revanche « exige du philosophe spéculatif qu’il retrouve la raison se construisant, selon une immanence totale, dans l’élément le plus opposé à elle-même, cette nature qui est bien son aliénation absolue » ; il fait donc de l’anthropologie un « moment privilégié du discours spéculatif », où se révèle le pouvoir propre du sujet fini, comme âme prenant possession de sa nature. » 58 Dans l’anthropologie sont interrogés les âges de la vie, la veille, le sommeil, la santé, la folie. Mais là où Kant critique l’habitude qui nous rapproche des bêtes, là où celui qui est véritablement moral ne doit pas être vertueux par habitude, c’est-à-dire extérieurement, conformément à la loi morale plutôt que par devoir et pur respect de la loi, là où il faut une abrupte révolution pour nous sortir des habitudes, selon Hegel, la liberté ne peut être une révolution. L’âme a d’abord à séjourner au cœur de la nature, à s’approprier son propre corps, à faire émerger quelque chose comme une volonté. L’homme se réalise lui-même à partir de la sensation, acquiert un caractère qui est forgé par les habitudes. La volonté se dessine, tout en risquant de tomber dans l’entêtement au lieu de parvenir à l’universalité. Ainsi, s’il y a véritable entêtement, le caractère peut mener jusqu’à la folie puisque « l’âme « reste avec persistance dans une particularité de son sentiment de soi » » 59 On peut ne pas passer de l’âme à la conscience réfléchie. Mais là où pour Kant « la folie est une irrémédiable chute dans la nature, elle reste, pour Hegel, susceptible d’un « traitement humain, c’est-à-dire tout aussi bienveillant que rationnel. » » « La raison est virtuellement présente au cœur du délire et souffre en lui d’une contradiction qu’elle est encore en mesure de supprimer. Comme le dit Bernard Bourgeois, « ce que l’esprit défait, il peut le refaire. » » 60 Lèbre entame alors son moment pessimiste, citant le professeur Bourgeois. Pourquoi est-il si difficile de rester hégélien ici ? Parce que la folie n’est pas seulement une déraison qui pourrait être traitée rationnellement, parce que la folie tient son origine d’un inconscient qui agit. De la même manière, il n’est pas dit que l’on puisse supprimer la singularité du caractère en passant à la raison universelle, il n’est pas dit que nous puissions changer aussi facilement. Avec Schopenhauer s’esquisse un caractère immuable, opposé à un intellect permettant le mouvement. La raison n’est que « l’instrument d’une volonté qui ne change nullement. » 61 « Il n’y a pas de plus grande illusion que celle d’une révolution intérieure » 62 Comment la raison pourrait-elle révolutionner un caractère alors qu’elle ne vient que tardivement ? Comment la raison pourrait-elle déterminer à agir alors que c’est la volonté qui impose les motifs et que les motifs rationnels restent peu convaincants ? La raison n’est jamais que secondaire. Au fond, le caractère n’est que l’individualisation de la volonté par un motif. C’est pourquoi nous ne pouvons connaître notre caractère qu’a posteriori. Le caractère est donc seulement empirique, on le saisit au cours même de son existence. Chaque acte nous révèle à nous-mêmes. C’est en observant nos actions que nous pouvons véritablement nous connaître, sans complaisance. Ce caractère résulte des habitudes et même si nos actions peuvent varier quelque peu, nos penchants subsistent et nous maintiennent inchangés. La raison ne fait que saisir ce que nous sommes a posteriori. Ainsi la folie véritablement installée ne peut être soignée. « La folie est une « interruption du fil des souvenirs » par la volonté, refusant de se voir présenter par l’intellect un événement passé qui lui était défavorable. Cet événement lui est toujours intolérable, puisqu’elle est par définition hors du temps. Mais l’irruption de la volonté dans l’enchaînement des souvenirs ne se contente pas de nier la représentation d’un événement : elle lui substitue une autre représentation plus inoffensive, sur laquelle elle se fixe, d’une manière qui reste inexplicable pour l’entendement. » 63 La folie ainsi ne change pas notre caractère, mais son irruption empêche toute reconnaissance possible de soi, sans compter qu’elle peut, selon Schopenhauer, provoquer des altérations somatiques du cerveau en même temps que des altérations psychiques. 64 La dernière partie de l’article de J. Lèbre revient sur le texte de Foucault « Qu’est-ce que les Lumières ? ». Quelle anthropologie aujourd’hui, après Freud lecteur du texte sur la folie de Schopenhauer, après la fragmentation de la volonté par Nietzsche, après les totalitarismes du XXe siècle ? Qui sommes-nous en tant qu’hommes ? Les Lumières, la « sortie » de l’homme hors de l’état de minorité, sont bien un processus qui reste toujours à faire parce que l’homme tend à abandonner l’usage de sa propre raison au profit de « tuteurs » ou d’autorités universitaires, religieuses, politiques, parce que le fou également reste un adulte mineur. C’est pourquoi l’homme moderne est celui qui ne cesse de s’interroger sur ses manières d’agir et de penser. « L’ethos, c’est alors bien le caractère moral comme exigence absolue, posée à l’homme, de se faire lui-même ce qu’il est, de dépasser ce que la nature fait de lui. » 65 Etre moderne, ce n’est donc pas se soumettre seulement à la raison, c’est aussi s’en libérer, c’est avant tout s’interroger sur ce que nous sommes, dans toute notre complexité. Il ne s’agit donc pas, dans une perspective kantienne, de s’affranchir de ce qui est empirique, de ce qui est naturel en nous imposant une loi transcendante, c’est rendre possible une élaboration de soi dans l’immanence même de l’être empirique. « Travail de soi » donc, et non « conversion » radicale. Ce travail sur soi est constitué de « règles diététiques, économiques, érotiques, procédures de maintien du corps et de la pensée », bref « ensemble de techniques qui ne sont pas des lois ». 66 L’éthique devient donc souci de soi et souci de l’autre, souci de soi parce qu’on s’interroge sur la « qualité et la longévité de sa vie », souci de l’autre « dans la mesure où les caractères peuvent s’élaborer l’un par l’autre (dans la relation pédagogique, matrimoniale ou politique, l’ethos du maître déterminant l’existence de ceux qu’il maîtrise) ou peuvent s’élaborer ensemble (dans les relations entre citoyens). » 67 De Foucault, J. Lèbre retient cette idée de « réserve sur nous et notre œuvre ». Il faut tenir l’équilibre entre la folie comme « anéantissement de l’œuvre » et le souci de soi moderne. C’est parce que le sens de notre histoire n’est pas clos que nous avons à repenser notre modernité. Peut-être un jour repenserons-nous notre rapport avec la folie que nous essayons aujourd’hui de maîtriser techniquement. Nous saisirons peut-être pourquoi nous avons oscillé entre la folie comme expression de la vérité et la folie comme parfaite étrangeté, pourquoi nous avons essayé systématiquement de la neutraliser et de la contrôler, pourquoi enfin nous tenons tant à la mettre à distance. Une brèche a été ouverte par Nietzsche et par Freud, mais également par la littérature, par Mallarmé, Raymond Roussel, Antonin Artaud, et par le surgissement d’un nouveau type de signifiant qui ouvre de nouvelles possibilités de sens. Nous ne savons pas encore quel rapport la modernité entretient avec elle-même. Mais le souci de soi reste une exigence puisque le sens pour nous n’est pas clos, ni d’un point de vue collectif, ni d’un point de vue individuel. La « déraison entêtée » de Hegel nous empêche de saisir définitivement le sens. La santé est bien la capacité de se reconnaître soi-même et d’intégrer tous ses souvenirs, aussi douloureux soient-il, selon Schopenhauer. Mais la permanence du caractère n’empêche pas l’irruption de la folie, de l’entêtement, qui consiste à rejeter de sa mémoire un événement douloureux en le remplaçant par autre chose, ce qui brise l’enchaînement des souvenirs et crée des lacunes dans la mémoire. L’entêtement peut devenir absolu. C’est pourquoi J. Lèbre considère finalement qu’on peut concilier à la fois la phrase de B. Bourgeois selon laquelle « on change si peu… » et l’idée selon laquelle il n’y a point de caractère puisqu’on a trop de difficultés à se reconnaître soi-même dans cette espèce de permanence du caractère.
Si J. Lèbre traite de l’anthropologie dans son article en se plaçant au niveau de ce qui est proprement naturel pour l’âme, au niveau des sensations, des habitudes, du sentiment de soi, il ne s’agit que de ce qui, dans le système hégélien, constitue la genèse spéculative de la conscience. L’âme n’est pas encore dans l’opposition entre sujet et objet, elle n’est pas encore exigence de savoir. Dans la Philosophie de l’esprit, l’anthropologie laisse place à une phénoménologie de la conscience qui elle-même précède une psychologie de l’esprit. L’âme est encore l’esprit en tant qu’il est soumis à la nature, qui vit avec l’alternance des saisons, les moments de la journée, qui tente de rejoindre l’extériorité en s’appropriant son corps. Mais l’esprit n’y est encore qu’en sommeil. La section « psychologie » succède à la section « phénoménologie » et s’interroge sur la distinction usuelle entre esprit théorique et esprit pratique. La psychologie est une science philosophique de l’esprit. Si la pesanteur est bien l’essence de la matière, c’est la liberté qui qualifie l’essence de l’esprit. Or la liberté n’est pas simple indépendance, mais conquête de soi au sein même de l’altérité, ce n’est pas un état de fait, mais un processus incessamment renouvelé. De la même manière que l’âme ne se réalisait pas par le rejet du corps, mais par sa conquête, l’esprit conquiert sa liberté par la connaissance de lui-même et par un processus d’idéalisation du réel qu’il ramène au sein de la vie psychique. La raison correspond alors plus ou moins à l’esprit théorique et pratique dans la section psychologie, tandis que l’esprit se rapporte davantage à l’esprit objectif qui concerne le droit, la morale et l’éthique. Mais la raison, en un sens plus général, se trouve également à chaque moment du système hégélien, si tant est que tout ce qui est effectif est bien rationnel. L’esprit subjectif (anthropologie, phénoménologie, psychologie) laisse place à l’esprit objectif (droit, morale, éthique), qui lui-même trouve sa raison d’être dans l’esprit absolu (art, religion, philosophie).
c. L’esprit subjectif, objectif et absolu
Critiquer Hegel peut se faire de deux manières : soit on s’attaque à certains points précis (Hegel a-t-il véritablement saisi l’essence de la folie ?), soit on s’attaque au système lui-même. Or deux voies se présentent pour sortir d’un système : soit on part du système même et on montre qu’en réalité il n’est pas clos mais permet l’irruption de la nouveauté et d’une nouveauté radicale ; soit on s’y oppose frontalement, ce qui est beaucoup plus risqué et peut-être moins fécond, ne serait-ce que parce que le système (et en particulier celui de Hegel) prend soin de réfuter tout ce qui pourrait le mettre en péril.
L’article de Franck Fischbach, « L’œuvre de l’esprit », vise à confirmer une thèse développée par B. Bourgeois dans Hegel, les Actes de l’esprit : « sur la base de la critique kantienne des métaphysiques dogmatiques de l’être, la philosophie se déploie entre Kant et Marx sous la forme d’une philosophie de l’acte ou d’une ontologie de l’agir. » 68 Dans cette lignée, F. Fischback pose la question suivante : « le hégélianisme, en subordonnant l’esprit objectif, effectivement à l’œuvre dans l’histoire, à l’esprit absolu, a-t-il été tenté par une relativisation de l’agir, voire par une remise en cause du primat de la pratique ? » 69 Il s’agit donc bien de s’interroger sur les rapports entre esprit subjectif, esprit objectif et esprit absolu. Or F. Fischbach entend bien montrer que si l’essence de l’esprit est bien l’activité, si même l’esprit connaissant ne peut se reconnaître lui-même qu’en tant qu’agissant lorsqu’il connaît, il y a bien chez Hegel supériorité du pratique sur le théorique, de l’agir sur le savoir. Encore faut-il nuancer les choses.
La distinction entre théorique et pratique est d’abord une distinction d’entendement, et représente les deux moments indissociables d’une théorie de la liberté. D’un point de vue théorique, l’homme dépend des choses qui existent indépendamment de lui-même. C’est pourquoi dans le réalisme on croit que les choses se donnent à nous telles quelles sans que nous participions activement à la constitution de ces choses-mêmes. Ainsi je m’imagine, en tant que sujet connaissant, qu’il suffit de laisser la chose être, de rester passif pour y avoir accès. De la même manière, au niveau pratique, le sujet est libre et agissant parce qu’il peut user comme bon lui semble des objets. Or au niveau théorique, il y a bien activité de l’esprit parce que l’objet n’est pas donné, mais construit par le sujet ; au niveau pratique, le sujet n’est pas véritablement libre parce qu’il est limité par le réel qui, par définition, résiste, et par ses propres désirs. Il serait donc faux de penser que l’esprit théorique est purement passif, et l’esprit pratique purement actif. En vérité, l’esprit théorique agit au sens où il saisit ce qui, dans l’effectif, est rationnel, et l’esprit pratique agit dans le sens où il permet au rationnel de devenir effectif. L’esprit, conformément à l’idéalisme transcendantal kantien, constitue son objectivité. La raison permet la rencontre entre les pensées du sujet et l’essence même des choses. L’esprit n’a donc affaire qu’à lui-même lorsqu’il connaît et est donc libre tant qu’il reste présent à lui-même. « « Faire de soi son propre objet » est bien selon Hegel une caractéristique, la caractéristique majeure de l’esprit. L’essence de l’esprit devient ainsi relativement claire : cette essence n’est précisément pas une substance toute faite, mais au contraire une activité continuelle : « L’esprit est essentiellement le résultat de son activité ». De sorte que l’essence de l’esprit ne peut être un « être au repos ». » 70 Thèse essentielle qui semble contredire l’article de M.-D. Gouttière dans l’article « La nostalgie hégélienne », on y reviendra. Comme il est de l’essence de l’esprit d’être actif, il ne peut véritablement y avoir de dissociation entre esprit pratique et esprit théorique, et comme l’esprit est agissant dans l’esprit théorique, on peut dire qu’il y a un primat du pratique sur le théorique. Dans l’esprit théorique, la pensée saisit le réel en son essence, autrement dit elle saisit l’effectif. Elle ne s’attache pas à l’immédiat, à la sensation, mais à ce qui dans le réel est effectif. Mais il ne s’agit pour Hegel de verser ni dans le solipsisme ni dans l’immobilisme au niveau pratique. L’esprit pratique est ce qui permet à l’esprit, par une action, de concrétiser ce qui était resté seulement abstrait ou théorique. Une action est effectuée par un sujet singulier à un moment déterminé. Le problème réside dans le fait que l’esprit objectif (où les individus agissent concrètement et imposent leur volonté au monde) laisse place ensuite à l’esprit absolu. L’esprit objectif, qui vise à extérioriser son intériorité, est contradictoire dans le sens où l’esprit pratique veut à la fois réaliser un but sans qu’il soit véritablement réalisé parce que cela mènerait à sa propre mort. La volonté qui s’imposerait totalement disparaîtrait en tant que volonté. Il s’agit alors que l’esprit pratique redevienne ou se réconcilie avec l’esprit théorique. D’où un problème : n’y aura-t-il pas au final un primat du théorique sur le pratique ? On sait que le philosophe est censé saisir que « tout ce qui est rationnel est effectif » et inversement que « tout ce qui est effectif et rationnel ». L’effectivité permet de saisir que ce qui est est ce qui doit être. Mais alors, ne risque-t-on pas de tomber dans une sorte de « quiétisme contemplatif » 71 qui identifierait immédiatement ce qui est et ce qui doit être ? La conscience religieuse représente cette identification immédiate. Si, dans l’esprit absolu, la philosophie succède à la religion, c’est parce qu’elle saisit que cette identification n’est pas immédiate. Cela permet à F. Fischbach de montrer qu’il y a réconciliation du pratique et du théorique, puisque « si la conscience philosophique est bien une conscience théorique en tant qu’elle a conscience de ce qui doit être comme étant déjà, elle reste néanmoins en même temps une conscience pratique parce qu’elle pense le devoir-être comme à l’œuvre dans ce qui est. » 72 L’idée absolue réunit pratique et théorique parce qu’elle montre non pas que ce qui est, est immédiatement ce qui doit être, mais que dans le réel, l’idéel est déjà à l’œuvre et prend donc le nom d’effectif ou d’Idée. « Le savoir philosophique est précisément le savoir de ce que l’essence des choses n’est rien indépendamment de l’acte de la pensée qui la détermine et la pose comme telle. La pensée n’est donc pas la confrontation à une réalité qui lui préexiste ou qui existerait objectivement et en soi indépendamment de la pensée elle-même, mais la pensée est l’acte qui porte les choses à l’existence par le fait de les penser. La philosophie est et n’est que le savoir de cela. » 73 Ce qui est véritablement, c’est ce qui est capable de se penser soi-même. C’est pourquoi seul l’Etat importe véritablement pour un peuple, et non la société civile ou la famille : l’Etat se pense lui-même et sait ce qu’il veut.
Ne risque-t-on pas à nouveau de retomber dans le théorique au détriment du pratique ? La thèse de F. Fischbach est relativement paradoxale, mais il faut bien avouer qu’elle permet de penser la nouveauté et d’éviter à Hegel de devenir celui qui entérine purement et simplement ce qui est en disant qu’il est déjà ce qu’il doit être. « Chez Hegel, c’est la volonté qui est conservatrice et la pensée qui est révolutionnaire : l’activisme hégélien n’est pas un volontarisme, mais un activisme de la pensée et de l’intellect. Aussi étrange que cela puisse paraître, son activisme est un intellectualisme. » 74 La véritable action ne consiste pas à penser ce qui doit être pour le réaliser dans un second temps (autrement dit, il ne s’agit pas de retomber dans l’unilatéralité de l’esprit pratique). L’esprit doit, avant d’agir, penser ce qu’il a fait, donc ce qui est. C’est seulement en pensant ce qui est et ce qui a été que l’on peut véritablement s’en libérer. Ainsi, se libérer de ce qui est en le pensant, permet de laisser place au nouveau qui, lui, ne peut être anticipé par la pensée. L’esprit ne peut créer véritablement que s’il ne sait pas à l’avance ce qu’il va créer. Il ne s’agit donc pas de faire se rejoindre, de manière asymptotique, ce qui est et ce qui doit être, comme ce serait le cas par exemple dans les utopies politiques ou dans les messianismes quels qu’ils soient ; il ne s’agit pas non plus de dire purement et simplement que ce qui est est conforme à ce qui doit être, comme ce serait le cas dans le quiétisme religieux qui se borne à constater que le monde est bien conforme à ce qu’il doit être puisque c’est Dieu qui l’a créé. Il s’agit plutôt de montrer que la pensée de ce qui est nous en libère et permet au nouveau, c’est-à-dire à ce à quoi on n’a jamais pensé, de pouvoir émerger. C’est pourquoi l’essence de l’esprit est bien la liberté. Ce qui est intéressant, c’est que cette manière de penser l’activisme de Hegel comme un intellectualisme, permet à F. Fischbach d’articuler deux sens de la liberté : « d’une part la liberté comme être auprès de soi dans l’autre, et d’autre part la liberté en son sens kantien-fichtéen, comme capacité à commencer absolument et par soi-même. C’est en effet en pensant son monde et en étant chez soi ou auprès de soi en lui (par où l’esprit agissant objectivement éprouve la satisfaction) que l’esprit se découvre lui-même en sa capacité de commencer par lui-même un nouveau monde : penser ce qui est, c’est le penser comme passé, c’est s’en libérer et libérer en soi le pouvoir de faire du neuf. Au-delà de la satisfaction que l’esprit agissant objectivement trouve dans le monde existant, l’esprit absolu connaît à nouveau l’inquiétude : cette inquiétude, qui était celle de Hegel lui-même à la fin de sa vie, est d’abord celle de l’esprit, inquiété par la radicale nouveauté de ce qu’il se sait capable d’engendrer. » 75 C’est l’inquiétude, le fait de ne pouvoir être au repos, qui caractérise l’esprit. C’est donc bien l’activité, au final, qui prédomine. L’esprit ne cesse d’agir. Ainsi le système hégélien n’est pas une clôture de l’histoire, et laisse une place au surgissement de la nouveauté.
C’est pourquoi l’article de Marie-Dominique Goutierre, « la nostalgie hégélienne » reste finalement peu convaincant. L’intérêt de cet article réside dans son aspect ouvertement polémique et critique envers Hegel, ce qui est agréable pour deux raisons : d’abord parce que tout lecteur de Hegel éprouve des difficultés à sortir de cet impressionnant système, sauf s’il le rejette en bloc en refusant d’y entrer ; ensuite parce que la profession de foi que font parfois les commentateurs de Hegel envers cet auteur laisse un peu songeur et anesthésie la réflexion. Un article critique donc, qui permet d’éviter la fascination propre à tout système. Mais la thèse de l’auteur reste peu convaincante ne serait-ce que parce que se placer du point de vue du réalisme ne réfute pas Hegel, et parce qu’on y oublie que l’esprit, même absolu, est avant tout un acte et non une substance. Selon M.-D. Goutierre, Hegel aurait été envahi par la « nostalgie », douleur du retour et affect propre à Ulysse exilé de sa patrie. Hegel éprouverait la nostalgie aristotélicienne de l’identité entre l’être et la pensée et la nostalgie cartésienne d’une certitude subjective absolue, tout en donnant une place prépondérante à l’esprit et à Dieu. Deux nostalgies donc : 1) il s’agit d’abord de saisir la philosophie hégélienne à travers son interprétation d’Aristote. Dieu et l’esprit ont un rôle déterminant dans la philosophie aristotélicienne : Dieu se confond avec l’Acte pur, est « pensée de la pensée » (noêsis noêseôs), il ne fait que se connaître lui-même, alors que l’homme, dans sa finitude, ne peut connaître qu’en se confrontant à la réalité extérieure, à ce qui « est » et n’est pas lui. Ce qui est vrai, c’est donc pour l’homme l’adéquation entre ce qui est pensé et ce qui est. Mais « en Dieu, l’être et l’esprit, l’être et la vie ne font qu’un. » 76 C’est d’ailleurs une mauvaise manière de parler puisque il n’y a pas en Dieu de distinction entre l’intelligence et l’être, c’est seulement lorsque l’homme en parle qu’il fait la distinction tout en l’abolissant. Mais « notre intelligence ne possède donc pas la vérité car elle n’est pas à elle-même, dans l’immanence de son opération, sa propre source de connaissance et de sagesse. » 77 Dieu saisit éternellement la vérité dans un acte pur, tandis que l’homme ne la saisit que par bribes ou par moments. Or, selon M.-D. Goutierre, Hegel aurait dit de l’homme ce qu’Aristote disait de Dieu : « la réalité, l’être, et la vie de l’esprit ne font qu’un, sont identiques. C’est bien le sens de l’interprétation hégélienne d’Aristote. Ce qu’Aristote dit de Dieu, Hegel le dit de la pensée philosophique se saisissant elle-même comme esprit absolu. […] La vie de notre esprit n’est pas distincte de celle de Dieu. Bien davantage, elle est un moment de celle de Dieu se développant elle-même dans l’esprit humain. » 78 De Dieu à l’homme, il n’y a donc pas rupture, mais continuité, et non une connaissance analogique comme c’était le cas chez Aristote. La philosophie n’est plus alors amour du savoir, mais savoir effectif. L’esprit absolu permet l’unification du réel et du rationnel, et la religion n’en est que la forme représentative puisque le Christ lui-même, comme incarnation de Dieu, permet l’unification du singulier et de l’universel. D’où la question de M.-D. Goutierre : « La philosophie hégélienne exprime-t-elle ainsi vraiment le mystère chrétien ? Peut-elle être une véritable sagesse théologique ? » 2) M.-D. Goutierre insiste alors sur le lien entre Hegel et Descartes puisque la question moderne est la suivante : « comment puis-je être certain que ma pensée est identique à la réalité ? » L’hégélianisme est pris entre la vérité au sens antique, au sens où elle cherche l’adéquation au réel, accessible par l’intelligence, et la certitude de la théologie médiévale donnée par la foi. La vérité, pour le croyant, est accessible par la révélation : la certitude est alors provoquée par l’amour et la foi en Dieu. Mais, avec la modernité cartésienne, la certitude provient du sujet lui-même. Or « Descartes, qui ne veut pas être théologien mais philosophe, tout en écartant la vérité objective divine de la foi, garde en quelque sorte l’attitude subjective d’un croyant : la certitude divine de la foi, qui implique une vérité, se dégrade dans la certitude subjective du cogito, dans la sincérité de la conscience de soi. » « La philosophie cartésienne » devient alors une « théologie chrétienne « laïcisée » ». 79 D’où la question : d’où vient la certitude qui m’assure que ma pensée rejoint le réel ? Hegel permet de répondre à cette question dans la mesure où la subjectivité devient absolue, mais alors il faut identifier l’homme à Dieu. Ainsi « mon « je pense » est en définitive un avec le « Je pense » du Christ. » 80
M.-D. Goutierre critique alors l’idéalisme absolu en adoptant une position résolument réaliste, puisque la philosophie hégélienne serait victime d’un oubli : celui du « réalisme de l’intelligence humaine et de toute la philosophie à savoir le jugement d’existence » 81 Le premier jugement est « ceci est », ce qui, soit dit en passant, correspond exactement au début de la Phénoménologie de l’esprit. Or Hegel aurait substantialiser l’intelligence, alors qu’elle reste fondamentalement tributaire de ce qui est. M-D. Goutierre semble critiquer Hegel à la fois en faisant référence au réalisme et à la philosophie transcendantale kantienne qui interdit toute connaissance intellectuelle détachée de l’intuition et à l’intentionnalité phénoménologique. « Il est (…) nécessaire de rappeler, en face de la philosophie hégélienne, que ce que nous connaissons de la réalité dans l’appréhension intellectuelle, nous le connaissons selon un mode intentionnel. Certes, nous sommes capables de connaître toutes choses mais au-dedans de notre intelligence, grâce à l’abstraction ; nous connaissons toutes les réalités intentionnellement, c’est-à-dire d’une façon qui n’est plus le réel dans ce qu’il a de substantiel. Le vécu intellectuel est intentionnel, il est relatif à nous. Et nous ne pouvons pas, à travers le vécu, rejoindre la réalité telle qu’elle est. Le jugement « ceci est » est nécessaire pour l’atteindre en tant qu’elle est. » 82 En ceci l’intelligence humaine implique d’une part une appréhension de la réalité, puis un jugement. Or, de cette manière, on ne peut pas identifier l’être et la pensée. On ne rejoint pas l’individuel (c’est d’ailleurs interdit par la conception aristotélicienne de la science), on ne pense que par abstraction, par détermination de ce qui est commun aux différents individus appréhendés. L’erreur hégélienne résiderait alors dans cette nostalgie, on pourrait même dire dans ce désir, d’identifier la pensée et l’être. Ce que critique donc M.-D. Goutierre, c’est l’identification de la pensée au réel. Or Hegel n’identifie pas le rationnel au réel, mais à l’effectif, c’est-à-dire à ce qui, dans le réel est rationnel. On pourrait alors penser qu’il s’agit d’une simplement tautologie que de dire que tout ce qui est rationnel est effectif ou que tout ce qui est effectif est rationnel, si l’on mettait de côté le fait que l’adéquation entre le rationnel et l’effectif est un procès et non un donné immédiat. C’est bien parce qu’Hegel n’a pas substantialisé l’intelligence, mais a fait d’elle un acte qu’on ne peut dire simplement que la pensée s’identifie telle quelle à l’être. L’être lui-même est bien ce qui est visé, Hegel ne nie pas le réel pour se réfugier dans une sorte de solipsisme, il ne nie pas non plus la contingence du réel. Etre idéaliste consiste bien à penser que le réel est structuré par des formes intelligibles. Connaître le réel implique bien de supposer qu’il y a entre lui et la pensée une structure identique. La pensée ne s’identifie pas au réel, mais identifie dans le réel ce qui est à elle, à savoir ce qui est rationnel.
Mais au fond la critique est moins d’ordre philosophique que théologique : ce que M.-D. Goutierre semble regretter, c’est que la foi ne soit utilisée chez Hegel que comme étape dans le développement de la raison afin de posséder la vérité. « La théologie hégélienne nous invite à redécouvrir et à approfondir la distinction de la sagesse philosophique et de ce que le chrétien peut vivre et affirmer comme théologien à partir de la foi. La foi chrétienne ne peut être le point de départ d’une pensée philosophique qui serait la philosophie définitive, absolue, l’expression adéquate de la vérité absolue. » M.-D. Goutierre voit l’hérétique en Hegel, le philosophe qui aurait détourné le mystère christique et ouvert la possibilité d’une conception athée de la philosophie : « l’homme qui cherche à connaître et à aimer Dieu ne peut rien en posséder. Il ne peut dire que sa vie lui permet de rejoindre et de posséder Dieu en lui. Il vit par moments de sa lumière mais sans la posséder. » 83 On peut tout de même se demander qui est le plus nostalgique d’Aristote entre M.-D. Goutierre et Hegel : « La créature ne peut rejoindre Dieu que dans une connaissance analogique, elle ne possède pas sa contemplation. Ce qui distingue cette position réaliste de celle de Hegel, c’est donc la pauvreté : la démarche analogique maintient constamment la pauvreté de l’intelligence, grâce au jugement d’existence. » Parce que si quelque chose est bien reproché à Hegel, c’est de manquer d’humilité, qualité (ô combien !) chrétienne ; ce qui lui est reproché, c’est de faire de la philosophie une science, de ne pas accepter la « pauvreté » de l’homme, de ne pas accepter que la vérité ne peut être atteinte que dans la « mendicité ». En quelque sorte, ça n’est pas faux : l’idée de faire de la philosophie une véritable sagesse, voire une science, est une prétention qui n’est peut-être pas souhaitable et fausse. Le propos semble davantage se laïciser à la fin de l’article : « C’est pourtant ce qui est le plus grand dans l’homme : non pas « la foi en la puissance de l’esprit », non pas « la confiance en soi de l’homme pensant », mais la quête incessante de la vérité, sans la posséder mais en la découvrant toujours plus profondément et d’une façon ultime dans la sagesse : tout l’effort de la recherche philosophique de la vérité est ordonné à cela. » 84 M.-D. Goutierre retrouve certes les valeurs de la foi chrétienne, mais également la conception platonicienne de la philosophie, à savoir le désir ou l’amour de la sagesse qui est à la fois tension et état de pauvreté extrême : le désir, fils de Pénia et de Poros, de la pauvreté et de l’expédient, permet de tendre vers la sagesse, sans jamais l’atteindre. Mais le propos reste profondément chrétien : il ne faut pas confondre l’intelligence divine et l’intelligence humaine : or « le rationnel n’est pas le divin, il est le mode propre d’une intelligence humaine. » 85 Il s’agit donc, selon M.-D. Goutierre, d’extraire la foi du concept et de critiquer l’identification de l’être à la vie de l’esprit. Mais il semble qu’on ne quitte une nostalgie que pour une autre : celle de l’identité entre l’esprit et l’être pour celle de la séparation qui ne sera jamais comblée entre l’esprit et l’être.
Conclusion
Bien d’autres aspects de la raison sont abordés dans la quinzaine d’articles réunis ici. Ainsi, un article d’Inacio Helfer 86 aborde la question de la philosophie de l’histoire chez Herder. Revenir à Herder permet ainsi de montrer comment la rationalité va s’appliquer à l’histoire à l’époque moderne, ce qui provoquera les foudres de Kant et de Hegel tout en leur permettant de constituer leur propre philosophie de l’histoire. L’article de Luc Vicenti 87 dépasse la distinction kantienne entre raison pratique et raison théorique pour penser une raison unifiée, une raison définie comme « effort du Moi », ce qui donne l’occasion d’une réflexion sur le Je pense fichtéen. La conscience de soi transcende la distinction entre théorique et pratique, éloigne Fichte de Kant et le rapproche de Hegel. Mais en tant que philosophie de la subjectivité, en tant que le Moi n’atteint jamais l’absolu, mais reste fondamentalement fini, Fichte se démarque de Hegel tout en faisant signe vers la philosophie de l’absolu. Particulièrement intéressant est l’article d’Isabelle Thomas-Fogiel qui montre le point d’implosion du système kantien en s’interrogeant sur le terme « intellectuel » dans le domaine des mathématiques 88. L’article d’Emmanuel Cattin, « Le système de la manifestation », s’interroge sur la manière dont Hegel conçoit l’histoire de la philosophie, sur l’insertion des philosophies dans le temps et sur la prise en compte de l’histoire par l’esprit absolu.
Deux articles enfin sont particulièrement exaltants et méritent d’être lus directement. Les reprendre aurait été inutile : Binswanger d’une part n’est pas suffisamment connu des philosophes et mérite des développements ; une argumentation purement logique d’autre part ne peut être réduite, sauf à opérer des sauts qui détruiraient tout le plaisir qu’il y a à voir la raison en action, passant patiemment d’une proposition à l’autre. 1) Pascal Dupond, dans « Imaginaire et généalogie de la raison : Le Rêve et l’existence. Ludwig Binswanger », pose la question de l’interprétation et de son lien avec la raison. Il aborde le terrain de l’analyse existentielle initiée par L. Binswanger et montre comment le symbole, point d’intersection du pulsionnel et du culturel, renvoie à une énergétique et à une topique dans la lignée de Freud, ainsi qu’à une « topologie de l’existence ». 89 Ainsi « l’interprétation serait un acte de la raison, mais d’une raison en genèse ». 90 Il commente ainsi avec précision deux textes de Binswanger : « Le Rêve et l’existence », qui a été publié dans l’Introduction à l’analyse existentielle, et Le problème de l’espace en psychopathologie. L’espace thymique, distinct de « l’espace du monde naturel », géométrique et physique, caractérise davantage le monde nocturne que le monde diurne. Il est structuré par certaines oppositions, le proche et le lointain, l’ascension et la chute, autrement dit par un axe vertical et un axe horizontal. Il s’agit ainsi de se demander comment on peut interpréter un rêve à partir de l’espace et comment cela témoigne de la manière dont un individu est-au-monde, Binswanger réinterprétant la psychanalyse à partir de concepts hégéliens, heideggeriens et husserliens. Ainsi, « l’essence de toute psychothérapie est de permettre à un humain de s’éveiller de son rêve, de passer de l’idios kosmos du rêve au koinos kosmos de l’esprit et de l’universel. » Sont alors permises à la fois la « formation de soi » et la culture 91. La raison devient alors herméneutique ou interprétante parce qu’elle « renonce à chercher dans le passé la vérité de l’avenir ou dans l’avenir la vérité du passé. Seule l’invention du sens peut délivrer de l’origine. » 92 Ainsi, lorsque la raison interprète, elle ne vise pas à se perdre dans une origine fantasmatique à laquelle on ne parviendra jamais à remonter, mais tente simplement d’exprimer ce qui est. 2) Quentin Meillassoux enfin, dans « Spéculation et contingence », expose les idées principales de sa thèse dirigée par Bernard Bourgeois. L’originalité de cet article provient d’abord de la sortie de l’histoire de la philosophie qu’opère Q. Meillassoux puisque si certains auteurs affleurent bien sous le propos, l’argumentation se veut purement logique. Citons simplement la note du bas de la page 341 : « Cet article a pour origine une conférence prononcée au mois de février 2001, dans le cadre du séminaire organisé par Francis Wolff (Paris X), intitulé « Position et arguments ». J’y expose les propositions principales du doctorat que j’ai soutenu sous la direction de Bernard Bourgeois en 1997 (L’inexistence divine – à paraître). La « règle du jeu » de ce séminaire, consistait à exposer des thèses propres, et à les soutenir par une argumentation aussi « nue » que possible, c’est-à-dire ne se revendiquant pas d’un courant philosophique institué pour faire valoir la légitimité des positions avancées. J’ai tenté, dans cet article, de m’en tenir strictement à une telle exigence – d’où la relative rareté des références. » Cet article est donc très stimulant intellectuellement : Q. Meillassoux y constitue des personnages philosophiques solides (l’homme de foi, le métaphysicien et le philosophe spéculatif), pose à côté du principe de non-contradiction aristotélicien et du cogito cartésien un « principe de factualité » non démontrable mais qui peut être argumenté. Tous les termes sont définis avec précision et on découvre comment spéculer sans faire de la métaphysique, comment spéculer de manière irréligieuse, comment penser la nécessité et la contingence. Un jeu, mais un jeu sérieux, de construction logique.
Pour conclure, la raison est bien la faculté la plus élevée en l’homme. Par-delà l’éclatement que produit sur elle la diversité des objets auxquels elle s’applique, elle comporte une unité fondamentale : celle d’être un acte ou un effort incessant. Elle ne peut donc être considérée comme purement et définitivement constituée : en tant qu’acte, elle ne cesse d’advenir et de répéter sa propre genèse ; en tant qu’elle parvient à des résultats probants, elle ne cesse de repousser ses propres limites, ou plutôt, comme le dit B. Barthelmé, de « penser à la limite du savoir ».
- Autour de Hegel, hommage à Bernard Bourgeois, éd. F. Dagognet et P. Osmo, Paris, Vrin, 2000
- cf. Platon, Phèdre, 276e-277a
- cf. Dits et écrits, vol. I, « Introduction, in Binswanger, Le rêve et l’existence », p. 93-147]. Certains sont moins originaux, le lecteur des œuvres de B. Bourgeois n’y trouvera pas une véritable nouveauté, mais une répétition, certes parfois brillante, des thèses de ce dernier 3cf. par exemple l’article de Charles-Eric de Saint-Germain, « Hegel et la naissance de l’individualisme », qui se fonde sur et cite abondamment les écrits de B. Bourgeois sur la politique hégélienne
- cf. c’est le cas par exemple de l’article de M.-D. Gouttière intitulé « la nostalgie hégélienne » qui tente une critique réaliste de l’idéalisme absolu hégélien.
- « Avons-nous changé ? Ethique et anthropologie chez Hegel et Schopenhauer », L’héritage de la raison, Hommage à Bernard Bourgeois, coordination Emmanuel Cattin, Franck Fischbach, Ellipses, Paris, p. 291
- Voir, entre autres, ces ouvrages majeurs : La pensée politique de Hegel ; Hegel à Francfort, Le droit naturel de Hegel ; Eternité et historicité de l’Esprit selon Hegel ; Etudes hégéliennes, Raison et décision ; Hegel ; Le vocabulaire de Hegel ; Hegel, Les Actes de l’Esprit, sans compter les présentations et les traductions des trois tomes de l’Encyclopédie des sciences philosophiques
- « Montesquieu conseiller du prince. Une tentation contrariée », in L’héritage de la raison
- Ibid., p. 21.
- Ibid., p. 26
- Ibid., p. 28.
- Ibid., p. 32.
- Ibid., p. 34.
- Ibid., p. 42.
- Ibid., p. 43.
- Ibid., p. 47.
- Ibid., p. 50.
- Ibid., p. 55.
- Il s’agit en particulier de La Pensée politique de Hegel, Paris, PUF, 1969 et de ses Etudes hégéliennes
- Ibid., p. 168.
- Ibid., p. 173.
- Ibid., p. 194.
- Ibid., p. 196.
- Ibid., p. 199.
- Ibid., p. 204.
- Ibid., p. 205.
- C’est le cas en particulier de l’article d’Isabelle Thomas-Fogiel, « Kant et le problème des propriétés de l’arithmétique », qui montre de manière précise et convaincante que le terme « intellectuel » provoque une véritable faillite du système kantien.
- Ibid., p. 62.
- Ibid., p. 63.
- Ibid., p. 64.
- Ibid., p. 65.
- Ibid., p. 67.
- Ibid., p. 69.
- Ibid., p. 71.
- Idem.
- Idem
- Ibid., p. 78.
- Ibid., p. 80.
- Ibid., p. 106-107.
- Idem
- Ibid., p. 109.
- Ibid., p. 112.
- Ibid., p. 114.
- Idem.
- Ibid., p. 117.
- Idem.
- Ibid., p. 119.
- Ibid., p. 121.
- Ibid., p. 122.
- Idem.
- Ibid., p. 123.
- Idem.
- Ibid., p. 127.
- Ibid., p. 128.
- Idem.
- Idem.
- Ibid., p. 286.
- Ibid., p. 286-287. J. Lèbre cite un article de B. Bourgeois : « Anthropologie kantienne et anthropologie hégélienne », in L’Année 1798 – Kant et la naissance de l’anthropologie au siècle des Lumières, dir. par J. Ferrari, Vrin, Paris, 1997, p. 147.
- Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, § 408, remarque.
- L’héritage de la raison, p. 290-291.
- Ibid., p. 291.
- Idem.
- Ibid., p. 295.
- Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, Supplément au livre III, chap. XXXII.
- L’héritage de la raison, p. 297.
- Idem.
- Ibid., p. 297-298
- Ibid., p. 231
- Ibid., p. 232.
- Ibid., p. 238
- Ibid., p. 247.
- Ibid., p. 247-248.
- Ibid., p. 251.
- Ibid., p. 253.
- Ibid., p. 256.
- Ibid., p. 215.
- Ibid., p. 217.
- Ibid., p. 218.
- Ibid., p. 224.
- Ibid., p. 225.
- Idem.
- Ibid., p. 227.
- Ibid., p. 229.
- Ibid., p. 229-230.
- Idem.
- Ibid., « La fin de l’humanité (Humanität) selon Herder ».
- Ibid., « Raison pratique, raison dialectique »
- Ibid., « Kant et le problème des propriétés de l’arithmétique ».
- Ibid., p. 300.
- Ibid., p. 301
- Ibid., p. 311.
- Ibid., p. 314.








