Emmanuel Faye vient de livrer au public une somme détaillée sur la question du sol : Heidegger, le sol, la communauté, la race1. Y participent des auteurs dont les intentions, sans être exactement les mêmes, se recoupent autour de Heidegger et son rapport au nazisme. Dans chaque texte se voit engagée une forte mise en perspective de la pensée de Heidegger et de son rapport, difficile à établir, concernant la philosophie politique. Qu’il y ait sinon un engagement du moins une « pensée » politique de Heidegger, une thèse de ce genre n’est pas du tout une évidence comme ce fut le cas pour Machiavel, Hobbes ou encore Rousseau. Le silence politique de Heidegger nourrit un certain nombre d’interrogations : que recouvre un tel silence à une époque qui marque la promotion d’une politique de l’horreur et dans un temps qui a vu beaucoup d’intellectuels allemands migrer vers d’autres terres? Heidegger, non content d’un tel silence, prend une carte au parti National Socialiste, accepte incontestablement une fonction institutionnelle de recteur de l’Université… Mais dans son œuvre, le plan politique disparaît pratiquement dans l’inessentiel de la sphère mondaine. Sauf que les camps d’extermination -comme le reconnaît la critique stimulante, déjà plus ancienne, de Max Dorra contre Heidegger- ces camps n’ont rien de très mondains 2… De quoi relativiser sans doute le triomphalisme de Faye selon lequel c’est seulement maintenant que « la critique de Heidegger commence à se frayer un chemin en France » 3. Cela avait de mon point de vue commencé dès le séminaire que Derrida a donné sur Heidegger concernant « La question de l’Etre et de l’Histoire » 4 avec un accueil fortement réservé de la part de ses contemporains…
Biaiser Heidegger
L’approche politique des textes de Heidegger affronte, d’une manière tout de même paradoxale, un « non-dit » dont l’aménagement n’est pas perceptible au premier regard. Ce « non-dit » transpire à partir de quelques énoncés lacunaires qui constitueraient comme un véritable système souterrain, une forme autre et essentielle de son engagement politique. Mais ces silences de Heidegger recouvrent en même temps la difficulté d’en parler de manière directe, sans détour, pour relancer finalement une inflation des moyens rhétoriques. Le lecteur serait donc amené à pratiquer des associations qui ne se donnent pas comme telles. Mais comment rendre compte d’une reconstruction de ce genre ? Il n’est pas certain qu’il y ait, comme le prétend par exemple Rastier, quelque chose de similaire à une « purification » chez Heidegger dans sa manière de répéter le mot « pur ». En reprenant l’exemple qu’interroge cette étude, on peut parler en effet de « l’essence encore non purifiée », expression récurrente et qui revient de façon certes insistante chez Heidegger mais sans que cette expression puisse étonner le moins du monde un lecteur de Kant, de sa Critique de la raison ‘pure’, texte qui fait circuler ce concept à chaque page de son exposition. Difficile du même coup de percevoir sous ce régime de la pureté « un radicalisme politique » 5 sans une élaboration forcément artificielle et des rapprochements conceptuels parfois lointains. Chaque étude vaut donc ici nécessairement comme une entrée oblique dans le corpus de Heidegger. Avec le défaut peut-être de partager le caractère énigmatique, l’absence d’originalité, « le niveau de généralité » qui lui sont encore reprochés 6.
On peut à bon droit se moquer des traductions et des expressions lyriques qu’on trouve sous la plume de certains traducteurs emblématiques. Et Faye en effet nous amuse en dénonçant un nouveau Molière dans la façon de rendre « das Wesen des Seyns » par « l’aîtrée de l’estre » 7. Mais cette bonne plaisanterie n’est sans doute pas exportable à la vigilance d’un Derrida, bien plus Cornélien en son genre. Et pour ce qui concerne les textes ainsi rassemblés, on remarquera tout de même que si Heidegger n’affiche pas de philosophie politique clairement localisée, la manière d’en parler adoptée par toutes ces études passera nécessairement par des périphrases et des constructions aussi énigmatiques que les formulations de l’auteur en question. L’intérêt des « enquêtes » proposées au lecteur consiste ainsi à essayer de poser les conditions d’émergence de concepts apparemment anodins dans la philosophie de Heidegger – et qui seraient, de fait, contaminés par l’antisémitisme lorsqu’on en suit la trame avec une plus grande précision, moyennant des détours sinueux. Toute la question sera de voir ce qu’il en est de ces détours, eux-mêmes étymologiques, de dégager un peu selon quelle méthode ils se recoupent et si cette méthode n’est pas elle-même une construction, un procédé déjà heideggérien dans sa manière de tordre la langue… Comment en effet rendre évidents des concepts si peu visibles et aussi obscurs pour autant que Heidegger se voit dénoncé effectivement comme le roi de l’obscurité ? Et ces concepts si fluctuants apparaissent-ils sous une autre lumière que celle de la tradition qui l’inspire ? Quel domaine de pertinence peut-on leur accorder relativement au champ politique qu’ils sont supposés révéler en réorganisant l’espace dont ils constituent le découpage ? Le sol, la communauté, la race, entrent-t-ils dans la configuration d’un geste philosophique qui décide d’une politique sous-jacente à l’économie du troisième Reich ? Et, sous des mots choisis avec précision, s’agit-il d’une innovation sémantique dans l’œuvre de Heidegger ou ces concepts sont-ils déjà l’objet d’un héritage, voire d’un usage populaire ? Y a-t-il finalement une rupture spécifiquement heideggérienne sur ce point ou une continuité, voire une communauté d’intérêt avec d’autres philosophèmes de la même époque ?
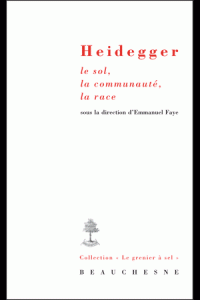
Il me semble qu’évacuer de telles questions de manière trop rapide, comme si l’idée de sol ou de race n’existaient pas au préalable dans l’encyclopédie des sciences philosophiques, cela conduirait vers d’autres mythes, une autre « mythologie » (pour reprendre la formule de Rastier) que celle qui se trouve ici dénoncée : une forme d’investigation sans doute moins comique que Molière mais qui n’en sera pas moins imaginaire. Autant de pièges dont l’historien se doit de prendre la mesure pour s’en prémunir. Affirmer que Heidegger ontologise des vocables d’abord communs issus de la rue, c’est tout de même ignorer que l’idée de sol était déjà fortement ontologisée dans d’autres discours préalables et notamment dans l’opuscule de Kant sur « La différence des races humaines », différence à laquelle le sol sert de principe distinctif, un principe avec lequel Heidegger ne cesse d’entrer en conflits pour des raisons qui tiennent à sa philosophie. Et certes, l’ouvrage dirigé par Faye montre assez bien que l’avènement du nazisme ne constitue nullement un point de rupture dans l’histoire allemande, mais tout au contraire un point culminant de cette histoire. Il y a incontestablement une continuité dans l’usage des concepts ici interrogés dont le nazisme marque en effet la promotion proprement politique, attendant de Heidegger sa légitimité philosophique (ce qui serait tout de même un peu trop concéder au pouvoir de l’époque qui n’avait nullement besoin de légitimation par le livre, brûlé sur place publique). Que cette affinité s’exprime dans la philosophie de Heidegger durant la période du rectorat et des carnets qui viennent de donner lieu à un travail éditorial, cela personne n’en conteste les faits. Reste à interpréter… et curieusement ce reste, pris en charge par les études rassemblées dans ce recueil, même en dénonçant le sectarisme des traducteurs français contemporains, donne le sentiment de parler la même langue que celle de Heidegger et de l’herméneutique générale qui en marque la généalogie. Ce qui me paraît tout de même engager un curieux retournement.
La couverture du nom Etre
Sans doute, comme le soutient Faye, Heidegger fait revenir avec insistance la question du sol, et ce dernier serait comme le terreau d’un enracinement pour la culture. Il est patent en effet que Heidegger regrette l’insuffisance d’une interrogation du sol dans la pensée moderne 8. Mais pour quelle raison cette invocation du sol ? La réponse, au demeurant, n’est pas donnée dans la question à elle seule. Pour Faye, Heidegger déplore en premier lieu l’absence du sol, une défiance regrettée par le philosophe en ce qu’elle laisse errer la pensée prise dans le manque d’enracinement qui définit la métaphysique cartésienne et le figure du nihilisme. Il semblerait alors que Heidegger appelle de tous ses vœux « un enracinement qui pourrait faire entrer la philosophie dans l’historicité de l’homme moderne ». Et comment cet enracinement pourrait-il se produire sans une préoccupation tournée vers l’être, concept dominant toute la pensée de Heidegger ? Le scoop de l’ouvrage de Faye sera finalement de découvrir que l’être n’est qu’une couverture 9, un nom d’emprunt, un prête-nom, un « Deckname » de sorte que le « Vaterland », le pays paternel y apparaît comme l’être même 10. Le glissement est ici incontestable, ripage à vrai dire inquiétant. Un dérapage qui est redevable in fine du procès de la métaphore, de son transport effacé dont Derrida a dit tant de choses dans La mythologie blanche 11. Ce nom d’emprunt, ce mot couvert, fait curieusement écran, couverture capable de dissimuler d’autres transports. L’ensemble des textes du collectif de Faye cherche à désobstruer ce cache (mais n’est-ce pas là tout de même un dévoilement encore Heideggérien censé le dénoncer par ailleurs ?). Il y aurait dans un transport si incongru la naissance d’un système occulte, placé sous « voile » et qui induirait un « retrait » de manière qui n’est pas si claire – comme nous le savons pour les actes manqués depuis Freud –, au point que cette lettre à Kurt Bauch en laquelle apparaît ce « mot écran », mériterait à elle seule une approche clinique ou pour le moins une psychanalyse raisonnée qui manque ici -et sans doute manque tout autant ce que le nom est véritablement en demeure d’occulter : le jeu fléché selon un type d’exercice auquel s’était livré la déconstruction derridéenne par une véritable analyse de l’œuvre de Heidegger qu’on ne saurait répéter indûment en singeant « Scribble » de Derrida…
Une telle méthode d’analyse, en laquelle revient l’idée de dévoilement passée inaperçue, aurait un intérêt évident dans la perspective d’une explication avec Heidegger. Mais un pistage de ce genre devient problématique lorsqu’il cherche à construire artificiellement un glossaire de noms qui seraient chargés d’antisémitisme, cryptés dans l’usage qu’en pratique Heidegger (ce que les nazis qui ne lisent pas de philosophie ne sauraient d’ailleurs décrypter rendant l’opération heideggérienne plutôt stérile, ce dont témoignerait par ailleurs la démission de Heidegger concernant son rectorat). Au-delà de ce pistage un peu désuet, il y a plus délicat encore : je ne vois pas comment faire subir le même traitement au concept d’ « enjuivement » qu’à celui de « modernité », de « dissimulation », d’ « Existence », de « subjectivité », d’ « occidentalité »… comme c’est le cas des textes rassemblés par Faye. Le projet un peu fou de numériser, comme le suggère Rastier, les concepts de Hitler et ceux de Heidegger avec « les objectifs de caractériser la création et la diffusion de ce qu’on appelle depuis Klemperer la LTI » [4], un tel projet de pistage peut conduire à des absurdités dont ce livre n’est pas exempt en réalisant des associations mécaniques, donnant au règne de la technique le sens cynique du contrôle, contrôle qui déjoue toute intelligence quant à la compréhension des concepts. Certains concepts retenus ne sont pas strictement une création de Heidegger, ni redevables à l’époque concernée. Une mise en algorithme du texte serait une police de la langue plus suspecte que celle qu’on veut bien dénoncer et qui ne touchera jamais à la hauteur des analyses critiques de Derrida.
La numérisation des occurrences textuelles entre Heidegger et Hitler remplacerait difficilement la pensée en tant que méthode spécifique ; et sous ce trait un peu limite, il faudrait tout de même se soustraire aux feuilletons télévisés qui montent en épingle les procédés d’investigation criminologique. Là où tout le monde est coupable, il y a de forte chance que la règle ne soit pas la bonne et l’idée pourrait venir à certains d’analyser le vocabulaire de Wittgenstein, qui était dans la même classe que Hitler, leur cherchant des vocables communs… A moins d’une maîtrise de l’outillage que ce livre ne montre guère en amalgamant des notions qui n’ont rien à voir, fussent-elles à double ou à triple sens… Tout le monde peut imaginer qu’à partir d’un quadruple sens tout se rejoint et les critères d’intelligibilité s’effondrent dans les soubresauts de la machine ou les bêtises d’un algorithme. Personne de sensé ne saurait souhaiter un tel traitement pour la philosophie, ni même une telle façon appliquée à notre historique individuel qui mérite autre chose qu’une méthode policière, autre chose que la LTI appliquée à Heidegger même quand il est question d’un concept aussi ambigu que celui de l’ « être esclave », esclave étant un vocable qui se retrouve chez Aristote autant que Sénèque… On aura donc du mal à souscrire à la thèse évoquée dans un flou artistique tout à fait alarmant relativement à quelque chose qui ressemblerait presque chez Heidegger vis-à-vis de ses lecteurs à « la séduction du bourreau » [5], au syndrome de Stockholm qui est non seulement un cliché à la mode mais une contre-vérité sur la personnalité de l’auteur dont il est facile de concevoir qu’il n’est pas encore un bourreau, à moins d’un usage métaphorique du mot tant dénoncé lorsque c’est Heidegger qui poétise…
Certes, la lettre évoquée de Heidegger est d’un intérêt sidérant. Il n’est pas question de faire de cette lettre un épisode inessentiel ou de considérer qu’il y aurait des moments d’errances dans la pensée de Heidegger comme Rastier le conteste à juste titre. Mais encore faut-il s’entendre sur la nature de ce « mot couvert », de cette couverture et montrer comment elle tisse une courtepointe, un réseau avec le reste de l’œuvre. La moindre enquête sérieuse consisterait à interroger la nature des liens qui rattachent ce mot à l’ensemble. La linguistique, la philologie, l’informatique, la technique ne sauraient ici prendre le relai de la philosophie pour cerner le mode de croisement qui s’y opère. Même à admettre qu’il s’agit d’un lapsus (ce qu’il n’est pas en effet), nous savons cependant que l’acte manqué a déjà une valeur dans la configuration d’une pensée et tient sans doute à son architectonique essentielle. Ce « nom couvert » de l’Etre que serait le sol des pères ne plaide-t-il pas contre la pensée de Heidegger contaminée par le nazisme qu’il annonce dans le cryptage de sa propre pensée ? Et pourrait-on en dernier recours se contenter d’affirmer qu’aucune philosophie n’est responsable du nazisme comme cela semble ressortir de l’égarement des lecteurs et traducteurs de Heidegger en France ? Sur tous ces points, le livre de Faye est parfois éclairant. Dire que Heidegger s’exempte du nazisme, ce serait évidemment une bien faible intention de lecture et d’une naïveté sans égal que le collectif de Faye dénonce avec raison. En revanche, considérer que Heidegger est le premier philosophe à penser le sol dans sa substance raciale et que, avant lui, seuls des idéologues sans importance avaient tenu de tels propos est une autre naïveté en laquelle s’engouffre l’étude dirigée par Faye, ignorante des textes de la philosophie. Ce n’est pas Heidegger le premier philosophe qui donnera au sol une importance qu’il n’aurait pas eue dans les pensées antérieures, et ce n’est pas par Heidegger que passe la coupure dans la continuité populaire de certains mythèmes hissés ici assez magiquement à la dignité du concept philosophique.
Des trous de taupes
Il est avéré en effet que ce n’est pas à Heidegger que revient l’horreur du sol en tant que principe de sélection. Comme je le montre dans mon livre sur La philosophie de Gilles Deleuze 12, c’est bien Kant qui, déjà dans la Critique de la raison pure mais de façon affligeante selon tout l’opuscule sur le principe Des différentes races humaines, compromet la doctrine nomade des facultés – toute une géographie de la raison pure à laquelle Kant préférera en fin de compte le territoire de l’histoire. Comme l’affirme Kant dans les Conjonctures sur le début de l’histoire, c’est sous le partage et la délimitation agraire que peut se concevoir une fixation effective et irréversible des dispositions naturelles. « L’homme dit Kant était destiné à tous les climats et à n’importe quelle constitution du sol. Par suite, en l’homme, des germes et des dispositions naturelles variés devaient se trouver prêts à être, selon les circonstances, développés ou entravés de façon à l’adapter d’abord à la place qu’il occupe dans l’Univers: de façon aussi à le faire apparaître, dans la suite des générations, comme pour ainsi dire adéquat à cette ‘place’ et créé en fonction de celle-ci » 13. Le sol s’intègre ainsi dans une eschatologie de la place et se ferme sur l’histoire qu’elle finalise. Cette adéquation à une place centrale va hanter toute l’Allemagne à la suite de Kant pour réaliser en fonction du sol d’Europe septentrionale, une sélection de types caractéristiques dérivés du genre supposé originel. La mise en œuvre de la dimension du sol comme substance de la sélection raciale permet à Kant de faire de l’Allemagne et du blond vif le lieu d’une race immédiatement dérivée du genre originel 14.
Cette position du sol comme substance développe ainsi une logique sédentaire apte à fixer les dispositions humaines en déterminant le développement de certains germes, tout en étouffant l’ensemble des autres germes incompatibles avec la pureté supposée de la race dont le sol constitue à la fois le crible et l’égouttoir. Aussi, la race, « là où elle a une fois pris racine et ‘étouffé’ les autres germes, résiste précisément à toute transformation » 15. Et ce qui inquiète Kant, ce sont les germes insuffisamment étouffés, leur retour possible, la résistance dont ils font preuve. Sous ce filtrage colonial des races, Kant regrettera de voir à l’œuvre « des conduits de dérivation », des lignes de fuite que parcourt un sujet nomade, erratique, incapable de fixer des caractères typiques pour développer de manière plutôt anarchique les germes qu’il enveloppe comme autant de motifs errants.
Si la Critique de la raison pure a « besoin de déblayer et d’aplanir un sol à la végétation folle » 16, c’est par la crainte de voir surgir l’ennemi que l’on retrouve dans la « dialectique transcendantale », sous forme d’une taupe. Le sol est donc menacé par le nomade et ses figures animales. Et, dans ce texte, Kant propose une entreprise de nettoyage systématique, à même « de déblayer et d’affermir le sol qui doit porter le majestueux édifice de la morale, ce sol où l’on rencontre des trous de « taupe » de toutes sortes creusés par la raison et qui menacent la solidité de cet édifice » 17. Cette menace du sous-sol, de la taupe souterraine, de ses boyaux de dérivation, trouve son nom de manière définitive dans un texte assez curieux où surgit cet étrange nomade contre qui la première Critique établit sa citadelle dératisée : « Au début sa domination, celle de la métaphysique, était, sous l’administration des dogmatiques, despotiques. Mais comme sa législation portait encore la trace de l’ancienne barbarie, elle dégénéra peu à peu, par suite des guerres intestines, en une pleine anarchie, et les sceptiques, une espèce de nomades, qui ont en horreur tout établissement stable sur le sol, rompaient de tant en tant le lien social. » 18.
L’intérêt du texte de Kant est pour le moins de donner lieu en Allemagne à des contestations proprement philosophiques à travers des œuvres au style singulier, des œuvres que Derrida autant que Foucault rendent accessibles, notamment par tout le bestiaire Nietzschéen qui se range dès l’ouverture au Gai savoir sous la figure de la taupe, animal qui sape, qui fore, qui mine, comme si en effet, pour sortir du territoire sédentaire de la pensée, il fallait non pas tant s’intéresser au sol qu’aux stratégies qui le trouent, en particulier au travers l’idée de Terre, la terre n’étant jamais réductible au sol, toujours ouverte sur une ligne de fuite, le fameux terrier dont Kafka également fera une puissance de pensée, sans parler du sous-sol dans l’œuvre de Dostoïevski pour ouvrir à cet «enfer de la philosophie » qui constitue l’un des objets de mon travail19. Il me semble du coup que le livre de Faye s’inscrit parfois dans un manichéisme de principe, insensible à d’autres images de la pensée qui courent sous l’édification d’un sol et d’une race qui y prend autoritairement racine. Sans doute pouvons-nous reconnaître qu’il n’y a pas de véritable « tournant » dans la pensée de Heidegger comme le laissait entendre Jean Grondin 20. Ce refus du « tournant » pour sauver Heidegger de son engagement nazi constitue le point nodal, l’acquis faudrait-il dire, de toutes les études rassemblées dans ce recueil 21. Pour autant, aucun système philosophique n’est coulé dans le béton. Pégny perçoit d’ailleurs une évolution du corpus et si évolution il y a, elle ne peut pas seulement évoluer vers le sens le plus désastreux. Que la lecture des œuvres progresse vers la découverte de nouvelles archives, cela ne peut suivre l’obstination d’un unique vecteur, le pire… Nulle pensée, fût-ce la plus pernicieuse, n’adopte la forme monolithique de l’être. On peut reconnaître dans la lecture du philosophe des lignes d’évolutions et des points de mutation qui justifient la publication de tant de livres, autres tout en restant les mêmes sur bien des points. Il n’est pas impossible sous ce rapport de reconnaître que l’être sera raturé dans l’œuvre de Heidegger d’une croix, Heidegger s’intéressant davantage qu’au sol à tout ce qui fait son « effondrement » et avec lui peut-être l’effondrement du nazisme. Il est notable que Heidegger ne pense pas seul, dans une espèce de coupure philosophique qui ferait de lui le diable souabe, pris dans d’obscurs idiolectes dont il aurait le secret 22. Il y a dans la pensée de Heidegger des taupes qui prennent le nom de Nietzsche et Schelling auxquels il consacre plusieurs ouvrages. Peut-être dans ce rapport à l’être, ce qui émerge avec force, ce sont des chemins qui ne sont pas de l’être, des chemins de vertige qui conduisent au « sans fond » en dehors du sol et de tout fondement, de toute raison (Grund), inscrivant le « nulle part » dans ce qui devait faussement apparaître comme une patrie, le déracinement se muant du coup en principe d’une pensée dont l’ontologie n’est plus du tout fondamentale. Que cet arrachement à l’être suppose un « berger » et un Führer, c’est évidemment regrettable et ne stimule pas beaucoup à lire Heidegger.
Conclusion
Pour conclure cette présentation sommaire, il me semble que la force du collectif tient à la diversité des analyses, remarquables pour certaines, témoignant d’une indépendance d’esprit qui ne peut plus laisser croire à l’idée d’un rêve, d’une fabulation d’Emmanuel Faye. Mais la faiblesse du collectif tient à son ressentiment dirigé vers certains auteurs français. Ce qui donne à la méthode adopté l’air d’un règlement de compte tout à fait hors de propos. On ne saurait accepter la volonté de dénoncer des coupables, de laisser croire que la philosophie française est aveugle aux mots d’esprit de Heidegger, ou encore de donner à penser que de Foucault à Derrida l’étude s’est laissée piéger par Heidegger qui les contaminerait en sous-main et de manière ingénue. En réalité, comme je le montre dans mon livre sur Derrida, et comme je l’ai également mis en perspective par plusieurs textes sur Foucault, le rapport à Heidegger qui s’ouvre dans Marges de la philosophie tient à une lecture « critique » et « clinique » de son œuvre pour en marquer les impasses et démanteler l’ontologie fondamentale qui la réduisait à une herméneutique. Tout ce qui est énoncé par Faye et Rastier sur la question du monde, de « la pauvreté en monde » à laquelle selon Heidegger les juifs seraient redevables de leur faiblesse essentielle, se trouve désamorcé par le séminaire de plus de milles pages que Derrida –né dans le judaïsme autant que Lévinas – consacre à La bête et le souverain, un séminaire implacable qui marque la distance infinie du philosophe français avec des pensées de la « forêt noire ». Les accusations portées contre Derrida sont pour ma part inintelligibles et témoignent d’une querelle de personnes, querelle fort peu scientifique comme le laisse deviner l’ouvrage de Jean-Pierre Faye sur Derrida 23. Sur ce dernier point, la collectivité de l’entreprise n’effacera pas le différend des subjectivités. La vérité est dans les textes, l’avenir fixera les responsabilités de chacun sans aucun sectarisme pour montrer peut-être les déboires médiatiques d’une précipitation qui tient de la mode.
- Emmanuel Faye (dir.), Heidegger, le sol, la communauté, la race, Beauchesne, 2014
- Cf. le très beau livre de Max Dorra que j’ai présenté aux Samedi du Ciph Heidegger, Primo Lévy et le Séquoia, Gallimard, 2001
- Heidegger, le sol, la communauté, la race, op. cit., p. 10, note 1
- Jacques Derrida, Heidegger : la question de l’Etre et de l’Histoire, Galilée 2014
- p. 288-289
- Pégny, p.184
- p. 24, note 2
- E. Faye, p. 13.
- p. 211, p. 270.
- p. 270.
- in Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1972.
- Payot 1993, rééd 2005, Variation I,3.
- in La philosophie de l’histoire, Paris, Gonthier, 1947, p. 16
- Ibid. p. 23.
- Ibid. p. 24
- Critique de la raison pure, PUF, 1943, p. 733.
- Ibid. p. 266.
- Ibid. p. 5-6.
- L’enfer de la philosophie Ed. Léo Scheer, 2012.
- Le tournant dans la pensée de Martin Heidegger, Paris, PUF, 2011
- p. 299
- Rastier, p. 283
- Jean-Pierre Faye, Lettre sur Derrida, Germina, 2013








