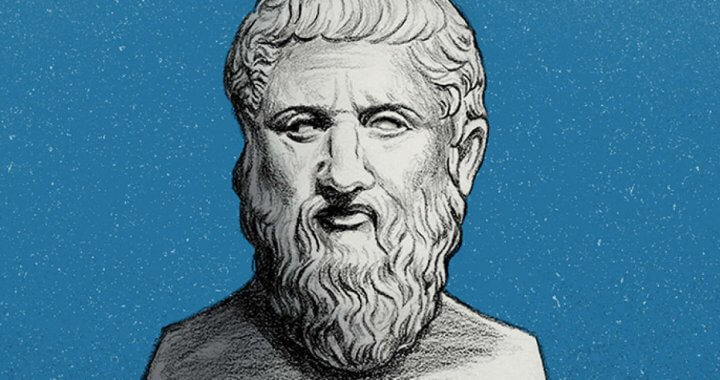Entretien avec Bernard Suzanne : Autour de la supposée théorie des Idées (Partie 2)
C : L’interprétation générale de la pensée platonicienne et la place du Sophiste
AP : Outre votre lexique, vos traductions et les introductions que vous avez proposées à de nombreux dialogues, vous développez une interprétation globale de l’écriture des textes platoniciens, dont on ne pourra ici qu’effleurer la richesse. Vous en avez déjà mentionné certains aspects dans les réponses précédentes. Je voudrais, si vous l’acceptez, aborder les points qui me semblent centraux et commencer par le Sophiste auquel vous attribuez une place absolument majeure. Pourriez-vous nous dire pourquoi le Sophiste fait l’objet d’une attention toute particulière au sein de votre approche ?
BS : Il faut, pour le comprendre, resituer le dialogue dans le plan d’ensemble des dialogues en sept tétralogies tel que j’ai cru le mettre à jour. Pour rendre la suite compréhensible, je vais donc lister, sans commentaires, ces tétralogies qui, je le rappelle, sont constituées d’un dialogue introductif et d’une trilogie.
- La mise en route : Alcibiade – Lysis / Lachès / Charmide ;
- Les illusions sophistiques : Protagoras – Hippias majeur / Hippias mineur / Gorgias ;
- Le fait du procès de Socrate : Ménon – Euthyphron / Apologie / Criton ;
- L’âme : Banquet – Phèdre / République / Phédon ;
- Le logos : Cratyle – Ion / Euthydème / Ménéxène ;
- La dialektikè : Parménide – Théétète / Sophiste / Politique ;
- La mise en pratique : Philèbe – Timée / Critias / Lois.
Ce cycle de formation de futurs philosophes rois s’ouvre avec Alcibiade au moment où il va pour la première fois prendre la parole à l’Assemblée, et donc commencer sa carrière politique (qui contribuera à la ruine d’Athènes), et se clôt avec les Lois nous montrant trois vieillards se « divinisant » en établissant des lois pour une cité que l’un d’eux, le Crétois Clinias, homonyme du père d’Alcibiade (comme si Platon voulait rembobiner la cassette), a été chargé de fonder comme nouvelle colonie par sa cité d’origine, Cnossos, la cité où avait régné Minos, pendant qu’ils gravissent les pentes du mont Ida, en route vers le lieu supposé de la naissance de Zeus, non pas pour faire comme Minos, qu’on disait fils de Zeus et qui fut le premier roi à régner par des lois, pour aller demander à son père de lui dicter ces lois, mais au contraire, pour profiter de l’ascension pour établir eux-mêmes ces lois en faisant usage pour cela de leur raison (logos), cadeau des dieux aux hommes pour qu’ils soient capables d’organiser eux-mêmes leur vie commune pour le meilleur (c’est cela que j’appelle « se diviniser »). Dans le dialogue introductif, l’Alcibiade, Socrate cherche à savoir quels logoi le jeune homme va tenir à l’Assemblée et quelles compétences, acquises par quel moyen, il pense avoir pour cela et cherche à lui faire comprendre qu’avant de se lancer ainsi dans une carrière politique, il vaudrait mieux mettre en pratique le précepte delphique « Apprends à te connaître toi-même » (gnôthi sauton) et chercher à comprendre ce que veut dire être un anthrôpos, ce qui constitue l’excellence (aretè) propre d’une telle créature et ce qui est le meilleur (to ariston) pour elle, individuellement et collectivement. Or ce qui distingue les anthrôpoi de toutes les autres créatures, c’est le logos. Il convient donc de chercher à comprendre ce qu’est le logos, qui n’a pu apparaître que parce que les anthrôpoi sont d’abord des êtres faits pour vivre en société (poitikoi) et à travers le dialogue (to dialegesthai). Il faut donc déterminer quel est hè tou dialegesthai dunamis (« le pouvoir/la puissance du dialegesthai ») qui fait justement la différence entre le premier et le second sous-segment de l’intelligible dans l’analogie de la ligne (cf. République VI, 511b4). Son pouvoir et ses limite ! Et c’est là tout le programme du cycle des dialogues. Et ce programme commence par un cycle court en cinq tétralogies qui, en nous menant d’Alcibiade débutant à Périclès installé, ou plutôt à l’auteur de ses logoi, Aspasie, dont on disait qu’elle écrivait ses discours, dans le Ménéxène, va nous montrer à quoi aboutit une éducation qui fait l’économie de la dialektikè telle que conçue par Platon, c’est-à-dire une éducation telle que celle proposée par les pareils d’Isocrate, qui conduit à des politiciens aux discours convenus et recyclables comme celui dont le Ménéxène nous donne un brillant exemple. Au centre logique de ce cycle court en cinq tétralogies, c’est-à-dire dans le dialogue central de la trilogie centrale (la troisième sur cinq donc), on trouve le procès et la condamnation à mort de Socrate (Apologie). La sixième tétralogie va donc nous montrer comment dépasser cela et accéder au dernier segment de la ligne (les tétralogies 2, 3, 5 et 6 parcourent les quatre segments de la ligne (2 et 3 pour le visible, 5 et 6 pour l’intelligible), entre une tétralogie introductive (1) et une tétralogie conclusive (7), de part et d’autre d’une tétralogie centrale sur l’âme (4), pont entre le visible/sensible et l’intelligible ; et, dans les trilogies, la progression se fait selon les trois parties de l’âme, dans un découpage qui anticipe plus ou moins le découpage stoïcien de la philosophie en physique, éthique et logique). Elle le fait à travers une trilogie dont le premier dialogue, le Théétète, qui nous replonge dans l’atmosphère des gymnases fréquentés par des adolescents, cadre de la première tétralogie, récapitule les cinq premières tétralogies et met en évidence l’échec auquel conduit le fait de ne pas avoir pris le temps de chercher à comprendre comment fonctionne le logos alors qu’il est l’outil même de toute recherche, dont justement celle entreprise par Théétète, que Socrate prétend faire accoucher d’un logos (Théétète ne commence à se poser la question qu’à la fin du dialogue, devant l’échec auquel il a abouti en proposant de définir le savoir comme opinion vraie accompagnée de logos alors que peu avant, Socrate lui a fait admettre que l’opinion est une forme de logos, ce qui fait que sa définition devient « un logos vrai accompagné de logos » !). Et c’est le dialogue suivant, le dialogue central de cette sixième tétralogie, le Sophiste, qui corrige cette erreur en nous faisant comprendre comment fonctionne le logos. D’où son importance majeure. Et il le fait, dans le dialogue central de la seconde tétralogie de l’intelligible, au moyen d’un « parricide », commis sur la personne, ou plutôt la pensée, de Parménide, mise à mort en pensée, en logoi, d’un Éléen par un seul de ses concitoyens qui est le pendant dans l’ordre intelligible de la mise à mort en actes de l’Athénien Socrate par une multitude de ses concitoyens dans l’ordre visible, qui intervenait dans le dialogue central de la seconde tétralogie du visible. Le lien entre ces deux mises à mort est mis en évidence par la « filiation » selon laquelle Parménide « engendre » (dans un sens large qui ne se limite pas à la relation de maître à disciple) Zénon, qui « engendre » Gorgias, qui « engendre » Calliclès et, par réaction Anytos, incapable de faire la différence entre Socrate et Gorgias parce qu’il s’en tient à de simples rumeurs mais qui fait néanmoins condamner Socrate à mort. La mise à mort en pensée de Parménide ouvre la porte à la possibilité du pseudos logos, le discours faux, qui oblige à penser deux plans distincts, celui des auta, les « ça-même » dont prétendent parles les logoi, et celui des mots et des logoi, qui ne sont pas ce dont ils parlent et peuvent donc suggérer des relations entre mots qui ne correspondent pas aux relations entre les « étants » (onta) dont ils prétendent rendre compte. C’est pour n’avoir pas distingué ces deux plans que Théétète échoue et que l’analogie que propose Socrate avec l’image de la volière ne marche pas, parce qu’elle assimile les oiseaux capturés directement à des savoirs (epistèmai), alors qu’elle fonctionnerait parfaitement si on les assimilait à des mots.
L’Étranger (et Platon qui le fait parler) fonde son analyse du logos sur deux principes qu’il suggère et met en pratique dans le Sophiste, le principe que j’appelle principe d’associations sélectives, et le principe de validation par le partage d’expériences au moyen du dialegesthai, qui ne supposent ni l’un, ni l’autre, aucune ontologie préalable , parce qu’on ne peut pas tenir un discours sensé sur l’être, l’étant (to on/ta onta) ou l’étance (ousia) tant qu’on n’a pas préalablement déterminé si, comment et dans quelles limites le logos nous donne accès à autre chose que les mots qui le composent et quel rôle spécifique y joue le verbe einai (« être »), qui n’est pas un verbe comme les autres, comme on l’a vu plus haut. Et c’est justement l’objet du Parménide introductif de montrer par l’exemple que, quand on ne respecte pas ce préalable de manière satisfaisante, et non pas en en restant sur l’échec que constitue la discussion entre Socrate encore jeune et Parménide sur les eidè/ideai, on ne peut tenir sur l’étant (to on) que des discours sophistiques dans lesquels on peut démontrer avec la même rigueur logique tout et son contraire. Il commence par exposer le principe d’associations sélectives dans sa plus grande généralité en faisant exprès de varier son vocabulaire à la fois sur ce que j’ai appelé « associations » et sur ce qui pourrait rentrer dans ces associations « afin que [son] logos soit pour tous ceux qui ont à un moment ou à un autre et d’une quelconque manière discuté sur l’étance (ousia), que ce soit pour ceux-ci (ceux qu’il vient de mentionner dans sa réplique précédente) ou pour les autres avec lesquels [ils ont] (lui et Théétète) discuté tout à l’heure (les fils de la terre et les amis des eidè) » (Sophiste, 251c8-d3), en éliminant l’hypothèse que tout peut se « mélanger/associer/… » avec tout, puis celle que rien ne peut se « mélanger/associer/… » avec rien, ce qui laisse comme seule possibilité que certains « mélanges/associations/communautés/… » sont possibles et pas d’autres, puis il passe au cas particulier des mots et du logos, dans la discussion sur les très grandes familles (megista genè), pour montrer que, dans cet ensemble réduit que constituent les mots, le principe reste valide : on ne peut pas associer les mots n’importe comment et, dans certains cas au moins, tout le monde admettra que telle association (dans l’exemple qu’il prend : « le mouvement est la même chose que le repos ») est inacceptable et que telle autre (dans l’exemple qu’il prend : « le mouvement est autre que le repos ») est acceptable. Or il suffit d’un seul exemple de rejet pour prouver le principe selon lequel tous les assemblages de mots ne sont pas valides, c’est-à-dire vrais et correspondant à la réalité de ce dont ils prétendent rendre compte, et que donc il convient dans chaque cas de s’assurer que les assemblages de mots qu’on propose sont pertinents et disent le vrai. Pour ce faire, il propose le principe de validation par le partage d’expériences dans le dialegesthai en le mettant en pratique avec les exemples « Théétète reste assis » (Theaitètos kathètai, 263a2) et « Théétète, avec qui, en ce moment, moi, je dialogue, vole » (Theaitètos, hôi nun ego dialegomai, petetai, 263a9), dans une « démonstration » qui reste pertinente pour chaque lecteur, non pas parce qu’il croit sur paroles Platon racontant une conversation qui n’a jamais eu lieu en réalité, mais parce qu’il peut s’imaginer dans une situation analogue où il serait capable de faire admettre la vérité d’une de ses affirmations et la fausseté d’une autre à tous ses interlocuteurs. Bref, le logos peut nous donner accès à l’étant, c’est-à-dire à ce qui est comme c’est, mais pas n’importe comment, et nous devrions donc partager nos expériences pour tenter de démêler au mieux le vrai du faux, ce qui n’est pas trop difficile quand il s’agit de ce que l’on peut voir, mais est plus délicat lorsqu’il est question de « notions » abstraites comme « beau », « juste », etc. Et c’est là que l’objectivité du bon (to agathon) que j’ai déjà évoquée peut, en fait, doit, nous servir de « lumière ».
Je pense que cette explication suffit à montrer l’importance majeure du Sophiste dans l’ensemble de la démarche de Platon.
Encore une remarque sur le Sophiste pour finir. Inutile de déplorer la perte d’un dialogue qui se serait appelé le Philosophe et aurait fait dialoguer Socrate, reprenant la place de l’Étranger d’Élée comme meneur de jeu avec son jeune homonyme camarade d’étude de Théétète, ou le fait qu’il n’ait finalement jamais été écrit. Malgré les apparences contraires, Platon n’a jamais eu l’intention de l’écrire en tant que dialogue distinct car c’est au lecteur de le trouver en filigrane dans le Sophiste, où le philosophe affleure plusieurs fois. En fait, comme dans le cas des dialogues socratiques du début du programme, l’objectif de Platon dans ses dialogues n’est jamais de finir sur des définitions en bonne et due forme dans le style d’Aristote, ou alors de manière ironique en en donnant sept, comme dans le Sophiste justement, mais de permettre au lecteur de progresser tout au long du dialogue dans sa compréhension de ce qui est examiné. Et le jeune Socrate qui aurait dû dialoguer avec Socrate dans ce Philosophe, c’est le lecteur, pour autant qu’après avoir suivi le programme jusqu’au Politique (jusqu’au Politique et pas en restant au niveau des mathématiques comme Théétète, dans la mesure où l’activité politique est la finalité du philosophe roi) et avant de se lancer dans les exercices d’application de la dernière tétralogie, il ait réussi à comprendre tout seul la différence entre le sophiste et le philosophe, largement balisée par le Sophiste.
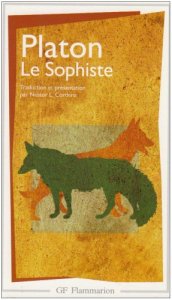
AP : Ce que vous dites est assez déroutant pour deux raisons. D’une part parce que cela propulse Platon dans une dimension idéaliste au sens moderne du terme, presqu’au sens hégélien, c’est-à-dire qu’il apparaît sous votre plume comme un philosophe pour qui la vérité semble à la fois substance et sujet. Dans ces conditions, comment faut-il comprendre la vérité chez Platon ? Est-ce la vérité même des choses, qui subsisterait indépendamment de nous, où la vérité n’est-elle jamais que celle que le sujet pensant peut en dire ? Vous évoquez dans vos réponses le fait de « dire le vrai » ; mais dire le vrai, est-ce dire la chose telle qu’elle est ou exprimer, relativement à ce que la pensée et les mots permettent, quelque chose qui demeure relatif à ce que permettent de dire les mots ?
BS : Pour Platon tel que je le comprends, la vérité (alètheia, dérivé de alèthès dont le sens étymologique est « non caché ») est une propriété du logos, celle de refléter ou, si vous préférez, en s’appuyant sur le sens étymologique d’alèthès, de « dévoiler » dans les relations qu’il établit entre les mots qu’il emploie les relations entre les pragmata (« faits/choses ») auxquels prétendent renvoyer ces mots. Il y a deux mots qui se font écho au fil des dialogues et sont particulièrement importants pour comprendre cela, ce sont les mots pragma et pathèma. Le premier, généralement traduit par « chose », est un substantif dérivé du verbe prattein, qui signifie « faire, accomplir » et évoque donc l’idée d’action, là où le second, que je traduis par « affection », dérive du verbe paschein, qui s’oppose justement à prattein comme le pâtir/subir à l’agir, et évoque le fait de subir, d’être affecté par quelque chose. Par ailleurs, ces deux substantifs en -ma évoquent des instances spécifiques de ce qu’ils désignent, une action (pragma) ou une affection (pathèma) particulière, et non pas le simple fait d’agir (qui serait praxis) ou de subir (qui serait plutôt pathos). Pragma est le mot qui est employé par Platon pour désigner ce à quoi renvoie un nom, ce qui explique que le dialogue où il apparaît le plus fréquemment est le Cratyle (72 occurrences), qui s’intéresse justement à la justesse des noms. Mais on le trouve aussi dans le Sophiste en ce sens. Ainsi, au début du Sophiste, l’Étranger fait remarquer à Théétète qu’à ce point, avant que la discussion ne commence, ils n’ont en commun à propos du sophiste que le nom (onoma) et qu’il vaut mieux, en toutes circonstances, « s’entendre sur le pragma lui-même au travers de logoi plutôt que sur le mot (onoma) seulement sans logos » (Sophiste, 218c4-5). Quant à pathèma, qui peut se traduire par « affection », au sens de ce qui nous affecte, qui a une action sur nous que nous subissons, c’est le mot employé par Socrate dans l’analogie de la ligne pour désigner ce qu’il associe à chaque segment. Mais, pour comprendre la relation entre les deux, il ne faut pas traduire pragma par « chose », comme on le fait le plus souvent, même si c’est bien l’un des sens dérivés possibles de ce mot (du sens premier « ce qu’on fait », on passe au sens « ce qui est fait », c’est-à-dire « événement, chose, affaire »), car cette traduction fait complètement perdre de vue l’opposition sous-jacente entre prattein (« agir ») et paschein (« subir »). Le sens premier de pragma est « ce qu’on fait », c’est-à-dire « agissement/activité », et ce que sous-entend Platon à travers l’emploi de ces deux mots, c’est que tout ce qui « affecte » nos sens et notre noûs, tous les pathèmata qu’il évoque dans l’analogie de la ligne, dans l’ordre visible/sensible aussi bien que dans l’ordre intelligible, supposent l’activité sur eux d’un « acteur/agent/activateur » extérieur, qui est ce qu’il appelle pragma. Des idées ne naissent pas spontanément dans notre esprit, mais supposent un pragma, matériel ou pas, qui en est la cause (qu’un pragma puisse être immatériel est montré par le fait qu’en République X, 608c9, Socrate mentionne un athanaton pragma, un pragma immortel, qui n’est autre que l’âme, et aussi par la remarque citée plus haut de l’Étranger dans le Sophiste, qui parle de pragma à propos du sophiste dans l’abstrait, pas de tel ou tel sophiste en particulier). Et c’est parce que les organes qui sont affectés par ces pragmata sont les mêmes dans tous les hommes que nous pouvons nous comprendre car, comme le dit Socrate à Calliclès dans le Gorgias, « si quelque chose de ce qu’éprouvent les homme (ti tôn anthrôpois pathos), autre pour les uns, autre pour les autres, n’était pas le même, mais si l’un d’entre nous éprouvait quelque chose (epaschen pathos) qui lui serait propre différent de[ ce qu’éprouvent le]s autres, il ne serait pas facile de faire connaître à autrui sa propre affection (pathèma) » (Gorgias, 481c5-d1). Platon est donc un réaliste, qui pense que, si nous éprouvons ou pensons quelque chose, c’est que quelque chose de matériel ou d’immatériel agit sur nous de l’extérieur, et ce, d’une manière à peu près semblable pour tous puisque conditionnée par la nature commune de nos organes. Mais dès lors que ces pragmata ne sont pas les mots qui forment notre langage et que ces mots ne sont que des étiquettes que nous mettons sur les eidè/ideai que des affections ressemblantes, débarrassées de considérations de temps et de lieu pour les rendre comparables, suscitent en nous, rien ne nous empêche d’assembler ces étiquettes dans des logoi d’une manière qui ne corresponde pas aux pragmata que ces logoi prétendent décrire, et donc d’arriver à des logoi qui ne disent pas le vrai, c’est-à-dire qui ne disent pas les étants comme c’est.
AP : Par ailleurs, lorsque nous lisons Platon, nous avons tout de même l’impression que s’y trouve une sorte de hiérarchie des consistances des différentes réalités ; et même si l’on dit que la différence se joue à même l’eidos, il n’en demeure pas moins que l’eidos visible différenciée de l’eidos saisie par le noûs inaugure une hiérarchie ontologique depuis deux types d’apparence.
Pouvez-vous, sur ce point, nous expliciter ce refus de l’ontologie fondatrice et cette importance accrue que vous accordez au logos ?
BS : Je ne parlerais pas de « hiérarchie ontologique », car des degré d’être, cela ne veut rien dire puisque « être » tout seul, sans attributs, ne veut rien dire, mais de hiérarchie gnoséologique (les segments de la ligne de la République), c’est-à-dire de degrés de connaissance pour chacun, et surtout de hiérarchie d’étance (ousia) mesurée à l’aune du bon (to agathon), c’est-à-dire d’importance plus ou moins grande au regard de notre recherche, au moyen du logos, du bon pour nous, individuellement et collectivement que tel ou tel « étant », connu à tel ou tel niveau de connaissance, peut avoir dans cette quête qui devrait occuper l’essentiel de notre vie. Et, oui, dans cette hiérarchie, appréhender les ideai purement intelligibles a généralement plus de valeur, et permet donc d’accéder à plus d’ousia, si l’on peut dire, qu’en rester à des eidè exclusivement visibles/sensibles, et plus encore si ces ideai sont des ideai de notions purement intelligibles comme « beau » ou « juste » (et bien sûr « bon » qui sert à en mesure la valeur) que si elles sont celles d’étants individuels visibles/sensibles, même si cet étant est Socrate, dont l’idea intelligible, ou au moins une partie d’elle, nous est suggérée par Platon dans ses dialogues, bien que les deux soient morts depuis longtemps.
Fondamentalement, à mon avis, Platon n’a pas voulu clarifier les différences entre un supposé sens « existentiel » d’einai (« être ») et son rôle de copule servant à introduire des « étances » (ousiai), comme on l’entend souvent dire, mais au contraire nous mettre en garde contre les pièges de ce supposé sens « existentiel », qui implique toujours un ou des attributs implicites, déductibles du contexte (par exemple dans l’opposition entre einai (« être ») et gignesthai (« devenir »), ou entre einai (« être ») et phainesthai (« paraître »), qui ne conduisent pas au même sens) ou simplement laissés à l’initiative de chaque interlocuteur ou lecteur, ce qui est la porte ouverte à toutes les incompréhensions et à tous les sophismes, comme le montre brillamment la seconde partie du Parménide. Platon n’a que faire de l’ontologie, qui ne peut être qu’un discours creux, et ne s’intéresse, si l’on veut à tout prix des noms savants en -logie, qu’à la logologie (discours sur le logos permettant de comprendre comment fonctionne cet outil) et à l’agathologie (discours sur le bon permettant de comprendre où nous devrions aller ensemble), la tâche fondatrice de la logologie étant déjà assez ardue comme ça puisqu’il faut étudier le logos au moyen du logos, seul outil dont nous disposions pour ce travail, c’est-à-dire apprendre à nager en se jetant tout de suite dans le grand bain !
AP : J’en viens à un autre élément crucial de votre lecture qui consiste à refuser l’espèce de tâtonnement platonicien qui, sur une cinquantaine d’années, se serait patiemment développé non sans contradictions et reniements. Naturellement, on a tendance à considérer que le plus spectaculaire d’entre eux serait les passages du Parménide où Platon renierait sa théorie des idées ; or, comme nous l’avons compris, vous ne défendez pas la thèse selon laquelle Platon aurait construit une théorie des idées si bien que le supposé reniement du Parménide ne tient pas. Ma question est donc double : 1) comment jugez-vous l’écriture même de l’œuvre de Platon et 2) comment lire la critique des idées dans le Parménide ?
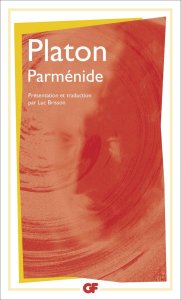
BS : À la première question, je réponds que je ne nie pas que la pensée de Platon ait pu se développer, non sans contradictions et reniements, sur une cinquantaine d’années, mais seulement que l’écriture des dialogues ait accompagné cette évolution et nous en conserve la trace. Au fil de mes précédentes réponses, j’ai déjà largement laissé voir quel était mon cadre interprétatif des dialogues de Platon. L’« évolution » qu’on y décèle n’est pas celle de Platon au fur et à mesure qu’il écrivait les dialogues, mais le procédé pédagogique voulu par l’auteur, en particulier, mais pas seulement, à partir de sa propre expérience antérieure, mais aussi à partir de son expérience de « professeur » à l’Académie. Et cette hypothèse invite à penser que Platon a probablement écrit ses dialogues sur une période beaucoup plus courte que ce qui est généralement supposé, et ce, vers la fin de sa vie (pour ceux qui penseraient cela impossible, je rappellerai que Thomas d’Aquin, au XIIIème siècle, a écrit sa Somme théologique, ouvrage monumental et ardu s’il en fut, mais aussi très rigoureusement structuré et très « scolaire », durant les sept dernières années de sa vie, en même temps qu’il parcourait l’Europe avec les moyens de transport de l’époque). Cela n’impose pas non plus qu’il les ait écrits l’un après l’autre d’un seul jet dans l’ordre de lecture prévu, ni qu’il les ait « publiés », ou disons plutôt « rendus publics », de son vivant en dehors de l’Académie, surtout s’il voulait se laisser le loisir de les retoucher au fur et à mesure qu’il avançait, comme une tradition le laisse entendre à propos de la République.[1]
Cela étant dit, on pourra constater que l’ordre que je mets à jour, que j’ai présenté un peu plus haut, n’est pas fondamentalement discordant avec les divers arrangements proposés par les tenants du cadre interprétatif « officiel » (dialogues de jeunesse, dialogues de maturité, dialogues tardifs), ce qui n’est pas pour surprendre si justement Platon s’est inspiré de sa propre « évolution » intellectuelle antérieure pour construire son plan d’ensemble. Et il serait bien dans sa manière (pas de réponses, seulement des indices que chacun doit déchiffre pour lui-même) de n’avoir jamais communiqué ce plan à ses proches avant sa mort et de les avoir laissés le trouver tous seuls à partir d’indications sommaires. Cela pourrait expliquer que la tradition ait conservé l’idée de tétralogies et de trilogies. Mais là, on est dans de simples hypothèses, sur des points sur lesquels nous n’aurons jamais de certitude (pas plus d’ailleurs que sur le fait que le plan que je propose est celui que Platon avait en tête).
Concernant la seconde question, relative au Parménide, mes réponses précédentes doivent déjà vous avoir donné une idée de la manière dont j’interprète ce dialogue et du rôle que je lui assigne dans l’ensemble des dialogues. J’ajouterai que, pour bien le comprendre, il faut faire attention au nom qu’a choisi Platon pour l’interlocuteur de Parménide dans son « jeu laborieux » (pragmateiôdè paidian, Parménide, 137b2) qui occupe le plus gros du dialogue : il s’appelle Aristote, et la seule indication que donne Platon à son sujet est qu’il allait devenir l’un des Trente Tyrans (Parménide, 127d2-3, information confirmée par la liste qu’en donne Xénophon en Helléniques, II, 3, 1), et Parménide le choisit comme interlocuteur parce qu’il est le plus jeune et celui qui sera le moins susceptible de lui causer des ennuis. Et de fait, il fait bien pâle figure dans la discussion et semble n’être là que pour permettre à Parménide de faire croire, pour faire plaisir à Socrate, qu’il conduit un dialogue, et surtout pour lui permettre de reprendre sa respiration (« Qui donc me répondra ? Pourquoi pas le plus jeune ? Il serait en effet le moins disposé à chercher la petite bête et il répondrait plus que tout autre ce qu’il pense, et en même temps ce serait une pause pour moi que la réponse de celui-là », Parménide, 137b6-8). Que faut-il déduire de cela ? Que cache cet Aristote pause-café qu’on nous présente seulement comme futur tyran ? À moi, cela dit que le dialogue est une leçon adressée à un autre Aristote, le philosophe élève, puis collègue, de Platon à l’Académie, une manière de lui dire : « Mon petit Aristote, si tu continues comme ça et ne comprends pas la leçon du Parménide, où j’ai fait démontrer par Parménide avec la même rigueur logique des conclusions complètement opposées, si tu ne comprends pas que ce n’est pas la rigueur logique d’un raisonnement que le fait être vrai, mais la conformité de ses conclusions aux faits (Achille rattrape la tortue, donc tous les beaux discours de Zénon sont faux et il y a nécessairement un problème dans son raisonnement, mais c’est à lui de le trouver, pas à nous à perdre notre temps à ça), tu finiras tyran comme ton homonyme, mais tyran de la pensée ! » Quant à la discussion entre Socrate et Parménide, où l’on voit une critique de ce qui aurait été une première version d’une « théorie des idées » de Platon, elle n’est pas une critique d’une théorie qui aurait été celle de Platon, ni même celle de Socrate, mais d’une théorie qui est justement celle qu’Aristote prête à Platon ! La discussion se passe avec un Socrate jeune pour rendre plus crédible qu’il ne vienne pas à bout des arguments d’un Parménide âgé, et la conclusion de cette discussion, dans laquelle on n’arrive à rien parce que les interlocuteurs, comme Aristote, fils de médecin, ne parviennent pas à se représenter les eidè autrement que par des analogies physiques, est que, même si l’on ne parvient pas à se représenter les eidè, on ne peut en faire l’économie sans annihiler le logos, et que donc il vaut mieux les accepter sans vraiment comprendre ce qu’ils sont que de les mettre au rancart (« si de fait maintenant, Socrate, au contraire on ne laisse pas être des eidè des étants, ayant porté son regard sur tout ce qu’on examine en ce moment même et d’autres [choses] semblables, et qu’on ne définit pas un certain eidos unique de chacun, on n’aura nulle part où tourner sa pensée, en ne laissant pas une idean de chacun des étants être toujours la même, et ainsi, on détruira tout à fait la puissance du dialegesthai », Parménide, 135b5-c3).
AP : Vous avez reconstitué si l’on peut dire l’ensemble des écrits de Platon en une série de « sept tétralogies », auxquelles vous avez consacré une introduction / justification. Comment avez-vous eu l’intuition d’une telle organisation ? Vous dites souvent qu’elle vous est « tombée du ciel » mais comment entendre cela ?
BS : Comme je l’ai dit au début, elle m’est en quelque sorte tombée du ciel pratiquement définitive dès le début de mes réflexions sur les dialogues. Le point de départ en a été la trilogie la plus évidente, la série Théétète/Sophiste/Politique, à laquelle il n’a pas été trop difficile d’adjoindre le Parménide comme introduction, puisque Socrate, dans le Théétète, fait allusion à cette discussion avec Parménide. Ensuite, si je me souviens bien, car ça remonte à près de cinquante ans, j’ai commencé à envisager la trilogie annoncée Timée/Critias/Hermocrate comme le déploiement du Politique, jusqu’à ce que me vienne l’idée que l’interruption brutale du Critias était délibérée et constituait le « test » (krisis, dont dérive le nom Critias) de fin d’études pour l’étudiant-lecteur : serait-il capable de comprendre, en voyant le dialogue s’interrompre au moment où « Zeus, le dieu des dieux, qui règne par les lois » va prendre la parole (le dernier mot du dialogue, qui interrompt la phrase dont je viens de citer le début, est eipen (« dit »)) dans l’assemblée des dieux qu’il a convoqués pour remettre de l’ordre dans le royaume d’Atlantide, que ce n’est pas des dieux qu’il faut attendre de l’aide pour régler nos affaires humaines et remettre de l’ordre dans nos cités, mais de notre logos, comme l’illustrent les Lois, qui prennent la place d’un Hermocrate que Platon n’a jamais eu l’intention d’écrire, ou va-t-il regretter de ne pas avoir la suite de la belle histoire de l’Atlantide inventée par Critias pour désamorcer les propos révolutionnaires de Socrate dans une discussion de la veille qui n’est pas la République, mais en avait repris les idées, en laissant croire que cela avait déjà été essayé dans le passé et n’avait pas marché, et donc pour mieux maintenir son pouvoir sur ses concitoyens en magouillant avec l’ennemi (Hermocrate est le général syracusain, allié de Sparte, qui a été responsable de l’échec de l’expédition de Sicile imaginée par Alcibiade et par conséquent de la défaite d’Athènes devant Sparte dans la guerre du Péloponnèse) et en les endormant avec des « histoires » inventées mais présentées comme très anciennes et censées justifier sa domination ? Je me trouvais donc avec la trilogie Timée/Critias/Lois, à laquelle il n’a pas été difficile d’ajouter comme introduction le Philèbe, dialogue sur le bon pour nous, êtres humains, lumière toute trouvée pour éclairer le travail d’élaboration de lois s’inspirant du modèle fourni par le travail du démiurge créateur du Cosmos ordonné que décrit, sans trop se prendre au sérieux, le Timée dans un « mythe vraisemblable », une fois passé le test du Critias. Il restait à voir si les autres dialogues pouvaient se voir comme des développements dont le Théétète pourrait passer pour un résumé. Or là, certaines tétralogies s’imposaient naturellement : la tétralogie Ménon – Euthyphron/Apologie/Criton unifiée autour du procès et de la mort de Socrate, puis la trilogie Phèdre (nature de l’âme)/République (« étique » de l’âme)/Phédon (destinée de l’âme), à laquelle le Banquet, sur l’amour, moteur de l’âme, fournissait une introduction toute trouvée, puis la trilogie Ion (discours du poète)/Euthydème (discours éristique)/Ménéxène (discours politique), à laquelle le Cratyle, dialogue sur les mots, composants des discours, pouvait servir naturellement d’introduction ; à ce point, il ne restait que huit dialogues à « caser » et les regroupements s’imposaient d’eux-mêmes : regrouper ensemble les quatre dialogues portant des noms de sophistes, le Protagoras, les deux Hippias et le Gorgias allait de soi et le Protagoras faisait une introduction naturelle à ce cycle (et c’est finalement l’ordre des trois autres dans la trilogie qui m’a posé le plus de problèmes) ; restaient l’Alcibiade, dont une longue tradition fait le dialogue par lequel il faut commencer la lecture de Platon, le Lysis, le Lachès et le Charmide, qui ont en commun de mettre en scène des adolescents (caractéristique que l’on retrouve dans le Théétète), ce qui en faisait un groupe introductif tout trouvé, surtout quand on remarque que leurs thèmes respectifs, la philia pour le Lysis, la sôphrosunè, version adolescente de la sophia, pour le Charmide et l’andreia (le fait d’être un anèr, un mâle) pour le Lachès, reconstituent en filigrane quand on les assemble la réponse à la question posée dans l’Alcibiade, celle de savoir qui est compétent pour gouverner ses semblables, puisque la réponse, donnée au milieu du dialogue central du cycle des dialogues, la République, à travers le principe du philosophe roi, c’est le philo-sophos anèr, formule qui, remarquons-le au passage sert à Théodore au début du Sophiste à présenter l’étranger d’Élée qu’il amène avec lui et qui va donner les clés de la formation du philosophe en expliquant quel est « le pouvoir du dialegesthai », ouvrant la porte à des considérations sur le politique. Il restait à trouver les principes d’organisation de tout cela. Identifier les trois parties de l’âme et les thématiques apparentées à chacune d’elles pour le séquencement des trois dialogues dans chaque trilogie, s’imposait assez facilement. Il était un peu plus délicat d’identifier une série de sept pour justifier la présence de sept tétralogies, mais la place centrale de la tétralogie sur l’âme, pont entre le visible/sensible et l’intelligible, qui faisait de la République, dialogue médian de la trilogie médiane, le centre logique de l’ensemble, avait de quoi séduire et ne paraissait pas absurde. Une fois admis que le programme complet devait avoir une introduction et une conclusion, qui pouvaient justifier chacune une tétralogie complète, le rôle d’introduction pour la tétralogie des ados s’ouvrant sur l’Alcibiade et le rôle de conclusion pour la tétralogie qui se terminait par les Lois et contenait le test final du Critias s’imposaient naturellement et il ne restait plus que quatre tétralogies à répartir de part et d’autre de l’axe central de la tétralogie sur l’âme, deux de chaque côté, et il devenait alors tentant de les associer chacune avec l’un des quatre segments de la ligne. Et, tout au long de ce travail, j’ai été rassuré par le fait que l’ordre des dialogues auquel j’arrivais ne s’écartait pas trop des ordres (différents dans le détail) auxquels arrivaient ceux qui sont dans la logique dialogues de jeunesse, dialogues de maturité, dialogues tardifs.
AP : Sur quelle base philologique vous appuyez-vous pour défendre une telle approche qui prend à rebours l’essentiel des datations dont nous sommes coutumiers ?
BS : Mes arguments ne sont pas tant philologiques que de cohérence. Comme vous avez pu le voir dans mes propos jusqu’à présent, il m’est difficile de présenter ma compréhension des dialogues sans faire référence à cette organisation. Et en fin de compte, ça marche ! Ça marche même de mieux en mieux et ça résiste au temps, puisqu’en cinquante ans environ, je n’ai apporté qu’une modification au schéma initial : au départ, j’avais suggéré pour la seconde tétralogie, celle des sophistes, l’ordre Protagoras – Hippias majeur/Gorgias/Hippias mineur, pour des raisons de symétrie qui n’avaient rien à faire ici (la « pendule » Gorgias entre les deux « chandeliers » Hippias !). J’ai finalement remis en cause cet ordre pour arriver à l’ordre Protagoras – Hippias majeur /Hippias mineur/Gorgias, qui fonctionne beaucoup mieux, pour des raisons qu’il serait trop long d’exposer ici. Par « Ça marche », je veux dire que ça donne une vision cohérente de l’ensemble des dialogues, ça explique certaines singularités pointées par les commentateurs, comme le rôle du Ménéxène si on doit le considérer comme un dialogue autonome, qui devient très clair dans cette organisation comme exemple des discours politiques à rejeter parce que non composés par des personnes qui maîtrisent la dialektikè, et dont le sens est donné par les deux pages introductives qui en expliquent le mode de composition ; ou encore l’absence du Philosophe et de l’Hermocrate, l’interruption du Critias, etc., et ça m’a permis d’arriver à une compréhension d’ensemble des dialogues sans reniements ou incohérences. Concernant l’ordre des dialogues, indépendamment de leurs dates supposées de rédaction et de publication, sur lesquelles nous n’avons aucune certitude, seulement des hypothèses empilées sur des hypothèses empilées sur…, comme je l’ai dit précédemment, l’ordre que je propose est assez proche de ceux auxquels arrivent les spécialistes qui raisonnent en termes de dialogues de jeunesse, dialogues de maturité et dialogues tardifs. En ce qui concerne les dates d’écriture, cette information, impossible à connaître avec certitude, n’a plus aucun intérêt dans mon hypothèse où elle ne peut plus servir à situer le dialogue dans la supposée « évolution » de Platon, puisque les dialogues n’accompagnent pas cette évolution « en temps réel », mais proposent une progression à visée pédagogique qui est justement balisée par le plan d’ensemble et fixée par avance.
AP : C’est une démarche sur le plan rationnel très satisfaisante ; mais je me demande toutefois si les commentateurs n’ont pas tendance à être plus cohérents que les auteurs eux-mêmes. Je veux dire par là que l’exigence de cohérence que l’on adresse à l’endroit des philosophes est peut-être égarante, en ceci qu’elle revient à ériger en principe le refus des errances, des erreurs, des sophismes, voire des contradictions grossières. Nous aimerions tous que les philosophes pour qui nous nourrissons une certaine admiration soient d’une rigueur absolue mais je me demande souvent si ce n’est pas un préjugé de commentateur qui revient à reconstruire une logique bien plus précise que celle qu’a réellement respectée le philosophe étudié.
BS : Comme je l’ai déjà dit, je ne refuse pas à Platon le droit à « des errances, des erreurs, des sophismes, voire des contradictions grossières » au cours de sa vie, mais je remets en cause l’idée qu’il aurait « publié » ses dialogues tout au long de sa vie. Il est en effet très difficile d’imaginer qu’il n’aurait pas changé d’opinions et n’aurait commis aucune erreur sur une période d’une cinquantaine d’années, mais dès lors qu’on suppose qu’il a écrits ses dialogues comme un tout à partir d’un plan initial établi dès le départ, au moins dans ses grandes lignes, il devient plus vraisemblable, je dirais même presque nécessaire, qu’il l’ait fait sur une beaucoup plus courte période à la fin de sa vie et l’idée qu’il n’ait pas changé d’avis, au moins sur les grands principes d’ensemble, sur cette période devient beaucoup plus acceptable. Je reprends l’exemple de Thomas d’Aquin et de sa Somme théologique. Un professeur qui a enseigné pendant des années de manière scolaire des matières conséquentes et ardues, nous a montré qu’il avait été parfaitement possible pour lui de mettre en forme ces matières dans un ouvrage de grandes dimensions, mais parfaitement structuré selon un plan d’ensemble fixé d’avance, sur une période de plusieurs années à la fin de sa vie, et à une époque où les moyens techniques de rédaction étaient plus proches de ceux de l’époque de Platon que de ceux de la nôtre. Et, si mes suppositions sont bonnes, Platon avait un avantage sur Thomas, c’est qu’il ne s’imposait pas par son plan tel que je le suppose les détails de chaque volume de l’ensemble, ni même la scénographie de chaque dialogue, mais seulement des thématiques qui lui laissaient ensuite toute liberté de fixer le moment venu la mise en scène et la liste des intervenants de chaque dialogue. Et si en plus, il avait décidé de ne pas les laisser sortir de l’Académie avant que l’ensemble soit terminé, il se laissait même la possibilité de retoucher les premiers écrits au fur et à mesure qu’il avançait, et aussi de ne pas les écrire dans l’ordre où ils devraient être lus.
Les universitaires contemporains imaginent Platon sur le modèle qui est le leur, celui de personnes qui doivent publier régulièrement pour se faire connaitre, se faire embaucher, faire progresser leur carrière et éventuellement arrondir leurs fins de mois avec des droits d’auteur. Mais, outre le fait que la notion de « publication » n’avait rien à voir au temps de Platon avec ce qu’elle est aujourd’hui, là n’était pas son problème. Il était le fondateur de l’Académie et donc son propre « patron », si l’on veut raisonner en termes modernes. Une des motivations qui aurait pu l’amener à « publier » est de faire de la publicité pour son Académie et d’en augmenter le recrutement. Mais tout ce que ses dialogues laissent deviner est qu’il ne cherchait pas le nombre, mais la qualité des « recrues » et que donc, une « publicité » non ciblée ne lui apportait rien, ou presque rien, par rapport à des conférences et du bouche à oreille (qui fonctionnait pas mal à l’époque, même sans Internet, puisque, pour ne citer qu’un exemple, Alcibiade, voguant vers la Sicile avec l’expédition qu’il avait vendue à Athènes et dont il était parvenu à se faire désigner comme l’un des chefs, a pu apprendre à temps pour fuir et passer à l’ennemi, Sparte, qu’Athènes était revenu sur sa décision de le nommer chef, l’avait finalement condamné à mort dans des affaires antérieures à son départ qu’il serait trop long d’exposer ici et avait envoyé à sa poursuite une expédition pour le ramener à Athènes). Et puis quelle publicité pouvait constituer des dialogues qu’on qualifie aujourd’hui d’aporétiques, c’est-à-dire semblant finir sur un échec, ou un dialogue comme le Ménéxène, où il semble se prendre au jeu de ceux qu’il avait précédemment abondamment critiqués, ou un dialogue comme le Parménide, où il viendrait dire au monde que finalement il s’était trompé dans ses publications antérieures mais n’avait pas de solution de rechange à proposer ?!…
Cela étant, le schéma d’organisation que je présente, en étant parfaitement conscient de ce que ce n’est qu’une hypothèse indémontrable, tout comme les hypothèses tout aussi indémontrables de ceux qui en restent aux trois périodes sur cinquante ans, qui n’ont pour elles que la relative unanimité à leur égard des spécialistes formatés dans ce moule depuis le début de leurs études, a pour sa défense plusieurs arguments. D’abord, il prend en compte tous les dialogues d’une manière cohérente. Ensuite il permet de lever pas mal de difficultés résultant de l’autre cadre interprétatif. Et il conduit à une lecture cohérente des dialogues. Il est plus en phase avec l’esprit du temps de Platon, où l’on n’était pas aussi « pressés » par le temps que maintenant, où l’on pouvait prendre le temps de « bien » faire ce que l’on faisait et où les bâtisseurs avaient été capables de mettre au point des principes de construction qui permettaient de corriger les effets de perspective dans le dimensionnement des colonnes de leurs temples. Plus en phase aussi avec ce qu’ils nous laissent deviner de leur auteur, qui n’était manifestement pas pressé de faire part au monde de « théories » qui auraient été les siennes et qui concevait un écrit comme un tout organisé sur le modèle d’un vivant, comme il le dit en Phèdre, 264c2-5. Alors, certes, on peut penser que tout ce que je crois découvrir dans les dialogues est le fruit du hasard et non pas de la volonté de Platon, tout comme on peut penser que les « lois » qui semblent régler l’Univers sont le fruit du hasard, mais en même temps, certaines de ces lois nous disent que le hasard est rarement producteur d’ordre. Et il me semble qu’il y a une limite à ce que peut produire le hasard en termes d’organisation et de cohérence.
Certes, il peut m’arriver d’aller trop loin et de prétendre découvrir sur des points précis des « intentions » auxquelles Platon n’avait jamais pensé, mais ces cas ne remettent en général pas en cause le gros du cadre interprétatif que je propose. Par exemple, Platon a-t-il été jusqu’à compter les lignes, ou les tablettes, ou les rouleaux, pour s’assurer que le milieu physique de son ouvrage tombait à la fin du Phédon, c’est-à-dire à la mort de Socrate ? On peut en discuter, mais cela ne remet pas en cause le schéma d’ensemble ; Platon a-t-il vu toutes les leçons qu’on pouvait tirer de sa représentation dans l’allégorie de la caverne des ideai par des astres, représentation qui lui était pratiquement imposée dès lors qu’il avait choisi de représenter l’idea du bon par le soleil, comme le fait que tous les astres se ressemblent puisqu’ils sont tous des point lumineux, comme les ideai purement intelligibles, qui n’ont ni forme, ni couleur, ni rien de sensible, sur lequel notre esprit puisse se fixer pour les distinguer, et que les étoiles ne peuvent être identifiées que par leur position relatives les unes par rapport aux autres, tout comme les ideai ne peuvent être comprises qu’à partir des relations qu’elles entretiennent les unes avec les autres représentées par les liens entre mots dans des logoi ? On peut légitimement en douter, mais ça ne remet pas en cause le fait que ces astres représentent les ideai, ni plus généralement les clés d’interprétation de l’allégorie que j’ai résumées tout à l’heure.
Une autre question est celle de savoir quel degré de dépendance il y a entre le plan d’ensemble des dialogues que je propose comme étant celui voulu par Platon et l’interprétation des idées qui y sont présentées à laquelle j’arrive. Dit autrement, y a-t-il une quelconque dépendance entre ce plan et, par exemple, ma compréhension de l’allégorie de la caverne, ou ma lecture du Sophiste ? Sans doute aucune ! Quelqu’un aurait très bien pu arriver à la même compréhension de l’allégorie de la caverne en restant dans le cadre interprétatif classique, puisqu’il ne s’agit que de comprendre une image spécifique dans un dialogue particulier. Ce n’est que lorsqu’on cherche à mettre en perspective une telle interprétation « locale » avec d’autres dialogues que ça peut changer quelque chose. Il n’en reste pas moins que mon cadre interprétatif « débroussaille » considérablement le champ d’exploration en le débarrassant de multiples problèmes qui l’encombrent aujourd’hui comme les problèmes de datation des dialogues, de leur ordre de lecture et de l’« évolution » supposée de la pensée de leur auteur, laissant plus de temps libre pour chercher à comprendre ce qu’a voulu dire Platon, sans toutefois pouvoir se réfugier derrière l’idée d’évolution de sa pensée pour s’éviter de chercher une cohérence qui n’est pas toujours évidente, mais dont la découverte peut s’avérer fructueuse (comme par exemple la compréhension nouvelle de l’allégorie de la caverne que je propose, qui fait un sort à la « théorie des deux mondes »). Plutôt donc que supposer des « évolutions » de Platon, il faut de demander à quel niveau de compréhension et de progression il suppose qu’en est arrivé le lecteur lorsqu’il aborde pour la première fois le dialogue étudié, ce qui permet d’expliquer des « imprécisions » dans l’expression, des simplifications, des « impasses », dont certaines pourraient passer, dans un autre cadre interprétatif, pour des contradictions.
AP : On voit dans cette organisation une place prépondérante accordée à la question politique. Comment justifiez-vous cette dernière ?
BS : Platon, comme il le dit dans son « autobiographie » au début de la Lettre VII, était né dans une famille qui devait le conduire à faire de la politique au plus haut niveau. Écœuré encore jeune par la manière dont il a vu ses parents et ses concitoyens pratiquer la politique, et interpelé par la rencontre et la fréquentation de Socrate, plutôt que de prendre le risque d’être tué ou assassiné en se jetant dans la mêlée, a préféré prendre du recul mais n’a pas pour autant renoncé à faire de la politique. Il a compris que tout passait par une autre manière de former ceux qui se destinaient à gouverner et a donc préféré devenir un éducateur de politiciens plutôt qu’un politicien lui-même. En parallèle, il a cherché à mettre en pratique le gnôthi sauton (« Apprends à te connaître toi-même ») dont Socrate avait fait l’une de ses devises, compris comme ne signifiant pas tant « Apprends à te connaître en tant que Platon » que « Apprends à te connaître en tant que tu es un être humain et cherche quelle est l’excellence (aretè) propre à un tel être et quelles sont tes aptitudes spécifiques pour tenter d’atteindre cette excellence ». Et sa réflexion sur les fonctions d’un dirigeant à la lumière de ses expériences de jeunesse l’ont amené à comprendre que l’être humain (homme ou femme) étant défini par son statut d’animal destiné à vivre en société et son aptitude au logos, la tâche la plus noble, mais aussi la plus difficile, pour un être humain était de gouverner ses semblables en faisant pour cela le meilleur usage possible de son logos (aptitude à la parole autant que raison) et que l’aptitude à cette fonction dépendait à la fois de dispositions naturelles particulièrement rares et de l’éducation reçue. Le cas particulier d’Alcibiade, qui disposait de tous les atouts (sauf de la maîtrise de soi) et a tout gâché en ne sachant se maîtriser et en subissant la mauvaise influence de son entourage, lui a montré que ceux qui pouvaient être les meilleurs pour le bon moyennant une éducation appropriée pouvaient aussi devenir les meilleurs pour le mal sans une telle éducation, comme il le suggère en République VI, 494b5-4957, sans jamais nommer Alcibiade, mais dans des termes qui ne laissent aucun doute sur le fait que c’est à lui qu’il pense en particulier (on peut même y lire une allusion à peine voilée à la conversation décrite dans l’Alcibiade). Et s’il ne pouvait rien sur les dispositions naturelles des uns et des autres, sinon chercher à apprendre à les reconnaître chez ses semblables, il pouvait quelque chose sur la formation des candidats dirigeants, d’où l’Académie et, pour que tout ne soit pas perdu de son expérience à sa mort, les dialogues comme testament.
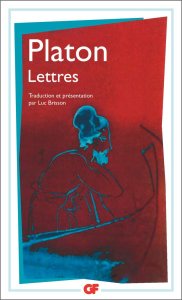
Conclusion
AP : J’aimerais vous poser, pour finir, une ou deux questions concernant sinon la postérité, à tout le moins les successeurs de Platon, et notamment Aristote. J’ai le sentiment que, à bien des reprises, nous plaquons le sens aristotélicien des mots sur les concepts platoniciens, ce qui crée parfois de graves confusions ; sans doute l’ousia en est-elle un bon exemple. Mais, de manière générale, comment jugez-vous le rapport d’Aristote à Platon ?
BS : Comme je l’ai déjà dit, Platon avait infiniment mieux compris Aristote, ses potentialités et ses défauts, qu’Aristote n’avait compris Platon. Il serait donc infiniment plus profitable, plutôt que de lire Platon à la lumière d’Aristote, de lire Aristote à la lumière de Platon, car presque toutes les bonnes idées d’Aristote viennent de Platon, à ceci près que, comme Platon ne donnait pas les réponses, mais laissait ses auditeurs les trouver par eux-mêmes, Aristote croyait qu’elles étaient de lui. Dans une petite monographie sur Aristote datant de 1919,[2] le célèbre philosophe anglais spécialiste de Platon A. E. Taylor a écrit à propos d’Aristote : « Aristotle is always anxious to insist on the difference between his own doctrines and those of Plato, and his bias in this direction regularly leads him to speak as though he held a thoroughgoing naturalistic and empirical theory with no “transcendental moonshine” about it. Yet his final conclusions on all points of importance are hardly distinguishable from those of Plato, except by the fact that, as they are so much at variance with the naturalistic side of his philosophy, they have the appearance of being sudden lapses into an alogical mysticism… He is everywhere a Platonist malgré lui,[3] and it is just the Platonic element in his thought to which it owes its hold over men’s minds ». Je suis entièrement d’accord avec lui sur ce point !
D’ailleurs, pour qui sait les chercher, on trouve dans les dialogues pas mal de « messages » adressés à Aristote. J’ai déjà évoqué le cas du Parménide, le plus « voyant », mais on pourrait aussi citer la dernière proposition de définition du logos à la fin du Théétète, par la différence (Théétète, 208c7, sq.), allusion à la définition aristotélicienne par le genre et la différence spécifique. Et pour revenir au Parménide et à ousia, auquel vous faites allusions dans votre question, il est intéressant de noter que le Parménide est le dialogue dans lequel ce mot est de loin le plus fréquent (59 occurrences, toutes dans la bouche de Parménide, toutes sauf trois dans la seconde partie du dialogue et toutes dans un sens « métaphysique », sur un total de 257 dans l’ensemble des 28 dialogues de mes tétralogies, dont 59 dans le sens usuel de « fortune, avoirs » ; le dialogue qui arrive en second est la République, avec 39 occurrences, dont 17 dans le sens usuel, ce qui n’en laisse que 22 dans un sens « spécialisé »), alors même que nous ne savons pas s’il faisait partie du vocabulaire de Parménide puisqu’il n’apparaît nulle part dans les fragments conservés de son ouvrage. Dans la continuité de ce que j’ai dit plus haut du choix d’un interlocuteur nommé Aristote pour « répondre » à Parménide dans son « jeux laborieux », je ne peux m’empêcher de voir là une pique de Platon à l’égard d’Aristote, cherchant à lui dire : « Mon petit Aristote, il ne suffit pas de changer un mot lorsque tu présentes la pensée d’un autre et de le remplacer par un mot extrait de ton vocabulaire, ce dont tu es coutumier, pour en faire un de tes précurseurs (moins doué que toi, bien sûr, puisqu’il est resté en chemin !) Il faut chercher à comprendre chaque penseur dans sa propre (in)cohérence et les mots qu’il emploie dans le sens que lui leur donne, en s’assurant qu’il n’en change pas d’une fois sur l’autre, comme le fait justement sans prévenir mon Parménide d’une démonstration à l’autre avec einai ! »
Concernant les idées pêchées par Aristote chez Platon, je prendrai l’exemple du Timée : dans ce dialogue, Platon, sans le dire explicitement, propose quatre manières d’« expliquer » l’homme : en tant qu’un être matériel comme un autre, donc fait comme tout le reste à partir des triangles élémentaires (la vision du « physicien ») ; en tant que doté d’un corps organisé, œuvre des dieux subalternes auxquels le démiurge a confié cette tâche en leur confiant l’âme humaine et qui en font le « plan » (la vision du « biologiste ») ; en tant que doté d’une âme, créée par le démiurge (la vison du « psychologue ») ; enfin en tant qu’artisan de lui-même ayant la justice pour « idea/idéal » et devant donc réaliser en lui l’unité intérieure de son âme composite du fait de son « incarnation » de manière à pourvoir ensuite vivre en harmonie avec ses concitoyens (la vision du « philosophe »). En fait, dans le Timée, ces quatre approches de l’homme, sont présentées dans l’ordre exactement inverse de celui dans lequel je les ai listées, et la quatrième de ma liste, donc la première dans le dialogue, est présentée à travers le rappel au tout début du dialogue des idées de la République sur la justice et non pas de sa matérialité (autres interlocuteurs, autre lieu, autre festivités permettant de situer le dialogue dans le temps), comme pour montrer justement que ce sont les idées et non les mots spécifiques employés par des personnes spécifique à des moments spécifiques dans des lieux spécifiques qui importent. Et ce rappel est fait avant que commence le mythe, avant donc la création du temps comme image mobile de l’éternité, pour suggérer que les idées sont en dehors du temps. Quel rapport avec Aristote ? Eh bien tous simplement qu’à travers ces quatre visions de l’homme, on trouve ce qui deviendra les quatre causes chez Aristote : la matière (les triangles), la cause instrumentale (les dieux subalternes fabriquant les corps, ou au moins leur « plan »), la forme (l’âme) et enfin la cause finale (la justice comme idea/idéal de l’homme).
AP : Nous avions évoqué en début d’entretien votre connaissance du néoplatonisme. Est-ce que des philosophes comme Plotin ou Proclus sont en mesure d’entendre encore le sens que Platon prêtait aux mots ?
BS : Avant de répondre, je précise que ma connaissance des néoplatoniciens est très limitée : j’ai lu il y a longtemps les Ennéades et quelques ouvrages de Proclus, mais je n’ai pas vraiment accroché tant leur approche de Platon teintée de mysticisme me semblait loin des intentions de Platon telles que je les comprenais.
Venons-en maintenant à votre question qui, me semble-t-il, rejoint une de vos précédentes questions sur la possibilité de traduire aujourd’hui Platon. Dans les deux cas, la question porte sur la possibilité pour les penseurs d’un lieu et d’une époque donnée de comprendre le langage d’un penseur d’un autre lieu et d’une autre époque, voire parlant une langue différente. Ma réponse à votre question antérieure répond donc en partie à cette question. Pour moi, comme je l’ai dit alors, il n’y a là aucune impossibilité, pourvu qu’on s’en donne les moyens et qu’on fasse les efforts nécessaires, et surtout qu’on cherche à comprendre les idées au-delà des mots, ce qui, dans le cas de Platon, est facilité par le fait qu’il était parfaitement conscient de ce problème et a écrit en conséquence sans jamais chercher à donner aux mots des sens « techniques ». Concernant les néoplatoniciens, la question ne me semble donc pas de savoir s’ils étaient en mesure de le faire, si cela leur était possible, mais si c’est bien ça qu’ils cherchaient à faire et s’ils se donnaient les moyens d’y parvenir, ou s’ils étaient plutôt dans une démarche, somme toute assez fréquente à toutes les époques, consistant à reformuler la pensée d’un auteur antérieur et prestigieux de manière à la mettre en accord avec des idées qu’on avait déjà avant d’aborder cet auteur, comme l’avait fait Aristote, non seulement à propos de Platon, qu’il avait pourtant longuement côtoyé, mais à propos de tous ses prédécesseurs et contemporains. Et je pense en plus que, dans le cas des néoplatoniciens, la réponse ne sera pas la même si l’on parle des précurseurs qui ont forgé cette « doctrine » ou de ceux qui sont arrivés après et avaient devant eux une relecture de Platon déjà bien formalisée et se trouvaient un peu dans la même situation par rapport à Platon que des étudiants à la Sorbonne au XIIIème siècle abordant Aristote à travers ce qu’en disait Thomas d’Aquin. Or il me semble que les néoplatoniciens ne cherchaient pas vraiment à comprendre Platon dans ses termes, mais à extraire de ses œuvres une doctrine et une mystique qui puisse tenir la route face aux doctrines développées par les intellectuels gnostiques et chrétiens, par exemple les discours sur le mystère de la Trinité.
[1] Dans son ouvrage intitulé La composition stylistique, parfois appelé aussi De l’arrangement des mots (Peri suntheseôs onomatôn en grec, De compositione verborum en latin), Denys d’Halicarnasse, rhéteur et historien grec du Ier siècle avant J.C., écrit que « Platon, ayant atteint l’âge de quatre-vingts ans, ne cessait pas de peigner et de friser ses dialogues et de les tresser de toutes les manières possibles » (La composition stylistique, 25, 32). Et il continue en faisant référence à des histories connues de tous selon lesquelles en particulier on aurait retrouvé après la mort de Platon une tablette de cire sur laquelle figuraient plusieurs versions de la première phrase de la République.
[2] A. E. Taylor, Aristotle, Dover Pub. Inc., New-York, 1955, réédition d’une édition de 1919.
[3] En français dans le texte.