Franck Fischbach est un philosophe français né en 1967, professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis. Son oeuvre constitue une contribution importante à la philosophie sociale autant qu’à l’élucidation de l’idéalisme allemand (Fichte, Hegel, Schelling). Il vient de publier La critique sociale au cinéma, Vrin, 2012.
Les propos ont été recueillis par Frédéric Porcher.
Actu-Philosophia : Franck Fischbach, vous êtes spécialiste de l’histoire de la philosophie allemande et de philosophie sociale, style philosophique longtemps méconnu en France dont vous avez défini les grands caractères dans votre Manifeste pour une philosophie sociale1.
À vous lire, on a le sentiment que votre travail a ceci d’original qu’il cherche à penser la société de notre temps en mobilisant un corpus philosophique extrêmement divers (G. Deleuze, M. Foucault, J. Rancière mais aussi S. Žižek, J. Butler, G. Agamben etc.), même si vos deux sources matricielles restent Marx et Heidegger. Ce qui m’amène à vous demander de préciser en quel sens vous faites de l’histoire de la philosophie ; je pense à votre travail de retraduction et de réinterprétation de Marx ou encore à la conclusion de Sans objet[On peut en lire une recension [ici. [/efn_note] qui parlait de « reconstituer une tradition philosophique »2. Comment, c’est-à-dire selon quelle méthodologie ou herméneutique, déchiffrez-vous le présent à partir d’un tel travail de lecture de la philosophie ?
Franck Fischbach : Je peux vous dire en quel sens, de quelle manière ou dans quel esprit je fais de l’histoire de la philosophie, mais ma réponse aura cela de décevant qu’elle n’en appelle pas à une méthodologie en bonne et due forme que j’aurais commencé par établir. J’y viendrai peut-être un jour, mais pour le moment je ne dispose pas d’une telle méthodologie, et encore moins d’une herméneutique. En revanche, je peux vous dire que j’ai toujours pratiqué l’histoire de la philosophie avec un œil sur les textes des classiques et un œil sur les enjeux du présent, c’est-à-dire de notre temps. J’ai toujours traité les auteurs sur lesquels j’ai travaillé comme des contemporains ou des quasi-contemporains, en étant persuadé qu’ils avaient non seulement des choses à dire sur notre époque, mais qu’ils pouvaient nous être utiles pour mieux comprendre ce qui s’y passe et en quoi elle consiste. Et par mes écrits, je tente de faire partager cette conviction qui est la mienne : je souhaite que les lecteurs puissent se dire qu’on peut donc lire Fichte, Marx ou Heidegger de telle manière que leurs textes, y compris les plus techniques, apportent une contribution importante à notre compréhension des enjeux politiques, sociaux, culturels de notre temps, et peuvent éventuellement même orienter une action. Si je cite le nom de Fichte, c’est dans la mesure où c’est à son sujet que j’ai commencé à mettre en œuvre cette démarche qui est la mienne, dans un des mes premiers ouvrages (aujourd’hui épuisé) qui portait sur le concept de « reconnaissance » (La reconnaissance. Fichte et Hegel, PUF, Paris, 1999): ce n’est quand même pas rien que quelqu’un qui, comme Axel Honneth, tente aujourd’hui de penser le social à partir ou en fonction des attentes de reconnaissance (et de faire une critique du social à partir de la déception de ces attentes de reconnaissance), ne puisse le faire qu’en convoquant un vieux concept élaboré deux siècles plus tôt par Fichte puis Hegel. Là est selon moi la différence entre une histoire des idées et l’histoire de la philosophie : la première se satisfait de savoir qui a pensé quoi à telle époque, la seconde veut en outre savoir si c’est encore utile pour nous aujourd’hui, c’est-à-dire si cela nous sert à penser notre temps.
La privation de monde : la thèse et ses implications
AP : À première vue, votre dernier livre, La privation de monde3, poursuit la thèse défendue dans Sans objet en ce que vous y approfondissez le sens de l’aliénation comme « perte du monde » ; l’aliénation étant, selon vous, le trait le plus essentiel de notre société moderne de type capitaliste. Mais, en réalité, il me semble que votre ligne d’argumentation n’est plus tout à fait la même puisque vous resserrez ici l’analyse de l’aliénation sur son présupposé fondamental qui est, selon vous, l’existant humain (Dasein) dont la structure, mise au jour par Heidegger, est l’être-dans-le monde (in-der-Welt-sein). Ce qui donne à votre livre une tournure peut-être plus fondamentalement ontologique. Pourriez-vous expliquer cette différence d’approche entre ces deux livres ?
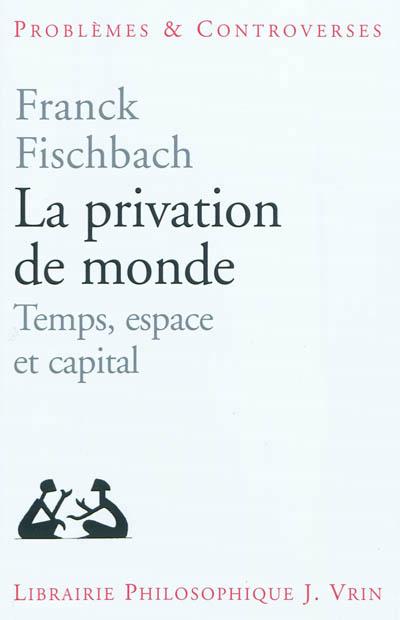
FF : Je vois ce que vous voulez dire : tout se passerait un peu comme si, dans Sans objet, j’avais tenu un discours relevant de la philosophie sociale ou de la critique sociale, voire de la théorie critique, alors que je serais passé à un discours relevant de l’ontologie dans La privation de monde, notamment parce que, comme vous le signalez fort justement, j’y fais usage du concept d’existant (Dasein). Ceci dit, je pense que toute dimension d’ordre ontologique n’était pas absente de Sans objet. Mais il est vrai qu’il n’y était pas question du Dasein, de l’existant que nous sommes. Pour autant, ce thème plus ontologique ne fait pas disparaître la dimension de philosophie sociale du propos : d’abord parce que le Dasein est toujours aussi un Mitsein, un être-avec, et donc pas un être isolé des autres (au contraire un existant est toujours auprès des autres existants, et l’existence est autant une dimension du toi, du moi que du nous) ; ensuite parce que la dimension de l’existence à laquelle je me consacre ici est celle du monde, et que le monde est toujours un monde pour nous ou à nous, pour une collectivité ou pour une génération (de sorte que la privation de monde est d’emblée un problème collectif ou social) ; enfin parce que c’est bien toujours d’une question relevant de la philosophie et de la critique sociales qu’il s’agit, aussi bien dans Sans objet que dans La privation : à savoir la question de l’aliénation.
AP : Le problème qui traverse l’ensemble de La privation de monde vise à comprendre le processus, en apparence paradoxal, qui fait que la mondialisation donne lieu à une privation de monde ainsi qu’à son « expropriation ». À quoi vous ajoutez une remarque extrêmement importante pour comprendre la portée et l’originalité de cette thèse, à savoir qu’elle n’offre aucun repli possible : la privation de monde concerne la « condition actuelle de l’homme »4 ; le monde ne sort donc pas indemne du processus, et c’est la réalité sociale en son ensemble qui se trouve dès lors grevée par cette privation. Partant de là, le monde ne nous est donc plus accessible autrement que sous sa forme privative, ce que vous souligniez déjà dans Sans objet en disant que « la perte du monde réel a emporté avec lui tous les mondes possibles » (p. 9), et que c’est donc notre lien avec le monde (réel et possible) qui se trouve perdu. Or la radicalité de cette thèse s’expose à de multiples paradoxes, au premier rang desquels un paradoxe intra-philosophique. Car, au fond, quelle place votre discours occupe-t-il dans ce diagnostic sur la réalité sociale dans laquelle vous vivez ? S’agit-il d’une position de surplomb, ce dont je doute, mais alors où vous situez-vous vous-même par rapport à la réalité sociale que vous décrivez ?
FF: Compte tenu de ce que j’ai pu écrire notamment dans mon Manifeste pour une philosophie sociale, vous avez tout à fait raison de penser que la position du discours que je tiens ne peut absolument pas à mes yeux être de l’ordre du surplomb. Pour moi le discours philosophique fait lui-même partie du monde, de la réalité historique et sociale : ce n’est pas un discours extérieur au monde. Faire de la philosophie, c’est bien une certaine manière de tenter d’être dans le monde, et de tenter d’y être avec et parmi les autres. J’aime cet aphorisme où Brecht dit ceci : « la pensée comme comportement social ; n’a de perspective que si elle est informée du comportement du monde qui l’entoure ; que si elle est en mesure d’influencer ce monde »5. Mais il n’est pas besoin d’être brechtien, ni même marxien pour penser cela ; il suffit de se rappeler que Fichte déjà (encore lui) estimait que la position du philosophe ne devait pas (ou plus) être celle d’un maître de vérité qui surplombe la conscience commune, mais celle d’un allié qui est aux côtés de la conscience commune. Si, en face des systèmes philosophiques qui « déclarent la pensée commune insuffisante pour la conduite de la vie », il s’en présentait un « se faisant fort d’établir qu’il n’y a rien de fécond pour la vie en dehors de la pensée commune, qu’on n’apprend la vie qu’en vivant, non en spéculant, considérerais-tu ce dernier système, demande Fichte à un représentant de la pensée commune, comme ton ami ou comme ton ennemi? Croirais-tu qu’il veut t’imposer de nouvelles chaines, et non pas plutôt qu’il veut te débarrasser de celles que tu as? »6. Ce texte de Fichte a pour moi une valeur fondatrice (comme Qu’est-ce que les Lumières ? de Kant en avait une pour Foucault) : il inaugure une pratique de la philosophie qui s’inscrit pleinement dans le monde, et une conception de la philosophie comme compréhension et clarification du contenu de la conscience commune.
Ceci étant dit, votre question est de savoir si je ne me contredis pas ou si je ne contredis pas la conception de la philosophie que je viens de rappeler lorsque je tiens un discours au sujet de la perte du monde ou de la privation de monde comme caractéristique de notre présent. Qui suis-je pour dire cela ? Où dois-je me situer pour pouvoir dire cela? Serais-je donc en possession d’un savoir ou d’une conscience que personne d’autre ne posséderait? Ce serait déjà une contradiction avec le type de philosophie dont je me réclame. Mais il y a plus grave : comment puis-je dire que la privation de monde est une aliénation, sinon en posant l’être-dans-le-monde comme une structure qui nous est essentielle ? Et comment puis-je poser l’être-dans-le-monde comme essentiel si je dis en même temps que ce qui caractérise notre temps, c’est justement que nous n’avons plus l’expérience de l’être dans le monde? Je répondrai à partir d’une phrase de Christophe Dejours que j’ai mise en exergue du dernier chapitre de La privation de monde : « Le monde du travail aujourd’hui, écrit Dejours, ne peut être reconnu comme un monde ; ceux qui l’habitent de nos jours y font plus que naguère l’expérience du désert et de la désolation »7. Cette proposition de Dejours témoigne du fait que les acteurs sociaux vont vers la réalité sociale et qu’ils prennent part à la vie sociale avec des attentes de réalisation et de satisfaction dont ils peuvent être conduits à expérimenter différentes formes de déception. Mon propre propos part de cela : les individus escomptent que la réalité sociale soit ou forme pour eux un monde, c’est-à-dire un ensemble relativement sensé dans lequel ils parviennent à trouver des formes de satisfaction, et ils sont nombreux à être amenés à constater que cette attente est déçue. En d’autres termes, mon propos ne s’appuie pas sur le constat de la non-existence d’un monde, mais sur le fait que les individus attendent un monde, escomptent leur propre inscription dans un monde, et font l’expérience de ce que cette attente, dans les circonstances actuelles, n’est pas satisfaite ou bien est très souvent déçue. Mon discours n’est donc évidemment pas celui d’un théoricien quasiment héroïque qui serait le seul à avoir encore accès à la dimension du monde dans une époque qui priverait tous les autres de monde. Je suis simplement quelqu’un qui, parmi les autres, escompte que sa réalité sociale lui soit ou lui redevienne un monde, qui, comme beaucoup d’autres, constate que ce n’est pas le cas pour le moment, et qui, avec quelques autres, se demande pourquoi.
AP : La radicalité de votre thèse, enfin, ne congédie-t-elle pas par avance tous les courants dits altermondialistes puisqu’il est impossible, si l’on vous suit, d’adopter sur le monde un autre point de vue que celui par lequel nous en sommes privés, autrement dit de faire jouer un monde contre un autre ?
FF : Faire jouer un monde contre un autre, opposer un monde possible au monde réel suppose que notre réalité actuelle soit encore elle-même un monde. Or c’est là ce dont je doute. Il ne s’agit pas pour moi d’opposer un autre monde à notre monde d’aujourd’hui, mais de savoir si notre réalité d’aujourd’hui peut ou non devenir un monde. Je ne désespère pas complètement que ce soit possible, mais je reste quand même assez sceptique parce qu’il me paraît que les puissances qui nous privent de monde sont d’une puissance colossale. Ce sont les puissances d’abstraction, au sens où il s’agit de puissances qui nous privent de tout monde en nous en abstrayant, en faisant de nous des sujets séparés de tout monde. Et au premier rang de ces puissances d’abstraction, il y a la puissance de valorisation, c’est-à-dire celle qui transforme en valeur quantifiable tout ce qu’elle touche : en donnant à la puissance de la valorisation une ampleur sans aucun précédent historique, la mondialisation financière ou la mondialisation par la financiarisation s’avère être le processus même de l’abstraction comme démondanéisation. J’y reviendrai peut-être dans la suite, mais sans doute est-il déjà possible de comprendre ici le rôle que je fais jouer au travail au terme de mon livre La privation de monde : c’est parce que le travail est aujourd’hui le lieu même de la production de la valeur et de l’extraction de la survaleur, c’est parce que le travail a été jusqu’ici à la fois le lieu et le moyen par lequel s’est opérée à l’époque capitaliste la privation de monde (parce que cette époque est celle qui fait des travailleurs les supports d’une puissance abstraite de travail coupée de tout lien avec un monde), c’est pour cela donc que le travail peut aussi être le lieu et le moyen de la reconquête d’un monde ; mais à la condition que l’on parvienne de nouveau à comprendre et à expérimenter le travail comme l’activité même de notre insertion dans un monde. Je n’ai aucune garantie que cette condition puisse être remplie un jour : je sais seulement que nombreux sont encore aujourd’hui ceux qui escomptent que le travail leur soit un monde, c’est-à-dire le lieu et le moyen d’un accomplissement d’eux-mêmes.
« Compléter Heidegger et Marx l’un par l’autre »
AP : Le plan de votre livre se compose de quatre chapitres agencés sous la forme d’un chiasme. Vous commencez par Heidegger que vous « complétez » par Marx pour ensuite revenir au « terrain commun » à Marx et Heidegger, c’est-à-dire, nous y reviendrons, à la notion ontologique de travail. L’entame de la première partie de Sans objet était déjà consacrée à cette entreprise de « faire dialoguer Heidegger et Marx », mais ici votre démarche me semble sensiblement différente. Tandis que dans Sans objet, vous vous contentiez de juxtaposer les deux démarches (la perte du monde du côté heideggérien / la perte de l’objectivité du côté marxien), vous cherchez ici, comme vous le dites explicitement (p. 63), à « compléter » l’un par l’autre et réciproquement.
Pourquoi le dialogue (ou la rencontre) entre les deux philosophes est-il si important pour vous ? Est-ce qu’il manque quelque chose à l’un que seul l’autre peut nous apporter ?
FF: Vous n’avez pas tort du tout de penser que, dans La privation de monde, j’essaie en quelque sorte de compléter Heidegger et Marx l’un par l’autre. Mais pourquoi le faire, et surtout : peut-on le faire, ou quel sens cela a-t-il de compléter ainsi Marx par Heidegger et Heidegger par Marx ? La possibilité de le faire est sinon attestée du moins renforcée par le fait que d’autres l’on déjà fait ou ont tenté de le faire avant moi : c’est ce qu’avait déjà fait le philosophe tchèque Karel Kosik, trop oublié aujourd’hui, et, plus près de nous, c’est aussi ce qu’ont fait Reiner Schürmann et Gérard Granel. Mais alors en quel sens est-ce que je procède à mon tour à ce complément de l’un par l’autre? Je crois que ce sens est déterminé par le fait que, depuis La production des hommes (2005), je n’ai pas seulement deux interlocuteurs, mais trois : Marx, Heidegger et Spinoza.
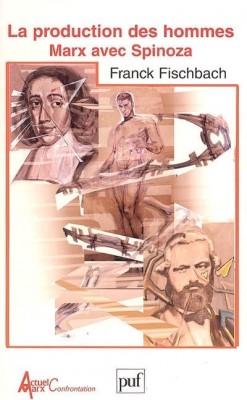
Au fond, c’est à partir de Spinoza que je procède au rapprochement et à la mise en dialogue de Marx avec Heidegger, et inversement. Pourquoi ? Parce que, pour le dire vite et donc assez schématiquement, si on s’en tient à Marx, on a bien la pensée d’une réalité sociale objective mais on ne voit pas comment cette réalité pourrait être pensée comme monde ; tandis que si on s’en tient à Heidegger, on a bien une pensée du monde, mais on ne voit pas comment ce monde peut aussi être une réalité sociale et historique existant objectivement : le monde semble même devoir être ici (chez Heidegger) pensé comme une structure de l’existant que nous sommes et pas comme une dimension de notre réalité historique et sociale. Donc, du côté de Marx, on a bien la réalité historique objective mais pas de monde ; et du côté de Heidegger, on a le monde, mais la réalité sociale existant objectivement semble assez lointaine. La référence à Spinoza est celle qui permet de penser le monde de manière non spiritualiste (alors que cette possibilité me semble être toujours présente si on s’en tient au seul Heidegger) : le monde, c’est la réalité objective elle-même en tant que totalité aussi bien naturelle que sociale et historique, ET c’est ce dans quoi nous existons nous-mêmes objectivement en tant que parties de ce tout (c’est-à-dire en tant que modes de la substance). Avoir le monde à la fois comme une réalité existant objectivement et comme une dimension de notre existence : c’est ce qu’on peut penser soit directement à partir de Spinoza, soit en complétant Marx par Heidegger et inversement. Au fond, j’ai besoin de Marx pour matérialiser le monde de Heidegger, et de Heidegger pour existentialiser la réalité sociale marxienne. Mais alors, me direz-vous, pourquoi ne pas revenir directement à Spinoza au lieu de tenter de l’obtenir indirectement par une étrange synthèse de Marx et de Heidegger ? C’est que ce n’est pas tout d’avoir un monde qui soit à la fois une réalité objective (Marx) et une dimension de notre existence (Heidegger), il faut encore qu’il ait un caractère historique ; et cette historicité se trouve chez ces deux post-hégéliens que sont Marx et Heidegger bien davantage que chez Spinoza.
Temporalité capitaliste : « tout changer en permanence précisément afin que rien ne change »
AP : Vous montrez que le diagnostic de Marx sur la temporalité capitaliste, mêlant indissociablement statisme et dynamisme, permet de reconsidérer les rapports entre révolution (ou rupture) et conservatisme ainsi que « le fonctionnement actuel, à fronts renversés, de l’échiquier politique » (p. 111) où réformisme et conservatisme passent l’un dans l’autre. Vous est-il possible de préciser ce type de relation réciproque ? En quel sens la temporalité capitaliste implique-t-elle à la fois rupture et conservatisme ? Enfin, n’est-ce pas là fondamentalement ce qui nous rend impuissants, comme vous l’affirmiez dans Sans Objet, à croire pouvoir changer un état du monde devenu pour nous intolérable ?
FF : En effet, je crois que nous assistons depuis une trentaine d’années (sans doute depuis Thatcher) à un fonctionnement politique à fronts renversés : alors que les partis du mouvement, de la réforme et du progrès étaient jusqu’aux années 70 les partis de gauche, tandis que les partis bourgeois étaient les partis de la conservation et de l’immobilisme, les choses se sont totalement inversées. C’est maintenant la droite qui n’a que le mot de « réformes » à la bouche, tandis que les partis de gauche et les syndicats apparaissent comme des incarnations de l’esprit de conservation, attachés à la défense des « droits acquis ». Ce renversement signe l’immense défaite idéologique subie par la gauche à la fin des années 70 et au début des années 80, une défaite à laquelle elle a malheureusement elle-même largement contribué. Je remarque cependant que, de façon significative, un terme a disparu à la faveur de ce renversement : c’est celui de « progrès » car la droite hésite quand même le plus souvent à présenter ses « réformes » comme autant de « progrès » – l’évidence du contraire étant quand même (encore) un peu trop forte. Mais cet effacement de l’idée de progrès est en lui-même hautement significatif : ce que nous avons de fait maintenant, ce sont des réformes qui ne sont pas des progrès… Qu’est-ce à dire, sinon que les néo-libéraux ont inventé la réforme qui ne change rien, la réforme précisément faite pour que rien ne change, la réforme qui sert à reproduire l’existant à l’identique, et même à le renforcer. C’est là une illustration de ce mélange de statisme et de dynamisme qui me semble caractéristique du régime capitaliste de temporalité : tout changer en permanence précisément afin que rien ne change. Mais ce ne sont là que les effets d’une structure sociale plus profonde, à mon avis caractéristique du mode de production capitaliste : en m’appuyant sur Marx et pour une part sur l’interprétation de M. Postone, je tente de montrer, dans La privation, que c’est le cycle même de la production capitaliste de la valeur qui implique que ce développement permanent des moyens de produire de la valeur soit mis au service de la reproduction à l’identique du cadre ou de la forme de la valeur elle-même.
AP : Si l’on vous suit, on se trouve aujourd’hui dans un espace mondialisé rivé au seul présent, et force est de constater qu’il n’y a donc plus ni histoire, ni temps. D’où la formule de Marx dans Misère de la philosophie que vous rappelez, et qui résume l’idéologie des économistes classiques : « (…) il y a eu de l’histoire, mais il n’y en a plus ». Cette lecture de Marx ne jette-t-elle pas un regard nouveau – même si c’est en quelque sorte a contrario – sur la thèse de la fin de l’Histoire, défendue en son temps par Fukuyama au sujet des démocraties modernes et libérales ?
FF : Rapportée à la temporalité propre aux sociétés capitalistes, c’est-à-dire, comme vous le rappelez, à une temporalité marquée par un éternel présent et par l’effacement de la dimension d’historicité, la thèse du Kojève des années 30, reprise par Fukuyama après la chute du Mur, prend en effet un autre relief. Elle devient en réalité pleinement compréhensible : en théorisant une fin de l’histoire et le règne d’un éternel présent, ces penseurs sont parvenus à exprimer dans la pensée une dimension réellement existante des sociétés de type capitaliste – à savoir la dimension en vertu de laquelle ces sociétés sont animées d’un incessant mouvement de reproduction du même, d’un dynamisme toujours au service du statisme, reléguant au passé et aux sociétés de type précapitaliste le dynamisme historique véritablement capable de nouveauté : c’est le « il y a eu de l’histoire mais il n’y en a plus » que vous citiez précédemment. La thèse de Kojève/Fukuyama exprime cette tendance des sociétés capitalistes à se considérer elles-mêmes comme l’aboutissement et donc l’achèvement du processus historique, comme le point donc à partir duquel il ne peut plus vraiment se produire historiquement quelque chose qui soit véritablement nouveau. Mais comprenons bien que la « fin de l’histoire » ne veut pas dire qu’il ne se passe plus rien : au contraire, il se passe constamment quelque chose, mais jamais rien de vraiment nouveau, et rien non plus qui soit digne d’être retenu plus que quelques semaines. La fin de l’histoire n’est pas la sérénité asiatique à laquelle pensait Kojève, au contraire : c’est plutôt une agitation permanente, une hystérisation du présent au profit d’une reproduction à l’identique de l’existant.
Pourquoi faut-il libérer le travail de son emprise par le capital ?
AP : Le dernier chapitre a ceci d’étonnant qu’après Marx, vous faites retour à Heidegger pour y défendre le « monde du travail » (Werkwelt) comme « lieu d’advenir de l’histoire » (p. 121). À travers ce dernier chapitre, vous rendez donc raison du dialogue entre Heidegger et Marx tout en esquissant la possibilité d’une sortie hors de la privation de monde par le travail.
Pour ce faire, vous vous appuyez sur une conception entièrement renouvelée et ontologique du travail (en référence à Marcuse notamment), et que vous opposez au travail salarié. Tandis que le premier spatialise et temporalise notre existence, le second est à la source de la valorisation du capital de telle sorte que c’est par un processus de captation du temps qu’il nous prive du monde.
Les deux formes de travail que vous prenez soin d’opposer sont-elles simplement homonymiques ? Existe-t-il finalement une commune mesure entre le travail concret et le travail abstrait ? Le travail est-il bien à la fois le poison et le remède de la privation de monde ?
FF : Vous avez raison : je mets en avant dans La privation une conception que l’on peut dire ontologique du travail, une conception qui fait de lui le vecteur de notre inscription dans le monde. Et en même temps je dis que le travail compris comme une capacité subjective de travail ou comme une puissance de travail est la condition même que prend notre privation de monde dans le système social de type capitaliste. Alors la question se pose en effet de savoir si ce sont deux choses réellement différentes qui portent le même nom, ou bien si ce sont deux formes que prend ou peut prendre un seul et même travail. Il n’est pas à exclure que j’ai pu avoir sur ce point des hésitations… Toujours est-il qu’aujourd’hui j’ai tendance à penser que le travail est un, substantiellement un, et qu’il peut prendre des formes non seulement différentes mais opposées et contradictoires. Mais, me direz-vous, cela ne fait que renforcer le problème : car comment le travail, le même travail pourrait-il être à la fois notre activité d’inscription dans le monde et le vecteur majeur de notre démondanéisation contemporaine ? La contradiction des caractérisations données ici du travail semble être telle qu’elle menace la cohérence, la consistance du support même de ces caractérisations, à savoir le travail. Je crois qu’on peut tenter de lever la difficulté de la manière suivante : le travail est bien fondamentalement et ontologiquement l’activité de notre inscription dans le monde, ce par quoi et grâce à quoi nous pouvons parvenir à être dans le monde ; quant au travail qui signe voire qui accomplit notre perte du monde, c’est le travail tel qu’il est incorporé au capital, c’est le travail tel qu’il est enrôlé à son service par le capital. Car c’est la logique capitalistique de la valeur et de la valorisation de la valeur qui fait du travail un travail abstrait, c’est-à-dire un travail rapporté à une simple puissance abstraite de travail dont on peut mesurer en unité de temps la quantité déposée dans un produit du travail, quantité elle-même constitutive de la valeur du produit en question. Le travail comme agent de la perte du monde, de la séparation d’avec le monde des sujets dépositaires d’une capacité de travail, c’est le travail dont le capital a pris possession et qu’il utilise comme facteur décisif de sa propre valorisation indéfinie. Ou comment le travail, c’est-à-dire l’activité même qui atteste notre finitude en nous inscrivant dans le monde, est transformée en l’activité indéfinie de valorisation de soi du capital.
AP : Allons plus loin : vous écriviez dans un ouvrage consacré aux fondements de l’ontologie moderne de l’agir, et ce en réponse à la lecture de Marx proposée par G. Granel qui avait le défaut, selon vous, d’assimiler trop rapidement l’ontologie marxienne à une ontologie de la production : « nous ne sommes pas certains qu’il faille encore maintenir le concept de « travail » pour comprendre ce « sens différent de l’existence » que Marx désigne comme Selbstbetätigung »8. Vous étiez donc conscient, à ce moment-là, de l’homonymie entre le concept de travail et celui de l’activité telle que Marx la défend, notamment dans les Manuscrits économico-philosophiques de 1844. Avez-vous changé d’hypothèse sur ce point et le cas échéant, pourquoi ?
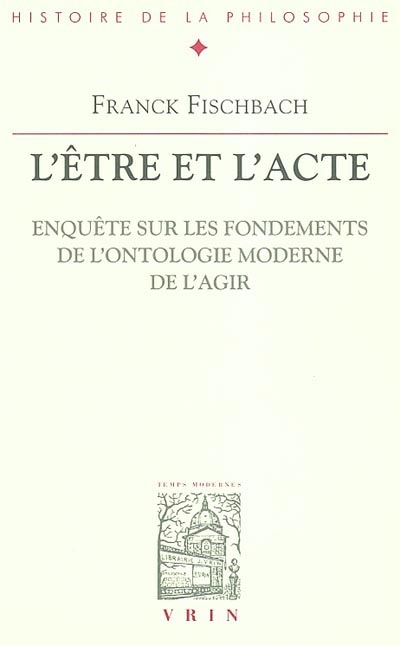
FF : Là encore, vous avez raison : il peut sembler, à première vue que j’aie changé de position au sujet du travail. Tout se passe comme si, à un moment, j’avais pensé que, au fond, il n’y a de travail à proprement parler que capitaliste, c’est-à-dire seulement sous le capitalisme (rejoignant ainsi une position proche de celle de M. Postone), et que ce que Marx appelle l’autoactivation, comme activité sociale libérée, ne devrait plus être appelée « travail » parce qu’il s’agirait de quelque chose de radicalement autre de ce que nous appelons aujourd’hui le travail. Je pense que ce serait une erreur de poser les choses en ces termes : il y a eu du travail avant le capitalisme, et il y en aura après. Ou plutôt : il y a eu des formes de travail ou bien une multiplicité de travaux avant le capitalisme, et le capitalisme est ce système économique non pas qui a inventé le travail, mais qui a unifié les travaux humains dans une seule catégorie abstraite de travail. C’est ce que Marx explique dès le chapitre 1 du livre 1 du Capital, et c’est ce que Alfred Sohn-Rethel avait particulièrement bien compris en considérant, à la suite de Marx, le capitalisme comme le grand pourvoyeur de catégories abstraites (parce qu’il met effectivement et socialement en œuvre des processus d’abstraction). De sorte que lorsque nous nous projetons vers ce que pourrait être le travail ou les travaux humains après le capitalisme, nous parlons toujours et encore du travail de façon capitaliste : je veux dire que nous continuons à parler du travail au singulier, oubliant le plus souvent que c’est le capitalisme qui a fait du travail un singulier, c’est-à-dire un concept à la fois un et abstrait. Alors : faut-il libérer le travail ou bien se libérer du travail ? Si « se libérer du travail » veut dire en finir avec le travail, abolir le travail (comme semble le dire Marx dans L’idéologie allemande), je pense que cette position n’est pas tenable et qu’il faut entendre la conscience commune quand elle nous dit : « mais enfin, il faudra bien que l’on continue à travailler ». En effet, il le faudra, il faudra maintenir les activités indispensables à la reproduction matérielle de la société. C’est donc qu’il faut libérer le travail, et plus précisément le libérer de l’emprise du capital et de la valeur puisque c’est bien cette emprise qui non seulement empêche le travail d’accomplir notre insertion dans le monde, mais fait de lui le vecteur principal de notre privation de monde. Mais, parvenu à ce point, l’alternative tend à s’effacer : si libérer le travail signifie le libérer de l’emprise du capital, alors cela revient aussi à nous libérer et à la libérer notre société du travail, du moins tel qu’il prévaut actuellement, dans la forme que lui donnent le capital et son enrôlement au service de l’accroissement indéfini de la valeur. J’estime que c’est là la position à peu près constante de Marx : libérer le travail de l’emprise du capital sur lui ; mais la chose est compliquée de ce que ce n’est que tardivement que Marx est parvenu à l’idée de ce que le capital a commencé par faire au travail quand il l’a enrôlé à son service : à savoir qu’il en a fait un concept abstrait et un terme singulier. Libérer le travail de cette emprise sur lui du capital, ce sera peut-être aussi rendre le travail à sa pluralité, à sa diversité, à son caractère polymorphe – c’est-à-dire à l’infinité des manières singulières que nous pouvons avoir de nous insérer dans le monde.
AP : En conclusion du même ouvrage, vous montriez que, contrairement à Heidegger pour qui seule la pensée pouvait libérer l’agir véritable, Marx défendait une conception « trans-individuelle et relationnelle » de l’agir libérant ainsi le sens à la fois commun et révolutionnaire de la « praxis »9. Or, à vous suivre dans la conclusion de votre dernier livre, il semble que vous ne dialectisiez plus les positions respectives de Marx et Heidegger, mais leur prêtiez cette fois une même ontologie. Dans cette mise en dialogue des deux philosophes, n’avez-vous donc pas tendance à oblitérer le débat à proprement dit ? Du même coup, ne risquez-vous pas de perdre, pour le dire vite, l’ontologie « sociale » de Marx en la rattachant à l’existant et sa capacité d’étirement et de dispersion dans le monde (p. 32) ?
FF : Vous n’avez pas tort de rappeler que, dans L’être et l’acte, je défendais (après E. Balibar) l’idée que l’ontologie de Marx est relationnelle, et qu’en ce sens on peut parler d’une ontologie sociale, ce qui me conduisait en même temps à contester la thèse heideggérienne selon laquelle l’ontologie marxienne ne serait au fond pas autre chose qu’une simple ontologie de la production, elle-même aboutissement et parachèvement de l’ontologie traditionnelle. Je jouais donc, si je puis dire, la relation contre la production : la relation de Marx contre la production que Heidegger fixe comme devant avoir été la position de Marx. Ceci étant rappelé, il est vrai et vous avez tout à fait raison de constater que je ne m’exprime plus exactement dans les mêmes termes dans La privation de monde. Mais je ne crois sincèrement pas avoir rompu avec l’idée que l’ontologie de Marx est une ontologie relationnelle et sociale, je ne pense pas l’avoir rabattue sur une ontologie de type heideggérien : l’ontologie d’un existant (Dasein) solitaire, individualiste et héroïque… Et ce qui l’atteste à mes yeux, ce sont justement ces aspects fondamentaux de l’existant (ou du Dasein) que vous rappelez et sur lesquels je mets souvent l’accent : la capacité d’étirement (dans le temps) et la faculté de dispersion (spatiale) dans le monde. Car cet étirement et cette dispersion sont aussi ce qui fait qu’un existant est d’emblée avec d’autres existants, au point d’être (si je puis dire) plus près d’eux que de soi-même : c’est la structure de l’existant qui, chez Heidegger, porte le nom de Mitsein, en vertu de laquelle l’existant est incontestablement un être relationnel, un être social – même si ce terme aurait certainement déplu à Heidegger (qui confond malheureusement le social avec l’être dans la moyenne).
« La distinction entre le communisme et le socialisme est une distinction importante »
AP : Votre philosophie est perçue, à juste titre ou non, comme une « philosophie engagée » en ce sens que votre lecture de Marx s’accompagne d’une prise de position très nette en faveur du socialisme et/ou du communisme. Dans un article de 2010, vous dénoncez la mise en opposition du socialisme et du communisme (A. Badiou, S. Žižek, T. Négri ) qui, dites-vous, n’est qu’un « montage » fait pour épargner le bon communisme en quelque sorte du mauvais socialisme10. En relisant Marx lui-même, vous défendez, au contraire de la fameuse « hypothèse communiste », l’idée selon laquelle le communisme, pour Marx, est d’abord et avant tout un « processus social » ou encore « une puissance » portée par des acteurs sociaux. De ce point de vue, comprenez-vous le socialisme et le communisme comme des expressions d’une même puissance et si oui, quelle en est la nature ? S’agit-il d’une puissance d’affirmation ou de négation, de révolution ou de subversion de la société ? Quel lien faites-vous en définitive entre cette puissance d’être communiste et le capitalisme tel que vous le pensez dans vos livres ?
FF : Pour moi, la distinction entre le communisme et le socialisme est une distinction importante, fondamentale même, ou susceptible de redevenir fondamentale. Pour le dire clairement, je m’inscris quant à moi dans une tradition socialiste, et non pas communiste, et je fais le choix désormais d’assumer pleinement cette relation positive au socialisme (à la « délicate essence du socialisme », comme dit Philippe Chanial) : je peux même encore aggraver mon cas aux yeux de certains en disant que ma perspective est celle de la « social-démocratie », au sens littéral du terme, c’est-à-dire au sens de la promotion d’une démocratie sociale. Je le fais contre ceux qui, après avoir enterré le socialisme en même temps que l’Union Soviétique, entreprennent maintenant de ressusciter le communisme, c’est-à-dire contre ceux qui pensent que le communisme sort indemne des 70 ans d’histoire de l’URSS et des 40 ans d’histoire de ses satellites, dont la faillite et les crimes ressortiraient en revanche entièrement à l’histoire du socialisme. Je propose à ceux qui pensent cela d’aller se promener un peu plus souvent dans les ex-démocraties populaires de l’Europe de l’Est et d’y proposer leurs analyses : ils n’y seront pas très bien reçus et ils constateront à leurs dépens que, pour l’immense majorité des citoyens de ces pays, le nom de leur 40 années de malheur, c’est bien celui de « communisme ». Mais, au-delà (à moins qu’il faille plutôt dire en-deçà) de cette question du communisme et du socialisme, je constate chez de très nombreux philosophes une fascination pour le concept du « commun » et un mépris pour le concept du « social ». Je veux pour ma part prendre le contre-pied de cette attitude, le concept du social étant selon moi un concept tout à fait digne des philosophes et de la philosophie, un concept à redécouvrir et peut-être à réinventer à un moment où, dans nos sociétés elles-mêmes, et après 30 années de culte rendu à l’individu prétendument autosuffisant, nous avons besoin de réintroduire la dimension du social, c’est-à-dire à la fois l’exigence (dimension normative) que leur vie sociale soit pour les individus le lieu d’une réalisation d’eux-mêmes et le constat (niveau descriptif) que cela n’est possible que dans et par l’association des individus. Dans cette perspective, je pose quant à moi que le social ou la socialité est une dimension fondamentale de notre existence et qu’elle est celle qui nous porte à vouloir faire de notre société quelque chose comme un monde ; j’ajoute que, dans une société de type capitaliste, des dispositifs de privatisation sont constamment à l’œuvre qui ont pour effet de nous priver de la dimension sociale de notre existence ou de la socialité comme dimension de notre existence. Durkheim pensait que la société est à la fois quelque chose qui existe et quelque chose qui est à vouloir : une société peut donc parfaitement exister, que néanmoins nous échouons à vouloir, parce que se sont développées en elle des forces qui entravent notre capacité à vouloir la société, et qui donc nous privent de notre socialité. Ce qu’il faudrait que nous puissions entendre à nouveau, c’est par exemple cette phrase de Durkheim disant que « vouloir la société, c’est vouloir quelque chose qui nous dépasse, mais c’est en même temps nous vouloir nous-mêmes » (Sociologie et philosophie, PUF, p.79).
- Franck Fischbach, Manifeste pour une philosophie sociale, La découverte, Paris, 2009
- Franck Fischbach, Sans objet. Capitalisme, subjectivité, aliénation, Vrin, Paris, 2009, p. 255
- Franck Fischbach, La privation de monde. Temps, espace et capital, Vrin, 2011
- La privation de monde. Temps, espace et capital, Vrin, Paris, 2011, p. 9
- Ecrits sur la politique et la société, L’Arche, 1970, p.131
- Fichte, Rapport clair comme le jour, Vrin, p. 24
- C. Dejours, Travail vivant, tome 2, Payot, 2009, p.183
- Franck Fischbach, L’être et l’acte. Enquête sur les fondements de l’ontologie moderne, Vrin, Paris, 2002, p. 163
- Id., p. 191 sq.
- Voir : « Marx et le communisme », Actuel Marx, 2010/2 n° 48, p. 13








