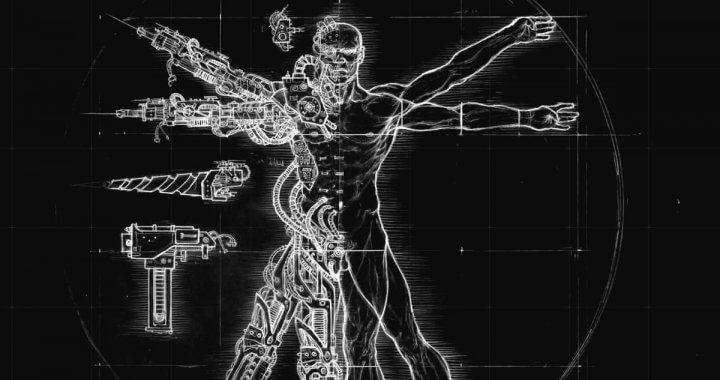On peut consulter la première partie de cet entretien à cette adresse.
C : Un livre universitaire et engagé
AP : Depuis combien de temps aviez-vous envie d’écrire ce livre ?
JFB : J’y pensais depuis assez longtemps. Cela faisait un petit moment que j’étais sur la piste de ces auteurs et de ces questions. D’abord parce que j’enseigne depuis des années l’histoire et la philosophie de la médecine, et notamment l’éthique médicale. Je vois donc assez clairement les ravages qu’entraînent les dérives de cette nouvelle discipline qu’est la bioéthique, qui me semble essentiellement être tout le contraire de l’éthique médicale et aussi de la morale : on le voit d’ailleurs lorsque le président du Comité Consultatif National d’Ethique affirme tout bonnement qu’ il « ne sait pas ce que sont le bien et le mal». Ensuite parce que, depuis très longtemps aussi, je m’intéresse à des auteurs tels que Georges Canguilhem ou Michel Foucault[1], qui ont réfléchi à cette question des normes mais aussi à la possibilité d’un « jeu sur les normes ». Ils ont évidemment une vision beaucoup plus subtile des normes que les auteurs que je critique, qui veulent juste effacer toute norme, toute valeur et vivre ainsi dans un monde plat. Si j’ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre, c’est sans doute parce qu’il était quelquefois éprouvant de lire toutes ces d’absurdités, qui sont le fait d’idéologues plus que de philosophes. Mais en contrepartie je dois dire que j’ai eu le plaisir de trouver quelques perles que je suis content de faire connaître à mes lecteurs. Et j’ai aussi porté à leur connaissance l’œuvre de philosophes qui s’opposent à ces thèses, qui sont assez nombreux dans le monde anglo-saxon, mais sont très mal connus en France.
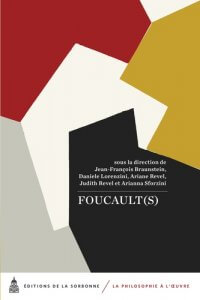
AP : Ce qui est frappant dans votre livre, d’emblée, c’est sa tonalité assez particulière. D’une part, on sent un attachement permanent à la mesure et à une argumentation précise. D’autre part, on y lit bien souvent de l’ironie. Avez-vous réfléchi à cette tonalité ? A votre avis, l’humour est-il important en philosophie ?
JFB : C’est en effet un livre que je voulais sérieux et que je me suis efforcé de rendre rigoureux, en donnant beaucoup d’extraits des œuvres de tous les auteurs que je discutais. J’argumente également à partir de bon nombre d’exemples précis. Il ne s’agit donc pas d’abord d’un pamphlet mais d’un livre universitaire. Cependant, comme vous l’avez noté, c’est un livre assez ironique et critique, parce que c’est en même temps un livre engagé. Je suis, pour être honnête, choqué, voire courroucé par les auteurs que je cite, et je me moque effectivement d’eux, car ils le méritent. Cela n’a pas plu à certains partisans de ces théories. Un certain nombre d’entre eux trouvent que l’humour n’est pas une bonne chose, que c’est la marque d’une position « en surplomb », donc « paternaliste ». Je trouve au contraire que l’humour est un élément essentiel pour faire prendre conscience de certains non-sens des théories citées. Il me semble par ailleurs que l’absence totale d’humour est un trait extrêmement caractéristique des auteurs que je critique, et plus largement de toute la mouvance politiquement correcte.
AP : Parfois, en vous lisant, on est tenté de penser à Michel Houellebecq, qui dresse toujours plus ou moins une critique acerbe de la société moderne perdue dans des occupations qui lui cachent un effondrement que vous évoquez à la fin de votre livre. Pensez-vous que ses romans puissent faire écho à ce que vous décrivez ?
JFB : Pour ce qui est de Houellebecq, vous avez raison de souligner sa présence, qui est en arrière plan tout au long du livre. Son humour à froid est évidemment un modèle pour moi. Je le cite d’ailleurs dans l’introduction comme dans la conclusion. Il me semble que Houellebecq a su être particulièrement visionnaire sur les idéologies propres à l’Occident contemporain. Je relève notamment ses remarques sur deux points particuliers. D’une part, l’« enthousiasme pour l’euthanasie », ou le « suicide assisté », lequel se pratique par exemple à grande échelle en Suisse, et qui est évoqué avec une cruelle ironie dans La Carte et le territoire.
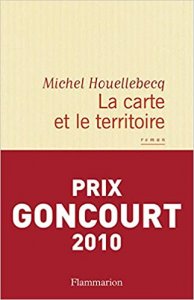
D’autre part, de l’expansion vertigineuse de la crémation en Occident, qui est une tentative radicale d’effacement des corps et des morts. Houellebecq souligne à ce propos que nous sommes la première société humaine dans l’histoire qui ne prend plus soin de ses morts. Sur ces deux points, mais bien au-delà, je suis très admiratif de Houellebecq, dans la mesure où il exprime parfaitement ce que j’appellerais la « dépression occidentale », notamment dans son dernier livre, Sérotonine. Comte parlait déjà d’une « maladie occidentale ». Houellebecq le rejoint sur ce point : sa description de la dépression occidentale est en même temps une protestation contre cette tendance suicidaire de l’Occident.
D : Le « politiquement correct » à l’Université
AP : Votre livre semble connaître un succès critique, aussi bien dans des journaux classés à droite comme le Figaro, que dans les journaux de gauche, comme Le Monde. N’est-ce pas un peu inattendu[2] ? Cette réception plutôt favorable par le grand public implique-t-elle que le livre soit moins bien perçu dans le milieu universitaire ? Vos collègues universitaires ont-ils lu votre livre ? Qu’en ont-ils pensé ?
JFB : Je crois que le relatif succès du livre, qui a été positivement apprécié dans la presse de droite comme dans certains journaux de gauche, mais aussi dans ce que l’on appelle maintenant « le monde réel », montre que, finalement, on est arrivé au bout du « politiquement correct ». Il s’agit avant tout de dénoncer des absurdités, des dérives. Est-ce clairement politisé ? Si le fait de dire que le corps existe est une affirmation de droite, ou si dire que la biologie est une science est également une affirmation de droite, alors oui, pourquoi pas ? Je suis deux fois de droite. Si penser que le réel existe est de droite, alors je suis derechef de droite. Mais je crois que cela va évidemment bien au-delà de ces considérations. Il s’agit de défendre la raison et la science contre de nouveaux lyssenkistes et la morale contre de nouveaux nazis. Oui, il y a deux sexes dans l’espèce humaine, non, on ne tue pas les enfants. Ces affirmations ne se discutent pas selon moi. Le relativisme absolu auquel conduisent de telles théories mène à des absurdités étonnantes bien dénoncées dans le canular réalisé récemment par P. Boghossian, J. Lindsay et H. Pluckrose[3]. Ils ont réussi à faire publier sans difficulté toute une série d’articles totalement absurdes ou révoltants dans des revues centrales de chacun de ces champs de pseudo-études. Ils ont ainsi démontré que toutes ces « studies » ne sont en fait que des « grievance studies », des études du grief et de la victimisation, qui n’ont rien à voir avec la science.
Le fait que mon livre ait un certain succès public n’arrange sans doute pas mon affaire auprès de certains de mes collègues. Mais il me semble que ce n’est pas l’essentiel. Ce qui fait que ce livre gêne ceux d’entre eux qui se sont engagés avec enthousiasme dans la religion du « politiquement correct », c’est que je cite précisément tous les auteurs que je critique et qu’il est dès lors assez difficile de réfuter mon argumentation. Il est compliqué de dire que Money, Butler, Singer ou Haraway, par exemple, n’ont pas écrit ce qu’ils ont écrit. Les citations sont là. Peut-être est-ce effectivement un point qui fait que certains de mes collègues sont très hostiles à ce livre. En revanche, j’ai eu nombre de réactions de collègues qui m’ont écrit pour me dire que mon travail était salutaire et courageux. Le plus triste est que certains jeunes collègues m’ont aussi fait des compliments, tout en me demandant que cela reste entre nous, car ils avaient peur de compromettre leur carrière. Je dois dire que leurs craintes sont malheureusement légitimes. La question de la liberté d’expression se pose avec de plus en plus d’acuité dans l’université française. Je ne pensais pas qu’on en arriverait là et que l’intolérance aurait pris si vite un tel essor.
AP : Votre livre est paru il y a bientôt deux ans. Je voudrais à présent vous poser quelques questions sur l’actualité. Diriez-vous que le discours de ces universitaires « fous » que vous citez répond à ce point à un courant dominant de la pensée philosophique actuelle ? Font-ils vraiment la loi ?
JFB : Ce sont des penseurs qui, institutionnellement, ont une très grande influence, notamment aux Etats-Unis et dans le monde anglo-saxon, où les départements universitaires de sciences humaines sont véritablement gangrenés par cette « critical theory » issue d’une certaine lecture, assez pauvre, de la « French theory ». Les questions des études de genre et des trans, de l’animalisme ou aussi de la « critical race theory » et de l’intersectionnalisme, occupent une place disproportionnée dans les facultés de sciences humaines du monde anglo-saxon. Elles commencent d’ailleurs aussi à pénétrer dans les départements de sciences dures, avec des dégâts encore plus grands. Il y a deux ans, il me semblait que la situation était moins dégradée en France et que mon livre pouvait contribuer à combattre cette invasion. J’ai sans doute été un peu trop optimiste : les réactions courroucées de bon nombre de mes collègues qui ont signé une pétition me dénonçant comme un « positiviste paternaliste » et « sexiste », aux « écrits délirants », dont on attend les « derniers soubresauts », m’indique que les choses étaient déjà plus avancées que je ne le croyais.
AP : Que pensez-vous de la montée de la « cancel culture », qui s’étend à présent non plus seulement aux identités de genre, mais également aux identités ethniques ?
JFB : Depuis la parution de ce livre la situation s’aggrave de jour en jour. Les délires « politiquement corrects » se succèdent désormais à grande vitesse : la réclusion imposée par la crise du Covid y est sans doute pour quelque chose, chacun fonctionnant d’une certaine manière en circuit fermé, avec ses idées fixes et à l’unisson de mouvements grégaires sur les réseaux sociaux. On pourrait retrouver pour qualifier ces mouvements la vieille notion de « folie épidémique » dont usaient les psychiatres du XIXe siècle, le moyen de transmission étant désormais les Twitter et autres Facebook. Chaque jour nous apporte un nouveau délire, qu’il s’agisse de vandaliser tous les monuments de notre histoire, de considérer la France comme un pays esclavagiste et « systémiquement » raciste, sur le modèle du mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis. On voit aujourd’hui de prétendus antiracistes organiser des réunions interdites aux Blancs ou aux « cisgenres ». Les Blancs seraient par définition racistes et plus ils le nieraient, plus ils le seraient : c’est la « fragilité blanche » décrite dans cet improbable best-seller mondial qu’est White Fragility de Robin di Angelo[4], livre à chaque page contradictoire. Mais qu’importe, la logique est raciste, répondait un étudiant à un professeur d’Evergreen College qui essayait d’argumenter avec ceux qui voulaient le rééduquer, comme durant la Révolution culturelle maoïste.

AP : Y a-t-il une continuité dans tous ces mouvements ? Sont-ils présents à l’université ? Avez-vous l’idée d’écrire un livre sur ces questions ?
JFB : Je dois dire que j’avais un moment pensé, pour mon prochain livre, à faire un « sequel » de La philosophie devenue folle qui aurait pu s’appeler La philosophie devenue raciste. En effet bon nombre de philosophes, disciples de la « Critical Race Theory » et de l’intersectionnalisme, sont persuadés que tout ce qui compte c’est la race et que, par exemple, le « canon » des philosophes enseignés devrait tenir compte avant tout de la race, mais aussi du genre, des philosophes. Il faudrait modifier en ce sens les programmes d’enseignement, y compris dans le secondaire. C’est évidemment l’exact opposé de l’effort vers l’universalisme et vers la vérité qui est au cœur de l’entreprise philosophique. J’ai renoncé à cette suite car le livre aurait été beaucoup trop noir et désespérant. Interdire telle ou telle réunion aux Blancs ou aux « cisgenres », c’est pour moi exactement la même chose que l’interdire aux Noirs ou aux Juifs. Je ne l’accepterai jamais, cela est pour moi abominable.
E : Bioéthique et médecine
AP : A propos de votre critique de la bioéthique, que vous inspirent les récentes lois bioéthiques, notamment celle relative à la « PMA pour toutes » ? Qu’en est-il de l’interruption médicale de grossesse, dont le délai a été récemment allongé ?
JFB : Cette loi bioéthique avance très tranquillement dans le sens de ce que Huxley annonçait dans Le meilleur des mondes, un « contrôle de plus en plus précis de la procréation, qui finira bien un jour ou l’autre par aboutir à sa dissociation totale d’avec le sexe, et à la reproduction de l’espèce humaine en laboratoire ». Ce qui est cependant plus choquant est que l’on demande désormais à la médecine, dont la fonction est de soigner des pathologies, de réparer une infertilité qui n’est pas du tout pathologique, mais qui est naturelle : quoique l’on en dise, deux hommes ou deux femmes ensemble ne peuvent en aucun cas procréer. L’incroyable invention de la notion d’ « infertilité sociale » permet d’y pourvoir et les médecins devraient donc se mettre au service de cette « demande sociale » et devenir les fabricants de cette nouvelle humanité. La définition de la médecine doit donc changer du tout au tout : elle n’a désormais plus rien à voir avec le soin, ce qui ouvre grand la porte à un eugénisme nouveau.
Dans cette loi une hypothèse était encore plus extravagante, celle de la ROPA, où un couple de femmes aurait pu, pour revendiquer une maternité commune de leur enfant, faire que l’une des femmes puisse porter l’embryon conçu dans l’utérus de sa compagne. Dans un tel schéma, très coûteux et dangereux au plan médical, l’enfant à venir serait ainsi un simple instrument d’assouvissement de désirs impossibles. Cette disposition provocatrice a été retirée au dernier moment, pour donner l’impression que l’Assemblée entendait les objections contre cette loi, qui étaient très majoritaires durant les consultations des Etats généraux de la bioéthique, mais elle montre bien que l’on est désormais dans le monde du fantasme.
En revanche, un ajout de dernière heure est passé quasiment inaperçu, alors qu’il autorise l’interruption médicale de grossesse jusqu’à neuf mois en cas de « péril grave pour la santé de la femme enceinte, ce péril pouvant résulter d’une détresse psycho-sociale ». Cette détresse psycho-sociale restera à préciser mais elle ouvre évidemment une très grande liberté d’interprétation. Je dois dire que nous ne sommes plus très loin de l’ « avortement post-natal » dont Singer et ses disciples, comme Alberto Giubilini et Francesca Minerva, se sont fait les apôtres : l’infanticide serait légitime s’il nous permettait d’éviter la charge indue d’un enfant arrivant « au mauvais moment » qu’il s’agisse de situation de famille, d’obligations professionnelles ou d’un choix de vie. J’avais assez longuement discuté ce « concept » d’avortement post-natal dans mon livre, car je présumais que ce genre de discussion aurait des conséquences. C’est arrivé chez nous, mais là aussi plus vite que je ne le pensais.
AP : Vous êtes un spécialiste de l’histoire de la médecine, que vous enseignez. Les débats passionnés autour des méthodes d’appréhension et des traitements de la Covid-19 n’ont pas dû vous étonner, alors que les Français ont majoritairement été surpris d’assister à des querelles scientifiques. Que traduisent-elles, à votre avis ? Comment les interprétez-vous ?
JFB : Ce genre de controverse entre médecins cliniciens et statisticiens n’est pas nouveau. La nouveauté est qu’il se poursuit sur internet entre des millions d’internautes alors qu’au XIXe siècle les débats se passaient plus calmement au sein des académies. D’intenses débats avaient eu lieu à l’Académie des sciences, en 1835, autour de deux méthodes d’opération du calcul de la vessie. Ou à l’Académie de médecine, en 1837, sur diverses méthodes de traitement de la typhoïde. La majorité des médecins s’opposaient à ces tentatives en expliquant que les praticiens ne rencontrent jamais deux maladies identiques et qu’ils ont toujours affaire à des cas particuliers, à des individus et non à des « populations » ou à des masses. C’était à l’Académie de médecine le point de vue de Risueno d’Amador qui estimait, citant Morgagni, que les observations doivent être « pesées » et non pas « dénombrées » (perpendae non numerandae sunt observationes). Claude Bernard, que l’on cite souvent à l’appui de l’usage des statistiques médicales, en était lui aussi un critique radical.
Un médecin comme Didier Raoult se réclame, me semble-t-il, de cette tradition lorsqu’il dit « penser en médecin » et pas en « mathématicien» ou en « méthodologiste». Il existe en effet un « style de pensée médical » très particulier, comme l’a expliqué le biologiste et historien des sciences polonais, Ludwik Fleck[5]. Canguilhem va dans le même sens lorsqu’il définit la médecine comme « une technique, ou un art, au carrefour de plusieurs sciences ». La médecine se caractérise par le fait qu’elle traite des individus, qu’elle agit dans l’urgence et qu’elle prend des risques pour restaurer l’état normal. La médecine ne peut être « expectante », elle doit être « active ». Il y a aussi sans doute l’idée que la médecine ne peut accéder à une connaissance « more geometrico ». Il y a en médecine un savoir qui s’acquiert par l’expérience des maladies : on devrait donc d’autant plus pouvoir faire des hypothèses sur l’évolution des coronavirus que l’on en depuis longtemps un spécialiste reconnu.

Mais évidemment la médecine ne peut se passer des sciences, elle est « au carrefour de plusieurs sciences ». Il va de soi que quelqu’un comme Canguilhem ne sous-estimait pas l’importance de la « méthode numérique » de Charles-Alexandre Louis dans la naissance de la médecine moderne. Statistiques et probabilités sont utiles en médecine. Mais la fameuse méthode des essais randomisées, qui fonde la « médecine fondée sur des preuves », l’Evidence Based Medicine (EBM), est une méthode qui n’a guère qu’une quarantaine d’années, qui est encore très discutée, y compris dans les journaux scientifiques les plus sérieux, et qui est sans doute plus adaptée aux maladies chroniques qu’aux épidémies.
Didier Raoult fut dans cette crise fidèle à l’idéal du médecin hippocratique, qui s’efforce d’être au lit du malade, ici dans son hôpital, de rassurer le patient et de lui donner confiance. Si sa figure a rencontré un succès si considérable, c’est que le public a apprécié chez lui une figure apaisante, celle d’un médecin expérimenté, qui fait preuve de calme et de courage dans la tempête. Son succès fut d’autant plus grand que, chaque soir, un autre médecin entretenait la panique en énumérant, devant les caméras de télévision, des chiffres de morts, sans jamais les analyser, tel un Charon souriant à l’entrée des Enfers.
[1] Cf. entre autres, Jean-François Braunstein (dir.), Foucault(s), Paris, éditions de la Sorbonne, 2017.
[2] La grande presse s’est abondamment fait l’écho de l’ouvrage, qu’il s’agisse du Monde, du Figaro ici et là ou encore de Marianne.
[3]On peut lire des compte-rendus de ce canular dans Marianne et Libération.
[4] Robin diangelo, Fragilité blanche. Ce racisme que les blancs ne voient pas, Les Arènes, 2020.
[5] Cf. en français, Genèse et développement d’un fait scientifique, Traduction Nathalie Jas, Paris, Flammarion, coll. Champs, 2008.